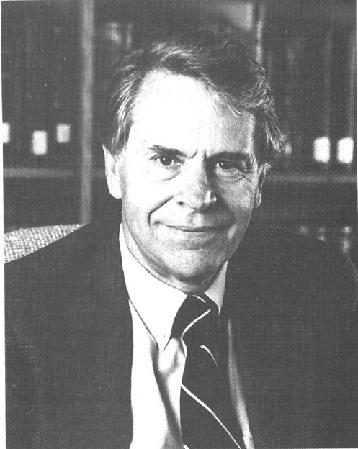L’histoire des femmes s’inscrit dans une transformation culturelle qui a consisté à rationaliser la vie. La conséquence de cette transformation est le rétrécissement de « notre horizon imaginatif et affectif » ! Telle est le constat déstabilisant de Christopher Lasch dans Les femmes et la vie ordinaire, un recueil d’« essais sur les femmes » (« courts travaux », « œuvres d’érudition », p. 15) édités et présentés par sa fille, Elisabeth Lasch-Quinn. L’ouvrage a paru récemment chez Flammarion, dans la collection « Champs essais »1. Selon Lasch, historien et critique social, nous ne comprenons l’humanité et ne classons l’expérience qu’à partir de moyens scientifiques, sans tenir suffisamment compte des « artifices de la clairvoyance artistique et littéraire ». Notre vision de la nature humaine est donc réductrice. L’ouvrage concerne « l’histoire des femmes et celle de l’Occident » (p. 10), « les contraintes historiques subies par le féminisme, la famille et l’amour ». Les nombreux sujets évoqués s’étendent du Moyen-âge (avec la querelle des femmes) au vingtième siècle (et la famille « post-moderne », p. 12). Mais Lasch se concentre sur les « relations entre l’idéologie moderne de l’intimité, le nouvel idéal domestique du dix-neuvième siècle et le féminisme » (p. 9).
La rationalisation de la vie explique plusieurs conceptions de l’amour, du mariage et du féminisme. Elle fonde la vie moderne, notamment en confiant aux seuls experts formés la conduite de l’existence quotidienne. Le capitalisme d’entreprise et l’État libéral moderne ont tendance à augmenter leur pouvoir au moyen d’« une structure bureaucratique et une philosophie paternaliste » (p. 13). Toutes les composantes de la vie ont été soumises à l’examen, la surveillance et « la manipulation par des experts extérieurs », ce qui a altéré la vie ordinaire. Celle-ci est pourtant le but et la condition préalable de la citoyenneté démocratique, une source d’autonomie, d’invention et de spontanéité qui « favorise la responsabilité individuelle et le courage requis pour la démocratie ». En réduisant « l’interaction humaine à ses composantes à des fins d’analyse », l’expertise professionnelle affecte l’intimité. En somme, la vie moderne semble « trop organisée, trop consciente d’elle-même, trop prévisible ».
Première partie : Les manières de la morale
1. La comédie de l’amour et la querelle des femmes : une satire aristocratique du mariage
Le féminisme et la controverse qui l’accompagne ne sont pas éternels. Dire que la société a toujours été patriarcale, qu’il y a toujours eu des attitudes patriarcales est une « interprétation anachronique » et anhistoricisante. Or il y a une grande différence entre les défenseurs de l’honneur des femmes, qui trouvaient naturel l’antagonisme sexuel, et les féministes modernes, qui voulaient faire la paix entre les sexes, de sorte qu’hommes et femmes se considèrent égaux. 2 D’un point de vue matériel, l’origine de la querelle des femmes se trouve dans les coutumes aristocratiques qui gouvernaient le mariage Moyen-âge et le définissaient « comme une institution dynastique », plutôt que comme l’expression de l’attirance sexuelle. Mais au XVIIIè siècle, la querelle est supplantée par « un nouveau débat sur des prémisses tout à fait différentes » (p. 42), en particulier l’affirmation – inédite – du caractère social et conventionnel de la masculinité et la féminité, alors susceptibles d’être modifiés par l’éducation. Mais tout en soutenant ce principe, les féministes continuaient de croire que les femmes devaient adopter la conduite appropriée à leur condition. Elles se demandaient concrètement dans quelles relations sociales elles étaient les égales des hommes ou leurs subalternes, mais pas abstraitement si la femme était l’égale de l’homme. La querelle des femmes n’était pas une controverse au sujet des femmes ! C’était une controverse au sujet du mariage. Il s’agissait de savoir, notamment, si un homme doit se marier, ou si en le faisant il épouse autre chose que des ennuis, etc. Le mariage signifiait la soumission et l’obéissance de la femme, la fin de l’égalité sexuelle et, partant, de l’égalité de l’amour.
De son origine jusqu’au XVIIè siècle, la querelle est restée « un débat sur le mariage, pour lequel les deux parties partaient de la même prémisse : le mariage est incompatible avec l’égalité sexuelle » (p. 52). 3 Il n’y a pas d’abord eu des polémistes au Moyen-âge se demandant lequel des deux sexes est supérieur à l’autre, puis des féministes affirmant au XVIIè siècle que la femme est l’égale de l’homme. Au XIIIè siècle, les lectrices de la seconde partie du Roman de la Rose n’appréciaient pas « l’affirmation de la liberté sexuelle de la femme et de cette supercherie qu’est le mariage ». Mais au XVIIè, le féminisme soutient des « arguments anti-mariage » et c’est ce qui a fait sa modernité.
Les conventions traditionnelles « associées à l' »art d’aimer » et aux joutes verbales des deux sexes » » (qui mettaient en œuvre un véritable « art de l’insulte sexuelle » !) empêchèrent les aristocrates et les conservateurs religieux de changer d’avis sur le mariage et le fait de courtiser. Les dramaturges et romanciers comiques français et anglais critiquaient la moralité sexuelle concurrente et plus permissive qui apparaissait dans la classe moyenne. Les satiristes aristocratiques s’en prirent au mariage dans la classe moyenne. Les aristocrates élaborèrent un « nouveau code de « civilité » », une « nouvelle éthique de la civilité matérielle », visant à lutter contre l’asservissement sexuel des femmes soi-disant pratiqué dans les cercles bourgeois et contre les attitudes sexuelles rétrogrades des nobles les plus rustiques. Aux XVIIè et XVIIIè siècles, les spéculations sur l’amour et le mariage restèrent dominées par le concept d’honneur, dont la version révisée influença le féminisme aristocratique. « Le féminisme du dix-septième siècle se développa dans un milieu raffiné », dans un cadre aristocratique où « naquît l’idée que la querelle des femmes n’était rien d’autre qu’une nouvelle forme de galanterie » (p. 111). La « conception nouvelle de la vie domestique » qui a commencé à apparaître aux XVIIè et XVIIIè siècles tentait de réconcilier mariage et égalité sexuelle et contenait en germe le féminisme moderne. Les précieuses considéraient le mariage comme un asservissement qui détruit l’amour et défendaient par conséquent le droit au célibat pour les femmes. Les relations entre hommes et femmes semblaient pouvoir être réordonnées parce qu’elles étaient perçues comme « le produit des coutumes, des « préjugés », des lois et de l’éducation ». L’origine du féminisme moderne est l’espoir en « une redistribution sexuelle fondée sur l’intelligence humaine et le modèle rationnel, et non sur l’inadéquation irrationnelle des sexes » (p. 64). Les idées féministes prirent racine dans « la révolution cartésienne en philosophie » : puisque l’âme est indépendante du corps, alors elle n’a « pas de sexe, comme le disaient les féministes » (p. 65). 4
2. Les mystères de l’attirance
et 3. La suppression du mariage clandestin en Angleterre : The Marriage Act (1753)
Bien avant l’époque moderne, l’amour romantique était déjà associé au mariage ! Mais nous croyons le contraire, parce que nous avons découvert tardivement qu’amour et mariage « ne vont pas toujours très bien ensemble ». Un antique tradition encourageait « un assouplissement du pouvoir masculin au sein du patriarcat », bornait ce pouvoir par des « limites civilisatrices », idéalisait « le mariage comme l’union du désir et de l’estime » et fondait l’amitié érotique sur l’égalité sexuelle (p. 69). Cette vision de l’amour conjugal devait beaucoup à l’influence des femmes. L’Occident a très tôt conçu que le mariage puisse reposer sur l’amour et l’égalité (« l’attirance sexuelle et le respect mutuel »). L’histoire ne se résume donc pas à l’« oppression éternelle des femmes » par le patriarcat (p. 70). L’histoire littéraire de l’amour romantique est une défense de l’amour romantique, écrite avec la conscience que le mariage « ne sert plus de critère auquel la pratique érotique devrait aspirer » (p. 73).
La modernisation du mariage au XVIIIè siècle a d’abord pris la forme d’une attaque contre le « mariage forcé », d’un « regain d’insistance sur l’importance du consentement parental, le besoin de prudence et de circonspection » (p. 104-105). La raison en est qu’au XVIè siècle, une nouvelle conception du mariage est apparu, chez les humanistes catholiques et les réformateurs protestants, qui insistait davantage sur la compagnie (la compatibilité entre époux) que sur le sexe, donc qui condamnait les mariages forcés ou non consentis par les parents et qui vénérait le mariage comme fondement et modèle de l’ordre social. En 1753, le Parlement d’Angleterre adopta donc une loi visant à empêcher les mariages clandestins, le Marriage Act. En réalité, les attaques contre les mariages arrangés en Angleterre reflétaient et contribuaient à « un changement dans les modèles de séduction aristocratiques amorcé dès le seizième siècle ».
Au début du XVIIè siècle, les aristocrates commencèrent à accepter « le concept d’un foyer conjugal isolé, replié sur lui-même, déjà répandu dans la bourgeoisie ». Ils se mariaient de plus en plus tard pour résister aux unions arrangées par les parents. On peut à la fois condamner les mariages forcés et valoriser le consentement parental : l’origine commune de ces deux attitudes est « le concept du mariage comme union à vie fondée sur la compatibilité ». Les classes moyennes et l’aristocratie soulignaient l’importance du consentement parental parce qu’elles rejetaient « les mariages d’intérêt et d’impulsion », l’union précipitée fondée sur un béguin passager. Au contraire, les opposants au Marriage Act fondaient le mariage sur la passion, l’amour associé à l’attirance sexuelle indélibérée, immédiate, puissante, ce qui prolongeait une tradition ancienne, « ancrée dans la pratique populaire » et que le Marriage Act cherchait à abolir (p. 97-98). Celui-ci participait d’une vaste campagne visant à imposer au reste de la population « les nouveaux idéaux « classe moyenne » », soutenus par l’aristocratie et la gentry anglaises. L’objectif de la campagne était aussi de « protéger les enfants des classes moyenne et aristocratique des mariages irréfléchis et des dangers de la séduction ». Il s’agissait, in fine, de réformer ou « discipliner les classes inférieures […] en dissuadant les pauvres de se marier ».

4. Domesticité bourgeoise, révolte contre le patriarcat, haro sur le chic
Le culte de la domesticité est apparu au XIXè siècle, quand les docteurs, philanthropes et humanistes attaquèrent l’autorité patriarcale et critiquèrent la licence aristocratique, ainsi que l’immoralité du peuple. Au XVIIIè siècle, les féministes considéraient le mariage comme « un arrangement égalitaire par nature » (p. 117) et c’est précisément pourquoi elles estimaient que plaire ne devait pas être la plus grande ambition d’une femme. Cette critique du « chic » resta durant tout le XIXè siècle « la pierre de touche morale du mariage « classe moyenne » ». Féministes et antiféministes s’accordaient sur l’idée que « les femmes devaient se rendre utiles au lieu de cultiver l’art de l’attirance sexuelle » (p. 120). La classe moyenne paraissait raviver les pires pratiques de l’aristocratie et « l’influence maternelle » semblait fournir l’antidote le plus efficace contre cette débauche. Difficile alors de confiner cette influence au foyer : il fallait mettre les vertus domestiques au service de toute la société. « Dès les années 1820 et 1830, écrit Lasch, les femmes commencèrent de mettre en place des sociétés de réforme morale consacrées à l’abolition des influences menaçant la vie de famille ». Le culte de la domesticité ne visait pas à confiner les femmes à la cuisine : il « engendra une réflexion féministe chez des femmes qui ne s’estimaient pas nécessairement féministes elles-mêmes » (p. 123). C’est seulement lorsque le féminisme a maîtrisé l’idiome de la domesticité – au lieu de partir des prémisses abstraites des droits des femmes – qu’il est devenu une force importante.
Les féministes hésitèrent à fonder leur argumentaire sur les différences sexuelles. Mais elles se mirent à parler de la femme en terme abstraits. Pour Elizabeth Cady Stanton, notamment, la femme est moralement supérieure à l’homme et la différence des sexes donne des arguments plus forts en faveur de l’octroi du droit de vote des femmes ! Manifestement, l’opinion publique changeait à grande échelle et le caractère national recherchait de nouveaux modèles. Pour les féministes, la ségrégation de sexes entraînait une obsession sexuelle malsaine, dont le remède devait être la coéducation. Le « chic » leur apparaissait comme une sujétion débilitante. Mais quand le débat sur la citoyenneté se modifia, la vie individuelle fut entièrement politisée. De « nouvelles formes de prédominance des élites » triomphèrent des critiques de l’inégalité économique et sociale, qui caractérisaient à l’origine la domesticité bourgeoise et le premier féminisme (p. 132). La conduite de la vie quotidienne des femmes (et des hommes) devait désormais dépendre « de l’assistance de professionnels ayant reçu une formation spéciale » (p. 133). Cette idée néo-paternaliste l’emporta contre la valorisation de la vertu, du sérieux dans le travail et de la responsabilité, que partageaient les premières féministes et antiféministes. L’Etat-providence s’engagea dans « la régulation des obligations morales », ce qui entama « l’intégrité de la famille et des autres institutions sociales » et priva la culture de la vertu, du sérieux, de la responsabilité et des autres qualités « que les critiques du chic considéraient comme indispensables aux femmes ». Auparavant, les féministes (et les antiféministes) attaquaient le patriarcat avant tout pour défendre « la capacité à prendre sérieusement des responsabilités individuelles, ainsi qu’à les remplir, tout en menant une existence productive ».
Seconde partie :
Du patriarcat au néo-paternalisme
5. Division sexuelle du travail, déclin de la culture civique et essor des banlieues.
Avant les années 60, la vie de la femme n’était pas « entièrement absorbée par les demandes du ménage et de la maternité » (p. 138). La maternité à temps plein est une invention récente, « le produit du développement rapide des banlieues après la Seconde Guerre mondiale ». Le nouveau féminisme, initié par Betty Friedan (La Femme mystifiée) était au départ « une réponse directe […] à la banlieue-isation de l’âme américaine » et non pas à l’oppression des femmes. C’est seulement plus tard que le féminisme envisagea « la condition qu’il cherchait à changer – la division du travail qui confinait les femmes au foyer – comme un système « patriarcal » » universel. Ce n’est qu’au XIXè siècle que la place de la femme a été exclue, dans sa définition, « de la participation à la vie courante en dehors du ménage » et qu’a été inventé « le foyer moderne, qui présuppose une séparation radicale entre la vie domestique et le monde du travail ». Mais le culte de la domesticité n’était pas « une description exacte ou complète de la vie des femmes au dix-neuvième siècle et au début du vingtième ». Loin de s’épuiser entièrement en tâches ménagères et dans l’éducation des enfants, les ménagères et les femmes célibataires travaillaient activement à l’extérieur de chez elles, créant des sociétés et des missions à l’étranger. 5
Nul besoin d’officier dans une carrière professionnelle pour sortir du foyer ! Les femmes contribuèrent « à un domaine intermédiaire de culture civique n’appartenant ni à la famille ni au marché » (p. 144). Mais dans les années vingt, la lutte des sexes se déplaça dans la chambre à coucher : il ne s’agissait plus de réformer la société pour la faire progresser, plutôt d’affirmer le droit des femmes au plaisir sexuel. Les activités exercées par « les femmes des clubs, les bonnes âmes, et les missionnaires de la culture » se professionnalisèrent, ce qui accéléra le déclin du service public bénévole. Les femmes durent alors choisir entre un foyer et une carrière. Dans les banlieues plus que dans les villes, « les femmes devinrent des mères et femmes d’intérieur à temps plein ». La famille de banlieue fut alors considérée comme un refuge sacré.
« La fameuse famille traditionnelle, au sein de laquelle le mari part travailler tandis que la femme reste à la maison avec les enfants […] fut une innovation du milieu du vingtième siècle, le produit d’une exaspération croissante à l’égard des obligations et contraintes externes » (p. 150).
Dès le début des années 1960, le refuge sacré en vint à être vécu comme « un camp de concentration confortable », selon l’expression de Betty Friedan. 6 Selon cette dernière, durant le « mouvement vers la banlieue » après la guerre, beaucoup de femmes instruites choisirent de n’être que des ménagères, alors qu’auparavant les femmes « ne se considéraient pas exclusivement comme des femmes au foyer » !7 Ces femmes résistaient à toute responsabilité sérieuse au niveau de la communauté, 8 ce qu’elles justifiaient « au motif que leur famille leur prenait tout leur temps ». En réalité, elles étaient victimes d’épuisement par l’ennui ! En intégrant la main-d’œuvre et en obtenant l’égalité avec les hommes, les femmes croyaient avoir trouvé la panacée, mais elles n’avaient pas vraiment grand-chose à y gagner. Le carriérisme était un piège, car la plupart des emplois ne produisaient « rien d’important et s’en trouvaient par là même déshonorants et démoralisants » (p. 160). Dans les années 1960 et 1970, les féministes affirmèrent la nécessité d’« entrer en compétition avec les hommes sur le marché du travail ». Mais travailler ne libère pas les femmes si le travail est régi par les exigences de l’économie d’entreprise, ce qui est pourtant le cas. Dans ces conditions, le travail ne peut pas satisfaire le désir féminin de devenir autonome, « utile et respectueux de soi ». Le travail des femmes ne rend pas non plus les institutions davantage démocratiques ou plus humaines. Le féminisme a été corrompu par le capitalisme d’entreprise. Mercantile, prosélyte et opposé à la tradition, le mouvement féministe emprunte sa logique au marché et, comme la publicité, fait du choix un slogan. En réalité, il n’admet que le seul choix de « la famille au sein de laquelle les adultes travaillent à temps plein dans le marché » et impose ce modèle à tout le monde, en le faisant passer pour le progrès. Il ferait mieux de remettre en question la définition de la réussite et de contester la séparation entre le foyer et le lieu de travail, la ségrégation de la vie domestique et l’existence professionnelle, qui est « le vrai problème » (p. 168). Là où le féminisme tente de subordonner la famille au lieu de travail et d’intégrer les femmes dans les structures existantes, il serait plus conséquent en rejetant l’idéologie du progrès, en essayant de « remodeler le lieu de travail autour des besoins de la famille » et en faisant « appel aux problèmes des femmes pour plaider en faveur d’une transformation complètes desdites structures » (p. 168-169).
6. L’île de Gilligan
Les campagnes de la fin du XIXè siècle en faveur du droit des femmes exagérèrent les différences sexuelles. Elles prétendirent que le droit de vote et l’accès aux professions libérales développeraient le domaine de la capacité d’amour et d’éducation des enfants ! L’accès des femmes au monde des hommes devait remplacer la compétition acharnée par l’attention et la compassion. Ces arguments réaffirmaient les stéréotypes qui entravaient les femmes : l’injonction à être douces et discrètes – là où les femmes devaient au contraire « devenir inflexibles et affirmées ». Certaines études révèlent « l’immaturité éthique » des filles, qui « changent les règles d’un jeu dans le but de résoudre les conflits et de préserver les relations ». Mais c’est ce que refuse de voir Carol Gilligan (Une si grande différence, 1982). Celle-ci souligne la différence pour affirmer l’égalité et, comme beaucoup de féministes, elle fait de l’émancipation des femmes « une affaire de droits à réclamer » plutôt qu’« une affaire de doubles critères à proscrire » (p. 176). Elle ne comprend pas que l’altruisme naît de l’absorption désintéressée dans le travail et de l’activité résolue. Mais comme les femmes ont rarement eu « l’occasion d’exercer une activité ayant un caractère impersonnel », elles se préoccupent beaucoup des questions d’égoïsme et d’abnégation et manquent de la confiance nécessaire « pour se jeter dans des activités ardues et risquées » (p. 177). Le respect de soi dépend pourtant de la maîtrise de ces activités, « des critères impersonnels auxquels on satisfait » (p. 178).
Dans la Laurel School de Cleveland étudiée par Giligan, des cliques et clubs d’adolescentes donnent le ton, répandent des ragots, confient des secrets et imposent une « structure de popularité » (p. 181). Les filles qui contrôlent l’admissibilité et l’exclusion sociales exercent une véritable tyrannie ! Les femmes peuvent entretenir des réseaux de relations « étouffant[s], inhibant[s] et oppressif[s] » (p. 182). Les premières féministes dénonçaient justement « les tyrannies mesquines par lesquelles les femmes cherchaient à se dédommager de l’étroitesse de leur existence » (p. 183). Mais par la suite, les féministes ont justifié leur combat pour les droits des femmes « au motif que cela élargirait la sphère de l’ »influence maternelle » ». On ne saurait guère mieux transformer des stéréotypes conventionnels en atouts politiques, par opportunisme ! Ce faisant, les féministes devinrent incapables d’expliquer « le mauvais esprit », les « jalousies mesquines » et le ressentiment qui caractérisent « le monde des femmes », lorsque celui-ci n’est pas « désintégré en un monde plus impersonnel au sein duquel la qualité des idées ou des savoir-faire compte plus que les « relations » ». Si des filles semblent perdre la candeur et l’indépendance de l’enfance, apprendre « à dissimuler leurs propres sentiments et à cacher ce qu’elles savent », ce n’est pas parce qu’elles auraient « intégré l’idée fausse d’une féminité soutenue par une culture patriarcale », adopté « les visions limitées des bonnes et gentilles dames que leur présentent leurs aînées ». Elles participent simplement à une « intense compétition pour le statut », dans laquelle le succès est très peu lié à la gentillesse. Le problème n’est pas que la jeunesse serait corrompue par l’influence du monde adulte, que les idéaux adultes lui serait imposés sans pitié, mais bien que ces idéaux sont absents ! Les filles de la Laurel School souffrent d’une « ségrégation générationnelle », d’une « déflation des idéaux » et de la « perte d’un ordre public impersonnel ». Depuis une époque récente, nous exigeons « des adolescents qu’ils passent le gros de leur temps à l’école », au lieu de faire leur éducation en travaillant au côté des adultes (p. 186). L’éducation formelle prolonge l’adolescence tout en la séparant « physiquement – de tout contact non surveillé, non arbitré du point de vue pédagogique, avec le monde des adultes ». Les écoles croient désormais que « les jeunes ne peuvent s’intéresser qu’aux choses qui touchent directement leurs propres vies ». Mais ce « dogme de l’immédiateté » décourage « l’identification imaginative des jeunes avec des images d’exotisme et d’étrangeté ».
Ce propos n’est pas sans rappeler, notons-le incidemment, le discours de Nietzsche, qui considère comme une erreur la tentative de rendre les établissements pédagogiques « modernes » et « actuels », car « l’immédiateté du présent ne va pas de soi, et ne correspond pas à la nature de la jeunesse comme accroissement de puissance » (Dorian Astor, Nietzsche, la détresse du présent). L’enseignement devrait affirmer « l’éternité de l’exemplarité individuelle » et être un moyen pour chacun d’accéder à une culture d’élite. Nietzsche voit dans la paresse de la jeunesse un symptôme de l’abandon dans lequel on la laisse. Pour Lasch, l’isolement par rapport au monde des filles de la Laurel School a pour conséquence de réduire dramatiquement leur vocabulaire : leur discours est « haché et maladroit » (l’une d’entre elles dit par exemple : « « C’est comme si, je sais pas, genre comme si on te jette avec quelqu’un, tu essaies de t’adapter, alors je sais pas. » », p. 187). Nietzsche recommandait à l’enseignement de contrôler drastiquement l’excellence de la langue d’expression et de refuser tout exercice prématuré d’expression personnelle au lycée, pour éviter qu’une logorrhée ne produise une illusion de subjectivité libre. Lasch, comme Nietzsche, semble considérer que l’école doit favoriser l’accès des élèves à d’autres manières de penser et de sentir (« encapacitation »). Les deux reprocheraient peut-être à l’institution scolaire de manquer sa mission d’école de l’intelligence et de l’autonomie et ils rejetteraient probablement le capitalisme cognitif, la conception de l’intelligence et de l’autonomie comme une simple plus-value9
Si les filles de la Laurel School sont muettes et angoissées, c’est en raison de « l’absence d’aspirations impersonnelles, de critères impersonnels de comparaison » qui protégerait leur vie des « vicissitudes des « relations ». Dépourvues de tout cadre de référence supérieur, elles investissent toutes leurs émotions dans la compétition pour l’acceptation par leurs pairs » (p. 188). 10 Aujourd’hui de nombreuses féministes « préconisent de se retirer dans un monde de femmes » (p. 189), alors qu’autrefois les féministes demandaient à être admises dans la république des lettres. 11 Quand les femmes se retirent « dans un petit monde à elles », leur conclusion sera toujours qu’il faut développer davantage « l’ouverture, l’authenticité, la coopération, la compassion et l’attention » (p. 190).
7. La dé-mesure de l’homme
Malgré l’essor des « études sociologiques de la différence sexuelle, l’histoire des femmes reste encore aujourd’hui insaisissable, parce que historiens l’ont séparée de l’histoire de l’humanité (p. 192). Des érudits féministes s’efforcent d’expliquer en quoi les femmes sont différentes des hommes, mais soit ils ancrent la différence dans la biologie et ils la croient anhistorique, soit ils font de son histoire « un récit monotone d’oppression » 12 La différence sexuelle ne s’éclaire pas non plus par l’histoire de l’activité des femmes. Lash dénonce ici « le marché de l’apitoiement sur soi-même », nourri également par l’histoire de la masculinité. Les « erreurs de lectures » et les « mauvaises interprétations » sont fréquentes lorsqu’il s’agit de différence sexuelle. En survalorisant celle-ci, en faisant d’elle l’unique source de tout conflit, certains finissent par renforcer les stéréotypes qu’ils cherchaient à discréditer ! Ils oublient qu’au XIXè siècle, beaucoup d’hommes étaient favorables au vote des femmes et que « de nombreuses femmes étaient contre » (p. 200).
A la fin du XIXè siècle, les classes moyennes éprouvèrent un « sentiment de suffocation », l’impression d’être asservi « à des routines qui privaient le travail et le jeu de toute joie, et drapaient toute chose d’une gêne étouffante ». Ce sentiment est le résultat d’une compagne générale visant « à soumettre des activités autrefois non supervisées à l’étude et au contrôle systématiques », notamment par « l’invasion pédagogique de l’enfance et de la jeunesse » (p. 201). Il s’agissait d’accéder à la vie intérieure et à l’intimité sexuelle, par des techniques de traitement mental ou diverses psychologies. La pseudo-science qu’on nomme « pédagogie » n’est rien d’autre que le résultat de cette application, à la vie quotidienne, des techniques d’administration du marché et de l’Etat ! La rationalisation ou la colonisation de la vie quotidienne a suscité un mécontentement qui explique, selon Lasch, l’idéalisation de la « vie âpre » du début du siècle (« l’attirance suscitée par l’impérialisme et la guerre, l’envie de vastes espaces », le « culte de la dureté »). Le féminisme était alors « perçu comme s’alliant de trop près aux demandes de collectivisation de l’économie domestique et de l’éducation des enfants » (c’est cette perception qui motivait une grande partie de l’opposition au féminisme). Beaucoup d’hommes ne trouvaient plus de sens dans une « vie bien réglée, émancipée du point de vue sexuel, et menée suivant des principes d’un égalitarisme impeccable ».
Selon Bly, le culte de la dureté et celui de la sensibilité ont pour origine commune « l’absence d’autorité mâle sur les garçons et les jeunes hommes ». Alors que le mâle doux et sensible n’a pas réussi à rompre certains liens avec sa mère, le mâle prédateur quant à lui ne les détruit qu’en supprimant les tendres sentiments attribués exclusivement aux femmes, puisque le rôle éducateur de la paternité n’est pas vraiment reconnu. Il est vrai que la virilité adulte est l’objet d’une lourde suspicion : tout homme occupant une position de pouvoir semble « aujourd’hui considéré comme un oppresseur corrompu » et nous présupposons que « les femmes en savent plus que les hommes pour ce qui est des « relations » ». Le jeune homme doit soit ressembler davantage aux femmes, soit s’endurcir jusqu’à exclure l’amour et l’amitié entre les deux sexes. Tels sont les effets de « l’éclipse de la paternité » (p. 207). Nous ne pouvons plus tenir pour acquises les notions de masculin et de féminin. Pour déterminer le sens de leur distinction et ainsi répondre au « malaise contemporain », il faut faire appel aux sciences humaines et aux sciences naturelles, et non pas simplement réinterpréter la mythologie comme le fait Bly. Sur ces sujets, nos prédécesseurs n’avaient pas nos incertitudes et nos confusions, contrairement à ce que supposent trop souvent « les études sociologiques de la différence sexuelle » (p. 208). La différence sexuelle n’est pas un problème éternel, universel, ni « le problème premier ». Elle « n’a pas d’histoire », pas d’autre, en tout cas, que celle d’une controverse, variable suivant les lieux et les époques, au sujet de cette différence. 13
8. Les familles : mauvaises interprétations des faits
Les données recueillies en 1990 par Judith Stacey (Brave New Families) nous présentent les femmes de la classe ouvrière en situation « de régression sociale, de dévastation économique et émotionnelle, ainsi que d’improvisation domestique ». Néanmoins, trois suppositions nous font croire à tort qu’elles sont « les pionnières de la famille « postmoderne » » (p. 216) : (1) l’idée que l’industrialisme aurait « isolé la famille du monde du travail et confiné les femmes au rôle de ménagères à temps plein » ; (2) l’idée que le féminisme serait « la seule source de respect de soi chez les femmes » (p. 217) ; (3) enfin l’idée que « la religion affecte une bonne compréhension du monde et perpétue d’anciens modèles de domination et de dépendance » (p. 219). Contre ces préjugés, Lasch montre que (1) les femmes de la classe ouvrière exercent un travail salarié depuis longtemps14 ; (2) qu’il n’est pas besoin d’être féministe pour « admirer de fortes femmes, pour voir clair dans les prétentions mâles de supériorité, ou pour assumer la responsabilité de sa propre vie » (p. 218) ; (3) enfin que la religion est « un défi à l’apitoiement sur soi et au désespoir », qui tentent particulièrement les laissés-pour-compte.
La famille nucléaire isolée est « une abstraction sociologique », qui n’a jamais été pleinement réalisée avant le Seconde Guerre mondiale. C’est seulement lorsque la grande migration vers la banlieue a détruit « les vieux systèmes de soutien » que les femmes ont pu « se consacrer, un temps, exclusivement à la domesticité ». Ensuite, elles ont rapidement été ramenées de force dans la main-d’œuvre par les pressions économiques. Des sondages récents montrent que « la plupart d’entre elles préféreraient rester chez elles » ! Elles ne prêtent peut-être pas des effets libérateurs aux circonstances qui les forcent à travailler pour gagner un salaire. Pour ce qui concerne le second point (2), il est clair qu’avant les années 60, les femmes ne s’inclinaient pas « bêtement devant les hommes » ni n’« arboraient leur impuissance comme un symbole d’honneur » (p. 217). Ce sont en grande partie les médias qui ont accrédité l’« image abstraite » de la famille prétendument traditionnelle et généré un mépris « dépourvu d’histoire » envers les ignorantes femmes du passé (pour le christianisme, hommes et femmes sont égaux devant Dieu !). Une femme de la classe ouvrière peut être féministe tout en désirant s’engager entièrement dans le mariage. Enfin (3) c’est seulement pour « décliner toute responsabilité vis-à-vis de soi-même » que les laissés-pour-compte rejettent « tous les torts sur l’oppression systématique », par exemple sur le patriarcat (p. 219)15.
9. Vivre dans l’État thérapeutique
Le droit de vote ne pouvait pas favoriser les intérêts immédiats des femmes contre les vestiges de l’autorité patriarcales ou contre les dominants. La plupart des femmes percevaient son inefficacité. « Les femmes de la classe ouvrière, écrit Lasch, ne recherchaient pas la reconnaissance abstraite de l’égalité des droits, mais la protection des femmes à l’usine ». Ce qui préoccupait les féministes étaient la réforme du mariage. Pour elles, le droit de vote des femmes n’était qu’« une méthode parmi d’autres pour équilibrer les relations hommes-femmes ». Elles le préconisaient parce qu’il leur sembler capable de transformer la famille traditionnelle. Leur vision de la famille restait « un programme de classe », inséparable de la conscience et des « intérêts d’une classe professionnelle émergente à la recherche de nouvelles formes de contrôle des conflits sexuels et sociaux qui menaçaient, à ses yeux, de mettre en pièces la société américaine » (p. 229). Bref le féminisme faisait partie du progressisme américain, lequel était une tentative de dévier de certains mouvements révolutionnaires (populisme, radicalisme travailliste), « par une réforme de la société, à partir du sommet ». Les féministes prônaient le mariage et, plus généralement, la coopération sociale. Elles voulaient « contrôler la sexualité » et les « passions socialement perturbatrices » (avidité, agressivité, etc.). L’idée progressiste selon laquelle les meilleurs doivent gouverner a fourni un argument opportuniste en faveur du droit des femmes.
Au XIXè siècle le contrôle de la sexualité a fait partie d’une campagne visant à contrôler l’ensemble de la société. La vie de famille s’est intensifiée d’un point de vue émotionnel, une nouvelle intimité est apparue et, ce faisant, les conflits entre maris et femmes se sont accrus. La plupart des féministes étaient des membres éclairés de professions libérales, qui voyaient dans les connaissances livrées par cette situation (par exemple la découverte des complications que le désir d’inceste engendre dans le cadre des relations hommes-femmes) l’occasion de développer « une science préventive de contrôle sexuel et social, qui pourrait servir entre autres à civiliser les pauvres » (p. 231). La volonté de « dominer les énergies dangereuses » a conduit au progressisme et aux « tentatives de contrôle de la sexualité dans la famille ». Pour les femmes de la classe moyenne, cette réalisation de l’individualisme et de l’autonomie faisait partie « d’un plus vaste processus sociopolitique », qui a abouti à l’essor des experts professionnels. En s’alliant aux professions d’aide, les femmes sont tombées dans la dépendance du « consommateur vis-à-vis du marché et des fournisseurs de services experts » (p. 233).
L’ancienne fonction d’ambassadrice de la culture attribuée aux femmes a servi « à justifier les demandes de plus grande influence sociale et de participation à la vie publique », comme le montre Jacques Donzelot. 16 Mais le rôle de missionnaire culturel était « la création délibérée de médecins cherchant à transformer les épouses et les mères en agents de l’influence médicale – de la « colonisation » médicale de la famille » (p. 238). La famille a été exposée à la surveillance et au contrôle de la médecine, l’intimité a été envahie « par le « complexe tutélaire » de l’État moderne » (p. 239), alors même qu’une nouvelle valeur était accordée à l’intimité et que la famille apparaissait « comme un foyer isolé des influences extérieures ». Au XIXè siècle, les médecins voulaient « transformer les femmes en agents d’une nouvelle moralité médicale », les réformateurs tentaient de faire d’elles les « arbitres de la moralité domestique » (p. 242). Ce sont des intentions hygiéniques qui ont conduit à la réforme du mariage et à l’extension de l’autorité médicale à la vie de famille. Un patriarcat d’État a supplanté le patriarcalisme familial. Nous sommes en présence d’une stratégie libérale visant à instaurer un État thérapeutique qui laisse la famille intacte tout en la soumettant à un contrôle constant. La famille en Occident n’est pas socialiste, puisqu’il ne s’agit de remplacer les parents par l’État ; mais elle n’est pas davantage patriarcale : elle est assistée par des conseillers et des psychologues qui ne veulent pas imposer la vie de famille de façon dictatoriale, ni la détruire.
Loin d’offrir des solutions à long terme, les thérapeutiques de contrôle social « créent de nouvelles formes de dépendance et découragent la participation à la vie politique ». Elles entravent les dirigeants politiques quand ils veulent rallier l’opinion publique à leurs projets. Les anciens mécanismes de participation populaire s’essoufflent et le citoyen est réduit à « un consommateur d’expertise ». Face à cette crise de confiance, l’État libéral devra, à l’avenir, « laisser place à un système plus véritablement démocratique », ou bien imposer un contrôle ouvertement dictatorial (p. 250).
En définitive, Les femmes et la vie ordinaire est un recueil d’essais pertinent et convaincant, qui s’offre comme un oasis au milieu du désert d’ignorance dans lequel les études sociologiques de la différence sexuelle plongent trop souvent les lecteurs. Certes, la traduction de Christophe Rosson pèche à quelques reprises (« in the end » ou « at the end » est rendu par l’abominable « au final », p. 214 et p. 244) et Lash ne s’interdit pas, à l’occasion, certains jugements de valeur surprenant, par exemple lorsqu’il survalorise les bénéfices du travail prétendument désintéressé. Mais en dehors de ces écueils au demeurant peu dommageables, l’ouvrage constitue une prouesse de rigueur, d’originalité et de pédagogie. Il établit définitivement que l’histoire des femmes est inséparable de l’histoire culturelle dans son ensemble. Les femmes et la vie ordinaire constitue une remise en cause radicale du féminisme mainstream, et ce n’est pas là son moindre charme.
- Christopher Lasch, Les femmes et la vie ordinaire, Traduction Christophe Rosson, Paris, Champs-Flammarion, 2018
- Les anciennes disputes au sujet des femmes trouvaient naturel la contradiction entre l’amour (qui repose sur l’égalité sexuelle) et le mariage (dans lequel la femme était censée se soumettre à l’autorité de son époux).
- Pour « la dialectique médiévale de l’amour », l’amour était incompatible avec le mariage, qui signe la mort de la passion érotique. Au Moyen-âge, la poésie courtoise soutenait l’adultère contre le mariage ! C’est l’inégalité au sein du mariage qui semble être la cause commune au roman courtois et à « son antithèse comique, la satire « misogyne », « antiféministe », anti-mariage » qu’on trouve dans les récits grivois et les fabliaux (p. 47), soit deux genres littéraires également appréciés par les aristocrates, et composés par des itinérants (non pas des bourgeois), qui considéraient qu’un chef de famille ne devait pas peiner « à exercer sa légitime autorité avec justice et équité » (p. 47). La querelle des femmes prit la forme d’un « débat stylisé », d’un « combat rituel » qui « sublimait la guerre ».
- Ce qui a permis d’imaginer pouvoir changer les « conventions qui gouvernaient jusqu’alors l’art de faire la cour, le mariage et la position des femmes dans la société », c’est la séparation de l’âme d’avec le corps et celle du moi d’avec ses rôles sociaux (comme dans la pensée de certains philosophes contractualistes).
- Les femmes étaient peut-être « des citoyennes plus actives avant d’obtenir le droit de vote qu’après l’avoir obtenu, en partie parce qu’elles avaient tout intérêt à prouver qu’elles pouvaient agir de façon responsable dans le domaine public ».
- Betty Friedan, La Femme mystifiée (1963).
- D’après une des études de Friedan auprès de ses anciennes camarades de classe pour l’année 1943, « 80% de celles qui avaient obtenu leur diplôme « avaient trouvé un moyen quelconque de suivre le chemin que l’éducation leur avait ouvert », en général sous la forme d’activité communautaire sur la base du volontariat » (p. 152).
- Elles étaient « prêtes à remplir leurs journées de besognes domestiques » et elles « refusaient d’accepter des postes à responsabilités dans les organisations collectives », laissant les « travaux intéressants et bénévoles » aux hommes.
- Certes Lasch souligne les vertus de l’absorption dans le travail désintéressé, alors que Nietzsche considère que le désintéressement n’existe pas et il reproche à l’enseignement d’« inscrire l’élève dans une pratique sociale du travail, c’est-à-dire, explique Dorian Astor, en fonction de l’utilité et du profit ». Pour Nietzsche, le risque est que l’éducation des démocraties modernes ne cherche plus « qu’à emporter l’adhésion de jeunes êtres « libres » (pour ne pas dire de jeunes consommateurs) ». Le sociologue insiste sur l’absence d’idéal là où le philosophe reproche à l’enseignement d’inculquer à la jeunesse un idéal oppressif et inhumain, parce qu’hostile à la culture, à l’individu et au peuple. L’un pense qu’il manque aux filles de la Laurel School l’« idée d’un ordre impersonnel qui existerait indépendamment de leurs souhaits et angoisses » (p. 186), l’autre assigne pour but à l’éducation de transformer l’homme en véritable individu émancipé. Pour Lasch, le discours des filles de la Laurel School témoigne du vide et de l’irréalité d’une vie ne consistant qu’en « relations » » (p. 186), alors que Nietzsche conçoit l’éducation supérieure sur le modèle de l’amitié, des écoles philosophiques grecques et la relation de maître à disciple (« la hiérarchie fondée sur ceux qui sont plus grands et plus anciens »). Mais il s’agit d’une amitié entre des individus solitaires et intempestifs. La rencontre du maître et du disciple est une solitude à deux. L’accès à la culture suppose une contemplation de la nature productrice d’asocialité (Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement). Si Nietzsche critique le désintéressement, il loue la morale terre à terre du devoir, de l’obéissance, du raisonnable, qui exige vraiment de sacrifier, d’obéir, de se maîtriser et d’être sévère envers soi-même.
- Chez Nietzsche, ce cadre est fourni par le passé des peuples, dont le disciple doit s’approprier les traces vivantes afin d’acquérir la culture. L’éducation doit former la jeunesse à la culture aristocratique.
- Le lecteur sera amusé d’apprendre que, lors des retraites organisées par Gilligan et Brown au cours de leurs travaux à la Laurel School, les enseignantes reconnurent qu’elles fournissaient elles-mêmes « aux élèves des modèles de comportement propres aux « bonnes petites filles » » et « elles fondirent en larmes » (p. 189) !
- Dans le second cas, la différence sexuelle est considérée comme « le produit des inégalités qui ont forcé les femmes à cultiver les vices et les vertus des opprimés ». Son histoire tend alors à « se dissoudre en un récit monotone d’oppression que ne soulagent que d’occasionnelles « subversions » de l’autorité patriarcale ».
- La différence sexuelle n’apparaît dans l’histoire « qu’aux moments où elle prend conscience d’elle-même, du point de vue critique ».
- « les femmes des classes moyennes menaient des vies actives en dehors de la famille, bien après l’avènement de l’industrialisme ».
- Les mouvements sociaux modernes ont tendance à exploiter sans cesse « la fibre du ressentiment » et à rejeter toute explication qui semblerait « rejeter la faute sur la victime ». Ils découragent les individus « d’assumer leur responsabilité personnelle », puis s’étonnent que ceux-ci se replient sur la religion.
- Foucault a souligné que la libération sexuelle résultait d’une médicalisation de la vie, requise par la croissance de l’appareil disciplinaire. La vie sexuelle a été exposée à l’examen scientifique et la vie émotionnelle rationalisée. Jacques Donzelot étend l’analyse foucaldienne à la famille. Il attribue la libération de la femme à la vieille vocation sociale de la femme.