Cet article est la version revue et augmentée d’une recension parue sur ce site il y a deux ans. Je remercie Thibaut Gress de le publier sous cette nouvelle forme. (juillet 2014)
Autoportrait de Narcisse
Dans son livre Un art moyen 1, Pierre Bourdieu montre que la pratique de la photographie, art apparemment très libre et très indéterminé quant à son objet, est en fait fortement déterminé socialement. On ne prend pas de photographie n’importe quand, alors même que les appareils individuels le permettraient, mais lors des temps forts de la vie sociale : mariage, fêtes, bal de promotion etc. Le regard et la pratique du photographe ordinaire, loin d’être neutres et spontanés, sont selon Bourdieu marqués par des pratiques et des attentes sociales très conventionnelles.
Presque un demi-siècle après ce livre, l’époque des photographies avec l’appareil Kodak-Pathé semble lointaine, maintenant que nous pouvons prendre en permanence des photos avec un téléphone. Ce n’est pas seulement la technologie qui a évolué, ce aussi sont les mentalités et les pratiques. Nous continuons bien, comme le disait Bourdieu, à « éterniser et solenniser les temps forts de la vie collective » (le mariage, les vacances, mais aussi le concert, la soirée en boîte de nuit…) mais la photographie ne sert plus seulement, et plus d’abord, à fabriquer « des images privées de la vie privée ».
Au contraire, la plupart des photographies sont vouées aujourd’hui à être mises aussitôt sur Instagram, repostées sur Facebook et stockées sur un profil Google+. De là la mode des selfies, ces autoportraits diffusés sur les réseaux sociaux. Ils participe d’une mise en scène permanente de soi à travers une image exposée publiquement au plus grand nombre. La façon même de prendre la photo a profondément changé. Comme l’explique très bien cet article « We’re all narcissists now » : « Today, no one bothers to use the remote shutter trigger or even the timer to make a self-portrait. We contemporary narcissists simply hold the camera or the phone in front of our faces and push the button ». « Aujourd’hui, plus personne ne prend la peine d’utiliser le déclencheur à distance ou même le retardateur pour faire un autoportrait. Nous les narcisses contemporains tenons juste l’appareil ou le téléphone devant notre visage avant d’appuyer sur le bouton ». L’appareil n’est plus ouvert sur le monde mais braqué sur nous. Le point de fuite n’est plus à l’horizon, dans le prolongement du bras qui tient l’appareil, mais situé directement sur nous : « The vanishing point is not off in the distance, but on our bodies ».
La photographie actuelle n’est pas moins conventionnelle ni moins normée socialement qu’à l’époque du livre de Bourdieu. Mais il est incontestable que ces normes ont changé dans le sens d’un renfermement du photographe sur lui-même. L’étonnement de Bourdieu quant à l’absence d’« anarchie de l’improvisation individuelle » vaut toujours. Alors que nous pouvons prendre un nombre gigantesque de photos avec le moindre smartphone, nous prenons tous à peu près les mêmes images : les vacances, les soirées entre amis, la petite qui fait ses premiers pas, le hublot de l’avion au moment du décollage etc. Nous ne sommes pas plus objectifs ni « artistes » qu’il y a cinquante ans, alors même que nous aurions encore plus les moyens technologiques de l’être. Cela montre que ce n’est pas l’évolution des appareils qui nous a rendus plus auto-centrés. En revanche, il est indéniable que la complaisance envers soi trouve un vecteur privilégié de satisfaction grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux.
De plus, nous savons désormais prendre la pause spontanément car on peut nous photographier à chaque instant. Et par cette posture faussement spontanée, nous invitons les autres à chercher avec nous le lieu invisible de l’intériorité, à partir duquel prendrait sens et vie notre enveloppe corporelle. Cette tentative de mettre au jour la vie intérieure voudrait révéler ce qui irradie de notre personnalité. Elle pourrait cependant révéler d’abord la vanité de cette quête d’un au-delà authentique des apparences. L’ironie est que plus on traque ce soi intime, plus on se complait dans une image de soi éphémère et mise en scène -plus on se perd, en fait, dans les mirages de ce que Christopher Lasch appelait la culture du narcissisme.

Robert Cornélius, autoportrait (1839)
La pratique de la photographie prise spontanément et massivement diffusée, est un indice probant de la montée du narcissisme comme trait typique de l’individu contemporain. De fait, depuis une quinzaine d’années, de nombreuses études ont paru sur ce trouble de la personnalité, notamment autour du pervers manipulateur, dans son rapport à autrui 2, au travail 3 ou dans le couple 4. Si l’intérêt pour ce sujet relève en partie d’un effet de mode, il est aussi le signe d’une inquiétude quant à l’évolution de nos sociétés et des comportements qui s’y développent. Pourquoi notre époque serait-elle propice à l’apparition de pervers de cette sorte ?
C’est l’intérêt du livre de Christopher Lasch, La culture du narcissisme 5, de montrer que le narcissisme, au-delà des cas strictement cliniques, est devenu un phénomène social généralisé. Lasch établit de façon très convaincante un lien de cause à effet entre ce profil psychologique et l’organisation de la société moderne.
S’appuyant sur une description psycho-sociologique des troubles engendrés par la culture de masse, sa thèse tranche avec les théories habituelles sur le traitement des pathologies : loin de défendre une meilleure prise en charge institutionnelle des citoyens, Lasch montre que c’est bien justement la mise en place d’une société de protection qui est à l’origine du narcissisme sous sa forme actuelle : « A mesure que les points de vue et les pratiques thérapeutiques acquièrent une audience de plus en plus vaste, un nombre sans cesse accru de gens se trouvent disqualifiés, en fait, lorsqu’il s’agit d’endosser des responsabilités d’adultes ; et ils tombent sous la dépendance d’une autorité médicale quelconque. Le narcissisme est l’expression psychologique de cette dépendance 6 ».
Le narcissisme est le révélateur d’un malaise plus diffus mais généralisé et qui touche tous les secteurs de la vie sociale. Lasch met en lumière une crise dans notre culture, qui s’avère désormais incapable de former des individus accomplis et autonomes. Son livre est un saisissant portrait de Dorian Gray de « l’homme psychologique », cet individu contemporain moyen qui se trouve de plus en plus dessaisi de sa propre vie.
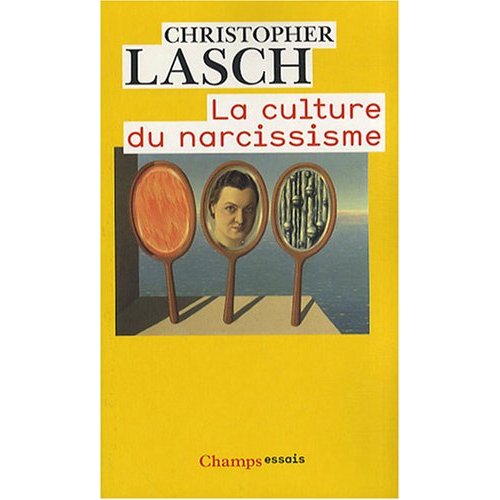
La figure de Narcisse, de la mythologie à la psychanalyse
Il convient d’éviter un contresens massivement répandu sur ce terme de narcissisme, que l’on prend communément pour un synonyme d’égocentrisme ou de vanité. Pour cela, il faut revenir à la légende grecque. On sait que Narcisse, fasciné par son reflet, finit par trop se pencher, tombe à l’eau et se noie. A trop s’aimer, il aurait provoqué sa perte.
Dans le langage courant, l’idée est restée : est dit narcissique l’individu qui a une trop grande estime de soi : il veut toujours être le centre de l’attention, il ramène tout à lui. Lorsqu’on accuse un écrivain ou un cinéaste de tomber dans ce travers, on lui reproche de faire des oeuvres nombrilistes, de se mettre outrageusement en scène. L’histoire de Narcisse pourrait donc être lue comme une mise en garde contre l’amour excessif de soi.
Néanmoins, le sens clinique du terme est à l’opposé de cette vision populaire. La clef du mythe est que Narcisse ne s’est pas reconnu dans l’eau. Il ne savait pas que c’était lui qu’il contemplait : « Narcisse se noie dans son reflet sans jamais comprendre qu’il s’agit d’un reflet, explique Lasch. Il prend sa propre image pour quelqu’un d’autre et cherche à l’embrasser sans penser un instant à sa sûreté. La leçon de l’histoire n’est pas que Narcisse tombe amoureux de lui-même mais que, incapable de reconnaître son propre reflet, il ne possède pas le concept de la différence entre lui-même et son environnement. »
C’est pourquoi au sens clinique, le narcissisme est une pathologie de la personnalité. L’individu qui en souffre a sans cesse besoin d’attirer l’attention sur lui non par satisfaction mais par manque. Il se montre étouffant pour les autres, dont il ne sait pas prendre en compte les désirs, du fait de son manque d’empathie. C’est pourquoi, il ne cherche dans la relation à autrui que sa satisfaction. Il a tendance à se comporter en parasite de son entourage ; il vampirise leur énergie, leur bonne volonté, tout leur temps parce qu’il est foncièrement incapable de se supporter. Il veut les placer sous sa dépendance et se donner le sentiment de les dominer, afin de compenser ses propres carences en terme d’estime de soi.
Une culture de l’infantilisation
A l’opposé de tout égoïsme (qui suppose au moins la capacité à définir rationnellement son intérêt et ses chances de réussite), le type du narcissique se caractérise donc par la détresse et l’anxiété permanentes face au monde, en particulier par une incapacité à constituer un rapport apaisé à son environnement.
« Malgré ses illusions sporadiques d’omnipotence, Narcisse a besoin des autres pour s’estimer lui-même ; il ne peut vivre sans un public qui l’admire. Son émancipation apparente des liens familiaux et des contraintes institutionnelles ne lui apporte pas, pour autant, la liberté d’être autonome et de se complaire dans son individualité. Elle contribue, au contraire, à l’insécurité qu’il ne peut maîtriser qu’en voyant son « moi grandiose » reflété dans l’attention que lui porte autrui, ou en s’attachant à ceux qui irradient la célébrité, la puissance et le charisme »7.
Pensons par exemple à l’apprenti-comique joué par De Niro, dans King of Comedy de Scorcese, dont le seul rêve est de passer dans le show télévisé à la mode et qui, pour arriver à ses fins, finit par prendre en otage le présentateur qu’il idolâtre.
La société contemporaine, estime Lasch, nous maintient ou nous ramène dans un était immature en nous promettant, via la publicité ou la propagande pour le progrès, des satisfactions illusoires, engendrant de ce fait un surcroît de frustrations et d’angoisses. Pourquoi ne suis-je pas épanoui, riche et génial comme on me l’a promis ? se demande le narcisse d’aujourd’hui, désarçonné quand ses rêves finissent par se heurter à la réalité.
Il n’est donc pas si certain que notre civilisation des Lumières soit encore à même d’amener tout homme à l’état de maturité : elle croit être sorti pour de bon de l’enfance de l’humanité, des conflits avec la nature et des drames de l’histoire 8
Incapable de combler ses désirs, replié sur lui-même, le narcissique éprouve toutes sortes de représentations déprimantes : peur de vieillir en particulier, peur de la décrépitude physique et de la mort. Coupé des autres, sans relations stables, le narcissique comprend que l’avancée dans l’âge ne peut être synonyme d’accomplissement, mais d’affaiblissement et de solitude accrue. Pour contrer ces images, il développera des fantasmes qui serviront de défenses psychiques : exaltation idéalisée de sa personne, espoirs délirants d’une fusion cosmique (mentalité New Age), quête spirituelle de pureté (gnosticisme), rejet du passé et attentes irréalistes quant à l’avenir (idéologie progressiste) etc.
« En prolongeant le sentiment de dépendance jusque dans l’âge adulte, la société moderne favorise le développement de modes narcissiques atténués chez des gens qui, en d’autres circonstances, auraient peut-être accepté les limites inévitables de leur liberté et de leur pouvoir personnels – limites inhérentes à la condition humaine – en développant leurs compétences en tant que parents et travailleurs 9 ».
Lasch décrit tout le contraire d’une culture de l’égotisme ou de l’orgueil. Bercé d’illusions quant à la possibilité d’être en paix avec lui-même et de s’accomplir, le narcissique ne fait que s’enfoncer dans ses troubles. Le remède semble donc aggraver le mal : c’est pourquoi Lasch pointe la responsabilité de l’institution psychanalytique.

Le Caravage, Narcisse (vers 1597-1599), Galerie nationale d’art ancien, Rome
La psychalyse, une religion pour notre temps ?
La psychanalyse s’est diffusée dans une société sécularisée, qui recherche son salut non plus dans la religion mais dans la cure psychologique. S’agit-il encore bien d’une voie de salut ?
« Assailli par l’anxiété, la dépression, un mécontentement vague et un sentiment de vide intérieur, “l’homme psychologique” du XXe siècle ne cherche vraiment ni son propre développement ni une transcendance spirituelle, mais la paix de l’esprit, dans des conditions de plus en plus défavorables. Ses principaux alliés, dans la lutte pour atteindre un équilibre personnel, ne sont ni les prêtres, ni les apôtres de l’autonomie, ni des modèles de réussites du type capitaines d’industrie ; ce sont les thérapeutes. Il se tourne vers ces derniers dans l’espoir de parvenir à cet équivalent moderne du salut : la “santé mentale”. » 10.
Lasch met en lumière la responsabilité des psychanalystes dans la formation d’un scientisme médical. Prendre soin de son corps, avoir une bonne image de soi, assumer ses désirs, dépasser sa culpabilité… La thérapie serait-elle devenue notre religion, une religion d’après la mort de Dieu ?
« L’atmosphère actuelle n’est pas religieuse mais thérapeutique. Ce que les gens cherchent avec ardeur aujourd’hui, ce n’est pas le salut personnel, encore moins le retour d’un âge d’or antérieur, mais la santé, la sécurité psychique, l’impression, l’illusion momentanée d’un bien-être personnel. Même le radicalisme des années 1960 a été utilisé, non comme une religion de remplacement mais comme une forme de thérapie par un grand nombre de ceux qui l’ont embrassé, pour des raisons plutôt personnelles que politiques. Une politique « radicale » donnait but et signification à des existences vides 11. »
Si les mouvements post-freudiens proposent bien de donner un nouveau sens à l’existence, par une meilleure compréhension des conflits intérieurs du sujet, c’est qu’ils prétendent dépasser les illusions religieuses. Il n’est pourtant pas certain, montre Lasch, que la thérapie soit plus bénéfique que le maintien de ces illusions. Il se pourrait au contraire qu’elles n’aient fait qu’aggraver cet état de minorité de l’homme :
« La thérapie s’est établie comme le successeur de l’individualisme farouche et de la religion ; ce qui ne signifie pas que le “triomphe de la thérapeutique” soit devenu une nouvelle religion en soi. De fait, la thérapie constitue une antireligion, non pas parce qu’elle s’attache aux explications rationnelles ou aux méthodes scientifiques de guérison, mais bien parce que la société moderne “n’a pas d’avenir”, et ne prête donc aucune attention à ce qui ne relève pas de ses besoins immédiats. Même lorsque les thérapeutes parlent de la nécessité de “l’amour” et de la “signification” ou du “sens”, ils ne définissent ces notions qu’en termes de satisfaction des besoins affectifs du malade […] Libérer l’humanité de notions aussi attardées que l’amour et le devoir, telle est la mission des thérapies postfreudiennes, et particulièrement de leurs disciples et vulgarisateurs, pour qui santé mentale signifie suppression des inhibitions et gratification immédiate des pulsions » 12.
Analyse pas terminée, analyse interminable : en privant l’homme de ses illusions, on ne lui a pas dessillé les yeux ; on n’a fait qu’engendrer des illusions plus douces, plus aliénantes. La pratique thérapeutique finit par produire des effets pervers, contraires aux objectifs grandioses annoncées : les premières victimes de la réduction de l’homme à ses pulsions sont alors les pulsions elles-mêmes. Il ne peut y avoir d’accomplissement du désir s’il ne se fait pas au nom d’un idéal qui dépasse la simple satisfaction organique. Le sujet, en qui affluent et grouillent les pulsions, ne peut leur trouver un sens que s’il parvient à les sublimer dans un idéal. C’est en ce sens que, pour Lasch, la religion était paradoxalement une cure meilleure que la psychanalyse, en ce qu’elle obtenait, au moins de certains de ses adeptes, une sublimation des pulsions (quête de Dieu, ravissement extatique, amour de l’humanité…) et qu’elle mettait l’homme face à ses limites, en vexant sa propension à se croire tout-puissant.
La critique du thérapeutisme montre à la fois comment le monde de la cure a permis de repérer l’expansion d’un trouble ; puis comment s’est constitué en réponse un scientisme d’un type nouveau. La psychanalyse n’est pas à l’origine du narcissisme mais a contribué à l’aggraver.
Le miroir du narcissisme
Pour Narcisse, le monde n’est que le miroir de ses désirs. Et si le monde ne le satisfait pas, c’est qu’il est mauvais. La psychanalyse post-freudienne, ne permet plus, selon Lasch, au sujet de sortir de lui-même ; au contraire, elle l’enfonce dans ses turpitudes. L’exaltation du moi entraîne en fait un effondrement de ce dernier. Lasch voit ce processus mortifère à l’oeuvre dans la littérature, qui lui sert ici de miroir grossissant pour un phénomène plus général :
« La popularité du genre autobiographique et de la confession témoigne, évidemment, du nouveau narcissisme qui s’étend à toute la culture américaine. Pourtant, les meilleures œuvres dans cette veine, parce qu’elles dévoilent le moi précisément, tentent d’établir une distance critique par rapport à ce moi et de mieux appréhender les forces historiques – reproduites sous forme psychologique – qui ont rendu le concept même d’identité de plus en plus problématique. Le seul fait d’écrire présuppose déjà un détachement envers le moi. De plus, l’objectivation de sa propre expérience, ainsi que l’ont montré les études psychiatriques sur le narcissisme, permet aux « sources profondes du grandiose et de l’exhibitionnisme – après avoir été convenablement inhibées dans leurs projets, apprivoisées et neutralisées – de trouver un accès » à la réalité. Pourtant, l’interpénétration croissante de la fiction, du journalisme et de l’autobiographie montre de façon indéniable que de nombreux écrivains parviennent de plus en plus malaisément à atteindre ce détachement indispensable à l’art » 13.
En rompant les barrières imposées au désir, notre société engendre chez l’individu des sentiments d’impuissance et de rage rentrée. L’écrivain, parce qu’il pousse jusqu’au bout un processus que l’homme ordinaire ne vit pas complètement, est le premier à exprimer parfaitement cette misère existentielle :
« Le voyage intérieur ne révèle que le vide. L’écrivain ne voit plus la vie reflétée dans son esprit mais, au contraire, le monde, même vide, comme son propre miroir. Lorsqu’il rend compte de ses expériences « intérieures », ce n’est pas pour nous donner un tableau objectif d’un fragment représentatif de la réalité, mais pour séduire afin qu’on s’intéresse à lui, qu’on l’acclame, qu’on sympathise, qu’ainsi l’on conforte son identité chancelante 14 ».
En France, la vogue de l’autofiction a certainement marqué l’aboutissement de ce renfermement de l’écrivain sur lui-même.
La littérature, quand elle ne veut être que le miroir de l’écrivain qui nous parle de lui, n’est plus capable d’offrir une quelconque image du monde. La quête intérieure de soi est bien un miroir aux alouettes : « Plus l’homme s’objective dans son travail, plus la réalité prend l’apparence d’une illusion. […] Pour le moi-acteur, la seule réalité est l’identité qu’il parvient à construire à partir de matériaux fournis par la publicité et la culture de masse, de thèmes de films et romans populaires […] Afin de polir et de parfaire le rôle qu’il s’est choisi, le nouveau Narcisse contemple son propre reflet, non pas tant pour s’admirer que pour y chercher sans relâche les failles, les signes de fatigue ou de décrépitude. […] Tous, tant que nous sommes, acteurs et spectateurs, vivons entourés de miroirs ; en eux, nous cherchons à nous rassurer sur notre pouvoir de captiver ou d’impressionner les autres, tout en demeurant anxieusement à l’affût d’imperfections qui pourraient nuire à l’apparence que nous voulons donner. L’industrie de la publicité encourage délibérément ce souci des apparences » 15.
A mesure que l’identité individuelle vacille, le monde, note Lasch, devient une suite confuse d’images tremblotantes. La culture du narcissisme est, on le voit, un impitoyable miroir de nous-mêmes.
La moralisation du sport
Un terrain d’étude privilégié du narcissisme est celui, justement, du terrain de sport. Quand l’activité sportive n’est plus considérée comme un moyen pour l’homme d’éprouver ses forces dans un jeu réglé, quand la compétition est assujettie à des exigences morales, financières et politiques, elle devient un instrument d’embrigadement. Le sport perd son sens initial, être une occasion d’éprouver nos capacités et d’admirer des performances exceptionnelles 16. Il vire à son tour à la recherche de la performance et de la victoire calculée :
« Le dicton de George Allen – « Gagner n’est pas le plus important, c’est la seule chose qui compte » – représente la dernière défense de l’esprit d’équipe contre sa détérioration. Généralement cité comme preuve de l’hypertrophie de la compétition, ce genre d’affirmation peut, au contraire, la garder dans des limites raisonnables. […] Aujourd’hui, les gens associent la rivalité à l’agression sans frein ; il leur est difficile de concevoir une situation de compétition qui ne conduise pas directement à des pensées de meurtre. […] A l’origine de ces propos gît la conviction que l’excellence, de fait, s’atteint au détriment d’autrui ; la compétition tend à devenir meurtrière, à moins d’être tempérée par la coopération ; et la rivalité sportive, si elle n’est pas contrôlée, exprimera la rage intérieure que l’homme contemporain cherche désespérément à étouffer (pages 157-158).[/efn_note] ».
Dans un monde où les individus sont montés les uns contre les autres, il devient difficile de maintenir un réseau d’amis, de camarades, de partenaires de jeux. L’association libre et fraternelle devient l’exception, la méfiance généralisée et la concurrence larvée, la règle :
« Dans une société bureaucratique, la fidélité à une organisation perd de sa force. Si les sportifs s’appliquent encore à subordonner leurs propres performances à celles de l’équipe, ce n’est pas parce que celle-ci, en tant qu’entité, transcende les intérêts individuels, mais simplement pour conserver des rapports harmonieux avec leurs collègues. Dans la mesure où il distrait les foules, le sportif cherche avant tout à promouvoir son propre intérêt, et vend ses services au plus offrant. Les meilleurs se transforment en célébrités ; ils deviennent alors des supports publicitaires et touchent des sommes qui dépassent souvent leurs salaires déjà élevés 17 ».
Le déclin de l’esprit sportif touche à une dimension essentielles de notre existence : celle du corps, des bases physiques, matérielles de notre vie. Le sport doit maintenant servir à entretenir une bonne image de soi (squash en milieu de semaine avec les collègues…). Il n’est pas valorisé pour lui-même, pour le plaisir du jeu où l’on éprouve ses forces, mais pour ses bienfaits sur la santé et pour l’image qu’il véhicule : motivation et dynamisme.
L’étude du sport sert à montrer un déclin de l’esprit d’équipe qui s’étend au monde du travail en général. Lasch montre comment la mentalité du capitalisme avancé ruine la mentalité industrieuse des origines. L’auteur n’est donc pas tant critique du capitalisme que de la concentration de la production entre de grandes firmes 18. La compétition sur le terrain ne se fait plus seulement pour jouer et gagner, mais au profit des annonceurs, des politiques et des thérapeutes, qui cherchent à promouvoir par ce biais la conformité des individus à des normes de bonne santé morale et physique.
Ce qui se manifeste dans le sport est une dégradation de l’esprit d’entreprise, une perte du sens de l’initiative : le capitalisme, en se “bureaucratisant” travaille à sa propre disparition.
Ce que l’individu perd en se salariant pour une grande entreprise, il semblerait néanmoins qu’il le récupère par l’autonomie promue par un mode de vie libéral.
Émancipation ou aliénation de l’individu ?
L’émancipation de l’individu apparaît, au départ, comme un effet bénéfique de la montée du niveau de vie et des opportunités permises par un marché libre. Lasch montre que cette libération, provoquée par l’extension du capitalisme industriel, finit par être nuisible aux individus : libérés de leurs attachements, de plus en plus interchangeables, ils ne peuvent s’engager sérieusement dans une voie professionnelle. Le travail devient moins une affaire de compétence et de dévouement personnel qu’un jeu de mise en scène de soi. L’employé des grandes firmes anonymes doit jouer un rôle, se montrer plus malin que les autres, gruger ses collègues et ses supérieurs.
La distance au rôle est amoindrie : il faut être personnellement, affectivement, investi dans son travail, faire des déclarations amoureuses à son entreprise 19. Cette exigence de sincérité provoque chez ceux qui en sont victime des angoisses. La distance au rôle ne peut être artificiellement rétablie qu’en surjouant son personnage, ironiquement, en essayant, dans son for intérieur, de ne pas se laisser « coloniser » par les mots d’ordre de la “motivation”.
L’individualisme sert d’expression à un désir de retrait dans la sphère privée, loin de la famille et du bureau. Illusoire façon de retrouver une autonomie que le travail ne permet plus d’acquérir :
« La critique de la « privatisation », bien qu’elle contribue à maintenir en éveil le besoin d’une existence plus communautaire, devient fallacieuse alors que diminue la possibilité d’une authentique vie privée. Il se peut qu’à l’instar de ses prédécesseurs, l’Américain contemporain se montre incapable d’établir aucune sorte de vie commune, mais les tendances à la concentration de la société industrielle moderne n’en ont pas moins sapé son isolement. Ayant livré ses compétences techniques aux grandes entreprises, il ne peut plus pourvoir lui-même à ses besoins matériels. 20. »
Le rapport à l’entourage se fait sur le mode de la dérision : je les fréquente mais juste dans mon intérêt ; je vais au travail mais juste pour gagner ma vie, sans y croire :
« Ce qui est à dénoncer dans le mouvement de prises de conscience, ce n’est pas qu’il traite de problèmes banals ou irréels, mais qu’il fournit des solutions qui vont à l’encontre de ses propres intentions. Né d’un profond malaise, dû à la détérioration des relations personnelles, ce mouvement conseille aux gens de ne pas trop s’engager en amour et en amitié, d’éviter de devenir trop dépendant des autres et de vivre dans l’instant –alors que ce sont, précisément, ces comportements qui sont à l’origine du malaise » 21.
Le développement de la personnalité narcissique a lieu dans une société qui a rompu ses liens avec le passé et se trouve, de ce fait, incapable de préparer l’avenir. L’individu, privé de conscience historique, est enfermé dans un présent rétréci 22.
Dans un autre essai, Le moi assiégé Lasch écrit : « Dans une époque troublée comme la nôtre, la vie quotidienne se transforme en un exercice de survie. Les gens vivent au jour le jour. Ils évitent de penser au passé, de crainte de succomber à une “nostalgie” déprimante ; et lorsqu’ils pensent à l’avenir, c’est pour y trouver comment se prémunir des désastres que tous ou presque s’attendent désormais à affronter. […] Assiégé, le moi se resserre jusqu’à ne plus former qu’un noyau défensif, armé contre l’adversité. L’équilibre émotionnel requiert un moi minimal, et non plus le moi impérial d’antan » 23.
Plusieurs passages de La culture du narcissisme sont écrits en écho aux thèses de Freud sur les frustrations provoquée par la domestication de l’homme dans la civilisation (je souligne) :
« Aujourd’hui, les Américains sont dominés, non par le sens de possibilités infinies, mais bien plutôt par la banalité de l’ordre social qu’ils ont érigé contre de telles possibilités. Comme ils ont intériorisé les contraintes sociales au moyen desquelles ils tentaient, jadis, de garder leurs appétits dans des limites civilisées, ils se sentent maintenant annihilés par l’ennui, à l’instar de ces animaux dont l’instinct s’étiole en captivité. Le retour à la sauvagerie les menace si peu qu’ils rêvent précisément d’une vie instinctive plus vigoureuse. Les gens se plaignent d’être incapables de sensation. Ils sont à la recherche d’impressions fortes, susceptibles de ranimer leurs appétits blasés et de redonner vie à leur chair endormie. Ils condamnent le surmoi et exaltent la fièvre perdue des sens. Les peuples industrialisés du XXe siècle ont construit tant de barrières psychologiques pour faire pièce aux émotions fortes, et ils ont investi dans ces défenses tant d’énergie, émanant d’impulsions interdites qu’ils sont incapables de se souvenir de l’impression que l’on ressent lorsqu’on est inondé par le désir. Ils ont plutôt tendance à se consumer, d’une rage issue de défenses érigées contre le désir, laquelle donne, à son tour, naissance à de nouvelles défenses contre elle-même. Apparemment incolores, soumis et sociables, ils bouillonnent d’une colère intérieure à laquelle une société bureaucratique, dense et surpeuplée, ne peut offrir que peu d’exutoires légitimes 24. »
L’ère de l’individualisme ne marque pas le triomphe mais l’effondrement de l’individu.
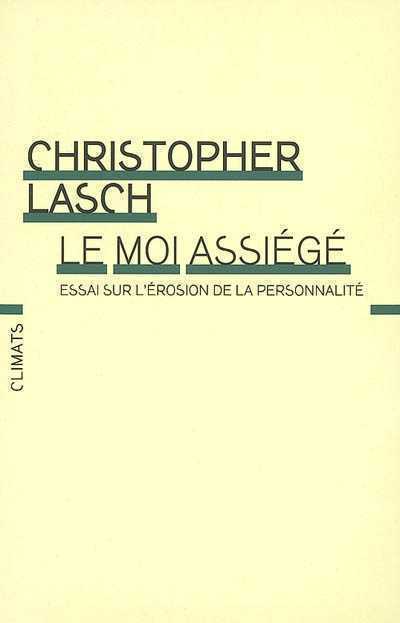
La guerre des sexes
Autre échec pointé par Lasch, celui de la libération sexuelle. Celle-ci a voulu satisfaire des demandes d’émancipation de la femme par rapport à son rôle de mère. Mais il n’est pas si certain, selon Lasch, que cela ait fait leur bonheur : au lieu d’être soumises à leur mari, elles se sont retrouvées de plus en plus sous la coupe de leur patron, de leur banquier. Qui plus est, les revendications féministes n’ont pas eu les effets escomptés : au lieu d’un apaisement des relations de couple, elles ont déclenché une nouvelle guerre des sexes. L’homme, faute de correspondre à l’ami idéal, au tendre compagnon, est considéré à présent comme un rival, un phallocrate. Le même mécanisme narcissique est encore à l’oeuvre : des désirs excessifs ne peuvent être satisfaits et engendrent en retour des frustrations inédites. Le mythe du prince charmant continue donc de faire des dégâts… Lasch ne parle pas en misogyne qui proposerait un retour de la femme au foyer. Il montre que l’équilibre ancien du couple a été rompu au profit d’une situation de rivalité généralisée entre hommes et femmes : la libération annoncée n’a pas su aboutir à un équilibre meilleur 25
Pire, la sexualisation inconditionnelle de la relation amoureuse (droit à l’orgasme) se fait au prix de ce que Lasch appelle une fuite devant les sentiments (flight from feeling). Les individus ne ressentent plus rien, ni des sentiments des autres ni d’eux-mêmes. Ils voudraient être des machines à jouir, sans entraves, mais leur chair est plus triste que jamais… L’idéal d’épanouissement absolu par la sexualité aboutit à des hommes et des femmes névrosés, hostiles les uns aux autres.
Le modèle du libertinage bourgeois, en « contaminant » les différentes couches de la société, fait sauter toute la distance polie qu’hommes et femmes avaient su établir entre eux. Chaque sexe ne se faisait pas trop d’illusions sur les faiblesses de l’autre. Il apprenait à les accepter, avec un mélange d’ironie et de bonhomie. En s’attaquant à la vie de famille précairement maintenue dans les milieux modestes, l’idéologie libertaire a constitué une nouvelle forme de lutte des classes.
Lorsqu’il montre que les désordres narcissiques proviennent des couches sociales supérieures et déstabilisent les classes populaires, Lasch semble pointer un complot des élites. Tout le mal viendrait des dirigeants, qui auraient trouvé le moyen d’oppresser la masse par les moyens d’une bureaucratie tentaculaire. De plus, pour qu’elle soit contente de son sort, on l’abrutirait par la télévision, la thérapie et des promesses d’épanouissement illusoires. Lasch répond à ce soupçon :
« Qu’on ne se méprenne pas. Je ne veux pas donner à entendre qu’il existe une vaste conspiration contre nos libertés. Toutes ces actions été entreprises en pleine lumière et, dans l’ensemble, avec de bonnes intentions. Elles n’ont pas été non plus le fait d’une politique cohérente de contrôle social. Les gens qui formulent une politique voient rarement au-delà des problèmes immédiats. […] Ce qui donne cohérence aux actions entreprises par les directeurs et professionnels qui gèrent le système, c’est leur volonté de promouvoir et de préserver le capitalisme des grandes sociétés dont ils tirent, eux-mêmes, le plus grand profit. Les besoins de ce système modèlent la politique mise en œuvre, et circonscrivent les limites des discussions publiques sur ce sujet. Si nous sommes, pour la plupart, conscients de l’existence de ce système, nous ignorons, en revanche, la classe qui le gère et qui monopolise la richesse qu’il crée. Nous nous refusons à faire une analyse « de classe » parce qu’elle pourrait ressembler à une explication par la « théorie de la conspiration ». Mais nous nous interdisons, du même coup, de comprendre comment sont nées nos difficultés présentes, pourquoi elles persistent, et comment elles pourraient être résolues 26 ».
Mettre les dirigeants face à leur responsabilité n’est pas les accuser d’intentions malveillantes. Le rôle des dominants dans le déclin de l’Amérique contemporaine est précisé par Lasch dans son dernier livre, La révolte des élites 27.
L’éclatement de la famille
Tout son projet de Lasch est de retracer une évolution sociale qui ne date pas de la décennie où il écrit, les années 1970, mais qui a commencé à la fin du 19ème siècle. Dans la postface, l’auteur revient sur son projet pour exposer son hypothèse de départ. Il y explique pourquoi la famille est un lieu privilégié de compréhension d’une culture, en quoi son étude est déterminante pour une société considérée, et quelles sont les répercussions de son déclin l’Amérique d’aujourd’hui (je souligne) :
« Le narcissisme de la culture et de la personnalité, tel que je l’ai compris, n’était pas simplement synonyme d’égoïsme […] L’école, les groupes d’affinités, la communication de masse et les « travailleurs sociaux » avaient miné l’autorité parentale et s’étaient emparé d’un grand nombre de fonctions familiales touchant à l’éducation des enfants. Je me suis dit que des changements d’une telle ampleur, dans une activité d’une importance aussi fondamentale, devaient avoir eu des répercussions psychologiques très étendues. La Culture du Narcissisme était une tentative d’analyse de ces répercussions – d’exploration de la dimension psychologique des changements à long terme dans la structure de l’autorité culturelle. Mes hypothèses de base provenaient d’un ensemble d’études, dues pour la plupart à des anthropologues, à des sociologues et à des psychanalystes qui s’intéressaient à l’étude de la culture et qui analysaient les effets de celle-ci sur la personnalité. Les chercheurs appartenant à cette école maintenaient que chaque culture établit des modèles distincts d’éducation et de socialisation des enfants qui ont pour effet de produire un type de personnalité distinct adapté aux besoins de cette culture […] Un certain nombre d’autres observateurs étaient parvenus à des conclusions semblables quant à la direction que prenaient les changements subis par la personnalité. Ils parlaient de l’effondrement des « contrôles pulsionnels », du « déclin du surmoi » et de l’influence croissante des groupes d’affinités. Les psychiatres, en outre, constataient une transformation dans les symptômes qu’ils détectaient chez leurs patients. Les névroses classiques traitées par Freud, disaient-ils, étaient remplacées par des désordres de la personnalité de type narcissique. Sheldon Bach a fait remarquer en 1976 : “Nous avions l’habitude de voir arriver des gens ayant des pulsions, comme l’obsession de se laver les mains, des phobies et des névroses bien repérées. Aujourd’hui, on voit arriver surtout des Narcisses contemporains” » 28.

Narcisse au cinéma : la fuite devant les sentiments
Je voudrais pour finir illustrer le propos de Lasch par deux exemples pris au cinéma. Puisque Narcisse aime outrageusement se mettre en scène, il n’est pas surprenant que le monde de fiction créé par Hollywood regorge de personnages souffrant de ce mal. Si de plus, ces films se passent dans le milieu de la télévision, on peut être assuré d’y trouver un vivier…
J’ai déjà évoqué King of Comedy de Scorcese, dont un célèbre critique de cinéma a dit qu’il est « one of the most arid, painful, wounded movies I’ve ever seen […] It is frustrating to watch, unpleasant to remember, and, in its own way, quite effective 29 ». En transposant, on en dirait autant du livre de Lasch, si dans les deux cas, cette vexation infligée au narcissisme n’avait pas un côté salutaire.
La prostituée du film d’Alan J. Pakula, Klute (1971), jouée par Jane Fonda, consulte régulièrement une psychanalyste. Elle lui raconte que, pour satisfaire les fantasmes de ses clients, elle est parvenue à simuler parfaitement ses émotions. Elle joue sur mesure le rôle qu’ils veulent. Si elle a choisi de gagner sa vie par la prostitution, affirme t-elle, c’est pour obtenir une parfaite maîtrise sur ses désirs. Elle confesse finalement, face caméra, le vide intérieur de son existence : sa sexualité simulée l’a privée de tout sentiment.
La productrice de télévision jouée par Faye Dunaway dans Network, de Sidney Lumet (1976), est elle aussi incapable de sentiments humains sincères. Elle mène sa vie comme si elle était un personnage de show télé : « If I stay with you, lui lance son amant horrifié, I’ll be destroyed […] like everything you and the institution of television touch is destroyed. You are television incarnate, Diana : indifferent to suffering, insensitive to joy. You are madness, Diana, virulent madness, and everything you touch dies with you 30 ».
Ces deux héroïnes jouent un rôle en permanence. C’est même leur seule personnalité : quand elles ne jouent plus leur personnage, elles ne retrouvent aucune personnalité propre. Elles sont devenues de parfaites créatures de fiction.
C’est peut-être dans ces moments où Hollywood fait des films qui sont des miroirs sans complaisance de son temps, qu’il échappe le plus à sa tendance inhérente au narcissisme.

La productrice de télévision (Faye Dunaway) dans Network de Sidney Lumet (1976) et la prostituée (Jane Fonda) dans Klute d’Alan J. Pakula (1971). Deux héroïnes qui pratiquent cette “fuite devant les sentiments” dont parle Lasch : la première au nom de ses ambitions professionnelles, la seconde pour satisfaire les fantasmes de ses clients. Exubérantes dans leur travail, elles sont froides et indifférentes en privé, incapables d’émotions véritables.
L’Anti-Narcisse
Depuis quarante ans, les essais dénonçant les maux contemporains n’ont pas manqué. On a critiqué pêle-mêle la société de consommation (ou du spectacle), l’ère du vide, l’homo festivus, le désordre amoureux ou encore la fin de la valeur-travail et la mort de l’athéisme… On ne cesse également de protester contre l’assistanat, la perte du sens des valeurs… On a identifié à chaque fois les effets du mal, sans vraiment trouver les causes. Je crois que Lasch, en un seul livre, a fait mieux que toutes ces analyses réunies, car il a réussi à montrer les conditions sociales d’apparition de la pathologie psychologique spécifique de notre temps. Complétant en somme Freud par Marx et Weber, il a brossé un portrait sans fard de l’homme contemporains -nous- non pour le plaisir d’être vexant, mais pour faire la lumière sur les tendances les plus mortifères de notre culture. Le portrait de Dorian Gray révélait les tares et les vices du personnage ; le portrait de Narcisse révèle l’infantilisation d’un individu qui ne sait plus se prendre en charge et faire sa vie.
Dans sa postface, l’auteur écrit :
« Les critiques ont accueilli La Culture du Narcissisme comme une « jérémiade » supplémentaire s’attaquant au sybaritisme, comme un constat sur les années soixante-dix. Ceux qui ont trouvé le livre trop sinistre ont annoncé qu’il serait de toute façon bientôt dépassé, puisque la décennie qui allait commencer nécessiterait bientôt un nouvel ensemble de tendances, de nouveaux slogans et de nouveaux mots d’ordre, afin de se distinguer des décennies précédentes » 31. Il n’y a bien sûr pas un mot à changer à ce livre, qui est sans doute encore plus actuel aujourd’hui qu’hier. Le narcissisme n’est pas qu’un travers superficiel d’une époque trop tournée sur elle-même mais le symptôme d’une crise profonde. Aux discours optimistes et satisfaits, il oppose une démarche qui ne flatte personne et qui est, pour cette raison, anti-narcissique.
Le constat peut paraître désespérant et même profondément pessimiste. Néanmoins, il n’y aurait pas de sens de la part de Lasch à faire ce constat s’il ne croyait pas en nos capacités à prendre conscience de nos aveuglements quant aux bienfaits automatiques de l’idéologie du progrès. En voulant mettre fin à tous les conflits et en nous promettant un avenir de satisfactions illimitées, notre société s’est enfermée dans des illusions grandioses et dérisoires, oublieuse des limites de l’être humain, de ce que Jean-Claude Michéa appelle sa part de tragique « non pas centrale mais irréductible » 32.
- Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Minuit, 1965.
- cf. Albert Eiguer, Le pervers narcissique et son complice, Dunod, 2003.
- cf. Marie-France Hirigoyen, Le Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, La Découverte, 1998.
- cf. Pascale Chapaux-Morelli et Pascal Couderc, La manipulation affective dans le couple : Faire face à un pervers narcissique, Albin Michel, 2010.
- Christopher Lasch, The Culture of Narcissism : American Life in an Age of Diminishing Expectations, 1979 ; La culture du narcissisme : la vie américaine à un âge de déclin des espérances, 2006, Flammarion, Champs
- Page 284.
- Page 37.
- C’est pourquoi on peut accueillir avec scepticisme la profession de foi optimiste de Luc Ferry dans son dernier essai, L’innovation destructrice (Plon, 2014), qui voit dans la civilisation occidentale la seule et unique à avoir sorti l’homme de son état de minorité. D’une part, notre civilisation n’est peut-être pas la seule à l’avoir fait ; de plus, il n’est pas certain qu’elle ait définitivement réussi. Il se pourrait que le culte du progrès nous aveugle largement. L’essai de Ferry n’est d’ailleurs, dans ce rappel de l’importance des traditions, qu’une reprise non-dite des thèses de Lasch et Michéa. Or, il termine, malgré cette mise en garde, sur une défense inconditionnelle de l’innovation et du progrès, qu’il considère comme indispensables. L’alerte aura été donc chaude mais de courte durée. Sa réflexion est au moins l’occasion pour lui de se moquer des contradictions de l’entrepreneur « moderne », qui veut en revenir aux bonnes vieilles méthodes de management tout en appelant sans cesse ses employés à révolutionner leurs outils de production.
- Page 284-285.
- Page 40.
- Page 34.
- Pages 40-41
- Page 46.
- Page 50.
- Page 129.
- Jean-Claude Michéa a montré les dérives du sport sous l’influence de la mentalité utilitariste, dans son essai Le plus beau but était une passe (Climats, 2014). [Lire une recension du livre sur ce site->https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article541]. La coupe du monde au Brésil ne nous a-t-elle pas montré nombre de matchs où les équipes jouaient non pour gagner, mais pour ne pas perdre, et où la violence sournoise a été utilisée comme tactique pour déstabiliser l’adversaire ?
- Page 159.
- On retrouve là des critiques proches de celles portées par John Kenneth Galbraith. Voir Le nouvel état industriel, 1968.
- Sur cette forme de soumission nouvelle induite par les méthodes de management de pointe, voir le livre de Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010.
- Pages 36.
- Page 57.
- Je forme cette expression de « présent rétréci » à partir de la notion bergsonienne de présent élargi. Se placer dans le présent élargi signifie pour Bergson ressaisir le passé (mémoire), qui presse sur le présent comme durée actuelle (attention) et qui s’ouvre sur l’avenir (volonté). On pourrait dire que le narcissique, étouffé dans une durée de plus en plus pauvre, est au contraire amnésique, indifférent et aboulique.
- Christopher Lasch, Le moi assiégé. Essai sur l’érosion de la personnalité, Climats, 2008. Dans ce livre, Lasch retrouve une étymologie possible de narcisse : du grec narkè, la torpeur. Le narcissisme est un narcotique. Ce point est essentiel : le narcissisme ne témoigne pas d’une suractivité mais bien d’un désir d’apaisement des tensions, de la quête d’un “Nirvana” comme échappatoire aux conflits et contradictions de l’existence. Narcisse ne rêve que d’une chose : vivre sa vie comme un songe. Bergson pointait dans le Rire ce risque pour l’être vivant de se laisser aller au somnambulisme. Nietzsche pointait pour sa part un “bouddhisme européen”, l’Europe désignant le monde occidental au sens large, et le “bouddhisme” un instinct de dépression profonde, menant au nihilisme. Voir la Généalogie de la morale, avant-propos, §5, ou encore Fragments posthumes, X, 25 [222].
- Pages 38-39
- Voir le livre de Lasch, Les femmes et la vie ordinaire : Amour, mariage et féminisme, Climats 2006.
- Page 275.
- La révolte des élites et la trahison de la démocratie, Champs, Flammarion, 2010. Voir sur ce site [un compte-rendu de ce livre->https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article374].
- Pages 294-296.
- « L’un des films les plus arides, pénibles et douloureux que j’ai jamais vu. Le voir est frustrant, s’en souvenir est désagréable et, à sa manière, il est très efficace ». Lire [la chronique de Roger Ebert->http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19830515/REVIEWS/50420001/1023] sur le film.
- « Si je reste avec toi, je serai anéanti, anéanti comme tout ce que toi et la télévision touchez. Tu es la télévision incarnée, Diana : indifférente à la souffrance, insensible à la joie. Tu es folle, Diana, folle à lier et tout ce que tu touches meurt avec toi ».
- Page 293.
- Jean-Claude Michéa, Orwell éducateur, Climats 2003








