« L’histoire accélère-t-elle ? » Voilà une question que L’Accélération de l’histoire ne cherche pas à trancher, mais plutôt à déplier. Par ce concept, Christophe Bouton vise un motif très fréquent dans les appréhensions contemporaines de l’historicité : celle-ci, en entrant dans la modernité, aurait modifié radicalement son rapport à la vitesse. Sur les plans technique, (géo)politique, économique, climatique aussi, le cours des événements serait devenu une locomotive folle lancée sans conducteur. Le caractère totalisant de ce phénomène permettrait d’y percevoir un trait constitutif de la modernité : non seulement la fréquence des changements augmenterait continuellement (en augmentant même la cadence de cette augmentation), mais ceux-ci auraient adopté un rythme qui les empêcherait de constituer des objets historiques. A force de se succéder les unes aux autres dans une instantanéité immédiate, ils seraient enfermés dans un devenir pur, pour ainsi dire aveugle, sans passé ni futur, sans mémoire ni télos, emmuré dans l’étincelle d’un éternel présent.
Théorisé ou popularisé par des esprits aussi éloignés les uns des autres que Daniel Halévy, Harmut Rosa, Pierre Nora, Paul Virilio ou Peter Conrad, ce motif a rencontré un vif succès, lui-même auréolé d’une certaine confusion. Christophe Bouton suggère même qu’il existe un lien entre l’omniprésence du concept d’accélération et son équivocité : « Le constat d’une accélération de l’histoire se rencontre de fait aussi bien chez des historiens, des essayistes, des philosophes, des hommes politiques, des industriels, des écrivains, des scientifiques, etc., qui investissent cette notion selon différentes perspectives, avec des significations et des stratégies distinctes.[1] » On pourrait presque croire qu’avec cette notion, c’est toute une « pré-compréhension » (Heidegger) de l’historicité qui s’engage. Il s’agit, en d’autres termes, d’une auto-évidence. Parler d’accélération relèverait, non de l’interprétation, mais du constat : nul jugement de valeur ne viendrait se loger derrière cette analyse.
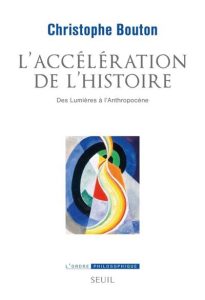 Or Christophe Bouton montre, dès l’introduction de son ouvrage, que cette idée soulève un certain nombre de problèmes. Quand on évoque l’accélération de l’histoire, à quelle histoire se réfère-t-on ? Est-ce l’history ou la story, l’historia ou la storia ? Pointe-t-on, autrement dit, l’histoire en tant que succession chronologique d’événements, à savoir d’histoire vécue, ou de l’histoire en tant que traitement d’informations, que récit, voire en tant que discipline – en somme d’histoire étudiée, racontée, mémorisée[2] ? Cette alternative ne saurait être considérée sans remonter en amont du problème, dans la contradiction impliquée par l’expression « accélération de l’histoire ». En physique, l’accélération renvoie à l’augmentation de la vitesse à travers le temps (un décollage d’avion, un animal qui chasse, une chute libre) ; comment l’histoire elle-même, soit le visage universel du temps, pourrait-elle accélérer[3] ? Ne confond-on pas, en s’exprimant ainsi, le critère et le référentiel ? Ne commet-on pas, par là même, une erreur de logique ? Peut-on appliquer une catégorie physique à l’histoire, et donc à des disciplines anthropiques, à l’image de l’économie, de la technologie, de la géopolitique ? On notera enfin, et c’est le principal, que se profile une « normativité immanente à cette expérience »[4] : éprouver l’accélération suppose toujours d’évaluer la modernité, quelles que soient les valeurs (émancipation/régression) convoquées à cette fin. Peu importe la structure narrative dans laquelle ce sentiment s’insère, il revêt nécessairement une dimension téléologique, ce qui permet à certains d’affirmer que l’accélération conduit vers la fin de l’histoire, à d’autres d’y percevoir le catalyseur de l’émancipation, à d’autres encore d’y cerner le stade ultime de l’anthropocentrisme, et ainsi de suite.
Or Christophe Bouton montre, dès l’introduction de son ouvrage, que cette idée soulève un certain nombre de problèmes. Quand on évoque l’accélération de l’histoire, à quelle histoire se réfère-t-on ? Est-ce l’history ou la story, l’historia ou la storia ? Pointe-t-on, autrement dit, l’histoire en tant que succession chronologique d’événements, à savoir d’histoire vécue, ou de l’histoire en tant que traitement d’informations, que récit, voire en tant que discipline – en somme d’histoire étudiée, racontée, mémorisée[2] ? Cette alternative ne saurait être considérée sans remonter en amont du problème, dans la contradiction impliquée par l’expression « accélération de l’histoire ». En physique, l’accélération renvoie à l’augmentation de la vitesse à travers le temps (un décollage d’avion, un animal qui chasse, une chute libre) ; comment l’histoire elle-même, soit le visage universel du temps, pourrait-elle accélérer[3] ? Ne confond-on pas, en s’exprimant ainsi, le critère et le référentiel ? Ne commet-on pas, par là même, une erreur de logique ? Peut-on appliquer une catégorie physique à l’histoire, et donc à des disciplines anthropiques, à l’image de l’économie, de la technologie, de la géopolitique ? On notera enfin, et c’est le principal, que se profile une « normativité immanente à cette expérience »[4] : éprouver l’accélération suppose toujours d’évaluer la modernité, quelles que soient les valeurs (émancipation/régression) convoquées à cette fin. Peu importe la structure narrative dans laquelle ce sentiment s’insère, il revêt nécessairement une dimension téléologique, ce qui permet à certains d’affirmer que l’accélération conduit vers la fin de l’histoire, à d’autres d’y percevoir le catalyseur de l’émancipation, à d’autres encore d’y cerner le stade ultime de l’anthropocentrisme, et ainsi de suite.
« L’objet du présent ouvrage, écrit Christophe Bouton, n’est pas d’apporter une pierre supplémentaire à cet édifice. Il s’agit plutôt, à rebours, de déconstruire la thèse de l’accélération de l’histoire.[5] » Déconstruire, cela implique de d’interroger les conditions de ce concept : ses conditions d’application (sa polyvalence, les divers champs embrassés par lui), ses conditions d’apparition (sa généalogie), ses horizons philosophiques (les conceptions de l’historicité ou de la modernité qu’il véhicule).
Car le concept d’accélération fait lui-même l’objet d’une historicité complexe, structurée autour de trois axes majeurs, que l’auteur déploie dans son premier chapitre. Sur le plan politique, l’idée que l’Histoire aurait rompu avec sa lenteur constitutive trouve notamment son socle dans la préface de la Phénoménologie de l’Esprit où Hegel, décrivant l’esprit comme engagé dans un « mouvement toujours en progrès », perçoit dans son époque un moment de bascule, d’engloutissement de la représentation, de transformation radicale dans le rythme du « développement » constitutif de l’historicité. Sur le plan technologique, l’idée daterait surtout de la révolution industrielle, et serait à comprendre comme le fil conducteur d’une triple évolution : accélération des moyens de transports, des rythmes de productions, des fréquences d’innovations. Chez Marx, une corrélation est théorisée entre le registres technique et politique : dans le Manifeste de 1848, par exemple, la transformation perpétuelle à laquelle s’adonne la bourgeoisie est présentée comme la condition, certes indirecte, de la révolution. Ces deux pans situeraient donc l’émergence de l’accélération au XIXe siècle, fruit des Lumières, de la Révolution, de l’essor du capitalisme industrialisé. Mais Christophe Bouton rappelle que cette idée cristallise un thème bien plus ancien : celui de l’eschatologie. Dès le Moyen Âge, on trouve, dans le sillage du chapitre 20 de l’Apocalypse de Jean, de nombreuses visions d’une histoire prise de vitesse à l’aube du Jugement dernier. A l’image de ce texte du IVe siècle, cité par Koselleck puis par Christophe Bouton : « Et les années seront pour ainsi dire réduites à des mois, et les mois à des semaines, et les semaines à des jours, et les jours à des heures.[6] » L’accélération constituerait donc moins une propriété inhérente à la modernité que la projection d’une vision apocalyptique, chrétienne ou sécularité, de cette même modernité.
C’est à la lumière de cette ambivalence que Christophe Bouton passe en revue les principales théories de l’accélération, du XIXe siècle à nos jours, de Heine à Hartmut Rosa en passant par Nietzsche, Henry Adams, Daniel Halévy ou Pierre Nora. Par-delà l’identification de trois schèmes réactifs (adhésion, hésitation, critique), l’enjeu de cette analyse tient au dégagement d’une normativité intrinsèque à la description de l’accélération. Heine par exemple, commentant l’ouverture d’une ligne de chemin de fer entre Paris et Rouen ou Orléans, salue le progrès technologie indéniable, le bouleversement « dans nos manières de voir et de penser », le sentiment de « voir les montagnes et les forêts de tous les pays marcher sur Paris ». Mais, ce vertige s’accompagne, sous sa plume, d’une vive inquiétude : subitement, « les idées élémentaires du temps et de l’espace sont devenues chancelantes »[7]. Qu’adviendra-t-il de cette métamorphose ? Des joies à découvrir, certes, pourtant teintées de nouvelles souffrances. On retrouve cette même binarité chez Henry Adams dont la « loi d’accélération » postule que ce phénomène acquiert un « effet exponentiel »[8] à partir du XIXe siècle, entraînant toujours plus de catastrophes techniques (accidents de voiture, carnages ferroviaires, armes à feu) – tout en donnant crédit à l’hypothèse selon laquelle l’Humanité, telle la comète qui frôla le soleil en 1843, parviendrait à éviter de justesse les périls qu’elle appelle.
Mais comment synthétiser toutes ces conceptions éparses ? Le regard d’un Nietzsche, axé sur la question de l’otium disparu, ne partage presque rien avec celui d’un Henry Adams, préoccupé par celle de la catastrophe. C’est dans cette optique que Christophe Bouton évoque la notion de « dictature du présent » : « l’accélération de l’histoire entraîne la perte du passé et la dissolution de l’avenir, donc une autonomisation du présent, qui devient la catégorie historique dominante de la modernité[9] », tel serait l’idée-force du topos de l’accélération. Cette optique supposerait que chaque époque soit structurée autour d’un « régime d’historicité », selon le concept proposé par François Hartog dans son livre éponyme[10]. Les expériences du temps dans une société donnée seraient susceptibles de se configurer, de s’orienter, de s’établir en fonction de certains paramètres. Et, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la Guerre froide, la vie occidentale serait régie par le présentéisme. Dans son commentaire des thèses d’Hartog, Christophe Bouton en discute les fondements : il reprend notamment l’objection de Lorenz, signalant que le présentéisme contemporain ne serait pas la marque d’une absoluité du présent ou d’une disparition du passé, mais au contraire d’un passé obsédant, spectral, d’un passé qui échoue à passer – et, réciproquement, d’un futur inquiétant, gorgé d’inconnu, empreint d’un risque incomparable aux menaces historiques, celui d’une destruction des écosystèmes. Ces deux remarques permettent à Christophe Bouton de faire un pas de côté : quittant les principales critiques à Hartog (le modèle du présentéisme, cohérent sur le principe, aurait besoin d’être vérifié empiriquement), il conteste son caractère totalisant. « Pourquoi ne pas considérer que la modernité donne lieu à plusieurs expériences du temps, à plusieurs régimes d’historicité qui sont parfois en tension les uns avec les autres ?[11] » Et si chaque époque, et si chaque société, loin d’être régies par une structuration unique, était fondamentalement polychronique ? Et si elles présentaient diverses expériences du temps, plusieurs dynamismes politico-historique, plusieurs extases possibles ?
« Si l’on résiste, écrit Christophe Bouton à la tentation de résumer le spectre de ses significations en un seul concept global, de réduire sa polychronie à un seul régime dominant, censé en livrer la clé, on découvre ainsi une modernité plurielle, potentiellement agonistique, structurée selon une multiplicité de régimes de temporalité et d’historicité en harmonie ou en tension les uns avec les autres[12]. » Fort de cette intuition, il identifie trois régimes d’historicité qui, travaillant notre époque, concurrencent le présentéisme. Au chapitre IV, il montre que, loin d’avoir été « dissous » par la modernité, le « vieux modèle de l’historia magistra vitae » s’y est transformé[13] : un « néo-passéisme » est né, caractérisé par une redistribution des relations théorique et pratique à l’histoire (une scission, claire, entre l’histoire des chercheurs, celle des enseignants et celle du débat public[14]), ainsi que par la nécessité d’un « souci de l’histoire » qui est à l’œuvre sitôt que celle-ci est invoquée pour les « leçons » qu’elle nous livre, notamment donc à travers le devoir de mémoire. A rebours des thèses sur la « fin des utopies » après la chute du Mur et prenant le parti de Marcuse qui définissait pour sa part l’utopie, non comme la vision d’une société abstraite, mais comme l’opposition, concrète et relative, à l’ordre des choses actuel, le chapitre V s’attache à montrer que l’utopie a connu une double métamorphose. Revisitant les trois arguments classiques de la critique des utopies (celles-ci seraient illusoires, puériles, néfastes), Christophe Bouton soutient que les formes contemporaines de l’utopie naissent d’une inversion : contrairement à Marx ou Engels qui, depuis la perspective d’un socialisme scientifique, reprochaient aux socialismes utopiques de manquer à l’impératif de révolution, les utopies actuelles reposeraient sur une aspiration réformiste. Acceptant la clause de non-violence, et donc « l’engagement démocratique », s’appropriant la nécessité de ne pas suspendre la délibération au nom du télos à atteindre, mais de la maintenir présente et vivace à chaque étape des luttes, celles-ci seraient fondamentalement progressistes : naissant d’une perpétuelle « expérimentation », se déployant dans une incessante « consultation », elles procèderaient de façon essentiellement graduelle[15].
Mais le souci du futur, à l’époque contemporaine, résulte aussi d’une expérience nouvelle : la rupture du principe même de l’histoire humaine, à savoir son imbrication désormais réciproque avec l’histoire naturelle. « Le fait nouveau dont la découverte a donné naissance au concept d’Anthropocène, constate l’auteur, n’est pas que la nature ait une histoire, en partie imbriquée avec celle des hommes, mais que l’action des hommes affecte des processus naturels fondamentaux comme le climat, qui étaient considérés auparavant comme pouvant déterminer l’histoire humaine, sans être pour autant déterminés par celle-ci. L’action non réciproque est devenue réciproque. » Proposant une généalogie du concept d’anthropocène[16], étudiant ses faiblesses[17], Christophe Bouton y perçoit, comme d’autres, une « leçon de modestie », invitant, sinon à une renaturalisation de l’homme, du moins à un changement de perspective : la condition de possibilité des processus historiques est l’existence d’une nature, d’une planète, d’écosystèmes permettant, autorisant la vie humaine. Mais le coup de force de son analyse consiste à montrer que l’Anthropocène, loin d’être réductible à un seul affect directeur (le vertige d’un futur potentiellement apocalyptique), se situe au contraire au cœur même de la polychronie contemporaine. Une perspective purement technique pourrait y voir un simple « défi » de plus, même une « nouvelle aventure »[18]. Après avoir vaincu quantité de péris d’ordres naturel ou biologique, le génie humain devra combattre, par l’innovation et la créativité, les périls que ces dernières ont fait advenir. Tel est, en un sens, la maxime de la géo-ingénierie, de l’éco-modernisme, de l’accélérationnisme. Mais une autre tendance de fond serait la collapsologie qui, arguant que l’effondrement du climat n’est pas seulement imminent mais qu’il est constitutif de notre époque, ressuscite certains motifs eschatologiques[19]. « Parce qu’elle est en cours de formation, affirme-t-il dans la conclusion de son ouvrage, l’expérience historique propre à l’Anthropocène est toutefois loin d’être homogène, elle est tiraillée entre des directions opposées qu’on peut classer en fonction des trois sens de l’accélération de l’histoire.[20] »
C’est au nom des alternatives qu’il suscite, et de son positionnement envers la théorie de François Hartog, que Christophe Bouton soutient que l’Anthropocène représente un nouveau régime d’historicité : « je voudrais développer l’hypothèse que l’Anthropocène est bien le nom d’un nouveau régime d’historicité. En d’autres termes, la ‘‘Grande Accélération’’ n’a pas fait que raviver d’anciens régimes d’historicité, elle en a forgé un de toutes pièces. L’intérêt de cette approche est d’inscrire l’Anthropocène dans un temps pluriel et stratifié, plus riche que le temps homogène et linéaire présupposé dans les chronologies établies par les sciences de la Terre.[21] » L’ancrage de ce régime dans « un temps pluriel et stratifié » est précisément ce qui le distingue du passéisme, du présentéisme ou du futurisme : l’Anthropocène n’obéit pas à une direction totalisante. Il convoque tout à la fois la conscience d’un présent éprouvé comme urgent, la « responsabilité pour le futur à court et à long terme[22] », une refonte de la spatialité et une nouvelle approche de l’imbrication entre nature et sociétés à travers le passé.
Que reste-t-il, au terme de cette déconstruction, du topos voyant la modernité comme le théâtre d’une accélération de l’histoire ? On notera d’abord que cette conception correspond à certains phénomènes objectifs incontestables, empiriquement vérifiables, mais qu’ils touchent à des champs trop hétérogènes pour pouvoir en proposer un récit simplificateur. Si bien qu’une invocation naïve de ce motif oublierait que celui-ci se situe au carrefour de plusieurs philosophies de l’histoire radicalement plurielles, souvent incompatibles, qui peinent du moins à se recouper. Ce discours, quand il est « monolithique », a également tendance à masquer sa normativité latente : il engage seulement, outre une vision du monde, un système de valeurs. Mais ce que souligne surtout Christophe Bouton, c’est son refus d’apposer à l’histoire un modèle globalisant, quel qu’en soit le contenu. L’originalité profonde de son ouvrage émane sans doute de cette théorie d’une histoire fondamentalement plurielle, soumise à des régimes distincts, offerte à un bouquet de finalités et de moyens divers, toujours tiraillée dans ses rapports au temps. Derrière ses strates, nul « développement » inexorable. Nulle dialectique univoque. Mais des appels multiples. Mais des dynamiques nombreuses, des chemins opposés. Ce qui distingue l’histoire de la locomotive, c’est que ses moteurs, différents les uns des autres, peut-être même en lutte, la poussent dans toutes les directions. Vers tous les horizons.
***
[1] Christophe Bouton, L’Accélération de l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, « L’ordre philosophique », mai 2022, p. 16.
[2] A propos de Marc Augé, l’auteur écrit : « Pour l’anthropologue, l’accélération de l’histoire signifie à la fois la surabondance des événements et des informations qui défilent sous nos yeux à un rythme toujours plus élevé, et leur transformation rapide en un passé révolu, deux faces d’une même tendance qui marquerait notre entrée dans la ‘‘surmodernité’’. » (Christophe Bouton, Op. cit., p. 6)
[3] « Bien entendu, une telle expression n’a en toute rigueur aucun sens, car l’accélération, qui est à l’origine un concept central de la physique newtonienne, est mesurée par le temps, elle désigne l’augmentation de la vitesse en fonction du temps. Le temps lui-même ne peut donc pas s’accélérer, car il faudrait un autre temps pour mesurer une telle accélération, ce qui entraînerait une régression à l’infini. » Christophe Bouton, Op. cit., p. 12
[4] Christophe Bouton, Op. cit., p. 17
[5] Christophe Bouton, Op. cit., p. 15
[6] Koselleck, « Raccourcissement du temps et accélération de l’histoire », p. 28 ; Christophe Bouton, Op. cit., p. 40.
[7] Henri Heine, Lutèce : lettres sur la vie artistique, politique et sociale de la France, Paris, Michel Lévy frères, 1855, p. 327.
[8] Christophe Bouton, Op. cit., p. 59
[9] Christophe Bouton, Op. cit., p. 93
[10] François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
[11] Christophe Bouton, Op. cit., p. 214
[12] Christophe Bouton, Op. cit., p. 125
[13] Christophe Bouton, Op. cit., p. 131
[14] « À partir de l’institutionnalisation de l’histoire comme discipline scientifique au XIXe siècle, on constate une distinction de plus en plus nette entre les ouvrages de recherche (thèses, livres, articles spécialisés), les manuels d’enseignement (secondaire et universitaire) et les interventions des historiens dans l’espace public. Les recherches historiques n’ont pas, pour la plupart, une visée pratique, elles instruisent une question posée dans le présent, qui n’est pas forcément une question sur le présent. » (Christophe Bouton, Op. cit., page 162.)
[15] Christophe Bouton, Op. cit., p. 206
[16] Christophe Bouton, Op. cit., pp. 215-219
[17] Christophe Bouton, Op. cit., pp. 219-224
[18] Christophe Bouton, Op. cit., p. 260
[19] Christophe Bouton dit qu’elle a « provoqué une renaissance du discours apocalyptique » (Christophe Bouton, Op. cit., p. 281)
[20] Christophe Bouton, Op. cit., p. 300
[21] Christophe Bouton, Op. cit., p. 282
[22] Ibid.








