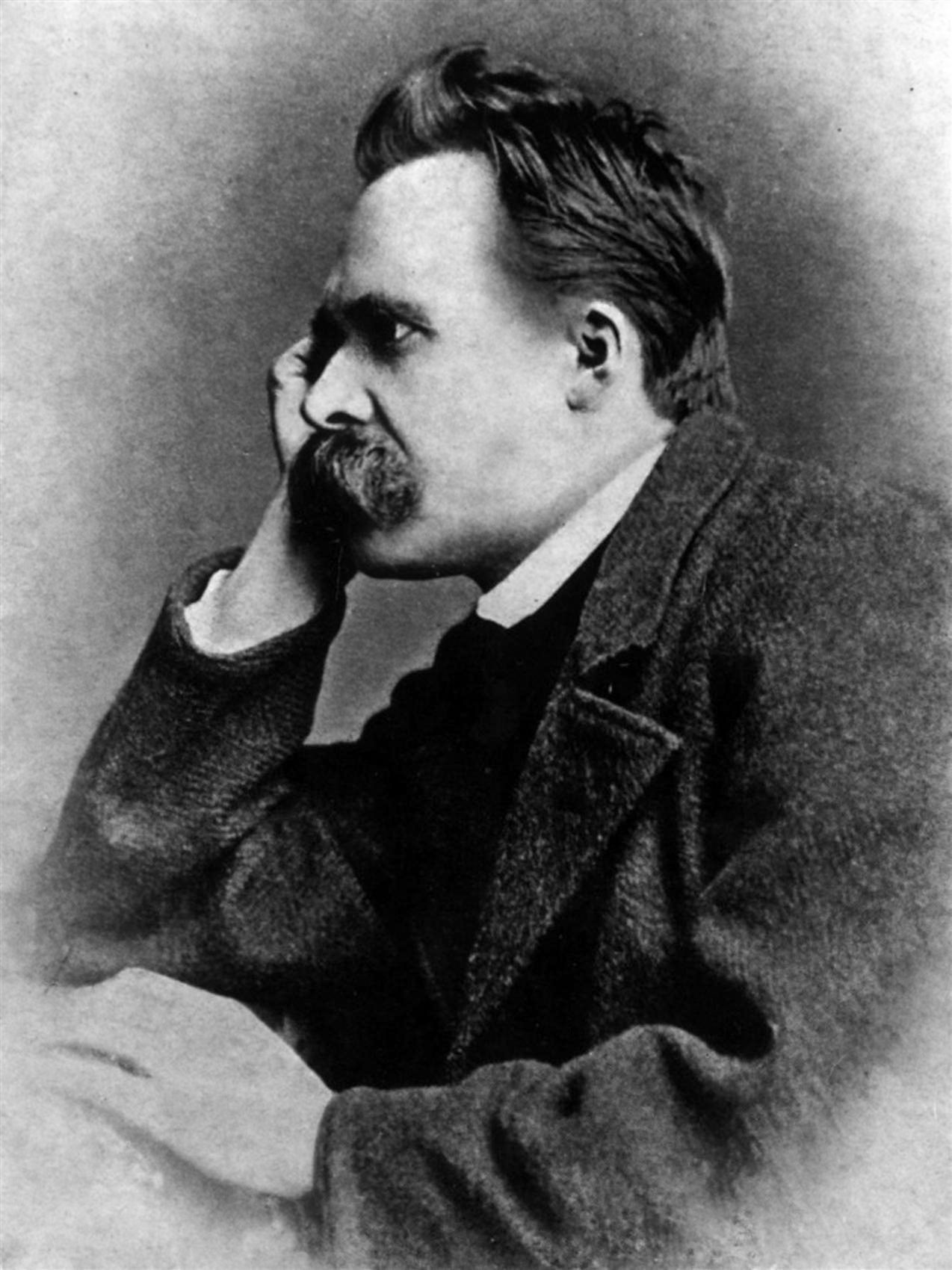Dans un ouvrage bref et percutant paru récemment aux PUF (collection « Philosophies »), Christophe Bouriau clarifie le rapport de Nietzsche à la Renaissance, en rappelant à la fois les critiques et les louanges que le philosophe adresse à cette période. Nietzsche et la Renaissance1 s’achève par « un examen critique » de ces interprétations nietzschéennes, ce qui permet au lecteur de mieux en évaluer la pertinence et les limites. Au terme de ce parcours, ce n’est pas seulement la pensée de Nietzsche qui gagne encore en profondeur : notre époque elle-même s’en trouve éclairée sous un jour tout à fait nouveau.
L’auteur rappelle d’emblée qu’en tentant de promouvoir un certain type de culture, appuyée sur des « valeurs nobles », et un certain type d’homme, le « Surhumain », Nietzsche s’oppose à la culture qui lui est contemporaine, parce qu’il la juge nihiliste et vouée à aboutir à la dégénérescence de l’humanité. Mais en voulant renverser les valeurs, « Nietzsche entend mener à son terme le geste subversif de la Renaissance, interrompu selon lui par la Réforme protestante et ses conséquences désastreuses » (p. 8). Le lecteur peut se réjouir de voir que Christophe Bouriau tient compte ici des acquis fondamentaux livrés par le commentarisme le plus rigoureux. Preuve en est que l’auteur fait droit aux analyses incontournables de Patrick Wotling, dont le nom apparaît à juste titre dès la première page de l’ouvrage. Si l’on ne comprend pas ce qu’est la Renaissance pour Nietzsche, impossible de comprendre également la culture qu’il tente de faire émerger. Mais la Renaissance est-elle pour lui une période historique, ou bien plutôt un concept qu’il révise à sa façon ? Quel rôle pourrait jouer un tel concept dans son projet d’inversion des valeurs ? Enfin l’interprétation nietzschéenne de la Renaissance est-elle pertinente d’un point de vue historique ? Dans le cas contraire, est-ce le signe d’une défaillance de Nietzsche ? Christophe Bouriau répond à ces interrogations en suivant l’évolution de la pensée nietzschéenne à ce sujet.
La période wagnérienne : Nietzsche critique de la Renaissance
La première étape de l’enquête de Christophe Bouriau est consacrée aux reproches que Nietzsche adresse à la Renaissance. Celui-ci commence en effet, durant sa période wagnérienne (1869-1876), par juger que la Renaissance a échoué, alors que Richard Wagner annoncerait l’authentique re-naissance de la culture antique. Nietzsche considère que les Renaissants fournissent une interprétation idyllique de l’Antiquité et que, dans cette perspective, l’opéra constitue un retour raté au modèle grec. En ce sens, la Renaissance ne produit pas de musique spécifique. A cette époque, la culture antique est réappropriée sous forme d’érudition, ce qui ne peut donner lieu qu’à une culture purement intellectuelle. La Renaissance valorise la connaissance pour elle-même, ce dont témoigne encore l’enseignement secondaire et universitaire contemporain de Nietzsche 2 : nous sommes ici en présence d’une fausse culture classique, qui privilégie l’érudition sur la vie plurielle. Au contraire, Nietzsche recommande d’incorporer ou de se réapproprier les références antiques, de déployer un mode de vie au service des instincts et des affects. Comme les Renaissants et modernes se sont généralement attachés aux idées de la Grèce tardive, décadente, romanisée et christianisée (la Grèce de Socrate et Platon), ils ne comprennent pas la Grèce primitive (celle d’Homère, de Pindare et d’Eschyle), ni la Grèce classique (celle de Phidias et de Périclès). Loin la cette culture rationaliste et optimiste qui est dérivée du socratisme, Nietzsche nous rappelle à la véritable culture antique qui doit renaître. A la croyance au progrès, à la science et au bonheur pour tous, il oppose la création artistique, la fête et la sensualité, c’est-à-dire l’affirmation de la vie, telles qu’elle s’exprime à travers les rites sexuels dionysiaques, les tragédies et les arts plastiques
Nietzsche reproche encore aux Renaissants de perpétuer certains aspects du Moyen Age. La distinction entre cultivé et inculte, en particulier, semble émerger du clivage entre clercs et laïcs3. Contrairement à Leon Battista Alberti ou Ermolao Barbaro, Nietzsche considère que l’homme ne peut pas surmonter sa férocité animale, mais qu’il doit plutôt tâcher de la discipliner et d’en user à bon escient. De plus il ne situe pas la dignité de l’homme dans l’effet produit par la seule formation littéraire, mais bien dans le développement de toutes les puissances de l’individu :
« Nietzsche donne aux humanistes renaissants une leçon d’humanisme »
Plus que les Renaissants eux-mêmes, c’est Wagner qui a fait renaître l’esprit de l’Antiquité grecque présocratique,4 dans la mesure où il réalise l’équilibre de l’apollinien et du dionysiaque, l’harmonisation des tendances passionnelle et rationnelle, chaotique et ordonnatrice, obscure et lumineuse. C’est cette paradoxale coïncidentia oppositorum que Nietzsche a reconnu à l’œuvre dans la pensée tragique5. Contrairement au christianisme qui sépare et oppose vertu et sensualité, spiritualité et passion, âme et corps, Wagner les unit et retrouve ce faisant l’esprit des présocratiques. De plus il s’approprie un événement historique « pour en faire le miroir de tout un peuple » (p. 27), comme l’ont fait auparavant Homère et les tragiques Grecs. Nietzsche admire généralement la façon dont Wagner réunit ce qui était séparé, en particulier lorsqu’il harmonise les aspects de la culture qui semblent d’abord isolés et indépendants les uns des autres. En mariant les arts, Wagner ressuscite le dithyrambe, union du chant poétique, d’un instrument et d’une danse expressive. Indiquons incidemment que Nietzsche apparaît encore une fois ici comme l’un des plus fervents défenseurs de cette unité sans confusion que nous choisissons pour notre part d’appeler « non-dualité » et qui s’est progressivement affirmée dans son éminence, tout au long de l’histoire de la philosophie, à la fois au plan logique (notamment chez les négateurs du principe de non-contradiction), au plan ontologique (par exemple chez Schopenhauer), ou encore au plan phénoménologique (chez Sartre), et enfin au plan spirituel, depuis Plotin et les Pères de l’Église jusqu’à Bertrand Russell et André Comte-Sponville, en passant par Maître Eckhart ou encore Bergson. A leur suite, Nietzsche fait dire à Zarathoustra : « Minuit, c’est aussi Midi. La douleur est joie aussi, la malédiction est bénédiction, la nuit est un soleil aussi. Allez-vous en, ou apprenez qu’un sage, c’est aussi un fou. » Libre au lecteur de déterminer si la non-dualité est bel et bien le seul schème de pensée fondamental capable d’offrir une alternative sérieuse à la métaphysique traditionnelle et contemporaine, considérée comme une onto-théologie étroitement associée la représentation de l’homme comme sujet.
Nietzsche a bien vu que la tragédie grecque arrache le spectateur « à sa vision individuelle et séparatrice des choses, résume Christophe Bouriau, pour le réconcilier avec la vie humaine en général, en l’unissant aux autres hommes auteur d’événements marquants de leur histoire commune » (p. 35). Les tragédies musicales de Wagner confèrent elles aussi cette joie « impersonnelle et générale » qui naît lorsque nous saisissons ce que Nietzsche nomme la « cohésion de tout ce qui est humain ». En insistant sur le facteur « qui unifie un groupe au-delà de ses clivages partisans ou sociaux » (p. 36), Christophe Bouriau touche ici du doigt un fait insigne, dont la compréhension a le pouvoir de changer le cœur humain, à savoir que l’individu est l’humanité elle-même ou, comme le répète à l’envi Krishnamurti, « vous êtes l’humanité, car vous êtes le monde et le monde est vous ». 6 Nietzsche recommande certes les hiérarchies et les distinctions : il rejette le besoin d’égalité et s’oppose à la morale de l’altruisme et de la pitié. Mais pour être le penseur du « pathos de la distance », il n’en est pas moins désireux de voir apparaître une individualité supranationale, une forme d’unité supérieure qui éterniserait profondément son type. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la « purification de la race » européenne évoquée dans Aurore ne signifie rien d’autre que la synthèse des métissages et la spécialisation des caractères nationaux au service de cette unité spirituelle supérieure. Remarquons en passant que la lecture d’Héraclite a pu influencer Nietzsche dans sa conception de la « cohésion de tout ce qui est humain ». L’Éphésien déclarait en effet que « pour les gens éveillés, il n’existe qu’un monde, qui est commun » et lorsqu’il demandait d’accorder que « toutes choses sont une », il précisait : « En écoutant non pas moi mais la raison ». Cela ne signifie pas seulement qu’une connaissance de toutes choses est disponible (accessible à tous) et universelle (une et la même pour tous les hommes). Héraclite suggère surtout que la réflexion ou la raison n’est la propriété exclusive de personne ; que l’impression de vivre dans un monde propre est illusoire ; enfin que la connaissance vraie de la réalité est impersonnelle ou anonyme. 7 Parfois, Nietzsche s’élève lui aussi au-delà de l’unité humaine jusqu’à la l’affirmation de « l’unité métaphysique de toutes choses » 8.
La positivité de la Renaissance : valeurs nobles et construction du surhomme.
La seconde partie de l’ouvrage analyse la façon dont la rupture avec Wagner conduit Nietzsche à réviser son jugement sur la Renaissance et à l’évaluer à nouveau frais. Le philosophe cherche désormais dans cette période une morale capable de donner naissance à un nouveau type de culture. Dans ce but, il s’inspire également d’éminents personnages historiques, tels que Machiavel, Borgia ou Raphaël. Le concept même de Surhumain s’inspire d’idéaux de la Renaissance. Le surhomme incarne, écrit Bouriau, « l’émergence de valeurs aristocratiques, nobles, viriles, anti-chrétiennes, dont la réactivation permettrait d’offrir une alternative au « nihilisme » contemporain […] Nietzsche voit dans la Renaissance une civilisation plus haute que la nôtre, animée d’une force supérieure et centrée sur des valeurs supérieures » (p. 45).
Le philosophe allemand se réapproprie le projet humaniste de promotion de l’homme complet et, sur cette base, il élabore son propre concept de surhomme. Après avoir explicité ces deux étapes de la démarche nietzschéenne, Christophe Bouriau présente la façon dont Nietzsche précise son concept de surhomme en se référant à certaines grandes figures de la Renaissance. Gilbert Merlio écrivait en 2009 : « Il y a sans doute chez Nietzsche la recherche d’un humanisme supérieur, à la fois héroïque et esthétique »9. Bouriau abonde dans le même sens, lorsqu’il souligne que « Nietzsche peut être dit « humaniste » en référence à la théorie humaniste de « l’homme complet », selon laquelle l’homme acquiert sa dignité en développant, grâce à un enseignement approprié, l’ensemble de ses dispositions » (p. 46). Proche de Rabelais, Nietzsche vante le rapport direct aux choses dans la connaissance de la nature. Pour lui la Renaissance a le mérite de revaloriser le corps dans la formation des êtres humains et le domaine de l’art, en opposition aux tendances chrétiennes. De là une esthétisation charnelle du christianisme, patente dans les productions de Michel Ange et de Raphaël. Comme de nombreux humanistes (Erasme, Rabelais, Alberti), Nietzsche estime que l’homme doit s’humaniser par la discipline des instincts et la culture. Il s’agit non pas d’étouffer, ni de surmonter, mais de canaliser l’animalité, comme a su le faire César Borgia, dont la sauvagerie naissait d’un débordement d’énergie qui était signe de santé. Il n’en va autrement de Machiavel, qui oppose la bravoure (virtù) du bon soldat aux vertus chrétiennes, responsables de l’efféminisation des mœurs, même dans l’armée. 10
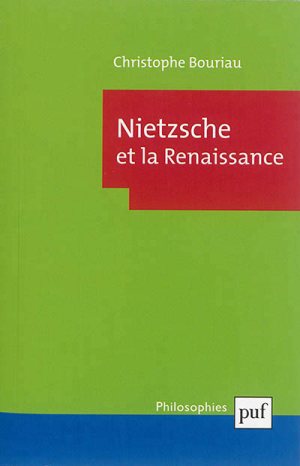
La suite de l’ouvrage établit le bilan des traits du Surhumain que Nietzsche a puisés dans les valeurs et les idéaux de la Renaissance : la grande santé, la virtù, la métamorphose et l’indépendance d’esprit. La pensée de l’Eternel Retour apparaît alors comme « une technique de métamorphose » par lequel l’individu intensifie volontairement son existence, accomplissant ce faisant la volonté de puissance. L’analyse de l’indépendance d’esprit ou affranchissement de la pensée (« die Befreiung des Gedanken ») confirme que Nietzsche, loin de faire l’apologie inconditionnelle de l’illusion et de l’audace interprétative, prône le réalisme et la « froide lucidité face au cours des événements » (p. 89). Il admire Machiavel précisément parce qu’à la suite de Thucydide il raisonne à partir de la réalité donnée plutôt qu’à partir de l’idéal. Mais confrontés à cette lucidité pénétrante dont parle Nietzsche, ne sommes-nous pas en présence d’un authentique exercice spirituel, présent non seulement à la Renaissance et dans l’Antiquité grecque, mais également en Orient, comme dans toute tradition spirituelle authentique ? Même s’il n’explicite pas particulièrement ce point, Christophe Bouriau ne semble pas l’ignorer, puisqu’il souligne que le réalisme ou la lucidité est pour Nietzsche le trait fondamental de toute culture supérieure. C’est aussi pourquoi il considérait le réalisme comme une caractéristique majeure de la doctrine bouddhique aussi bien que comme l’attribut des anciens hellènes 11. Là encore, Héraclite a pu faire partie des inspirateurs de Nietzsche, dans la mesure où l’Éphésien, très critique envers l’inattention, nous incitait à la plus extrême vigilance : « Alors que [le lógos] est là, écrivait l’Obscur, ils se dressent pour devenir les gardiens des vivants éveillés ». Le réalisme de Nietzsche confine à un Éveil spirituel semblable, qui déborde manifestement le cadre de la seule Renaissance. 12 Tout se passe donc comme si chacun des traits du surhomme précédemment énumérés (grande santé, virtù, métamorphose et indépendance d’esprit) pouvait être considéré comme une technique originale de transformation de notre nature, sous la forme d’un exercice spirituel que Nietzsche tente à chaque fois d’inscrire dans une tradition qu’il recreuse et approfondi considérablement
« La Renaissance illustre selon Nietzsche le retour d’une morale aristocratique, d’une évaluation aristocratique des choses » (p. 88-89).
Homme devenu indépendant d’esprit, lucide et courageux, le surhomme n’est pas un idéal imaginaire consolateur, mais un modèle qui nous incite à « nous réconcilier avec la réalité donnée », au lieu de la fuir dans l’idéal. Pour le comprendre, Christophe Bouriau rappelle sur quelles figures déterminées de la Renaissance Nietzsche s’appuie pour préciser son concept de surhomme. Dans cette perspective, les termes « renaissance » et « surhumain » apparaissent presque synonymes l’un de l’autre. Mais le philosophe envisage la Renaissance davantage comme une axiologie, « un type exemplaire de rapport à la vie » consciente, plutôt que comme une période historique à proprement parler. De ce point de vue, César Borgia se présente comme un exemple inaccompli de surhumanité, contrairement à Napoléon ou Goethe, mieux aboutis. L’important est que « Nietzsche utilise l’adjectif « renaissant » pour qualifier, au-delà de toute considération historique, un certain type de rapport à la vie. Est « renaissant » celui qui incarne tout ou partie des « valeurs nobles » qui caractérisent la Renaissance, valeurs qui se combinent pour former le modèle du surhomme. […] Le surhomme est celui qui incarne l’ensemble des « valeurs nobles » de la Renaissance, sans exception » (p. 102-105).
En réactivant les valeurs nobles de la Renaissance, Nietzsche cherche à mobiliser la puissance de transformer le monde et soi-même dans le cadre d’un projet collectif ou commun, une démarche qui rassemble des hommes entre eux. C’est en ce sens que la Renaissance est naturelle : elle ambitionne de « composer entre elles des aspirations puissantes et divergentes au sein d’une même création » (p. 106). Cette entreprise suppose de métamorphoser le réel ou l’organisation politique de l’existence humaine et tout à la fois de se transformer soi-même, de discipliner nos tendances multiples, voire concurrentes, pour les unifier. C’est justement le propre de l’homme supérieur d’être capable de dominer (bändigen) ses instincts, de transfigurer ses matériaux et soi-même dans la réalisation d’une œuvre. De nouveau, Nietzsche reste cohérent avec son prédécesseur Héraclite, lequel estimait en effet que « la plus haute excellence consiste à se maîtriser ». Et là encore, la coïncidence des opposés apparaît comme un trait fondamental de l’homme complet : Goethe « unit nature et culture, sensualité et raison, passions intenses et rigueur de la forme. Il incarne la passion disciplinée, la puissance des instincts (dionysiaque) dominée par la puissance formatrice et création (apollinienne). Il incarne ainsi l’être total ou complet, épanouissant à travers la création – qui est également autocréation – l’ensemble de ses dispositions, tant sensibles qu’intellectuelles » (p. 108).
Nietzsche contre Darwin
Christophe Bouriau propose une analyse particulièrement stimulante des rapports entre Nietzsche et Darwin. Cette enquête était nécessaire dans la mesure où, selon Nietzsche, les préjugés et les valeurs modernes contrarient la volonté de puissance du surhomme et conduisent celui-ci à l’échec. Le sacrifice des exceptions, résume Christophe Bouriau, « revient « toujours » dans le cours de l’histoire » (p. 112) 13. Pour Nietzsche il n’y a pas sélection des meilleurs, contrairement à ce qu’a pensé Darwin selon lui, il y a seulement sélection des plus viables, c’est-à-dire les êtres qui « parviennent le mieux à s’adapter à un environnement » (p. 113). Au contraire, l’homme supérieur est le moins viable, le moins adapté à la civilisation chrétienne. Non parce que sa capacité d’adaptation serait défaillante, ou sa puissance de métamorphose faible, mais parce qu’« étant l’exception, il ne trouve pas l’occasion de se reproduire et d’imposer ses évaluations » (p. 114). Tel est donc l’effet pervers de l’évolution : le paradoxal affaiblissement et la fragilisation des plus puissants !
Christophe Bouriau est fidèle au texte lorsqu’il prête à Nietzsche le projet « de corriger la sélection naturelle par une sélection artificielle, volontariste, seule susceptible de renverser la tendance » (p. 115). C’est précisément ce projet que Nietzsche nomme la « grande politique ». Le philosophe considère effectivement que Darwin interprète mal la sélection naturelle et il tente bel et bien de résoudre cette difficulté par un nouvel eugénisme. Comme le rappelle Dorian Astor dans Nietzsche. La détresse du présent, la sélection naturelle entraîne selon Nietzsche un abêtissement qui est également naturel. Contre ce nivellement des exceptions novatrices et cette formation de troupeaux stables, Nietzsche recourt à une action volontaire compensatrice, un artifice censé modifier la nature. N’oublions pas cependant que la grande politique ne consiste pas seulement de recourir à l’art ou à l’artifice de l’eugénisme pour corriger la nature, contre le darwinisme. Elle implique également de s’appuyer sur la nature pour corriger la contre-nature engendrée par le christianisme.
Ces analyses entrent en résonnance avec les débats qui animent depuis plus d’un siècle les théoriciens de l’évolution concernant la place de la sélection naturelle dans le devenir de la civilisation. La civilisation nie-t-elle le processus évolutif, en s’opposant à l’évolution par sélection naturelle des plus adaptés ? Ou bien cette évolution a-t-elle toujours lieu au sein de la civilisation ? N’y a-t-il pas plutôt un rapport d’opposition contradictoire entre nature et culture, qui aboutit au dépassement de cette contradiction, comme si la civilisation réalisait dialectiquement le processus sélectif, l’homme achevant l’intention de la nature ? Il n’est pas si aisé qu’il n’y paraît de déterminer l’avis de Darwin à ce sujet : alors que Patrick Tort estime être fidèle à Darwin en déclarant que, « par la voie des instincts sociaux, la sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui s’oppose à la sélection naturelle »14, Gérald Fournier estime quant à lui que le système de contrainte sélectionniste a persisté, dans un biotope ou une niche écologique qui est devenu de plus en plus « biomimétique », tout en reconnaissant que l’homme s’est émancipé du plan biologique, au moyen de sa technique, sa morale, sa culture. Ces interrogations n’auraient sans doute pas pris l’importance qu’elles revêtent désormais si Nietzsche ne s’était pas engagé dans un dialogue critique avec le darwinisme, dont Patrick Tort semble vouloir livrer les tenants et les aboutissants. Il doit être clair, en effet, qu’il ne s’agit pas ici seulement d’une difficulté scientifique particulière, mais bien d’un problème conceptuel fondamental qui intéresse directement la philosophie.
Même si un ouvrage consacré à « Nietzsche et la Renaissance » peut difficilement s’attarder sur les rapports de Nietzsche à Darwin, il n’aurait pas été inutile d’approfondir davantage l’analyse, en s’interrogeant sur la pertinence des griefs que le philosophe formule à l’encontre du scientifique. Darwin et Nietzsche expliquent également la morale par la vie, considérant tous deux que la morale a une origine naturelle. Mais quand Darwin conçoit la vie comme sélection naturelle, Nietzsche lui oppose l’interprétation de la vie comme lutte et volonté de puissance. Ce que Nietzsche reproche à la pensée Darwin, c’est essentiellement son côté utilitaire et mécanique, ainsi que son progressisme. Pour autant, Darwin a-t-il réellement parlé d’une évolution morale ? Nietzsche estime que tout progrès suppose d’abord une dégénérescence. Selon lui, Darwin conçoit au contraire le progrès comme la survie du plus adapté. Seulement cette formule, « the survival of the fittest », n’est pas de Darwin mais de Spencer. Darwin est plutôt réticent à l’égard de l’idée de progrès dans L’origine des espèces, mais il lui fait davantage de place à la morale dans La Filiation de l’homme (The Descent of Man, 1871), lorsqu’il postule un « progrès constant par la sélection naturelle ». Il envisage alors l’accession de l’humanité tout entière à une morale humaniste, ce qui est conforme à la tradition de la philosophie morale anglaise. Nietzsche entend au contraire lutter contre la « moralisation » de l’idée d’évolution, telle qu’elle apparaît surtout chez Spencer, grand partisan de l’altruisme 15 Il reproche au darwinisme de considérer que seule la confiance en un avenir meilleur peut consoler l’homme de descendre du singe : c’est le nihilisme qui conduit ici au progressisme, cette illusion qui nie l’absurdité tragique de l’existence.
Pour Darwin, la « lutte pour l’existence » est un processus qui exerce de moins en moins d’influence sur l’évolution de l’homme civilisé. A sa place, l’éducation joue un rôle de plus en plus important (La Filiation de l’homme), du fait de la sélection naturelle des instincts sociaux. Le développement de ces instincts, associé à celui de nos capacités rationnelles, s’est accompagné d’un élargissement du sentiment de « sympathie », ce qui produit des effets opposés à la sélection, comme peuvent en avoir par exemple les soins apportés aux malades et aux infirmes. Bref : une éthique a été sélectionnée qui s’oppose à l’élimination et donc à la sélection. Autrefois ce qui procurait un avantage pour la survie était de nature biologique, mais depuis ce renversement l’avantage est social. Nietzsche ne semble pourtant pas conscient des affinités qu’il entretien avec son adversaire : il paraît ignorer que, selon Darwin, protéger les « faibles de corps ou d’esprit » produit des effets dysgéniques, c’est-à-dire diminue la qualité biologique de la progéniture. Darwin souligne que la reproduction des faibles entraîne des conséquences dégénératives, qui s’accentuent au cours du temps. Mais c’est à partir de là que le débat blesse et que la différence se transforme en opposition, puisque Nietzsche adopte pour son propre compte le raisonnement eugéniste, alors que Darwin estime au contraire que « refréner notre sympathie » porte « une atteinte dégradante à la partie la plus noble de notre nature », autrement dit à nos sentiments moraux, en particulier le sentiment du devoir, qui est le « plus noble de tous les attributs de l’homme ». Tolérer les effets dysgéniques de la protection des faibles est donc une obligation morale, qui est issue de notre instinct de sympathie. De ce point de vue, ce n’est pas seulement l’élimination des faibles qui est barbare, mais également le simple non-secours. On est loin du Nietzsche de l’Antéchrist, qui veut faire périr les faibles et les ratés par « philanthropie » ! 16
Remarquons que, dans ces réflexions, Darwin et Nietzsche envisagent tous les deux l’homme comme un animal domestique qui, du fait de cette domestication, souffre d’une dégénérescence physique et comportementale. Cette convergence est d’autant plus troublante qu’elle est confirmée par la science contemporaine, qui va même jusqu’à expliquer l’origine de ce « syndrome de domestication », en la situant dans une perturbation du développement de l’embryon, une altération du système nerveux. Comme l’avait déjà montré Konrad Lorenz, c’est la domestication qui explique le caractère immature ou inachevé de l’homme, sa « néoténie ». 17
Regard critique sur la Renaissance de Nietzsche
Nous savons désormais que Nietzsche est Renaissant, ou à tout le moins qu’il prolonge le projet de la Renaissance, considérée comme une phase de renversement des valeurs chrétiennes. Mais la « grande politique » ne contredit-elle pas la pensée renaissante, en particulier l’humanisme ? N’est-elle pas en rupture, plutôt qu’en continuité, avec la Renaissance ? Bouriau résout ces difficultés en présentant les mesures nécessaires selon Nietzsche à l’épanouissement des surhommes, après avoir exposé les causes de l’étouffement des surhommes.
Même si l’idéal du surhomme trouve sa source dans les valeurs nobles de la Renaissance, « les moyens envisagés par Nietzsche pour assurer la sélection des meilleurs sont des moyens proprement « inhumains » et en rupture totale avec l’humanisme de la Renaissance » (p. 125). C’est le cas particulièrement de l’élimination des « dégénérescents ». Nietzsche sélectionne ce qui, dans la Renaissance, peut favoriser l’apparition du surhomme, notamment la virtù, mais il estime qu’il faut renoncer à l’humanisme, pourtant caractéristique de cette période historique. Mais est-il légitime, d’un point de vue historique, de présenter la Renaissance comme un mouvement opposé aux valeurs chrétiennes ? Nietzsche estime que les valeurs nobles de la Renaissance sont incompatibles avec les valeurs chrétiennes : qu’en pensaient les premiers intéressés, à savoir Renaissants eux-mêmes ?
Machiavel oppose lui aussi la « virtù » aux vertus chrétiennes, mais Montaigne envisage leur solidarité. Pour l’ancien maire de Bordeaux, toute vertu suppose des ennemis à vaincre ou des obstacles à franchir, donc toute vertu inclut la virtù et la maîtrise de soi. La vertu authentique suppose précisément la coopération de la virtù et des vertus chrétiennes. Nietzsche s’éloigne encore de la réalité historique lorsqu’il sépare christianisme et culture supérieure, celle-ci exigeant le rejet de celle-là. N’est-il pas possible, au contraire, de transformer le christianisme au moyen des valeurs nobles ? N’est-ce pas précisément ce que le protestantisme a rendu possible ? Certes Nietzsche considère que « la Réforme a tué l’esprit de la Renaissance » (p. 139), mais Christophe Bouriau s’interroge sur la légitimité historique de cette présentation du protestantisme. Il estime que les valeurs que Nietzsche promeut ne sont pas profondément opposées à celles qui guident la réforme luthérienne ! L’auteur pense en effet trouver un analogue de « l’indépendance d’esprit », telle que Nietzsche la conçoit, dans la pensée même de Luther et il souligne combien l’engagement et la créativité sont chers à ce dernier. Luther semble avoir « profondément modifié notre représentation de l’activité professionnelle » (p. 140), peu valorisée dans le christianisme. Mais ces références à Montaigne et Luther suffisent-elles vraiment à établir, comme le pense Christophe Bouriau, que « les « valeurs nobles » sont compatibles avec les « valeurs chrétiennes » » (p. 141) ?
Renaissance et Réforme : rupture ou continuité ?
Le lecteur attentif s’étonnera de voir Christophe Bouriau associer hâtivement le courage valorisé par Luther à la virtù nietzschéenne, au prétexte que Luther conçoit la vocation (Beruf) comme « une tâche voulue par Dieu, dans l’accomplissement de laquelle l’individu peut donner le meilleur de lui-même et s’épanouir » (p. 141). L’auteur voit également dans la vocation luthérienne un analogue de la créativité, la « puissance d’adaptation et création » que Nietzsche considère comme une valeur noble. Mais à ce compte, toute vertu ne peut-elle pas être identifiée à une valeur nietzschéenne ? De plus il n’est pas tout à fait évident que la réforme luthérienne valorise « l’homme complet ou accompli » (p. 144). Quand bien même cela serait établi, il resterait encore à démontrer que ce caractère synthétique et achevé est effectivement lié à l’esprit de la Renaissance et non pas plutôt à d’autres pensées de l’accomplissement humain, qui sont légion. Dira-t-on qu’il s’agit d’un trait commun à toute culture supérieure ? On risque alors peut-être de confondre les vertus nées de la puissance avec leurs caricatures émanées de la faiblesse. Admettons que Luther tente de faire « retour aux textes antiques et à la culture des humanités » (p. 144), doit-il pour autant être considéré comme un authentique Renaissant ? Bouriau admet qu’en réactivant les valeurs du Nouveau Testament, autrement dit les valeurs de la faiblesse, les réformés rompent bel et bien avec la Renaissance. Mais qu’en est-il de Nietzsche lui-même, demande l’auteur ? Est-il parvenu à rompre effectivement avec le christianisme ?
La suite de l’ouvrage critique l’interprétation d’Eric Blondel, qui voit en Nietzsche un chrétien qui s’ignore, au prétexte que le philosophe s’appuie sur la figure du Christ pour attaquer les chrétiens, auxquels il reproche d’avoir travesti le message de Jésus. Voilà Nietzsche transformé en « réformateur d’inspiration luthérienne » (p. 151) ! Christophe Bouriau accorde à Blondel que Nietzsche ne prend pas pour cible le Christ lui-même, plutôt les chrétiens. Il rappelle cependant que Nietzsche voit en Luther un falsificateur de la parole évangélique. Convenons donc qu’il y a davantage de divergences entre Luther et Nietzsche que de points communs. Au terme de ces analyses, il apparaît clairement que « Nietzsche n’est pas un chrétien qui s’ignore » (p. 155). Il revient alors au lecteur de déterminer si le philosophe admet ou non un christianisme authentique, porteur de valeurs nobles. Reste que Nietzsche propose une « vision sélective de la Renaissance » (p. 156), purifiée de ce que cette période comportait de chrétien. Cette perspective vise à promouvoir de nouvelles valeurs et le surhumain :
« Nietzsche n’est donc pas « renaissant » au sens où les Renaissants eux-mêmes l’étaient, puisque certains d’entre eux restaient fortement attachés aux valeurs chrétiennes » (p. 156).
Ces analyses peuvent donner le sentiment étrange d’une opposition entre l’interprétation philosophique de Nietzsche, qui serait relativement libre, et une description historique qui serait plus fidèle à la réalité. N’oublions cependant pas que l’Histoire est toujours un récit d’événements, une narration, une vision partielle, une description limitée, bref un commentaire sans doute critique et rigoureux, mais certainement pas une science exacte, ni une reconstruction intégrale ou une résurrection du passé. Si Christophe Bouriau avait davantage explicité sa propre conception du travail de l’historien, il aurait été vraisemblablement plus facile de comprendre ce qui le conduit à affirmer que « la séparation qu’il [Nietzsche] établit entre « valeurs nobles » et « valeurs chrétiennes » ne se justifie pas d’un point de vue historique ». Certes il est des Renaissants manifestement attachés à certaines valeurs chrétiennes, mais le sont-ils en tant que tels, c’est-à-dire en tant que Renaissants ? Après tout, la Renaissance est un type de rapport à la vie, qui peut bien être rapproché d’autres rapports à la vie, précédents ou contemporains, tout en conservant une singularité relative, certes, mais tout de même constitutive. Il serait intéressant d’éclairer avec cette lumière-là les textes dans lesquels Nietzsche loue non seulement les valeurs nobles de la Renaissance, mais proprement l’effort par lequel les Renaissants les ont pensées à nouveau frais, la tentative même de les réactiver, dans un autre contexte et à une période différente de l’histoire, en dépit de toutes les difficultés que cette démarche doit nécessairement rencontrer. Mettre en valeur une continuité entre Réforme et Renaissance, n’est-ce pas en effet risquer de sombrer dans un réductionnisme oublieux des émergences singulières pointées par Nietzsche ? Inversement, voir une opposition frontale dans la conception nietzschéenne du rapport entre Réforme et Renaissance et penser cette opposition comme une contradiction entre vie religieuse et émancipation vis-à-vis de la religion – ne doit pas faire oublier la façon dont Nietzsche tente de surmonter le dualisme et de penser l’apparition du contraire à partir du contraire, jusque dans son interprétation philosophique de l’histoire. Libre donc à chacun de voir dans la position de Nietzsche du « mépris » à l’égard des éléments de continuité entre Réforme et Renaissance, ou au contraire l’expression d’un choix interprétatif cohérent et pertinent, formulé par l’un des plus profonds penseurs de l’Histoire. Il était néanmoins nécessaire de rappeler que Nietzsche livre « une interprétation philosophique » de la Renaissance, « centrée sur les conditions d’intensification de la volonté de puissance et le perfectionnement de l’humanité » et c’est ce que Christophe Bouriau parvient à établir admirablement.
L’acquis majeur de l’ouvrage réside sans doute dans ses ultimes conséquences, à savoir que Nietzsche forge sa typologie à partir d’« une reconstitution sélective des traits à ses yeux caractéristiques » de différentes périodes de notre histoire (p. 163). 18. Le travail de Christophe Bouriau pourra intéresser particulièrement tous ceux qui s’interrogent sur la valeur de l’humanisme. Ils trouveront en effet chez Nietzsche un interlocuteur privilégié et de quoi enrichir constamment leur réflexion à ce sujet. Néanmoins, malgré toutes ces clarifications, le lecteur scrupuleux trouvera des raisons de continuer à s’interroger sur la persistance, chez Nietzsche, de références constantes au passé et à sa réactivation, quand il ne s’agit pas de sa pure et simple répétition ou de son « retour éternel », notamment lorsque le philosophe renvoie aux catégories archaïques de l’« aristocratie », la « noblesse », le « gentilhomme » ou, comme ici, la « Renaissance », ce qui peut paraître singulièrement rétrograde de la part d’un penseur de l’avenir !
La Renaissance a été un échec, de l’aveu même de Nietzsche, mais selon lui une autre Renaissance est nécessaire et possible, à condition que nous renoncions à l’humanisme, ce qui revient bien, comme le souligne Bouriau, à abandonner « l’idée phare de cette période ». Entre Darwin, qui semble croire au progrès moral et Nietzsche, qui tente de réactiver le passé, peut-être reste-t-il la possibilité d’une troisième voie. Nous continuons d’évoluer biologiquement, et notre évolution culturelle s’accélère, mais psychologiquement ou moralement, aucun changement profond ne semble avoir bouleversé le cœur humain. L’esprit semble incapable de connaître une profonde mutation – à proprement parler une révolution –, sauf à se libérer du passé et à réaliser que nous ne devenons pas meilleurs avec le temps ou, pour le dire avec Krishnamurti, que « l’évolution psychologique n’existe pas… Dans le domaine psychologique, le temps est l’ennemi de l’homme » 19.
- Christophe Bouriau, Nietzsche à la Renaissance, Paris, PUF, coll. Philosophies, 2015
- Cf. Introduction aux études de philologie classique
- Cf. Enclyclopaedie der Klassischen Philologie, in F. Nietzsche, Vorlessungsaufzeichnungen, Werke, III, 2, éd. F. Bornmann et M. Carpitella, W. de Gruyter, 1993
- Cf. Friedrich Nietzsche, Richard Wagner à Bayreuth, 1876
- Cf. Naissance de la tragédie
- Cf. Jiddu KRISHNAMURTI, Krishnamurti to himself, Mercredi 16 mars 1983, cité in Dernier Journal, Ed. du Seuil, Coll. « Points Sagesses », p. 43
- Rien d’étonnant de la part d’un penseur de la non-dualité, auquel la tradition attribue par ailleurs l’idée que l’âme tire sa substance du milieu qui l’environne et qu’elle communique avec lui.
- Cf. Friedrich NIETZSCHE, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement
- Cf. Gilbert MERLIO, « Nietzsche, Darwin et le darwinisme », Revue germanique internationale, 10 | 2009
- Cf. MACHIAVEL, L’art de la guerre. La virtù est à la frontière de l’humain : elle est la capacité de dépasser les limites habituelles de l’humanité (comme la bienveillance et tempérance) par un débordement de dureté et de férocité.
- Le bouddhisme est « cent fois plus réaliste […] cent fois plus froid, plus véridique, plus objectif » que le christianisme », cf. Friedrich NIETZSCHE, Antéchrist, § 20-23
- L’âme alors devenue « solitaire et infinie… reposerait, couchée sur les prodigieux hiéroglyphes de l’existence, sur la doctrine pétrifiée du devenir, non pas semblable à la nuit, mais à la lumière ardente et rutilante, inondant l’univers ». Cf. Friedrich NIETZSCHE, Crépuscule des idoles, III, § 5.
- cf. Par-delà bien et mal, § 269
- Cf. Patrick Tort, Les tribulations critiques d’un doctorant lyonnais, Extrait d’un entretien à paraître, Réponse à Gérald Fournier (source : http://www.charlesdarwin.fr/polemiques.html)
- Cf. Werner Stegmaier, Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum Problem der Evolution, in : Nietzsche-Studien, XVI (1987), p. 276.
- Plus particulièrement, Darwin estime que l’abstention du mariage, certes capables de limiter la dégénérescence, ne peut être que volontaire ou consentie, jamais coercitive, car il y a des avantages conquis qui ne sont pas biologiques, mais moraux. A cet égard, Darwin se tient à distance de l’égoïsme spencérien, qui condamne toute forme d’assistance, et il défend au contraire l’aide au plus démunis.
- L’origine du syndrome de domestication serait une déficience des cellules de la « crête neurale », qui participent au développement de l’embryon, entraîne une glande surrénale de petite taille et de faible activité, ce qui explique par exemple la docilité des animaux domestiques. « [Les animaux qui ont été domestiqués], conclut Vincent Nouyrigat, sont devenus mignons, propres et gentils. En un mot : civilisés » (Science et vie n°1167, p. 83). Désormais, il est établi scientifiquement non seulement que les animaux domestiques sont constitutivement plus dociles que leurs homologues sauvages, mais également qu’ils souffrent – entre autres symptômes – d’une réduction de la taille de l’encéphale (- 20% chez le cheval !). Nous-mêmes avons un cerveau plus petit que celui de nos ancêtres Cro-Magnon. C’est un fait qu’anatomiquement nous ressemblons à des adolescents tardifs de Cro-Magnon !
- « Nietzsche sélectionne ainsi dans la période de la Renaissance les traits qui caractérisent à ses yeux un certain type de rapport à la vie, rapport qui selon lui s’est malheureusement éteint à l’époque moderne » (p. 158)
- Cf. Jiddu KRISHNAMURTI, Krishnamurti to himself, Jeudi 17 mars 1983, cité in Dernier Journal, Ed. du Seuil, Coll. « Points Sagesses », p. 46