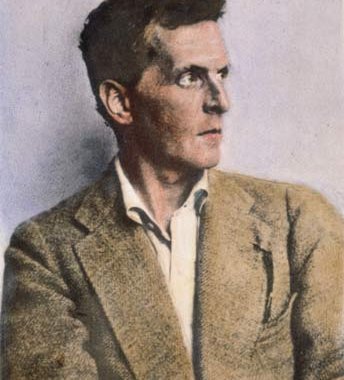Qu’est-ce que comprendre ? Est-ce interpréter ? Toute compréhension requiert-elle un langage ? Y a-t-il une compréhension hors-contexte ? Le contexte est-il le monde (ambiant) ? Est-il pourvu de sens ? Est-il normatif ? Voilà les principales questions philosophiques qui structurent la remarquable étude de Charlotte Gauvry Heidegger et Wittgenstein. Contexte, monde ambiant, arrière-plan1. Ce sont elles en effet qui servent de critère lorsqu’il s’agit de répondre à la question principale de l’ouvrage : y a-t-il une proximité philosophique entre les œuvres de Martin Heidegger et Ludwig Wittgenstein ? L’interrogation ne porte pas sur tous les aspects de leurs œuvres, ces auteurs étant connus pour s’être démultipliés (on compte usuellement deux Heidegger et deux, voire trois Wittgenstein), mais sur des aspects bien particuliers de leurs écrits, tout à fait centraux néanmoins : d’une part, la dimension herméneutique de la phénoménologie de Heidegger, de l’autre, le contextualisme dans la philosophie du langage de Wittgenstein.
Si l’ouvrage de Gauvry s’inscrit dans une tradition comparatiste, c’est pour immédiatement se distancier de toute entreprise d’assimilation : depuis les travaux de Hubert Dreyfus, certains auteurs anglo-saxons, incluant Robert Brandom, Charles Taylor et Richard Rorty, ont tenté de rapprocher les analyses faites par Heidegger dans Être et temps de celles menées par Wittgenstein dans ses Recherches philosophiques. Or, d’après Gauvry, un tel rapprochement, d’ailleurs beaucoup plus rare dans le monde francophone, repose sur une mécompréhension tant de l’herméneutique heideggérienne que du contextualisme wittgensteinien. L’objectif du livre – et sa pars destruens – est donc d’expliquer en quoi il y a maldonne. Une pars construens est également annoncée, visant à « jeter un éclairage nouveau sur le type de normativité qui est en jeu dès l’herméneutique de la facticité » et, surtout, fournir « une meilleure compréhension du contextualisme et des forces normatives qui y sont en jeu » (p. 10 et 11). La partie critique passe avant tout par l’analyse méticuleuse de la position de Dreyfus et du « commentaire inaugural » (p. 21) de l’interprétation assimilationniste, à savoir le livre Being-in-the-World. Gauvry ne s’en tient néanmoins pas à Dreyfus, puisqu’elle consacre plusieurs sections aux lectures comparatives et assimilationnistes de Taylor, Brandom, mais aussi Stanley Cavell. Par-là, elle fait découvrir à son lectorat toute une tradition anglo-saxonne à cheval entre « philosophie analytique » et « continentale » (ces labels ne sont toutefois que rarement utilisés dans le livre), les auteurs précités étant encore peu lus dans le monde francophone ; bien que les temps changent, grâce à diverses études et entreprises de traduction dues notamment à Jocelyn Benoist, Christiane Chauviré, Sandra Laugier et Jean-Philippe Narboux, qui tous exercent par ailleurs une forte influence sur le travail de Gauvry.
Qu’y a-t-il donc de contestable, d’après Gauvry, dans les interprétations assimilationnistes ? Pour Dreyfus, l’initiateur de ces interprétations, « Heidegger comme Wittgenstein accorderaient une importance décisive au contexte ordinaire dans lequel s’ancrent nos pratiques quotidiennes » (p. 32), ce que Gauvry elle-même admet (p. 9). Toutefois, Dreyfus va plus loin, en procédant à une « interprétation wittgensteinienne de l’être-au-monde en termes d’arrière-plan de pratiques partagées » (Being-in-the-World, p. 144, cité en p. 33) et, parallèlement, à une « interprétation herméneutique de la (ou des) notion(s) wittgensteinienne(s) de ‘contexte’ » (p. 33). Or, c’est précisément ce chassé-croisé que Gauvry vise à critiquer. Les deux premières parties de l’ouvrage (p. 37-245) soulignent les différences entre l’herméneutique heideggérienne et le contextualisme wittgensteinien, tandis que la dernière partie (p. 249-347) critique plus particulièrement les assimilations « normativistes » des deux auteurs. Je commencerai, dans la présente recension, par relever les principales divergences que Gauvry identifie chez Heidegger et Wittgenstein, au-delà des proximités apparentes entre leurs pensées ; je traiterai ensuite de la critique faite par Gauvry des lectures normativistes de ces auteurs. Fort de cela, je procéderai à un commentaire général du livre et indiquerai les nouvelles perspectives de recherche qui y sont ouvertes.
1. Le contenu de l’ouvrage
1.1. Une série de divergences
Gauvry s’attaque tout d’abord à la thèse voulant que Heidegger et Wittgenstein partagent un même concept d’« arrière-plan », pour la compréhension duquel l’idée d’« usage » jouerait par ailleurs un rôle central. Comme l’indique Gauvry, l’équivalent d’un « arrière-plan » chez Heidegger est sans doute identifiable dans la notion de « monde ambiant » (Umwelt). La philosophie, d’après Heidegger, se doit de prendre pour objet principal la « vie ». Celle-ci, rappelle Gauvry, n’est pas tant comprise comme processus biologique que comme phénomène (socio-)historique, ou encore comme règne du « sens » (p. 49-50). Le « sens » ne renvoie toutefois pas à une dimension « théorique ». En effet, « le théorique surgit toujours lui-même d’un domaine qui le précède et le prépare : le monde ambiant pré-théorique de la vie » (p. 49). Dans ce monde pourvu de « significativité », les objets sont toujours compris « en tant que » quelque chose. Leur saisie n’est toutefois pas prédicative, mais intuitive ; elle révèle une « articulation » qu’un éventuel énoncé peut – mais ne doit pas – venir expliciter (cf. notamment p. 59-69). Ainsi, comme le souligne Gauvry, Heidegger considère que notre abord du monde, ou notre « intentionnalité », est avant tout pratique : une chaise est par exemple vue en tant que l’on peut s’y asseoir, c’est-à-dire suivant son « usage ». L’« en tant que » est dès lors déterminant dès le niveau perceptif et l’intentionnalité d’emblée rapprochée de la notion de « comportement » (p. 74-75 et 78).
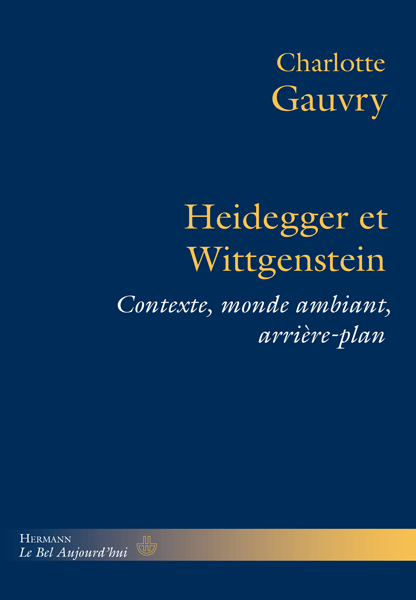
Ces considérations, Gauvry l’admet, font écho à certains aspects de la pensée de Wittgenstein, notamment son insistance sur la notion d’usage. Toutefois, Gauvry, s’appuyant sur les travaux de Jocelyn Benoist, soutient que la présence de la notion d’usage chez Heidegger et Wittgenstein révèle certes une « similitude thématique », mais que sa place dans l’économie des deux théories est très différente, de sorte qu’il n’y a pas identité de « modèles ». Chez Heidegger, tout objet mondain est rabattu sur la notion d’« outil » (Zeug). Or, chez Wittgenstein, il en va tout autrement : bien que l’usage joue un rôle important, et qu’il soit lui aussi parfois compris à partir des propriétés de l’outil, il s’agit d’une notion qui s’applique premièrement aux signes, notamment aux mots, ceux-ci héritant leur sens de leur usage (p. 174 et 177).
Surtout, c’est l’assimilation entre « monde ambiant » heideggérien et « contexte » wittgensteinien que Gauvry va critiquer. Wittgenstein comme Heidegger élargissent certes au langage en son entier une certaine forme d’« indexicalité », comprise au sens large comme « recours au contexte » (p. 195-207). Or, en procédant à une lecture détaillée des thèses de Wittgenstein sur le contexte, Gauvry différencie clairement cette notion de celle de « monde ambiant ». Le livre prend soin de distinguer différentes variantes de « contextualisme » (p. 99-105) et fournit une longue analyse de la notion wittgensteinienne de « contexte », choisissant, avec James Conant, de voir une « préfiguration » (p. 135) des thèses tardives dans les premiers écrits, faisant remonter le tout à Frege (cf. notamment p. 127-128). Il s’agit de distinguer le contexte de Wittgenstein non seulement des jeux de langage, mais aussi de sa notion de forme de vie, comprise comme « arrière-plan socioculturel commun » : « le ‘contexte’ désigne, au sein d’une forme de vie donnée, les circonstances spécifiques qui sont discriminantes pour la compréhension d’une situation d’énonciation spécifique » (p. 153 et plus généralement p. 141-157). S’inspirant de Charles Travis, Gauvry soutient que le contexte, chez Wittgenstein, ne joue pas le rôle de « complément de la sémantique », mais de « standard de correction de ses règles d’usage » (p. 147). La notion de « monde ambiant » chez Heidegger ne remplit en rien un tel rôle, notamment parce que la « saisie » de ce monde n’implique pas l’usage du langage. En somme, dit Gauvry, il y a certes un intérêt pour le contexte et l’usage chez Wittgenstein et Heidegger ; cet intérêt ne suffit toutefois pas à reconnaître une proximité profonde entre leurs entreprises philosophiques respectives. L’assimilationnisme ne saurait se contenter de ces ressemblances de surface.
La stratégie critique visant à admettre une similitude thématique entre auteurs, mais à rejeter la communauté plus profonde de pensée va être rigoureusement développée par Gauvry et appliquée à de nombreux autres aspects des œuvres de Heidegger et Wittgenstein. Ceci se manifeste par exemple dans son analyse du « voir comme » wittgensteinien comparé au « voir en tant que » de Heidegger : là où Heidegger fait primer le voir pratique sur le voir « théorique », Wittgenstein considère que l’on voit, en fonction des contextes, soit des propriétés purement sensibles des choses (forme, couleur, etc.) soit des objets sous d’autres « formats de description », comme « un homme préoccupé » (p. 220). Il n’y a ainsi pas, chez Wittgenstein, de hiérarchie entre le pratique et le théorique (p. 177-178). Par ailleurs, tandis que tout voir pour Heidegger est un « voir en tant que », le « voir comme » chez Wittgenstein n’intervient que dans des cas particuliers, soit lors de changements de circonstances : « soudain, on voit le livre comme une arme, face au danger » (p. 226).
Une autre différence majeure identifiée chez Heidegger et Wittgenstein par Gauvry est celle des rapports entre compréhension et interprétation. La saisie pratique de la significativité du monde est qualifiée par Heidegger de « compréhension » (p. 69 et 78). L’« en tant que » revient en effet toujours à attribuer de manière antéprédicative une utilité à l’objet (p. 180-181). Comme le rappelle Gauvry, il faut néanmoins distinguer chez Heidegger « la compréhension primaire du comportement et la compréhension prédicative de l’énoncé », dite « apophantique » (suivant une terminologie aristotélicienne). L’apophantique, qui est théorique, et qui requiert une « explicitation-interprétation » de la significativité, est qualifié de « privatif », en ce qu’il soustrait les choses à la pratique pour leur attribuer des « déterminations » (p. 182 et 234). Indépendamment de ce point, le « sens » discursif qu’elle qu’il soit « présuppose donc la significativité première pré-linguistique du monde ambiant » (p. 184).
Or, insiste Gauvry, les rapports entre compréhension et interprétation diffèrent du tout au tout dans la pensée wittgensteinienne. Gauvry, citant à nouveau Benoist, montre que les signes linguistiques, pour Wittgenstein, acquièrent leur signification suivant leur contexte d’énonciation, de sorte qu’ils varient d’un cas à l’autre, ne servant dès lors aucunement à « expliciter-interpréter » un réseau de sens pré-linguistique donné à même le monde ambiant (p. 184). Plus généralement, pour Wittgenstein, l’usage des signes ne requiert aucune interprétation. Il y a certes des cas où il faut interpréter, « l’expression d’un visage par exemple », mais la plupart du temps, le maniement des signes va de soi. Comme le résume Gauvry, suivant Laugier, « l’application des règles n’est pas sujette à interprétation » (p. 237 et 238).
Un point tout à fait crucial évoqué par Gauvry est le fait que la différence entre interprétation et compréhension se rejoue au niveau des projets philosophiques de Heidegger et Wittgenstein. En effet, tous deux invitent à procéder à des « descriptions ». Comme le rappelle Gauvry, cela a mené certains lecteurs à rapprocher ces deux projets. Il en va ainsi non seulement de Dreyfus, mais également de Françoise Dastur, qui affirme que les deux auteurs en question en viennent à défendre une « philosophie conçue comme activité et non pas comme doctrine » (« Langage et métaphysique chez Heidegger et chez Wittgenstein », p. 324-325). Or, là encore, Gauvry soutient que la ressemblance n’est pas si évidente. Certes, tant Heidegger que Wittgenstein s’attèlent à des descriptions. Toutefois, chez Heidegger, décrire revient à manifester ce qui se donne déjà articulé à même la significativité du monde ambiant (p. 228). Par contraste, la description, pour Wittgenstein ne consiste pas en l’explicitation d’un sens pré-donné, mais vise à présenter les divers usages des signes linguistiques afin de les « clarifier » et de « dissoudre » ainsi les problèmes philosophiques (p. 230-231).
1.2. Les lectures normativistes
Comme indiqué ci-dessus, la dernière partie de l’ouvrage se concentre sur les lectures dites « normativistes » de Heidegger et Wittgenstein, soit celles de Taylor, Brandom et Cavell. Ces interprétations ont en commun de réunir les notions de monde ambiant heideggérien et de contexte wittgensteinien sous le label unique d’« arrière-plan » compris comme entité normative. Cet arrière-plan, d’après Taylor, serait constitué d’une « échelle de valeurs » (Philosophical Papers, p. 11, cité p. 263), elle-même dépendante de « conventions » (p. 264). Pour Brandom, le « sens » d’un objet, tel qu’identifié par Heidegger au niveau pratique, ne serait rien d’autre que sa « valeur » (p. 282-283). En outre, les normes sociales seraient « implicites » ; l’application d’une règle est l’explicitation d’une norme institutionnelle (p. 290).
Gauvry clôt son étude par une critique de ces interprétations. Elle leur reproche principalement d’attribuer un caractère externe aux normes relativement aux pratiques. Ceci vaut tant pour Heidegger que Wittgenstein. Il n’est en outre « pas légitime de considérer que les normes de l’action et de la compréhension sont socialement déterminées chez Heidegger » (p. 324). Le « monde ambiant », ou « socio-culturel », cohabite chez Heidegger avec un « monde partagé » et un « monde propre ». Or, Heidegger insiste sur le primat à accorder au monde propre, ce qui, dans Être et temps, reviendra à qualifier le commerce avec le monde ambiant de comportement « inauthentique » ; le comportement authentique, lui, consiste en l’expérience de l’angoisse, qui court-circuite le réseau de significativité mondaine (p. 80-89). Le rapport à soi est décrit comme « norme du mouvement de la vie » et c’est donc dans la déprise à l’égard de l’arrière-plan que l’on se rapporte correctement à soi (p. 329). À noter par ailleurs que cette norme, d’après Gauvry, est « immanente » au comportement (p. 336).
En ce qui concerne Wittgenstein, Gauvry souligne que « le recours au contexte joue un rôle normatif qui ne procède ni par évaluation ni par interprétation » (p. 330). La « norme de correction » des pratiques n’est pas à aller chercher dans un arrière-plan, mais est, là aussi, « immanente », au sens où les règles qui fixent la correction d’une pratique ne sont déterminables que dans le contexte dans lequel la pratique s’exerce. Toutefois, soutient Gauvry, contrairement à Heidegger, la norme, chez Wittgenstein, s’appuie sur une « communauté d’usagers » et des « contraintes contextuelles réelles » (p. 336). Ce renvoi au réel, affirme Gauvry, est une insistance sur l’objectivité des contextes, ceux-ci appelant à des réactions « normales » basées sur des « raisons » (p. 347). L’ouvrage s’achève par une conclusion dont on regrettera peut-être la brièveté, mais qui a l’avantage de fournir un résumé très clair du propos.
2. Commentaire général et pistes de recherches
Il ne fait aucun doute que le livre de Gauvry sera incontournable pour toute comparaison future entre Heidegger et Wittgenstein. Ce travail tout à fait admirable se base sur une grande connaissance des interprétations d’expression tant française qu’anglaise des deux auteurs concernés, ce qui a pour intérêt de familiariser le lectorat francophone de Heidegger avec la vaste littérature anglophone dans le domaine et d’apporter une contribution majeure à la tradition francophone d’interprétation de Wittgenstein. Surtout, au-delà de son rapport à la tradition des commentaires, le livre de Gauvry parvient, par une lecture attentive des textes originaux, à éclairer les œuvres de Heidegger et de Wittgenstein d’une lumière nouvelle, distinguant des notions qu’une première approche, guidée par le lexique, tendrait à assimiler : « monde ambiant » et « contexte », « pratique » et « usage », « voir en tant que » et « voir comme », « description » et… « description ». L’opposition entre ces notions voisines permet à Gauvry de procéder à des distinctions particulièrement fines, qui resteraient autrement inaperçues. À cet égard, le livre s’avère extrêmement précieux, permettant non seulement une meilleure compréhension des rapports entre Heidegger et Wittgenstein, mais aussi de leurs théories respectives.
L’entreprise de Gauvry doit également être saluée d’un point de vue méthodologique : son étude porte une grande attention à l’exégèse, réinscrivant les énoncés des auteurs dans leurs corpus respectifs avant d’en déterminer le sens, par contraste avec les commentaires procédant (parfois hâtivement) à une évaluation philosophique de thèses isolées. À cet égard, Gauvry manifeste un certain goût pour l’interprétation « contextualiste » des énoncés philosophiques. On serait tenté de voir là une certaine influence de la tradition holistique en histoire de la philosophie, exemplifiée par les travaux de Jean-François Courtine et Alain de Libera. Un autre intérêt méthodologique majeur de l’ouvrage est la distinction entre « similitude thématique » et – disons – « modèle philosophique ». Comme indiqué ci-dessus, Gauvry pointe à plusieurs reprises l’existence, chez Heidegger et Wittgenstein, de thèmes communs, mais insiste sur le fait que ces thèmes ne jouent absolument pas le même rôle dans l’économie générale de la pensée de chacun des auteurs. Ainsi, les notions que Heidegger et Wittgenstein ont en commun s’appliquent par exemple à des domaines distincts : l’« usage » porte sur les objets du monde ambiant chez Heidegger, mais sur les signes chez Wittgenstein ; ou alors, ces notions s’appliquent au même domaine, mais ont une portée plus restreinte : tout voir est un « voir en tant que » pour Heidegger, ce qui n’est pas le cas du « voir comme » de Wittgenstein. L’enjeu est tout à fait décisif, puisqu’il consiste à interroger le sens même de l’idée de proximité philosophique. Gauvry montre ainsi qu’au-delà des diverses ressemblances thématiques, voire même de certaines « sensibilités » communes (en l’occurrence, sensibilité à l’usage, à la contextualisation, etc.), deux philosophes sont surtout assimilables lorsqu’ils partagent des modèles philosophiques. Or, à ce niveau plus profond d’analyse, la phénoménologie herméneutique de Heidegger et la philosophie contextualiste de Wittgenstein ne se ressemblent plus vraiment, vues leurs divergences sur des questions aussi centrales que la nature de la compréhension, son lien au langage, la relation de la compréhension à l’interprétation, les rapports entre théorie et pratique, le but de la description en philosophie ou encore l’interaction entre les normes, le soi, le social et le réel.
Le livre de Gauvry est donc une grande réussite, tant en termes de contenu que d’un point de vue méthodologique ; il marquera les études sur Heidegger et Wittgenstein, mais aussi, de manière générale, les entreprises comparatistes en histoire de la philosophie. L’une des grandes forces du livre, d’ailleurs, est qu’il suscite chez le lecteur divers interrogations sur l’ancrage historique plus large des deux penseurs discutés. La comparaison effectuée par Gauvry fait venir à l’esprit toute une série de pistes de recherches sur la structuration du champ philosophique au début du 20ème siècle dans le monde germanophone. Les proximités entre Heidegger et Wittgenstein s’inscrivent dans un contexte historique que l’on pourrait, géographiquement du moins, qualifier d’« austro-allemand ». Certaines préoccupations heideggériennes sont héritées de la phénoménologie de Husserl, à commencer par celle d’une description de la Lebenswelt, c’est-à-dire du monde tel qu’il se donne dans l’expérience naïve (cf. notamment les textes réunis dans le volume 48 des Husserliana). Dans quelle mesure la pensée de Heidegger ressemble-t-elle à, ou diffère-t-elle de celle de son maître sur ce thème ?, et dans quelle mesure la notion de contexte chez Wittgenstein s’y apparente-t-elle ou s’en distancie-t-elle ?, voilà des questions particulièrement intéressantes – car décisives pour la « traçabilité » (expression d’Alain de Libera) de la notion philosophique de monde ambiant – que le livre de Gauvry nous incite à poser. De Husserl, on pourrait vouloir faire un pas de retrait et s’interroger sur le rapport plus général, qu’il soit de similitude ou de différence, entre les positions de Heidegger et Wittgenstein, d’une part, et les thèmes discutés dans la tradition austro-allemande, c’est-à-dire chez les penseurs inspirés par les travaux de Bolzano et de Brentano, d’autre part ; Husserl, puisqu’il fait partie de la dite « école de Brentano » est bien sûr un membre éminent de cette tradition. À cet égard, il convient de rappeler qu’une partie importante des notions centrales de Wittgenstein sont déjà discutées au sein de l’école de Brentano. Comme l’a montré Kevin Mulligan dans son livre Wittgenstein et la tradition austro-allemande, les thèmes de la « description », du « vouloir-dire », de la « signification », des « règles », du « contexte », des « outils », de l’« usage », et de la « normativité », pour n’en citer que quelques-uns, ont tous occupé Brentano et ses élèves ou « élèves d’élèves ». Il semble donc que Wittgenstein partage un nombre important de soucis philosophiques non seulement avec Heidegger, mais aussi avec la tradition austro-allemande ; tradition, d’ailleurs, dont ni Heidegger ni Wittgenstein ne sont officiellement des membres ! D’aucuns voudraient peut-être élargir la comparaison, et passer de deux à trois (et plus) termes : Heidegger, Wittgenstein, tradition austro-allemande.
Voilà donc quelques pistes que l’ouvrage de Gauvry, en sus de ses passionnants développements déjà extrêmement détaillés, évoque dans l’esprit du lecteur. Il y en a sans doute d’autres, tant la comparaison effectuée par ce livre est essentielle pour la compréhension des proximités et différences entre certains courants centraux de l’histoire de la philosophie du 20ème siècle, à commencer par la phénoménologie et la philosophie du langage ordinaire. Quoi qu’il en soit, l’objectif premier de Gauvry était de montrer que les proximités philosophiques usuellement identifiées entre Heidegger et Wittgenstein sont superficielles. Les défenseurs du rapprochement entre les deux auteurs en question, inspiré de Dreyfus et alii, auront désormais fort à faire.