Dans le cadre de sa très didactique entreprise de présentation de l’histoire des arts dont nous avons déjà rendu compte ici pour l’art antique et là pour l’art médiéval et renaissant, Carole Talon-Hugon vient de publier le troisième volume consacré cette fois à la période classique, c’est-à-dire aux XVIIème et XVIIIème siècles1. Cette période extrêmement riche par sa reprise de certains canons antiques, mais aussi par l’institutionnalisation des arts par la création des Académies puis par l’apparition de l’esthétique proprement dite au XVIIIème siècle donne l’occasion à l’auteur de préciser certaines données – notamment sur Baumgarten – et de montrer comment l’évolution des Lumières s’inscrit dans une autonomisation du sensible initiée en fait dès Gracian et son Homme de cour où il est déjà question du goût, quoique ce dernier doive s’entendre en un sens significativement différent de celui qu’élaboreront les hommes des Lumières.
A : L’artiste et son statut
Le premier élément qui frappe à la lecture de l’ouvrage est l’insistance de l’auteur sur le statut des artistes, notamment des peintres, à partir de l’institutionnalisation des arts consécutive de la création de l’Académie en 1648 par Colbert. Cette Académie de peinture et de sculpture, qui prend pour devise libertas artibus restituta libère les artistes des corporations, et élève ces derniers du statut de broyeur de peintures et de teinturiers à celui de la dignité inhérente aux arts libéraux. On ne peut ne pas songer aux analyses d’Antoine Schnapper développées dans le métier de peintre au Grand Siècle où l’auteur étudie la transformation sociale et économique des peintres à partir de 1648, quand bien même demeurent des hiérarchies au sein même des peintres. « Si l’hétérogénéité sociale de nos peintres est grande, écrit Antoine Schnapper, peut-on distinguer parmi eux une hiérarchie ? L’une est évidente à partir de 1648, c’est l’appartenance ou non à l’Académie royale de peinture et de sculpture, même si (…) elle ne garantit pas la fortune. (…). A partir de 1650 environ, presque tous les peintres dont le patrimoine est supérieur à 50 000 livres étaient académiciens et la fortune moyenne de nos cinquante-six académiciens dépasse 63 000 livres. »2
Concrètement parlant, cela revient à substituer le cadre collectif et institutionnel à la concurrence des ateliers, et donc à donner une espèce de ligne unifiée à observer qui le sera d’autant plus qu’une certaine sécurité financière est garantie aux membres de l’Académie. « Il ne s’agit plus d’acquérir un savoir-faire par apprentissage pratique et imitation du maître d’atelier, mais de bénéficier d’une formation théorique autant que pratique où l’anatomie, la perspective et les humanités feront de ce nouveau peintre-académicien (Sébastien Bourdon, Le Brun, Le Sueur…) un créateur savant et lettré. »3 Mieux encore, cinq ans après sa création sont mises en place des conférences qui accentuent l’intellectualisation de la profession et donc sa dignité. On rapproche ainsi la peinture de la poésie avec le ut pictura poesis emprunté à l’Epître aux Pisons d’Horace : Horace invitait le poète à utiliser toute la puissance iconique du langage pour agencer les mots en vue de visualiser une scène. Au XVè siècle, la formule avait déjà changé de sens : il s’agissait de conférer à la peinture une dignité égale à celle de la poésie. « Par un biais ou un autre, l’Ut Pictura Poesis invite à faire en sorte qu’une histoire soit comme filigranée dans l’image. »4
Dans sa célèbre étude, à laquelle nous renvoyons le lecteur qui souhaiterait en savoir davantage, Rensselaer W. Lee avait ainsi rendu compte de l’importance de cette formule d’Horace, dans ses transformations renaissantes. La doctrine de l’ut pictura poesis cherchait à imposer au peintre une érudition, faisant du poète un « revendeur de marchandises intellectuelles élaborées par d’autres artisans. »5 Et l’auteur de poursuivre son analyse chez Léonard : pour ce dernier, l’invention appartient à l’art du poète, et relève aussi de l’art du peintre : la poésie instruit, certes, mais la peinture également. Le problème du poète est alors qu’il est contraint de rendre les choses en les fractionnant. Le tableau peut représenter au même moment tous les traits du visage, comme autant de voix chantant une douce harmonie. « Léonard anticipait donc de deux siècles et demi sur la célèbre distinction entre poésie et peinture. »6 Entre donc en jeu la rivalité de la peinture et de la poésie, la première présentant sur la seconde l’immense avantage de l’étendue spatiale par laquelle une pluralité de scènes peut être représentée simultanément là où la poésie est tributaire du temps pour déployer ses images.
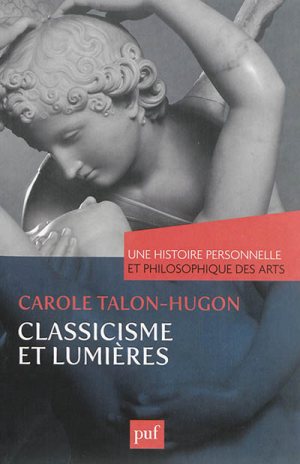
Si cette analyse du statut de l’artiste par la dignité de son art et l’institutionnalisation que rend possible la création de l’Académie en 1648 est fort claire, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure cantonnée à la sphère française, l’auteur centrant son propos sur la France de Louis XIII et Louis XIV, mais demeurant assez discrète sur d’autres pays européens, notamment l’Italie. Il faut garder à l’esprit que cette histoire est explicitement personnelle et qu’elle ne prétend donc nullement à l’exhaustivité, ce parti-pris devant être sans cesse rappelé pour ne pas se tromper de sujet. Néanmoins, nous nous permettons de mentionner le fait qu’en Italie, l’intellectualisation de la peinture a commencé dès la Renaissance – ce que rappelle au fond Lee en mentionnant la peinture de Léonard – notamment avec Michel-Ange et sa vaste méditation néoplatonicienne ou encore Léonard chez qui se mêlent aristotélisme et néoplatonisme. En outre, un sculpteur comme Bernin, mort en 1680, goûta sans le secours des institutions le plaisir d’être traité en dignitaire, voire en Seigneur, dans toutes les cours européennes qu’il fut amené à connaître. « Le Bernin, note Hibbard, est sans doute le premier artiste à avoir occupé une position tout à fait semblable et égale à celle des princes et des ministres de son époque. »7 On peut donc se demander jusqu’à quel point l’institutionnalisation des arts par l’Académie suffit à rendre compte de la dignité croissante de la condition d’artiste, et ainsi interroger la vague européenne du XVIIè siècle consistant à traiter les artistes comme des êtres socialement respectables et dignes de figurer aux côtés des plus grands princes européens. Que faire également du cas de Poussin, traité avec tous les égards, malgré son exil romain extra-académique ?
B : Dialectique de l’intellectualisation et de l’émotion
A côté de l’intellectualisation du travail de l’artiste et de ce qui en découle socialement, demeure pourtant une dimension infra-intellectuelle, celle du plaisir et de l’effet sur les passions que doit susciter l’œuvre. L’auteur articule fort bien dans son livre cette dialectique de l’intellectualisation et de l’émotion, émotion du reste tirée de l’Orateur de Cicéron, lequel proposait que l’objectif de l’orateur fût de movere, docere, placere, émouvoir, instruire et plaire. Si la Renaissance avait explicitement repris cet objectif, l’époque moderne le développe, et le sublime jusqu’à la célèbre formule de Diderot dans les Essais sur la peinture : « touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m’indigner d’abord. » (cité p. 21)
Plus généralement, Carole Talon-Hugon consacre de belles pages à la question du plaisir et de l’émotion, en mentionnant le Compendium de Descartes[Nous nous permettons de renvoyer à notre propre ouvrage sur la question : cf. Thibaut Gress, Descartes. Admiration et sensibilité, Paris, PUF, 2013 ainsi qu’à la recension qui en a été faite à [cette adresse [/efn_note], mais aussi le Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique (1660) de Corneille où ce dernier expose clairement le mécanisme de l’instruction morale à partir des passions : une sorte d’édification se trouve menée à partir des réactions émotionnelles et affectives. On trouve cette ambition aussi chez Molière, qui affirme dans le premier placet au roi de Tartuffe que la comédie corrige les hommes en les divertissant. « L’Ut pictura poesis affirmant que tout ce qui vaut pour la poésie vaut pour la peinture, l’exigence d’éducation vaut aussi bien pour l’une que pour l’autre. »8 Et l’auteur d’exemplifier tout cela par spectacle de Médée tuant ses enfants et nous conduisant à prendre en horreur la passion de la vengeance.
Il demeure une difficulté, celle de la fameuse querelle entre les coloristes et les dessinateurs ; la couleur est souvent associée à la partie sensualiste de la peinture, tandis que le dessin, par sa capacité à découper et organiser, est assimilé à la partie intellectualiste, par laquelle la peinture avait précisément acquis sa dignité. Cette querelle est donc riche de dangers pour el statut des peintres car c’est leur capacité à intellectualiser – et non à émouvoir – qui avait contribué à leur conférer ce nouveau statut ; si le dessin est menacé par la couleur, alors cela même qui avait contribué à dessiner ce nouveau statut risque d’emporter avec lui la dignité chèrement acquise des artistes. « Remettre en question comme le font les coloristes, la prééminence du dessin, revenait donc à contredire ceux qui avaient permis l’ennoblissement de la peinture. »9 Il ne faudrait néanmoins pas faire de l’intellectualisation une condition nécessaire et suffisante de la dignité de la peinture, un peintre et sculpteur comme Bernin ayant acquis une reconnaissance éminente tout en évoluant intellectuellement à un degré très en-deçà d’un Léonard, d’un Michel-Ange ou d’un Poussin.
C : « L’invention des beaux arts » : le beau et le sublime
Ce qui correspond à la deuxième partie du livre de Carole Talon-Hugon prolonge un des éléments les plus réussis de l’ensemble de son entreprise, à savoir rendre compte de l’évolution de la manière dont nous percevons les objets artistiques, et donc de la manière dont se construisent les catégories mentales avec lesquelles nous percevons une statue ou un tableau à travers les siècles. Le concept de « beaux arts » apparaît au début du XVIIIè siècle, période où le docere s’efface progressivement au profit du placere, et où l’impératif d’édification s’estompe au profit d’une espèce de plaisir sensible déjà présent dans les écrits de Descartes. « Ainsi l’expression de « beaux-arts » est plus qu’une expression : c’est une nouvelle catégorie mentale. »10
L’auteur consacre des pages intéressantes et très utiles à la nouvelle science montrant que, contrairement à ce que pensaient les Anciens, le monde n’est pas en lui-même coloré, les qualités chromatiques n’existant en fait que dans l’esprit de celui qui les reçoit. Les qualités sensibles renvoient à des sensations ou à des idées proprement humaines et non à des qualités intrinsèquement comprises dans les choses. S’il n’y avait personne pour les percevoir, le lys ne serait ni blanc, ni doux, ni odorant. Cela amène la peinture et les arts en générale à se recentrer sur le fonctionnement de l’esprit humain et, plus particulièrement, sur la manière dont le sujet interprète et reçoit certaines qualités sensibles. La conclusion de l’ouvrage reprend sous forme condensée et de manière admirable ce problème : « Contrairement à ce qu’affirmait la conception métaphysique qui valait jusqu’alors, la beauté n’est plus une propriété objective et transcendante, mais une idée agréable suscitée dans le sujet par certaines expériences sensibles. Mais cette beauté disjointe du bien et du vrai, cette beauté « absolue » n’est pas pour autant tenue pour la valeur artistique par excellence, et l’on continue à penser que les arts doivent non seulement plaire et émouvoir, mais aussi instruire. »11
Cette désobjectivation des qualités du monde amène à soulever la question de la beauté : la beauté peut-elle demeurer une qualité du monde dans de telles conditions ou n’est-elle qu’un certaine manière qu’a le sujet d’éprouver certaines sensations ? Carole Talon-Hugon pointe à très juste titre l’importance de Francis Hutcheson (1694-1746), auteur capital, quoique méconnu. Dans son décisif traité consacré auxrecherches sur l’origine de nos idées de beauté et de vertu, il se met en quête du point commun à tous les objets jugés beaux, et conclut que les « figures qui excitent en nous les idées de beauté semblent celles dans lesquelles il y a de l’uniformité au sein de la variété. »12 Parmi les figures géométriques, l’hexagone est plus beau que le pentagone, qui l’est lui-même plus que le carré ou le triangle. Mais on en reste à une beauté formelle. La théorisation du sens interne par lequel se révèle le sens esthétique constitue l’une des plus précoces, sinon la plus précoce, des contributions à l’émergence d’une esthétique autonome fondée sur la seule sensibilité.
L’auteur confronte aussitôt après cette recherche d’une beauté au sens esthétique à la difficile question du sublime ; elle rappelle fort opportunément, contre une certaine doxa qu’il ne s’agit nullement d’une notion des Lumières mais bien plutôt d’un concept du Grand Siècle, déjà théorisé en 1674 par Boileau dans son Traité du sublime réédité 18 fois. John Denis, en 1688, fait également part de sa fascination pour le spectacle horrible des Alpes, fascination apparentée au sublime. A cet égard, Shaftesbury et Burke sont bien largement postérieurs à ces premières thématisations, qui déboucheront sur l’idée d’un sublime perçu comme une « horreur agréable » ou une « joie terrible » selon les mots d’Addison.
A cet égard, il apparaît également assez clair que Kant s’inscrit lui aussi dans un héritage déjà plus que centenaire lorsqu’il entreprend sa propre analyse du sublime, défini comme ce qui est « absolument grand » et l’ouvrage présente le grand mérite de rappeler ce fait historique. Néanmoins, nous ne sommes pas entièrement certain d’être d’accord avec cette remarque, dont le sens nous gêne toutefois moins que la formulation : « Au XVIIIème siècle, le sublime concerne le spectacle esthétique de la nature et jamais des produits de l’art. Burke conteste l’idée que la peinture puisse être sublime, et Kant affirme que seule la nature peut l’être. Et en effet, la grandeur est la définition même du sublime. »13 Il y a, au moins chez Kant, une sorte de sublime artistique ressenti par le sujet, sublime incarné par les pyramides d’Egypte et Saint-Pierre au Vatican. Dans le cas de la pyramide note en effet Kant, « au cours de cette appréhension, les premières perceptions disparaissent toujours en partie avant que l’imagination n’ait saisi les dernières, et la compréhension n’est jamais complète. Observation qui peut aussi suffire pour expliquer la stupeur ou cette espèce d’embarras qui, comme on le raconte, saisit le spectateur lorsqu’il pénètre pour la première fois dans l’église Saint-Pierre de Rome. Car il éprouve ici un sentiment de l’impuissance de son imagination à présenter l’Idée d’un tout – ce en quoi l’imagination atteint son maximum et, en s’efforçant de le dépasser, s’effondre sur elle-même, tandis qu’elle se trouve ainsi plongée dans une satisfaction émouvante. »14 Il y a là un quantum de l’imagination qui échoue d’une certaine manière à maintenir les images déjà appréhendées et qui semble ainsi débordé à mesure que progresse l’appréhension, ce qui fait que la compréhension n’est jamais complète.
Alors, avons-nous affaire à un sublime artistique avec les pyramides d’Egypte ou encore Saint-Pierre ? En toute rigueur, Carole Talon-Hugon a raison de rappeler avec Kant que l’ « on ne devrait pas montrer le sublime dans les produits de l’art (par exemple des édifices, des colonnes, etc.), où une fin humaine détermine la forme aussi bien que la grandeur »15 mais il nous semble en même temps qu’il y a une ambiguïté dans le texte même de Kant qui se trouve un peu écrasée : s’il ne peut certes y avoir au sens propre de sublime dans ce qui est produit par l’homme, l’homme ne pouvant dépasser l’homme, il n’en demeure pas moins que le sujet peut éprouver une impression comparable à celle du sublime là où surgit le colossal, si bien que du point de vue du sujet il est fort possible que le sentiment du sublime émerge malgré tout face aux pyramides ou dans Saint-Pierre. C’est ce qu’explique fort bien Jacob Rogozinski dans un bel article : « Apparemment sublime (sans concept ni fin), la Basilique serait en vérité ordonnée à la présentation d’un concept, simplement colossale. A la fois colossale et sublime, puisque rien ne nous permet plus de distinguer rigoureusement ces deux jugements. »16
D : Critique et histoire de l’art
La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à la notion de critique d’art qui émerge au Siècle des Lumières, en 1747 avec Etienne la Font de Saint-Yenne, puis trouve ses lettres de noblesse avec Les salons de Diderot de 1759 à 1781. « La naissance de la critique d’art supposait une série de conditions à la fois institutionnelles et sociologiques. »[Talon-Hugon, op. cit., p. 99[/efn_note] Le Baron Grimm publie un périodique, Correspondance littéraire, philosophique et critique, si bien qu’en quelques années un nouveau genre est né et se répand à grande vitesse à travers l’Europe. L’institution des salons invente les notions de public et d’amateur. Parfois même, le jugement du public est plus fiable que celui des spécialistes, ce qui rappelle les analyses de Jacqueline Lichentstein dans Les raisons de l’art dont on peut consulter la recension à [cette adresse.
Dans les Cours de peinture par principes, Roger de Piles soutient que c’est de son côté que l’on trouve le plus de bon sens appliqué aux choses de l’art, et un goût qui n’est perverti ni par les modes ni par les cabales. Le public participe à la création de la valeur esthétique de l’œuvre et telle est peut-être la plus grande révolution en cours au XVIIIème siècle, anticipant largement sur la notion d’esthétique de la réception chère à H.-R. Jauss. L’amateur légitime n’est pas un professionnel mais un connaisseur éclairé tandis que le sens commun reconnaît la hiérarchie des goûts. Hume montre que la norme du goût dont il parle ne réside pas dans une qualité esthétique, mais dans une « capacité esthétique. Elle ne doit pas être recherchée du côté de la règle, mais dans la figure de l’expert, dont les qualités sont résumées dans cette formule. « Un sens fort uni à un sentiment délicat, amélioré par la pratique, rendu parfait par la comparaison et clarifié de tout préjugé ». »17
A côté de cette critique d’art émerge une nouvelle manière de faire de l’histoire de l’art ; cela implique de considérer que Pline n’était pas un historien de l’art au sens réel du terme car il ne considérait qu’une petite période et pensait l’histoire en termes de progrès et non d’évolution. La grande révolution est à cet égard renaissante : Vasari est crucial, peintre, collectionneur et érudit : il montre qu’il y a un développement logique et inévitable. Chaque artiste occupe une place dans un contexte qui lui assigne un horizon de possibilités ; il introduit l’idée d’un jugement de valeur relatif, soit cette idée qu’il convient bien d’évaluer la réussite d’une œuvre par rapport aux possibilités d’une époque. « L’œuvre de Vasari ne relève pas de l’histoire de l’art au sens contemporain. »18 note Carole Talon-Hugon, mais il n’en demeure pas moins qu’il introduit une rupture sensible avec les œuvres de Pline quant à la signification même d’une histoire de l’art.
C’est donc Winckelmann qui apparaît comme le vrai créateur de l’histoire de l’art, notamment avec son Histoire de l’art chez les anciens. Il ne se cantonne pas à la Renaissance italienne. Il commence une « historicisation de l’art. »19 impliquant que l’art a une histoire où les critères d’évaluation sont eux-mêmes historiques et donc changeants, ce en quoi il rompt avec Vasari. L’art est une production de l’esprit humain qui comme les autres productions est soumise aux déterminations de l’histoire, de la culture et de la société.
Conclusion : esthétique et philosophie de l’art
Une fois encore, nous ne pouvons que vivement recommander cet ouvrage, qui conviendra à tous ceux qui s’intéressent à l’esthétique, à l’histoire de l’art, et à la philosophie de l’art. Une fois encore, le choix de rédiger une histoire « personnelle » implique certaines absences, mais cela présente le mérite symétrique d’évoquer avec passion les sujets traités dans l’ouvrage.
La fin de ce dernier aborde avec bonheur la naissance de l’esthétique proprement dite, et rappelle qu’en plus de Baumgarten, Johann Georg Sulzer (1720-1779), philosophe suisse, qui avait également rédigé une Théorie générale des beaux-arts publiée en 1774. Si cet ouvrage est évidemment postérieur aux analyses de Baumgarten qui mourut en 1762, il n’en demeure pas moins que c’est par Sulzer que le terme d’esthétique pénètre en France, avec l’article de Diderot pour l’Encyclopédie de 1776. Par ailleurs, le philosophe suisse ne cite jamais Baumgarten dans ses ouvrages de 1751-1752, malgré le fait qu’il ait lu celui-ci, et ne le mentionne en 1774 que pour critiquer son approche ; contre Baumgarten qui demeure leibnizien, Sulzer exalte la théorie autonome de la sensibilité20, et c’est à ce titre qu’il est reçu en France. « C’est donc bien plutôt Sulzer que Baumgarten qui donne à l’esthétique son périmètre moderne et son visage familier en en faisant la philosophie des beaux-arts. »21 Ce n’est pas le moindre des mérites de l’ouvrage que de rappeler au lecteur français l’importance de ce philosophe suisse quelque peu oublié.
- Carole Talon-Hugon, Une histoire personnelle et philosophique des arts, Tome III. Classicisme et Lumières, Paris, PUF, 2015
- Antoine Schnapper, Le métier de peintre au Grand Siècle, Paris, Gallimard, 2004, p. 264
- Talon-Hugon, op. cit., p. 11
- Ibid., p. 15
- Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis. Humanisme et théorie de la peinture, traduction Maurice Brock, Macula, 1998, p. 155
- Ibid., p. 158
- Howard Hibbard, Le Bernin, Traduction Françoise Marin, Macula, 1984, p. 56
- Talon-Hugon, op. cit., p. 24
- Ibid., p. 35
- Ibid., p. 44
- Ibid., p. 127
- Ibid., p. 51
- Ibid., p. 69
- Kant, Critique de la faculté de juger, § 26, AK V, 252, Traduction Renaut, GF, 2000, p. 234
- Ibid., p. 234
- Jacob Rogozinski, « A la limite de l’Ungeheuer sublime et « monstrueux » dans la Troisième Critique », in Kants Ästhetik, de Gruyter, 1998, p. 655
- Ibid., p. 106
- Ibid., p. 116
- Ibid., p. 117
- Pour en savoir plus, cf. Elisabeth Décultot, « Métaphysique ou physiologie du beau ? La théorie des plaisirs de Johann Georg Sulzer », Revue germanique internationale, 4/2006, en ligne : http://rgi.revues.org/146
- Ibid., p. 126








