Les éditions PUF ont lancé il y a peu une série de volumes consacrés à l’histoire et à la théorie des arts dont nous avions rendu compte ici même afin de saluer l’utilité et la qualité de l’entreprise. Avec le deuxième volume1, dévolu aux mondes médiéval et renaissant, Carole Talon-Hugon poursuit son récit et s’intéresse aux deux voies divergentes des arts, l’une d’inspiration néoplatonicienne, métaphysique, et l’autre plus mathématique, d’inspiration plus pythagoricienne. Balayant un spectre assez large, elle n’oublie nullement le théâtre au sujet duquel elle brise un certain nombre de préjugés quant à sa fonction sociale et dresse ainsi une fresque s’étalant sur plus d’un millénaire, assumant certains choix et certaines sélections que nous allons restituer et interroger.
Il est en effet complexe d’aborder la richesse des questions charriées par le monde médiéval autour des arts, ne serait-ce qu’avec la querelle iconoclaste qui s’étend sur plusieurs siècles et mobilise les plus grands penseurs de l’époque, et de les conjuguer à celles de la Renaissance, hantée par la possibilité d’incarner la Beauté, voire par la possibilité d’en former l’Idée adéquate ; c’est donc une gageure que de proposer de ces deux périodes un panorama scientifiquement recevable quoiqu’adossé à une subjectivité revendiquée en moins de 120 pages, ce que pourtant parvient à faire, une fois encore, l’auteur de cet ouvrage.
A : La structure de l’ouvrage
La première partie de l’ouvrage, nettement métaphysique, est consacrée à l’héritage de Plotin et à celui de l’Antiquité mais concerne essentiellement les pratiques médiévales à partir du XIè siècle. Il faut en effet toujours rappeler que le monde du haut Moyen Age demeure en grande partie méconnu, et ne peut s’appuyer que sur des hypothèses très fragiles, s’opposant aux sources bien plus fiables dont nous disposons à partir du XIè siècle. Le titre de la première partie n’est pas sans faire penser à la célèbre étude d’André Grabar, Les origines de l’esthétique médiévale2 où le rôle de Plotin était nettement valorisé dans la manière même dont le sens du spectateur et de la réception des arts devait être conçu. « Par les opinions qu’il a émises sur la manière dont il convient d’étudier l’œuvre d’art, d’interroger et de jouir de toute vision et en particulier de la contemplation d’une création artistique, Plotin annonce le spectateur du Moyen Age. »3 En insistant sur certains traités des Ennéades, Carole Talon-Hugon poursuit sans aucun doute les analyses d’André Grabar et rappelle combien décisive fut la place de Plotin dans l’élaboration médiévale de l’esthétique.
La seconde partie, moins métaphysique, plus iconographique, s’intéresse au sens et à la fonction des images dans le monde médiéval et traite donc de la querelle iconoclaste et en suit les effets jusqu’à la Renaissance avec Léonard et la désacralisation de l’image. Nous ne pouvons pas ne pas penser dans cette partie au classique d’Alain Besançon, L’image interdite4, dont les perspectives ne sont toutefois pas tout à fait reprises dans le présent ouvrage. Rappelons que la partie byzantine de l’Empire romain vit se développer des individus hostiles aux images, fidèles à l’Ancien Testament, que l’on nomma les iconoclastes et qui ne tolérèrent que les décorations ornementales. Au-delà des épisodes et des rebondissements nombreux de la querelle qui agita les VIIIème et IXème siècles, et qui ne prit vraiment fin qu’en 843 avec Theodora, il faut comprendre l’enjeu central du problème, soit celui de la manière dont l’image risque de nous détourner du modèle, ce qui ne peut être évité que si celle-ci atteint la lumière intelligible que vient favoriser le matériau spécial qu’est l’or. L’image ne sera donc tolérée qu’à la condition de nous ramener au modèle et non de nous en éloigner, ce qui revient à dire qu’elle ne possède pour elle-même aucune valeur ; elle n’est qu’une médiation.
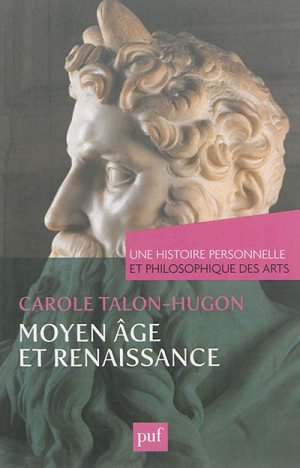
Le livre permet ainsi de mesurer tout le chemin parcouru avec la Renaissance qui investit l’image d’un sens autonome, et même supérieur à celui du texte, en tant que l’image donne à voir la scène d’un coup avec la vivacité de ce qui se présente à l’œil, fenêtre de l’âme. L’image se dépouille de son aura néoplatonicienne, de son étroite parenté avec l’intelligible, ou avec le divin ; elle est « désacralisée »5
Enfin, la troisième partie aborde plus spécifiquement la Renaissance, de Giotto à Raphaël, interroge les reprises antiques, mais aussi la singularité et la nouveauté de la période qui, comme toute période, ne saurait pourtant être réduite à l’unité ni même à la cohérence d’un dogme commun. Ce n’est pas le moindre des mérites de l’auteur que de rendre sensible l’éclatement interne à la Renaissance ou, plus exactement, l’éclatement des réponses à une question qui, elle, est commune.
B : Le théâtre médiéval
Le théâtre médiéval est un élément complexe, parcouru d’enjeux multiples et contradictoires, notamment à travers sa relation à l’Eglise qui tout à la fois le condamna et le fit revenir en grâce, assurant ainsi sa pérennité après avoir tout fait pour l’éradiquer. Peu connu, parvenu sous forme de fragments d’auteurs écrivant sous pseudonyme, nous ne pouvons que reconstruire ce qu’il fut à partir du XIè siècle avec des indices plus ou moins explicites de ce que fut son expression ; si chacun connaît le nom de Rutebeuf, Adam de la Halle est sans doute moins connu, tandis que Jean Bodel n’est évoqué que par les spécialistes.
L’auteur s’intéresse, nous l’avons dit, au théâtre à partir du XIè siècle, ce qui ne signifie pas qu’il n’existait pas auparavant dans la chrétienté médiévale. L’Eglise, dès le Xè siècle reprend des fêtes païennes et folkloriques dans les processions tandis que bien des offices religieux reconduisent une certaine dramaturgie antique, laquelle pénètre ainsi le cœur liturgique de l’Eglise. Le prototype de ces phénomènes théâtraux repris par l’Eglise est sans doute la procession du dimanche des Rameaux, donnant lieu à une expression théâtrale imagée, tandis que chants et contre-chants miment le dialogue théâtral durant les messes. Les tropes – interventions musicales chantées dans l’office – constituent sans doute l’aspect le plus spectaculaire de cette évolution observable dès le Xè siècle, à laquelle ont été consacrés de nombreux articles[On pourra consulter, entre autres, celui de [Nicole Sevestre [/efn_note].
Carole Talon-Hugon commence néanmoins son étude typologique avec l’apparition du drame liturgique, soit avec la mise en scène de textes sacrés dans l’enceinte d’une église ; la parole du prêtre et le corpus biblique sur lequel il appuie ses sermons sont théâtralisés pour gagner en efficacité et l’on représente ainsi des épisodes de la Bible. Mais, très rapidement, l’attitude traditionnellement ambiguë de l’Eglise vis-à-vis de la représentation théâtrale va redevenir hostile à ces manifestations, et Innocent III, au XIIè siècle, en interdira la représentation à l’intérieur des églises, imposant au spectacle de se trouver sur les parvis ; c’est ce qu’on appellera les drames « semi liturgiques » ou les « jeux ». Apparaissent également les « miracles », mélodrames à visée moralisante, comme en témoigne le Miracle de Théophile de Rutebeuf.
A la fin du XIVè siècle, apparaissent les « mystères » qui sont joués également sur les parvis ou les places de la ville et dont la durée de représentation peut être de 40 jours. Viennent enfin les « moralités » au XVè siècle, mises en scène d’allégories à visée éducative et satirique. Au-delà de la liste des formes différenciées de représentation théâtrale, importe le sens même du théâtre à cette époque ; il semble que le théâtre ne soit pas professionnalisé, ni ne se donne dans un lieu clos, encore que la publication très récente de L’Anthologie de l’avant-scène théâtre consacrée au théâtre médiéval vienne nuancer l’idée selon laquelle la professionnalisation ne serait apparue qu’à la fin de la Renaissance6, voire celle selon laquelle il serait intégralement dévolu à l’expression des vérités de morale et de foi. L’extrême diversité des formes théâtrales, encore peu connues, de ce bas Moyen Age, se révèle infiniment plus subtile que ce que l’on a pu croire dans les dernières décennies.
C : Le courant métaphysique du plotinisme
L’un des aspects très éclairants de l’ouvrage de Carole Talon-Hugon, après l’exposé sur le théâtre médiéval, est de présenter une interprétation des images médiévales et renaissantes comme étant parcourues par une espèce de double voie dont l’issue n’est peut-être toujours pas tranchée. La première, comme nous le disions précédemment, serait pythagoricienne, mathématique, et chercherait à traduire par les rapports proportionnels et harmonieux la beauté dans l’œuvre. La seconde, plus métaphysique, ambitionnerait de restituer malgré la matérialité l’éclat du Beau ou du Vrai. Dans la première voie, le travail de la forme se révèle décisif, puisque porteur des structures mathématiques de la beauté, alors que dans la seconde prime indiscutablement la recherche de l’expression d’une Idée ou d’une Forme à laquelle la matière resterait à jamais extérieure bien qu’elle en soit le présentoir.
Carole Talon-Hugon observe à très juste titre que dans l’art chrétien primitif disparaît rapidement le souci de la forme extérieure, de la structure mathématique et de l’harmonie au profit d’une recherche de la spiritualité. Et c’est chez Plotin qu’elle mène son investigation pour rendre compte de ce phénomène[Pour une analyse détaillée du Beau chez Plotin, on peut se rapporter aux très belles leçons de Jérôme Laurent, L’éclair dans la nuit, chroniquées [à cette adresse [/efn_note]. L’auteur convoque ainsi le traité I, « sur le Beau » où Plotin refuse en effet que la beauté soit réductible à une question de proportion ou encore d’harmonie car, si tel était le cas, aucune couleur ne serait belle en soi, et la beauté se laisserait ramener à une affaire de relations entre éléments, excluant de ce fait les éléments simples. « Mais alors, s’interroge Plotin, comment l’or est-il beau ? Et comment se fait-il que, la nuit, l’éclair et les astres apparaissent beaux ? »7 Contre cette réduction de la beauté à l’agencement formel des éléments selon des structures harmoniques, Plotin exalte l’expression de l’Idée, l’éclat de la Forme, donc de l’Intellect qui « est le beau »8, permettant ainsi à l’œuvre sensible d’être porteuse de cela même qui la transcende : « la beauté sensible, écrit Carole Talon-Hugon, a ainsi la capacité à faire repousser les ailes que l’âme a perdues au cours de sa chute ; la beauté nous élève. Si bien que la beauté visible ou audible est à la fois manque et déperdition, mais aussi moyen d’une ascension vers l’Idée du beau. »9
Toutefois, une telle analyse est aussi bien valable pour les artefacts humains – ce que nous appellerions aujourd’hui les « œuvres d’art » – que pour les paysages naturels ou les éclairs qu’affectionne particulièrement Plotin. Il nous faut alors nous demander si ce dernier a pu élaborer une saisie spécifique des œuvres d’art et de leur beauté ou s’il est resté tributaire d’une conception métaphysique écrasant l’ensemble de l’être sous la question de la Forme, s’interdisant de ce fait de relier l’œuvre humaine à une beauté spécifique. Il est clair, note Carole Talon-Hugon, que Plotin conserve, notamment dans le Traité 5 (Ennéade V, 9, 11) le sens ancien des arts comme tekhnè, comme savoir-faire, comme maîtrise, bien qu’au-dessus des arts mimétiques se trouvent les arts créatifs que sont l’architecture et la menuiserie – et non la peinture ni la sculpture, subordonnées à leur modèle. « Par ailleurs, écrit Plotin, toutes les techniques qui produisent des objets sensibles – par exemple l’architecture et la charpenterie – dans la mesure où elles servent des proportions, devraient tirer leurs principes de là-bas et de la réflexion de là-bas ; mais comme elles les mélangent avec le sensible, elles ne peuvent pas être entièrement là-bas. »10
Toutefois, en Ennéade V, 8, 1, la beauté des choses sensibles de la nature et celle des œuvres d’art sont présentées comme tenant à la présence d’une forme qui impose son ordre à la matière. Mais dans le cas des objets artefactuels, cette forme est déposée dans l’âme de celui qui les produit. L’art est le lieu des formes, donc il y a plus de beauté dans l’art que dans ses réalisations. Dans l’art, la beauté demeure égale à elle-même, intacte, jamais diminuée par le don de la forme qu’elle fait au sensible. Chez Plotin, l’art comporte ainsi une dimension spirituelle, mais il est métaphysiquement utile « parce qu’il contribue à la conversion du regard que sa philosophie appelle de ses vœux. »11 Si bien qu’on a là « le cadre d’une théorie artistique et d’une pensée du beau qui vont dans le sens d’une spiritualisation de l’art et, corrélativement, d’un refus du naturalisme. »12
Concluons sur ce sujet. Remarquons d’abord avec l’auteur que l’expérience du peintre ou du sculpteur est éminemment spirituelle avant que d’être artistique au sens moderne du terme. En outre, pour le spectateur, il doit s’agir de recherche dans l’œuvre non pas tant un plaisir esthétique qu’une voie pour s’élever et pour purifier son âme. A cet égard, l’agencement sensible de l’œuvre importe moins que ce dont elle est porteuse – l’art où s’exprime la Forme –, soit le sens même de l’origine de l’âme. Enfin, pour provoquer la conversion du regard, pour favoriser la montée de l’âme vers l’intelligible, l’œuvre ne doit pas être enchaînée au sensible : elle doit manifester la victoire de la forme sur la matière. La lumière est ainsi l’intelligence de l’intelligible.
D : L’art renaissant
On notera que l’auteur passe du statut des images à l’analyse de l’art renaissant ; cela signifie que se trouvent exclus l’ensemble des réflexions et des propos scolastiques consacrés à l’œuvre d’art et à la beauté, exclusion du reste assumée par l’auteur rappelant que cette histoire des arts est personnelle et subjective. La question du « resplendissement du beau » n’est ainsi pas analysée par Carole Talon-Hugon, ce qui est loin d’être absurde dans la mesure où rien n’indique que la trinité thomasienne claritas-integritas-conveninentia s’applique aux œuvres d’art. L’entreprise s’avère ainsi très loin de celle d’Umberto Eco qui avait cherché à rendre compte presque exhaustivement des théories médiévales des arts et de la beauté, en les présentant de manière succincte13.
La Renaissance est ainsi présentée dans son versant de rupture vis-à-vis du monde médiéval, car elle ne cherche plus tant à exprimer des vérités supérieures qu’à reproduire la visibilité avec le plus de virtuosité possible sans que cela ne s’identifie pourtant à un simple geste mimétique ou de reproduction fidèle. Le monde visible ne subit plus les déformations que l’art de l’icône réclamait pour guider le regard vers l’invisible ; « il s’agit à présent de représenter le visible tel qu’il se donne à la vue. »14 Tel est ainsi le souci de Giotto qui ne peint pas que des choses visibles, mais qui peint selon le visible. En d’autres termes, il s’inspire du sensible pour peindre ce qui n’est pas sensible.
Parallèlement, les artistes se mettent à voyager pour voir des œuvres si bien que les commandes ne constituent plus l’unique motif d’un déplacement ; ils voyagent pour admirer et copier car l’œuvre elle-même devient objet d’admiration pour ce qu’elle est. Institutionnellement, les faits se traduisent en droit : l’Académie des arts du dessin en 1563 à Florence est une révolution significative, provenant de l’initiative de Vasari (1511-1574), l’auteur des Vies des peintres de son temps et du siècle antérieur, à la fois source cruciale d’informations et en même temps parcourues de légendes invérifiables. Dire que c’est une Académie, c’est dire que la peinture est une histoire intellectuelle autant que manuelle, et qu’elle n’est plus une technique au sens d’un savoir-faire purement matériel ; elle est une cosa mentale pour reprendre la si célèbre définition de Léonard de Vinci.
Mais dans ces conditions, le balancement entre l’approche métaphysique plotinienne et l’approche mathématique formelle oscille dans un sens nouveau : la victoire plotinienne de la métaphysique laisse progressivement la place à une beauté qui n’est plus métaphysique mais qui est intrinsèquement liée à la configuration du sensible, voire à la configuration du plaisir, d’où naîtra l’esthétique. Certes demeurent des titans comme Michel-Ange, qui conservent indiscutablement une approche essentiellement métaphysique, mais le curseur se déplace de plus en plus vers la configuration formelle seule porteuse de beauté.
La Renaissance peut donc être conçue comme ce moment où la beauté trouve à se réaliser dans les arts plastiques, et où l’héritage grec hésitant entre conception métaphysique du beau et approche mathématique, se rééquilibre en faveur de la seconde, sans jamais toutefois mettre totalement fin à la visée métaphysique de la Beauté.
Conclusion
Ce deuxième volume, tout aussi réussi que le premier, propose une habile synthèse consacrée à l’évolution des arts dans une période très étendue et très complexe. Une fois encore, le pari est réussi, en tant que l’ouvrage offre les clés indispensables à l’appréhension initiale du théâtre médiéval, du plotinisme esthétique ou encore de la révolution renaissante. Le novice y apprendra énormément de choses, tant théoriques que pratiques, l’étudiant y piochera des schèmes permettant de s’appuyer sur de grandes lignes directrices fort éclairantes, et même le spécialiste de la peinture renaissante pourra en tirer quelques informations sur le théâtre médiéval qui est si peu enseigné et si peu joué.
Nous avons gardé pour la conclusion un élément crucial de la Renaissance qu’est celui de la perspective ; innombrables sont les ouvrages qui y sont consacrés, et il n’est nulle question ici d’en interroger le sens philosophique ni même les origines. Mais l’auteur a le mérite de rappeler un point qui fait souvent l’objet d’une confusion dommageable : la perspective n’est pas la profondeur ou, plus exactement, la perspective n’est pas l’impression de tridimensionnalité rendue par une surface. Il est en effet très courant d’entendre, voire de lire, des approximations autour de la perspective souvent ramenée à un simple rendu visuel de profondeur. Or, contre ce raccourci ruineux, interdisant de comprendre la spécificité de la peinture renaissante, il faut rappeler avec Carole Talon-Hugon que les anciens disposaient évidemment du raccourci, donc d’une certaine profondeur, mais ils ne disposaient pas de la diminution en proportion exacte pour le regard. La perspective, qui signifie littéralement « relatif à l’optique », désigne dans ces conditions une certaine manière de concevoir selon les lois de l’optique l’ordonnancement de plans verticaux proportionnés entre eux, et relatifs au fonctionnement de l’œil. Tel fut le mérite d’Alberti ou de Piero della Francesca que de théoriser rigoureusement le rythme scientifique de la diminution et le Génie de la Renaissance fut d’être capable de respecter ces règles sans que celles-ci ne mènent à une morne série de productions similaires et stéréotypées mais rendent au contraire possible une infinie diversité de traitements, dont l’expression se retrouve de Fra Angelico à Raphaël, dans un combat de styles à jamais épique.
- Carole Talon-Hugon, Une histoire personnelle et philosophique des arts., Tome II, Antiquité et Moyen Age, PUF, 2014
- André Grabar, Les origines de l’esthétique médiévale, Paris, Macula, 1992
- Ibid., p. 31
- Alain Besançon, L’image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, Fayard, 1994 ; cf. pour une présentation moins large, Marie-France Auzépy, L’iconoclasme, PUF, 2006
- Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 65
- cf. Darwin Smith (dir.), Le théâtre français du Moyen Age et de la Renaissance, L’Avant-Scène théâtre, 2014
- Plotin, Ennéades, I, 6, [1] 1, GF, 2002, p. 68
- Ibid., 1, 6, 6, p. 75
- Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 25
- Plotin, Ennéades, V, 9, [5], 11, GF, 2002, p. 209
- Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 33
- Ibid., p. 33
- cf. Umberto Eco, Art et beauté dans l’esthétique médiévale, Traduction Traduction Maurice Javion, LGF, 2002
- Ibid., p. 76








