Fin 2008, les éditions PUF ont conjointement fait paraître en collection de poche, c’est-à-dire en Quadrige, deux des principaux ouvrages de Carl Schmitt, à savoir la Théorie de la constitution1 et le Nomos de la terre2, décidant ainsi de faire de ces deux textes des « classiques » de la philosophie politique du XXè siècle, ce qui n’est pas tout à fait innocent lorsque l’on songe à toutes les polémiques encore vivaces qui gravitent autour de ce sulfureux auteur. La première remarque qui vient à l’esprit est celle d’un soulagement, car la première traduction de ces deux textes avait paru dans la collection Léviathan qui, certes s’avère prestigieuse, mais dont le coût décourage la plupart des bourses ; rappelons en effet que Le nomos de la terre, pour 300 pages, coûtait à l’époque la somme de 60 € et que la réédition en Quadrige permet de ramener cette dernière à un prix plus abordable puisqu’il est divisé par quatre et chute à 15 €. De la même manière, la théorie de la Constitution passe de 42 à 19 €, diminution moindre donc, qui doit avoir sa logique propre. Mais cette réédition en Quadrige qui, pour le nomos de la terre divise le prix par quatre, n’est pas sans contrepartie et à ce petit jeu, c’est le confort de lecture qui y perd : les marges de l’édition Quadrige sont en effet extrêmement minces, et il est fort difficile de parvenir à lire les trois derniers mots de chacune des lignes sur les pages de gauche, mots qui s’obstinent à demeurer cachés en raison du brochage du livre ; certes l’ouvrage est d’un point de vue pécuniaire bien plus accessible, mais sa lisibilité s’avère moindre que dans l’édition Léviathan.
Une fois ces considérations éditoriales achevées, nous pouvons passer au contenu de l’ouvrage, en particulier du Nomos de la terre, ouvrage écrit en 1950, donc au moment où Carl Schmitt commençait son long purgatoire en guise de punition pour avoir collaboré avec les dirigeants nationaux-socialistes. Une longue introduction d’une quarantaine de pages ouvre le livre, introduction que l’on doit à Peter Haggenmacher et dans laquelle ce dernier pose les principales problématiques que sont celles de Schmitt en 1950, tout en resituant le contexte historique de ces années qui font immédiatement suite à la Deuxième Guerre mondiale. Haggenmacher insiste longuement sur le lien intime qu’entretient le Nomos avec un autre texte qu’est Terre et mer, au point de faire de celui-là la version définitive de celui-ci. C’est donc un aboutissement auquel parvient Schmitt en 1950 alors que commence sa longue retraite à Plettenberg, et les écrits qui suivent 1950, toujours selon Haggenmacher, « n’ajoutent rien d’essentiel à la riche moisson des quatre décennies mouvementées qui précèdent le nomos de la terre. »3
Le nomos contre la loi et le positivisme
La démarche générale de Carl Schmitt, déjà identifiable dans la question clé de la société des nations, consiste à penser le problème du fondement d’une entité politique en tant qu’institution ; n’est-il question que d’une norme, exclusivement dépendante du positivisme qui l’aurait instituée, ou est-il possible de trouver un fondement plus substantiel, moins contingent peut-être, que cet arbitraire positiviste instituant la norme ? Aux yeux de Carl Schmitt, pour lequel les deux ennemis principaux sont évidemment le positivisme et le normativisme, il faut trouver un fondement autre que la décision positiviste pour fonder l’institution : là où le positivisme pose l’équivalence du droit et de la loi positive, faisant de celle-ci le fondement de celui-là, Carl Schmitt va penser la question de la terre comme étant source du droit, arrachant donc celui-ci à l’acte arbitraire de la décision, afin de mieux marquer combien le positivisme confond en réalité décisionnisme et normativisme, ainsi que l’avait fort bien expliqué Kervégan : « Le positivisme est tacitement décisionniste, puisqu’il reconnaît pour seule source statutaire du droit la décision souveraine du législateur. Mais il interprète cette décision selon une perspective normativiste ; une fois acquise la forme légale, la décision a pour lui la force d’une norme inconditionnée. »4 Contre ce geste positiviste, Schmitt rétablit donc une origine substantielle du droit, et ce sera à la terre que reviendra le rôle d’établir les rapports juridiques.
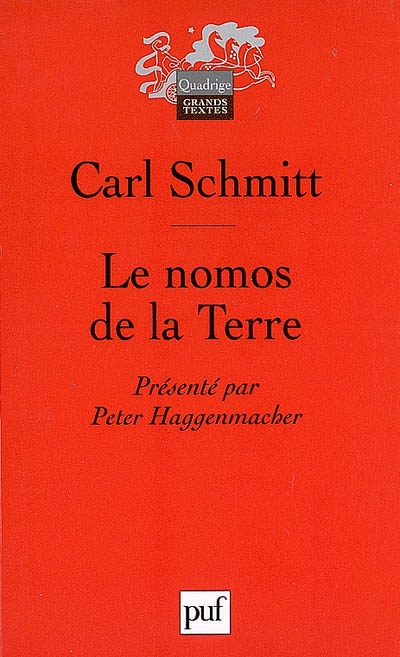
De ce qui vient d’être dit, nous pouvons donc déjà comprendre la question éminemment politique que pose Schmitt à partir de la terre : comment la prise des terres permet-elle de définir de manière substantielle les rapports juridiques ? Poser une telle question comme fil dirimant de son ouvrage, c’est au fond poser les rapports guerriers dans leur dessein de conquêtes comme fondement de la possibilité du droit lui-même ; il n’y a de rapports juridiques que comme résultats de rapports conflictuels dans lesquels les possessions de terres sont en perpétuelle évolution, et c’est évolution qui dessine lentement la grande carte du droit européen. C’est pourquoi, dès la préface, Carl Schmitt peut écrire qu’ « il est question ici de terre ferme et de mer libre, de prises de terres et de prises de mer, d’ordre et de localisation. »5 On le voit aisément, un tel enracinement de la possibilité du droit dans un ordre guerrier n’est pas consensuel et s’oppose nettement au décisionnisme aveugle, car interprété de façon normative, du positivisme, auquel Carl Schmitt impose avec force l’ordre de la terre. Ce n’est pourtant pas une réduction du droit à la simple géographie à laquelle il procède, puisque « la pensée juridique reste malgré tout autre chose que de la géographie. »6, et surtout puisque la géographie désigne des espaces physiques qui ont une existence en soi, tandis que les terres – et les mers – dont Carl Schmitt ne cesse de parler, sont soumises aux aléas des conquêtes humaines que l’histoire ne cesse de mettre en branle.
Un premier écueil serait ici à éviter, écueil qui consisterait à lire cette idée d’une fondation du droit dans les prises de terres comme étant la reconduction d’une pensée de l’enracinement et, pour le dire d’un slogan bien connu, d’une pensée pétainiste ou barrésienne pour laquelle « la terre ne ment pas ». Pour dissiper ce malentendu, il convient de bien comprendre ce que signifie le « nomos » dans « le nomos de la terre » ; rien ne serait plus faux que de le traduire par la « loi », car ce serait faire croire que la terre elle-même dispense une loi à laquelle le droit doit se plier pour être effectif ; contre cette mésinterprétation toujours possible, Carl Schmitt développe de longues mises en garde en faisant d’abord appel à l’étymologie. « Le mot grec pour la première mensuration qui fonde toutes les mesures ultérieures, pour la première prise de terres en tant que première partition et division de l’espace, pour la partition et la répartition originelles, c’est : nomos. »7 Ce que Schmitt cherche à mettre en valeur, c’est le fait suivant : contre l’interprétation du nomos comme loi, il serait bon de se rappeler le sens originellement spatial du mot, et se rappeler également qu’il s’agissait d’une mesure visant à morceler l’espace conquis afin de le répartir. Ainsi, nous avons dans la terre elle-même, dans cette réalité incarnée, une sorte de triple enracinement par lequel le droit devient possible : d’abord, et d’un point de vue extrêmement pragmatique, dans la terre se jouent les récoltes qui récompensent l’effort ; le sol travaillé par l’homme montre ensuite certaines divisions, creusées par la délimitation des champs ; enfin, la terre est délimitée par des clôtures et des haies. De cette triple caractéristique de toute terre, Carl Schmitt va essayer de faire jaillir une thématisation consciente de tout système juridique.
Le sens initial du droit est donc d’ordre spatial ainsi que nous venons de le voir, mais de surcroît il s’oppose au décret populaire – psèphisma – c’est-à-dire à quelque chose de l’ordre d’une décision populaire arbitraire ; contre cette décision arbitraire doit se faire jour le sens substantiel, car spatial, de ce nomos dont le lien avec la terre est étymologiquement établi, et dont l’éloignement à l’égard du positivisme, dont je rappelle le caractère tacitement décisionniste et normativiste, est avéré. « Le mot nomos est utilisable pour nous parce qu’il est en mesure de mettre les enseignements dus à la problématique mondiale actuelle à l’abri d’un légalisme positiviste embrouillé, en particulier de la confusion avec des termes et des concepts de la science juridique intraétatique du XIXè siècle. »8 : le refus schmittien de ne pas traduire nomos par « loi » et d’en revenir à ce sens spatial originel permet certes de ne pas sombrer dans le positivisme, mais c’est en réalité l’idée même de « loi » qui apparaît positiviste : toute loi, quel qu’en soit le fondement, est nécessairement positiviste lorsque l’on raisonne dans un cadre politique ; par conséquent, lutter contre le positivisme juridique, c’est aller jusqu’à refuser la prééminence du concept même de « loi », et chercher à y substituer des termes plus substantiels, témoignant d’un arbitraire moindre que celui que véhicule l’idée de loi. Ce terme substantiel, Schmitt pense paradoxalement le trouver dans ce nomos, que nous traduisons souvent par loi, mais dont il restitue toute la saveur spatiale et terrestre, de sorte que ce dernier soit un « acte constituant originel qui ordonne l’espace. »9
S’affranchir du positivisme, c’est aussi chercher à comprendre la genèse d’un Etat, la genèse d’une situation : le droit, en sa partie philosophique, ne peut pas se contenter de simples données ; il doit aussi comprendre comment on en est arrivé là ; il me semble que l’un des reproches implicites, non thématisés, mais omniprésent dans cet ouvrage, consiste à faire remarquer aux positivistes qu’ils sont incapables de prendre en compte la genèse d’une situation, comme si à leurs yeux tout était toujours déjà là. En d’autres termes, ce que Carl Schmitt reproche aux positivistes, c’est de croire qu’il n’y a que des faits, en oubliant que tous ces faits ont été amenés par des circonstances, la plupart du temps guerrières : un Etat n’est pas une génération spontanée, il est le produit d’une prise de terres, dont il a fallu assurer la pérennité et la légalité par un système juridique, si bien que la prise de terres doit être considérée en amont de la considération des lois ; cela ne signifie pas que toute prise de terres amène un nouveau nomos, mais cela signifie que tout nomos définit un nouveau système spatial. Voilà très précisément ce que le positivisme, aux yeux de Carl Schmitt, ne peut penser.
Trois moments juridiques
De manière très schématique, nous pouvons dire que Carl Schmitt définit trois grandes périodes de conquêtes de terre, et donc de rapports juridiques, systématiquement pensés à partir des relations de guerre – c’est d’ailleurs en cela que l’ouvrage apparaît comme personnel et polémique. Il y a d’abord l’époque médiévale, où existe une Respublica christiana, et où les rapports juridiques s’originent dans des problématiques théologiques. Dans ces conditions, qu’est-ce qu’un ennemi, concept central du politique selon Carl Schmitt ? L’ennemi, c’est celui qui refuse l’ordre religieux dans lequel l’espace s’inscrit, c’est-à-dire que l’ennemi est celui qui ne reconnaît pas le pouvoir de l’Eglise ; ce sont les Juifs, les Sarrasins, etc., autant d’ennemis qui apparaissent comme étant les hostes perpetui. Cet ordre médiéval est issu d’une prise de terres lié aux grandes invasions, et pour le dire très rapidement, le Pape et l’Empereur se répartissent deux formes de pouvoir, l’Empereur revendiquant l’auctoritas, tandis que l’Empereur réclame la potestas. Ce qui est primordial, c’est alors le fait que le combat contre l’ennemi, dont on rappelle qu’il menace l’ordre religieux, revêt la dimension d’une justa causa, puisqu’il s’agit de mettre hors de nuire ces ennemis impies. L’ennemi médiéval est un ennemi de nature morale, que l’on combat parce qu’il menace un ordre lui-même théologico-moral, et pour cette raison la lutte que l’on mène à son encontre semble juste.
Une des thèses fortes de l’ouvrage, et dont Carl Schmitt restitue la logique avec brio, est de penser la transition du monde médiéval au monde moderne, par la médiation du monde renaissant, à l’aide de la déthéologisation d’un certain nombre de concepts, et surtout par l’abandon de la justa causa, au profit de la thématisation du justus hostis ; l’ère moderne substitue ainsi à la dénonciation de l’ennemi comme être immoral à la reconnaissance de l’ennemi comme ennemi légitime. Pour le dire très concrètement, cela signifie que les guerres ne consistent plus à jeter l’anathème sur l’ennemi mais au contraire à envisager l’ennemi comme étant son semblable, dans le cadre d’une communauté régie par une règle de droit. Ainsi « on détache définitivement l’argumentation théologico-morale de l’Eglise de l’argumentation juridique de l’Etat ; et, chose tout aussi importante, on sépare le problème de la justa causa, qui relève du droit naturel et de la morale, du problème typiquement juridique et formel du justus hostis, distingué du criminel, objet d’une action punitive. »10 Ce passage du monde médiéval au monde moderne par l’abandon de la justa causa constitue certainement un des sommets des analyses schmittiennes, tant elles produisent un schème d’intelligibilité puissant, opératoire, et précis.
Le monde contemporain, enfin, apparaît aux yeux de Carl Schmitt comme celui qui procède à un double mouvement : d’abord, c’est un monde qui fait de la guerre le crime lui-même. « La guerre elle-même devient un crime dans l’acception pénale du mot. »11 Ensuite, puisque la guerre devient le crime en tant que tel, alors celui qui est à l’origine n’est plus précisément ce semblable que l’on combat dans le cadre de rapports juridiquement réglés, mais il est au contraire la crapule à anéantir ; il y a dans la guerre contemporaine une inhumanité de l’agresseur, à qui il convient de faire rendre gorge pour sa laideur morale. « L’action menée contre lui n’est donc pas davantage une guerre que ne l’est l’action de la police étatique contre un gangster : c’est une simple exécution et, en fin de compte, du fait de la transformation moderne du droit pénal en lutte contre les nuisances sociales, ce n’est qu’une mesure contre un agent qui nuit ou qui dérange, contre un perturbateur qui est mis hors d’état de nuire avec tous les moyens de la technique moderne – par exemple une police bombing. La guerre est abolie, mais seulement parce que les ennemis ne se reconnaissent plus mutuellement comme égaux sur le plan moral et juridique. »12 Pour le dire crûment, la guerre contemporaine désigne moins un ennemi qu’elle ne désigne un salaud. Là encore, l’acuité des thèses de Carl Schmitt donne à penser, naturellement dans le cas du national-socialisme, mais aussi pour des guerres que Schmitt n’a pas connues, comme celles récentes de Bosnie. C’est « le retour de la notion de justus hostis conçue juridiquement, à une notion quasi théologique de l’ennemi ; mais en cela précisément il s’agit du contraire de l’attitude de réciprocité exempte de discrimination qui apparaît de façon si marquée et si chrétienne chez Vitoria. »13
Il ne serait probablement pas exagéré de dire que les faveurs de Schmitt semblent aller à cette guerre moderne où les rapports interétatiques régissent le geste guerrier lui-même : les guerres entre Etats permettent de mettre fin aux guerres civiles, tout en attribuant aux Etats la personnalité juridique. « Le concept de justus hostis crée aussi la possibilité d’une neutralité d’Etats tiers fondée en droit des gens. »14 L’Etat qui se forme est une « aire homogène est ferme de sol européen, que l’on se représente en même temps comme un magnus homo. C’est alors seulement qu’il prend sa forme, comme sujet de droit et comme « personne » souveraine. »15 Cette situation qui semble aux yeux de Schmitt atteindre le summum du souhaitable en termes juridiques est mise à mal par les traités du XXème siècle, en particulier ceux de 1919 qui, pour la première fois, ne s’appuient pas sur une structure spatiale concrète ou substantielle ; il y a en 1919 une sorte d’abstraction fondamentale qui vient perturber cet ordre moderne qui avait si bien fonctionné, et dont les conséquences vont être de détruire ces rapports inter-étatiques bien réglés aux yeux de Schmitt.
Du Nouveau Monde aux Etats-Unis : le libéralisme contre le droit moderne
Tout au long de l’ouvrage, il y a un espace qui se trouve convoqué afin de livrer tout son rôle dans la formation du droit, c’est celui des Etats-Unis ; d’abord « nouveau monde », ce gigantesque espace pose avec une force certaine la question de la prise de terres, tout comme il soulève les problèmes d’appropriation du point de vue de leur reconnaissance ; qui peut reconnaître que la prise d’une terre est légale, valide, légitime ? Quelle instance de validation va être convoquée pour précisément garantir cette prise de terres ? Autant de questions que soulève la conquête du nouveau monde, et qui poussent Schmitt à établir un lien certain entre ces prises de terre et la thématisation du droit interétatique : plus qu’une énième conquête, le nouveau monde apparaît comme le paradigme même du droit moderne. « C’est ainsi, écrit Carl Schmitt, que la découverte d’un nouveau monde par les Européens au XVè et XVIè siècles n’est en rien un hasard et ne se ramène pas à l’une des nombreuses invasions réussies dans l’histoire universelle. Ce n’était pas non plus une guerre juste dans un sens normativiste, mais une performance du rationalisme occidental revenu à lui, l’œuvre d’une formation intellectuelle et scientifique telle qu’elle s’était constituée au Moyen Age européen, et cela essentiellement à l’aide des systèmes conceptuels qui ont joint le savoir de l’Europe antique et du monde arabe à l’énergie du christianisme européen pour en faire une force maîtresse de l’histoire. »16
Mais une fois que ce Nouveau Monde fut aménagé, qu’une pensée économique put en émerger et que les Etats-Unis s’affirmèrent de plus en plus comme une incontournable puissance mondiale, cela même qui fut le symbole de la réussite du droit moderne, développa les conditions de la ruine de ce dernier : la pensée libérale qui, pour Schmitt, abolit le politique et les frontières au profit de l’internationalisme financier, abolit du même geste l’idée de spatialité ; on oublie avec la pensée libérale, explique Schmitt, que l’ordre juridique s’enracine dans un espace circonscrit. A cela s’ajoute le traité Cobden (anglais) de 1860 qui, conjointement à l’essor des Etats-Unis, constitue le fer de lance de cet oubli. « Depuis le traité Cobden de 1860, la pensée économique libérale et le caractère global du commerce étaient devenus naturels pour la pensée européenne et courants dans la pensée en général. »17 Ce qui se produit donc en 1919, lorsqu’aucun nomos ne vient garantir le nouvel ordre, n’est pas une incongruité aux yeux de Carl Schmitt ; c’est au contraire l’aboutissement logique de la lame de fond libérale qui, substituant le commerce mondial au droit spatial, prépare la voie à une déspatialisation des rapports juridiques laquelle ne peut conduire qu’à l’échec selon Schmitt. « La véritable cause de l’échec de la Ligue de Genève tenait au fait qu’elle ne s’était aucunement déterminée sur l’ordre spatial, et qu’il lui manquait jusqu’à l’idée même d’un ordre de nature spatiale. »18
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce livre, qui est d’une rare intelligence et d’un pouvoir de séduction intact ; chaque phrase semble pesée, murie, pensée pour être percutante, et c’est en définitive à un schéma d’intelligibilité hors du commun que nous convie Carl Schmitt, jonglant avec brio avec l’histoire, le droit et la philosophie ; ce serait le rabaisser que d’y voir un livre simplement « brillant » comme on le dit si souvent, c’est bien plus que cela : c’est là un événement majeur de la pensée du XXème siècle, contestable certainement, et peut-être même contestable parce que majeur, mais au-delà des polémiques possibles, au-delà de l’aspect parfois très personnel de l’ouvrage, il y va d’une intelligence en acte et d’une séduction qui n’est pas tentation.
- Carl Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, Coll Quadrige, 2008
- Carl Schmitt, Le nomos de la terre, Traduction Lilyane Deroche-Gurcel, revue par Peter Haggenmacher, PUF, coll. Quadrige, 2008
- Présentation du Nomos de la terre, p. 1
- Jean-François Kervégan, Hegel et Carl Schmitt, le politique entre spéculation et positivité, PUF, coll. Quadrige, 2005, p. 32
- Carl Schmitt, Le nomos de la terre, p. 45
- Ibid. p. 45
- Ibid. p. 70
- Ibid. p. 73
- Ibid. p. 82
- Ibid. p. 121
- Ibid. p. 122
- Ibid. p. 125
- Ibid.
- Ibid. p. 143
- Ibid. p. 146
- Ibid. p. 133
- Ibid. p. 233
- Ibid. p. 241








