En 2018, Alain Laurent a eu l’excellente de publier aux Belles Lettres, dans la collection qu’il dirige, une sorte d’anthologie de textes1 permettant de se rappeler un mouvement politique et intellectuel qui fut à la fois éphémère et marquant, à savoir le mouvement C.I.E.L, acronyme signifiant « Comité des intellectuels européens libéraux », à ne surtout pas confondre avec l’actuel SIEL. Ce comité constitué autour de Raymond Aron dès 1978 mena un combat essentiellement hostile à l’Union Soviétique et au Programme Commun, et regroupa des penseurs pour le moins différents et inattendus, révélant le caractère hétéroclite de la pensée « libérale », et peut-être même son introuvable unité.
Alain Laurent, membre fondateur du CIEL et secrétaire général adjoint du Comité, présente dans ce livre à la fois le manifeste fondateur et les grandes interventions, aussi bien écrites qu’orales, de nombre de ses membres ou de ses sympathisants. Apparaissent ainsi plusieurs dimensions de l’ouvrage : si la plus évidente consiste à éclairer les sentiments d’un certain nombre de penseurs à l’endroit d’une situation historiquement datée, d’autres plus inattendues se superposent rapidement à la couche initiale. En effet, ce qui frappe avec vivacité est l’incapacité des auteurs à définir une doctrine voire un socle commun de principes sur lesquels s’accorder, la présence de Philippe Sollers venant à peine de sortir du maoïsme ou de Jean-François Revel se disant encore de « gauche » et très proche de Mitterrand, rendant plus qu’opaque la cohérence de l’ensemble. Idem, l’intervention de Jacqueline de Romilly – qui ne faisait pas partie du CIEL – montre à quel point le rapport à l’individu était problématique et soulevait déjà de graves et insolubles discussions.
En réalité, au-delà de l’intérêt historique de cet ouvrage, il nous semble qu’il constitue un symptôme tout à fait remarquable du caractère introuvable du libéralisme ; rien n’y est clairement défini, et si chacun se félicite de la liberté de parole qui y règne, nul ne semble prêt à en déduire que la pluralité contradictoire dans un « combat » est peut-être une force du point de vue de la liberté mais est une faiblesse cruciale du point de vue de l’efficacité. Nul mystère ne peut ainsi prévaloir dans la rapide disparition du comité qui, dès 1986, cesse ses activités, et révèle ainsi son impossible pérennisation.
A : Le contexte
L’ouvrage propose en son commencement une excellente présentation de l’histoire du CIEL par Alain Laurent qui permet de saisir les enjeux historiques du mouvement mais aussi le caractère disparate des motivations de ses membres, depuis la lutte contre l’Union Soviétique par le soutien à certains intellectuels dissidents de l’Est, jusqu’à la crainte suscitée par le Programme Commun, en passant par une sorte de réaffirmation anhistorique de certains principes jugés essentiels.

Tout commence ainsi le 26 janvier 1978 où, dans plusieurs quotidiens nationaux, paraît un texte intitulé La liberté ne se discute pas. La culture contre le totalitarisme., texte qui vise aussi bien le Parti Communiste français que la Nouvelle Droite qui connaît à l’époque une certaine audience, Parti Communiste et Nouvelle Droite communiant dans un anti-atlantisme résumé d’une formule cruelle par Raymond Aron : plutôt le commissaire soviétique que le hamburger de Brooklyn !2. Raymond Aron, Jean d’Ormesson, ou encore Philippe Sollers signent le texte, ce qui témoigne d’emblée de l’hétérogénéité du comité. On y trouve également de futurs soutiens de Mitterrand avec Gérard Depardieu, bien que le texte avait été soutenu en sous-mains par Raymond Barre et son cabinet.
Le 21 janvier avait eu lieu en amont une conférence au Lutetia où l’accent est mis sur la défense des intellectuels dissidents soviétiques, plus petit dénominateur commun des membres du comité. Cela jette d’ailleurs un certain trouble sur la nature du mouvement puisque l’on se demande s’il s’agit d’intellectuels défendant des intellectuels, ou s’il s’agit de penseurs réfléchissant les conditions tyranniques de l’Union Soviétique à la fin des années 70.
Dès lors, le CIEL se constitue assez vite, reçoit des adhérents, et organise la défense des droits de l’homme. Ionesco, Jean-Marie Domenach s’en mêlent et, une fois lancé, le Comité appuie des initiatives dont la célèbre organisation médiatique des bateaux pour le Vietnam. Il prend fait et cause pour Zinoviev, gagne en popularité, et reçoit régulièrement de nouveaux soutiens, comme Alain Besançon, Michel Drancourt, Eduardo Manet.
En 1979, le CIEL publie désormais un bulletin, tient ses assises en décembre, et des sociologues comme Michel Crozier ou Raymond Boudon s’y font remarquer par de grandes interventions.
A la fin de l’année 1980, des personnalités inattendues rejoignent le mouvement ; Levinas, d’abord, Edgar Morin, ensuite et de manière surprenante André Bergeron, secrétaire général de FO de 1963 à 1989. René Girard se joint lui aussi au comité tandis que la Pologne, martyrisée par l’URSS, occupe tous les esprits et devient la cause fondamentale du CIEL.
Avec l’élection de François Mitterrand – qu’avaient souhaitée des membres du CIEL comme Philippe Sollers ou Gérard Depardieu – le mouvement se politise, notamment devant la présence de ministres communistes au gouvernement. Annie Kriegel, Michael Lonsdale ou encore François-Georges Dreyfus rejoignent la cause qui semble promise à un certain avenir du point de vue politique en dépit des préventions initiales de Raymond Aron.
Mais, en 1983, la mort de Raymond Aron semble désorganiser quelque peu le Comité avant de le réorienter vers un aspect plus politique, et de nouveaux ralliements toujours aussi hétéroclytes se poursuivent en 1984 avec l’arrivée de Patrick Poivre-d’Arvor, Jacques Garello ou encore le général Méry, tandis que le CIEL connaîtra son point d’orgue l’année suivante autour d’un immense colloque organisé le 27 avril 1985 à la maison de la chimie auquel participent Emmanuel Levinas, Alain Finkielkraut, Michel Crozier, Jacqueline de Romilly, Brice Lalonde ou encore Pascal Salin.
Mais après ce point d’orgue, tout retombe. Alain Laurent interroge les causes de la cessation du CIEL après ce colloque et les attribue au succès du comité :
« C’est que d’une certaine manière, pour le CIEL, la mission est accomplie – sans toutefois qu’il faille surestimer son influence, son rôle ayant été plus celui d’un témoin et d’un catalyseur de prise de conscience que d’un acteur décisif. »3
Certes, le péril communiste a disparu, l’URSS amorce son déclin et les libéraux remportent les élections législatives de 1986. Néanmoins, Alain Laurent reconnaît que le manque d’unité du CIEL put être dommageable, au moins sur le plan économique, car, économiquement parlant, des penseurs comme Sollers, Leroy-Ladurie, ou encore Bergeron ne sont pas libéraux. Alain Ravennes est, quant à lui, un gaulliste de gauche qui est profondément antilibéral sur le plan économique. En outre, en 1985, une rumeur – justifiée – a associé le CIEL au Mouvement pour l’indépendance de l’Europe fondé par le gaulliste de gauche Georges Gorse dont la proximité avec les communistes était connue, ce qui jetait le trouble sur le caractère anticommuniste du Comité. Plus troublante encore était la répulsion du Mouvement pour l’Indépendance de l’Europe envers toute forme d’atlantisme auquel on sait à quel point Raymond Aron était pourtant acquis.
On voit ainsi dans l’histoire de cet éphémère Comité qu’une réunion d’intellectuels, soutenue officieusement par Raymond Barre, mais faisant rédiger son manifeste par un gaulliste de gauche antilibéral, regroupant gaullistes, libéraux, anciens Mao et socialistes libéraux a certes pu jouer un certain rôle dans l’histoire politique française mais était condamnée à dépérir rapidement au vu de son incohérence doctrinaire et idéologique, le seul soutien aux intellectuels de l’Est ne pouvant cimenter de manière durable des penseurs aussi différents.
B : L’introuvable unité
Au-delà donc de la dimension historique du volume, il est intéressant de noter l’incapacité des différents membres à se mettre d’accord sur des choses essentielles. Certes, ces désaccords chroniques et cette unité introuvable sont érigés en symptômes de leur liberté et de la pluralité démocratique, si bien que les obstacles objectifs au succès politique sont travestis en force intellectuelle et en expression même de la diversité inhérente aux principes libéraux ; mais, plus fondamentalement, la lecture des différents textes montre parfaitement la faiblesse structurelle du Comité. Symptomatique à cet égard est le texte cosigné d’Eugène Ionesco et d’Alain Ravennes, intitulé « l’homme, la culture et le pouvoir » :
« Nous lançons de larges débats sur des points essentiels, et sans prétendre les conclure par de fausses unanimités ni de bâtards compromis. Ils manifestent notre volonté non point de résoudre nos différences, mais de les protéger, de les maintenir vivantes et fécondes, dans une même et irréductible volonté de défendre l’entière liberté de la création, de l’expression, de la culture. Nous n’entendons pas nous mettre d’accord sur tout, mais refuser ensemble que l’on nous « mette d’accord » par une doctrine ou une pratique totalitaire. »4
Mais on peut se demander jusqu’à quel point « maintenir vivantes et fécondes » des différences peut être un objectif intellectuel. A cet égard, le texte d’Alain Ravennes, qui sert de Manifeste fondateur, apparaît comme extraordinairement faible et même contradictoire. Comme s’il pressentait la fragilité du mouvement et son introuvable unité, Ravennes faisait de l’hétérogénéité de ce qui allait devenir le CIEL l’expression même de la diversité européenne : « L’Europe, écrivait-il, n’a jamais été elle-même et vivante que dans la dissemblance et le foisonnement. »5 Et Ravennes de mobiliser la notion de contradiction inhérente à l’homme européen : « Il n’y a pas de patrie européenne, mais il y a un homme européen, aux contradictions incoercibles et fraternelles. Les libertés européennes, c’est d’abord la liberté pour chaque Europe, nous voulons dire chaque pays, chaque habitant du continent, d’être eux-mêmes. »6
Le problème évident de ce texte est qu’en insistant sur la « diversité » de l’homme européen et même sur ses « contradictions », il croit pouvoir justifier les contradictions internes au CIEL en tant que reflet de la réalité que le Comité doit défendre. Nous n’avons pas d’idéologie commune, écrit Ravennes, mais nous réclamons « le pluralisme idéologique, la diversité, l’enracinement et la spontanéité de la culture, en refusant que l’esprit humain puisse être borné, inhibé ou régenté par la dictature brutale ou insidieuse d’un « déterminisme historique ». »7 Pareille affirmation est très difficile à comprendre pour peu que l’on cherche à en saisir le sens précis: s’il n’y a pas d’idéologie commune, et s’il y a réellement une pluralité, alors on voit mal au nom de quoi il faudrait s’en prendre au communisme qui est une position parmi d’autres et qui pourrait rentrer dans la pluralité évoquée. Toutefois, si l’on décrète qu’il n’y a pas d’idéologie commune mais qu’il faut refuser le déterminisme historique, alors il y a au moins une « idéologie commune » qui est celle de l’individualisme faisant de l’individu la réalité suprême qui ne saurait être transcendée par aucune autre, et qui ne saurait en l’occurrence être déterminée par le mouvement de l’histoire. Nous avons déjà là un texte dont la cohérence est difficilement trouvable et qui est fort décevant ; mais le problème se redouble lorsqu’Alain Ravennes convoque Aristote : « Au sens strict, l’indivisible liberté ne s’énumère pas. De la même façon, toute loi sur la liberté est un contresens. Pourtant, « l’homme est un animal politique », la leçon ni la réalité ne sont neuves. »8
Si l’homme est un animal politique, il se définit en tant que membre d’une cité, donc par son appartenance à un cadre politico-naturel et il n’est pas un individu ou, plus exactement, ce n’est aucunement son individualité qui le définit et qui détermine sa réalité fondamentale. Pourtant, Alain Ravennes considère que l’acquis fondamental de l’Europe est justement l’individualisme et l’érection de l’individu en réalité suprême : « L’Europe moderne a inventé l’individualisme. Elle a été la première à poser l’être humain individuel comme une incarnation de l’humanité tout entière, à fonder les libertés politiques et personnelles sur le respect sans discrimination des lois générales. »9 Et ce serait justement cela que menacerait l’URSS, notamment à travers sa persécution des intellectuels dissidents.
Quoi qu’on pense de l’URSS et de la question socialiste, force est de constater que ce manifeste fondateur est médiocre, pour ne pas dire profondément incohérent, et qu’on peine à identifier la pensée dont il est porteur. Il est évident qu’Alain Ravennes passe à côté de ce que signifie le caractère politique de l’homme pour le Stagirite, et qu’il ne comprend pas non plus que certaines affirmations structurant le texte ne peuvent être considérées comme des évidences dénuées d’idéologie. Ainsi en va-t-il de cette proposition : « Alors, répétons que l’esprit ne doit admettre d’autres contraintes que celles par lui-même reconnues nécessaires à son action et à sa portée. »10 Naturellement, Aristote aurait profondément rejeté une telle déclaration signifiant que l’homme, loin d’être un animal politique, est un individu auto-déterminé. Et si l’individualisme est le gain européen détruisant le primat de l’appartenance collective, alors non seulement on ne voit pas du tout pourquoi Ravennes parle de l’animal politique mais, de surcroît, on ne voit pas en quoi il n’y aurait pas d’idéologie commune aux signataires du manifeste qui semblent tous adhérer à cet individualisme.
Cette impression de confusion et d’incohérence ne se dissipe jamais à la lecture de l’ouvrage, et même les interventions de Raymond Aron paraissent embarrassées. En conclusion des assises de juin 1982, celui-ci constate l’absence de consensus parmi les participants. On a des « discussions, non pas passionnées, mais divergentes quelquefois, toujours diverses. »11 Et Raymond Aron de préciser un point passionnant concernant les problèmes tactiques et stratégiques : le général Jacques Guillermaz a parlé de la Chine, de la nécessité d’armer ce pays alors même qu’il s’agit d’un pays socialiste exerçant une forte attraction culturelle, révélant donc l’ambiguïté de ce que combat le CIEL. Si ce dernier combat le socialisme comme tel, il doit faire de la Chine maoïste un pays ennemi ; mais si l’on intègre des intérêts géostratégiques, il peut être utile de s’allier à la Chine, indépendamment de la question idéologique, ce que constate désabusé Raymond Aron :
« En tant qu’intellectuels, en fonction des convictions du CIEL, de toute évidence, nous sommes contre le régime chinois. Mais le Général Guillermaz nous a dit qu’étant donné la situation internationale, nous avions intérêt à conforter, à renforcer la puissance militaire de la Chine. Je pense qu’il a raison ; je n’en suis pas sûr ; mais, en tout état de cause, une question de cet ordre cesse d’être posée de manière abstraite à un pur intellectuel. Inévitablement, nous devons devenir des analystes de la stratégie. »12
Cette remarque de Raymond Aron est au fond tragique. Lorsqu’il dit que « nous avons intérêt à renforcer la puissance militaire de la Chine », que signifient le « nous » et que signifie « l’intérêt » ? S’il y a un « nous », c’est que d’une certaine manière la communauté nationale ou européenne comme communauté politique transcende l’intérêt d’individus martyrisés par le régime chinois. Mais alors on délaisse le primat de l’individu qu’on abandonne à son sort funeste pour revenir à des considérations collectives d’animaux pour le coup politiques, et l’on revient à une sorte de Realpolitik que pourtant semblait congédier le Manifeste du CIEL. De la même manière, l’intérêt dont il est ici question renvoie à un intérêt national lié aux rivalités entre nations irréductible à la question de l’individu. En d’autres termes, en disant qu’il pense que le général Guillermaz a raison, Aron semble reconnaître l’impossibilité de conduire un combat « libéral » ou, en tout cas, « individualiste » dans le cadre des relations internationales où prévaut un certain réalisme politique. Et si le « nous » prévaut sur l’individu, alors pourquoi encore se réclamer du libéralisme si la stratégie révèle l’inanité de ce dernier ? Ajoutons que Raymond Aron ne consacra pas un mot au CIEL dans ses Mémoires pourtant parus en 1983, ce qui paraît indiquer en creux une certaine insatisfaction à l’endroit de ce Comité pour lequel il fut toutefois toujours disponible.
C’est en fait toute la question des principes sur lesquels repose le CIEL qui est en jeu. Il est par exemple très difficile de déterminer si le CIEL s’oppose par principe à la pensée socialiste ou s’il s’oppose à son application concrète. Une intervention de Michel Crozier est ainsi troublante car elle semble signifier que seule la mise en pratique du socialisme a échoué, et que le socialisme n’est donc pas à combattre par principe mais seulement en ses applications déviantes, thèse qui est sans doute aussi celle de Jean-François Revel qui a toujours soutenu un socialisme non marxiste. Crozier, dans son intervention, propose ainsi un état des lieux des désaccords, y compris au niveau principiel, et expose sa propre vision :
« Je pense que ce qui est le plus choquant dans la vision, dans le développement du socialisme, dans la pratique non dans sa théorie, c’est finalement que tout y devient impersonnel, que tout y devient sujet d’une concertation non préparée, qui est une sorte de grande confusion dans laquelle chacun s’épuise, sans pouvoir vraiment donner un peu plus que / de l’opinion qui ensuite va être confondue, triturée avec celle des autres, en fonction d’un objectif qu’il ne reconnaît pas. »13
C : Idéologie et politique
Au-delà de l’introuvable unité et même de l’introuvable cohérence du Comité, se joue un autre élément qui relève d’une sorte de méfiance intrinsèque envers le politique – ce qui rend d’ailleurs d’autant plus incompréhensible la convocation par Alain Ravennes de la notion aristotélicienne d’animal politique dans le Manifeste.
Dans l’optique libérale, il semble que la seule menace pesant sur l’individu soit celle émanant du pouvoir politique de sorte que le plus petit dénominateur commun que puissent partager les membres du CIEL consiste à protéger les individus des volontés démesurées de façonner les hommes dont le politique est porteur. Avec son ambition structurelle de façonner un homme nouveau, libéré des vices sociaux, le socialisme constitue une menace de premier ordre du point de vue libéral dès lors qu’il s’empare de l’Etat ; mais on voit aussitôt pourquoi la lutte contre le socialisme se fait hésitante car, si c’est le pouvoir politique qui menace l’individu, alors ce sont moins les principes socialistes comme tels que l’exercice concret du pouvoir qui constitue un problème. Dès lors, on comprend mieux les propos d’un Michel Crozier incriminant la pratique socialiste et non la théorie, puisque c’est au fond le pouvoir et l’Etat qu’il déplore davantage que le socialisme lui-même.
Il y a en effet une prétention du pouvoir politique de connaître les fins vers lesquelles tendent les individus qui justifient un certain nombre de coercitions auxquelles sont allergiques les libéraux. Tout en étant gaulliste de gauche, Alain Ravennes ne cesse néanmoins de réclamer la séparation de la politique et de la culture, afin de laisser la culture se développer de manière spontanée – on se demande ce qu’il pensait de Malraux… – et de ne pas attribuer à la sphère politiqued’ingérence culturelle et civilisationnelle. Toute pensée finale est mortelle pour la culture affirme le Manifeste.
Ce que l’on comprend à la lecture de nombre de textes dont le plus clair est celui de Ionesco et Ravennes, c’est la détestation du pouvoir politique et la crainte que ce dernier soit la source de tous les maux publics, le pouvoir politique étant le coupable universel et exclusif des problèmes rencontrés par les individus dans la sphère publique :
« Nos censeurs auraient dû savoir que notre première préoccupation est de refuser que la politique puisse régenter ou délimiter la culture, prétende définir et commander le bonheur et d’affirmer à l’inverse le primat de la culture et de la personne humaine.
La politique est un mal nécessaire pour organiser, sous le contrôle du suffrage universel – seul moyen constitutionnel d’éviter la tyrannie –, les éléments inévitablement sociaux et collectifs de la vie. »14
En d’autres termes, le politique n’a pas à se mêler du beau, du vrai, du bien. Mais alors, à quoi sert-il ? Quelque chose dans le libéralisme contient les germes d’une profonde dépolitisation car si le politique n’est jamais que l’élaboration des moyens par lesquels se trouve protégé l’individu, alors le politique n’est plus qu’une sorte de gigantesque assurance perdant justement sa dimension politique, ce dont les auteurs ont sans doute conscience ainsi qu’en témoigne la précision suivante :
« Le libéralisme politique reste moqué pour sa mollesse, sa banalité, son manque de foi. Mais il est la seule conception et la seule pratique compatibles avec la dignité de la personne humaine. Car, précisément, la foi, la conviction, le désir doivent rester des apanages des l’individu. Et l’on sait où s’achève toujours l’exaltation du groupe et de sa puissance : à Dachau ou dans l’archipel du Goulag. »15
Il y a là évidemment quelque chose de profondément problématique ; si l’on fait de l’individu la réalité suprême, alors il va de soi que tout objectif politique, en tant qu’il serait collectif, constitue une menace pour la dignité de l’individu ; mais la dignité de l’individu est-elle la même chose que la dignité de la « personne » ? Et le politique reste-t-il un cadre politique dès lors que sa mission, si l’on peut dire, n’a de sens qu’à la mesure de renoncer à tout projet collectif, à toute finalité en vue de permettre à chaque individu de préserver sa supposée individualité ? En quoi le politique n’est-il pas ici une sorte de gigantesque mutuelle ramenée au service de l’individualité ? Et plus encore, qu’est-ce qui assure l’unité sociale – et donc la pérennité d’une société – dès lors que le pouvoir politique renonce à tout objectif, y compris celui de l’unité sociale ?
Tout le problème du libéralisme apparaît dans ces quelques lignes : il considère comme évident que l’homme est un individu et, plus encore, qu’il est d’emblée un individu. Mais on peut tout à fait émettre de sévères réserves à l’endroit de cette croyance et suivre en cela la remarquable intervention de Jacqueline de Romilly qui montre qu’il est au moins un objectif du pouvoir politique dans un Etat libre, à savoir façonner les hommes en vue d’en faire des individus ; on comprend d’ailleurs pourquoi cette dernière se tint à distance du CIEL, sans doute parce qu’elle ne croyait pas à cette spontanéité de l’individualité qui semble innerver la pensée de nombre de ses membres. « Je conçois, explique Jacqueline de Romilly, qu’il y ait quelque paradoxe à offrir comme des moyens de façonner l’individu et l’individualisme ce qui constitue en apparence leurs limites : maintien du rôle de l’Etat, restauration de la discipline, revalorisation de la culture et du passé. »16 Et la grande helléniste de conclure par l’idée que l’individualisme n’est possible que dans une « collectivité organisée »17
D : l’indétermination du libéralisme
Cette discussion permet de prendre conscience de deux problèmes inhérents au libéralisme. Le premier nous semble tenir à la restriction de l’identification des menaces contre la liberté individuelle à la seule sphère du pouvoir politique, comme si la société civile était par principe exempte de germes liberticides. Il est à cet égard assez étonnant de considérer que, même dans les années 1980, ces auteurs si soucieux de liberté ne semblaient attribuer qu’à l’Etat le pouvoir coercitif et ainsi dédouaner l’ensemble de la société civile de toute forme de coercition aussi bien idéologique qu’économique. Certes, le repoussoir qu’était l’Union Soviétique braquait le projecteur sur un Etat tout aussi tyrannique que haïssable, et les circonstances pouvaient justifier cette restriction de l’analyse à la menace la plus visible : mais il est étrange de constater qu’aucun texte reproduit dans l’ouvrage ne semble envisager la dimension liberticide née de mouvements civils, qu’il s’agisse d’associations, de pouvoirs économiques et financiers, ou encore d’idéologies nées au sein de la société civile.
Un symptôme de cette cécité est offert par l’intervention de Karl Popper à l’occasion de la remise du prix Tocqueville ; alors que l’on s’attendrait à un hommage rendu à la clairvoyance tocquevillienne comprenant que les sociétés démocratiques connaissaient une dépolitisation croissante rendant l’Etat inoffensif et transférant les menaces liberticides vers la société civile elle-même, on assiste à une sorte de discours suranné au sein duquel Popper cherche à sauver la pensée de Tocqueville de toute dimension historiciste et laisse de côté tout ce qui fait de l’analyse tocquevillienne de la démocratie un des outils de compréhension les plus puissants du monde démocratique.
La seconde limite du libéralisme, particulièrement visible à l’issue de la lecture de ces différents textes, réside dans la gigantesque indétermination de ce dernier, rendant impossible l’identification de ce qui est libéral et de ce qui ne l’est pas. Si l’on prend un cas très concret comme la multiplication des safe spaces dans les campus américains, il est très difficile de déterminer si cela est une conséquence logique d’une vision libérale pour laquelle l’individu devient tellement sacré que l’offense même intellectuelle n’est plus tolérée ou si, à l’inverse, il s’agit d’une mesure antilibérale de restriction coercitive de la liberté de parole. Mais cette limite est elle-même aggravée par la difficulté du libéralisme à penser les coercitions nées de la société civile et à les identifier comme coercitions. On peut ainsi avoir, comme aux Etats-Unis, une Constitution qui, par le Premier Amendement, garantit la liberté d’expression au niveau fédéral tout en connaissant une multiplication des safe spaces issue de volontés civiles et menaçant très concrètement la liberté de nombre d’orateurs, la police étant régulièrement appelée pour protéger physiquement des orateurs tenant des propos ayant le malheur de heurter certaines sensibilités. Il est, au vu de l’indétermination foncière de la pensée libérale, absolument impossible de déterminer si ces situations sont une stricte et nécessaire conséquence de la pensée libérale ou, au contraire, l’expression de l’émergence de forces profondément antilibérales, car on peut y voir avec John Gray l’expression évidente d’un « ultra-libéralisme » développant sa logique jusqu’à son terme[Un article éclairant de John Gray peut être [consulté à cette adresse.[/efn_note] ou, inversement, la manifestation de pensées collectivistes où l’individu se définit prioritairement par l’appartenance de groupe, de sorte que le sentiment d’appartenance au groupe absorberait jusqu’à l’absurde l’individualité.
Il en va de même pour les Gender Studies et, plus généralement, de l’inclusivité, dont il est très difficile de déterminer si elles sont l’expression d’une pensée néomarxiste visant à déconstruire les reliquats de naturalité pour imposer l’idée que tout est social ou, à l’inverse, l’expression d’une pensée libérale imposant de prendre en compte toutes les formes possibles d’individuation au nom du caractère sacré de l’individualité. En somme, il est impossible de déterminer si les mouvements contemporains d’émancipation sont inspirés par la libération de l’individu à l’endroit de normes l’écrasant ou s’il s’agit de volontés collectivistes de purification du champ social présupposant que le social constitue le cadre impur devant sans cesse être reformé. La récente arrivée de Laura-Maï Gaveriaux dans le comité dirigeant du think tank libéral et libertaire Génération libres exprime fort bien cette indétermination radicale des fondements mêmes du libéralisme.
E : Ambiguïtés libérales
En fin de compte, il est probable que le libéralisme ne soit pas une doctrine unifiée ni une pensée cohérente mais bien plutôt un tempérament consistant à éprouver une certaine défiance instinctive envers un type de danger très précis, à savoir les abus du politique. Etat d’esprit plus que corpus dogmatique, manière de sentir davantage qu’analyse précise de la liberté, il se méfie de l’Etat dès lors que celui-ci prétend détenir des connaissances que nul ne peut détenir et ce, parce qu’en prétendant les détenir, l’Etat vise à les imposer à chacun, occasionnant à la fois une situation liberticide – impositions arbitraires de fins à l’individu – et générant en même temps une considérable perte d’efficacité – l’Etat ne saurait mieux comprendre les éléments particuliers du monde social et du marché, et son intervention ne peut à ce titre qu’être parasitaire.
Néanmoins, c’est essentiellement l’aspect liberticide et donc axiologique que privilégient les membres du CIEL, ainsi qu’en témoigne le manifeste de juin 1982, où les membres de CIEL précisent leur rapport à la politique :
« Rappelons-le : lorsque la politique prétend distinguer le bien et le mal, le fatal et le futile, les justes et les injustes, les hommes de l’avenir et ceux du passé, elle entre dans la « folie » et l’abus, alors que sa fonction est de raison / et de mesure. La résistance intellectuelle, c’est d’abord s’opposer à l’excès de la politique. »18
Mais là encore se joue une ambiguïté car il est très difficile de déterminer quand et où commence l’excès ; il semble en effet que, dans une perspective libérale, le politique soit par lui-même excessif, et qu’il ne soit toléré qu’à la mesure de sa propre dépolitisation. En outre, apparaît une autre difficulté : pour quelle raison le pouvoir politique devrait-il renoncer à toute forme de détermination morale et axiologique au sein de la société civile ? Les raisons semblent extrêmement variées, et paraissent procéder de niveaux différenciés d’analyse. Elles semblent tantôt cognitives, la complexité du monde social étant telle que nul ne saurait raisonnablement prétendre connaître ce qui serait bon et sain pour la société, tantôt morales, l’individu n’ayant pas à subir la coercition d’une entité transcendante. Mais, dans le premier cas, les ingérences du pouvoir politique relèveraient plutôt de l’inefficacité et de l’absurdité, tandis que dans le second elles seraient liberticides, et il n’est pas anodin de voir Hayek sans cesse osciller de l’une à l’autre des raisons sans jamais signaler le glissement.
Si l’on se réfère à Droit, législation et liberté, il apparaît qu’Hayek place argumentativement le curseur sur l’aspect gnoséologique du monde social dont la complexité de détail interdit toute vue d’ensemble satisfaisante :
« Pour procéder à cette tâche, nous devons rappeler une fois de plus le fait fondamental mis en relief au début de notre étude : l’impossibilité pour qui que ce soit de connaître tous les faits particuliers sur lesquels est fondé l’ordre global dans une Grande Société. C’est l’une des étrangetés de l’histoire intellectuelle, que dans la discussion des règles de conduite, ce fait crucial ait été si peu pris en considération, alors que seul il rend intelligible la signification de ces règles. Les règles sont un artifice pour parer à notre ignorance constitutive. »19
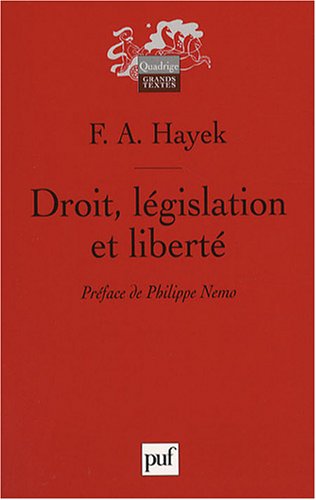
Mais alors, si l’on supposait par l’absurde que les faits particuliers étaient connaissables par l’Etat, faudrait-il continuer à refuser une organisation sociale artificielle en vue d’orienter au mieux la société ? On voit ici que la question axiologique refait aussitôt surface car si le fondement du problème est gnoséologique, on ne voit pas bien pour quelle raison il faudrait refuser la construction artificielle d’un ordre fondé sur une connaissance parfaite du particulier, sauf si le refus d’une autorité transcendante était axiologiquement justifié, ce qu’il n’est pas chez Hayek. C’est au contraire l’incapacité structurelle de toute entité à connaître en détail la complexité du social qui semble fonder la défense de la liberté individuelle, Hayek précisant que « tout examen de l’ordre moral ou légal qui ne tient pas compte de ce fait passe à côté du problème central. »20.
Pourtant, au début de DLL, comme pour conjurer ce faux-semblant, Hayek considère que la liberté doit être affirmée de manière dogmatique et sans justification, sa défense étant l’inconditionné du politique car un système ne demeure libre que si l’on rejette les mesures permettant d’obtenir certains résultats particuliers :
« Une défense efficace de la liberté doit par conséquent être dogmatique et ne rien concéder aux expédients, même là où il n’est pas possible de montrer qu’en regard des avantages de l’expédient, qui sont connus, certaines répercussions nuisibles précises découleront de l’atteinte à la règle. »21
De nature axiomatique, la liberté n’a pas à être justifiée, et le libéralisme est moins une doctrine qu’une protection principielle de cet axiome. Il faut alors en déduire que la limitation structurelle de la connaissance du monde social ne saurait dire quoi que ce soit de la liberté, laquelle est hypostasiée en axiome que rien ne saurait fonder, le libéralisme n’étant donc pas une doctrine mais la défense inconditionnée de cet axiome, lequel se trouve être justifié par une raison extérieure, à savoir la radicale inefficacité de l’intervention politique.
Conclusion
Ce recueil de textes assuré par Alain Laurent est plus que bienvenu ; s’il a le mérite d’éclairer un mouvement intellectuel quelque peu oublié quoiqu’important, il présente également sous une forme synthétique nombre de discussions et de désaccords inhérents à la pensée libérale dont il n’est pas sûr qu’ils soient surmontables.
Le paradoxe est qu’il est difficile, à l’issue de la lecture de ce volume, de partager l’analyse qu’avait pourtant menée Alain Laurent dans un ouvrage par ailleurs de grande qualité, à savoir que le libéralisme serait bien une philosophie et non un sentiment ni une inspiration. Dans La Philosophie libérale, Alain Laurent prenait en effet le contrepied de Lucien Jaume et affirmait que le libéralisme « est en soi une philosophie – ou mieux : il résulte d’une activité proprement philosophique de l’esprit humain. »22 Et Alain Laurent de justifier cette affirmation en montrant que le libéralisme est une démarche philosophique en tant qu’elle est attachée à partir de prémisses énoncées dans le cadre d’un travail rigoureux, argumenté, menant à des résultats cohérents.
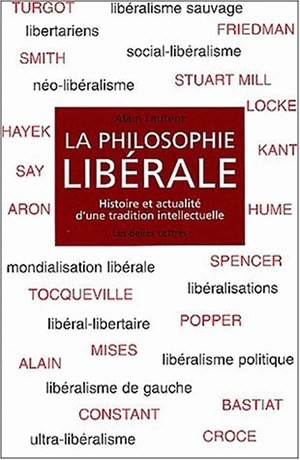
Mais n’est-ce pas ici confondre philosophie et axiomatique ? Et, plus encore, n’est-ce pas éliminer d’emblée le caractère problématique de la nature de l’axiome qui, pour être un axiome, doit être rationnellement évident à défaut d’être démontrable ? Or, rien n’est moins évident que l’idée d’une liberté individuelle spontanée, et si l’on est tout disposé à reconnaître avec Jean-Marie Domenach que la liberté individuelle devient une évidence lorsque l’on souffre de sa privation, il est impossible d’en déduire sa nécessité axiomatique – et exclusive, une nécessité ne pouvant être déduite d’une situation conditionnée. C’est en ce sens que l’on peut penser le libéralisme comme un antidote contre certains poisons liberticides davantage que comme une doctrine cohérente et unifiée, dont chaque principe semble irrémédiablement indéterminé.
- C.I.E.L. Un combat intellectuel antitotalitaire. 1978-1986, Présenté par Alain Laurent, Paris, Belles Lettres, 2018
- cf. Raymond Aron, Mémoires, Paris, Robert Laffont, Coll. Bouquins, p. 936
- Ibid., p. 24
- « L’homme, la culture et le pouvoir », cité p. 92.
- Alain Ravennes, « Manifeste fondateur : la liberté ne se discute. La culture contre le totalitarisme », cité p. 29
- Ibid., p. 30
- Ibid., p. 34
- Ibid., p. 31
- Ibid., p. 30
- Ibid., p. 32
- Raymond Aron, « conclusion des assises de juin 1982 », cité p. 47
- Ibid., p. 48
- cité p. 76-77
- art. cité, p. 93
- Ibid.
- Jacqueline de Romily, « L’individualisme dans et par l’enseignement », cité p. 135
- Ibid., p. 136
- « Une résistance intellectuelle », cité p. 153-154
- Hayek, Droit, législation et liberté, Traduction Raoul Audouin et Philippe Nemo, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2007, p. 335
- Ibid.
- Ibid., p. 168
- Alain Laurent, La philosophie libérale, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 38








