On connaît le rapport paradoxal de René Girard à la France et à l’Université : il mena sa carrière, de son doctorat à ses postes de professeur, aux États-Unis mais fut élu, en 2005, à l’Académie française ; ses ouvrages connurent un beau succès auprès du grand public cultivé mais furent très largement ignorés par les universitaires, assurément en raison d’une méthodologie hâtivement jugée bancale (fonder une anthropologie sur la littérature !) mais également du caractère explicitement chrétien de sa pensée : « Si Girard indispose, c’est parce qu’il ne cachait pas de voir dans les Écritures juives et chrétiennes une source unique et irremplaçable d’intelligence anthropologique » (p. 24). On en arrive alors à cette situation inconfortable que les travaux portant sur la pensée de Girard foisonnent dans le monde alors qu’ils se font bien plus discrets en France. Nulle surprise, dès lors, que Bernard Perret puisse espérer que son ouvrage contribuera, d’une façon ou d’une autre, au développement des études girardiennes.
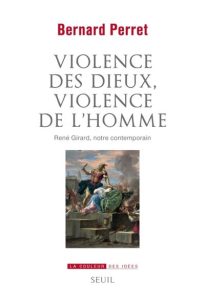 Violence des dieux, violence de l’homme poursuit deux objectifs qui se formulent de la façon suivante : d’une part offrir une synthèse critique de l’œuvre Girard ; d’autre part, « esquisser une sociologie historique girardienne centrée sur la question de la violence » (p. 25), projet qui tente de prolonger la réflexion anthropologique de Girard dans des directions que lui-même n’explora guère, plus particulièrement dans celle d’une analyse des sociétés modernes.
Violence des dieux, violence de l’homme poursuit deux objectifs qui se formulent de la façon suivante : d’une part offrir une synthèse critique de l’œuvre Girard ; d’autre part, « esquisser une sociologie historique girardienne centrée sur la question de la violence » (p. 25), projet qui tente de prolonger la réflexion anthropologique de Girard dans des directions que lui-même n’explora guère, plus particulièrement dans celle d’une analyse des sociétés modernes.
Cinq chapitres composent le livre de Bernard Perret : le premier donne un aperçu synthétique de la pensée de Girard tandis que le deuxième confronte l’anthropologie mimétique avec d’autres champs du savoir : la neurobiologie, la psychanalyse, l’anthropologie. La troisième partie est tout entière centrée sur la question de la violence préparant ainsi les analyses du cinquième et dernier chapitre consacré à la question de la violence dans les sociétés modernes caractérisées par l’ouverture et l’interdépendance généralisées. Quant à la quatrième partie, elle présente la spécificité judéo-chrétienne, des écrits prophétiques de la Bible jusqu’aux Évangiles.
Puisqu’il n’est guère question, dans une recension aussi brève, d’embrasser l’ensemble de l’ouvrage, centrons-nous sur la question de la violence qui, au fond, du titre à la dernière partie, forme le leitmotiv du travail de Bernard Perret.
Pour Girard, le désir est de nature imitative, il s’enracine dans un triangle dont les sommets sont le sujet désirant, l’objet du désir et le médiateur : l’erreur commune est ici de considérer que tout un chacun court après les mêmes biens alors que le désir, fondamentalement, vise à travers l’objet de la convoitise l’être même du médiateur. C’est à partir de cette base, celle de la rivalité engendrée par le désir mimétique, que la violence se trouve analysée dans le grand livre de 1972, La Violence et le Sacré. Girard met en évidence que les pratiques sacrificielles ont pour but de concentrer la violence sur une victime innocente – le bouc émissaire – afin de protéger la communauté d’une propagation des passions destructrices. En ce sens, la culture est une œuvre de méconnaissance car elle masque les mécanismes de violence à l’œuvre dans toute société : l’animosité des uns pour les autres se métamorphose en une unanimité vengeresse et fédérative dirigée contre la victime, la seconde étape recouvrant la première et la reléguant dans l’oubli. Notons enfin que Girard n’hésite pas à universaliser les analyses précédentes en affirmant que toutes les pratiques ritualisées, et non le seul sacrifice, obéissent aux mêmes mécanismes de jugulation de la violence.
C’est à partir de cette anthropologie que se comprend la singularité judéo-chrétienne, et que Girard donne à la révélation un sens à proprement parler épistémologique : ce que révèlent en effet certains textes vétéro-testamentaires et de façon encore plus décisive les Évangiles n’est autre que le mécanisme de la violence que les autres cultures et religions laissaient dans l’ombre du sacrifice : « Le mythe est contre la victime, alors que la Bible est pour » affirme ainsi Girard de façon péremptoire (p. 242). Ce retournement de perspective est à l’origine d’une mise en lumière de la violence et conduit même, dans le christianisme, à une identification de Dieu aux victimes des pratiques sacrificielles et, par extension, à l’ensemble des personnes souffrantes. La Passion devient alors l’événement d’une théologie contre-sacrificielle : en prenant la place de la victime, le Fils de Dieu expose aux yeux de tous l’injustice d’une société fondée sur la violence.
Qu’en est-il alors de la violence et du sacrifice dans les sociétés modernes et sécularisées qui ont largement renoncé au christianisme ? Qu’en est-il également de la violence et du sacrifice dans des sociétés de plus en plus horizontales qui décuplent les relations de rivalité ? Comme l’affirme Bernard Perret, « notre situation a bel et bien un caractère apocalyptique, mais ce n’est nullement dû à une incapacité foncière et définitive de maîtriser la violence par des moyens de moins en moins tributaires de l’esprit du sacré violent : toute l’histoire prouve le contraire. Si notre situation est apocalyptique, c’est parce que l’intensification des interdépendances sociales et des contraintes de survie collective nous oblige à franchir de nouvelles étapes dans la construction d’un ordre humain non violent et que rien ne nous garantit que nous en sommes capables » (p. 313). Comment l’anthropologie mimétique pourrait-elle nous aider dans ce contexte ? C’est à cette question, urgente, que tente de répondre Bernard Perret dans la dernière partie de son ouvrage, mais ce sont assurément ces développements qui laissent le lecteur insatisfait : car dire que les modèles de comportement se substituent à l’imitation rituelle de la violence chez Platon, énoncer que les rois reportèrent sur leur personne la violence de la société, souligner que la concurrence n’est autre que la ritualisation moderne de l’antagonisme mimétique, rappeler que la démocratie est le seul régime qui prend pour principe l’élimination de la violence, etc., ne nous semble hélas pas constituer des pistes de réflexion à la hauteur de la question soulevée.








