Un projet monumental
Nous ne pouvons pas présenter cet ouvrage sans commencer par les premières lignes des « Remerciements » :
« Ce volume s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Raison et Révélation : l’Héritage Critique de l’Antiquité — financé par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada (subvention Partenariat 2014-2021), sous la direction de Jean-Marc Narbonne.
Il correspond au Thème 1 de ce grand projet septennal, qui en compte au total 3. Dans son ensemble, cette recherche débouchera sur trois publications interconnectées chez le présent éditeur :
L’esprit critique dans l’Antiquité, tome 1 : Critique et licence dans la Grèce antique
L’esprit critique dans l’Antiquité, tome 2 : La naissance de la théologie comme « science » (actes du colloque de Paris en 2019)L’esprit critique dans l’Antiquité, tome 3 : Renouveau culturel et postures critiques à l’époque impériale et dans l’Antiquité tardive (actes du colloque de Québec prévu en 2021) »1
Il s’agit donc du premier tome d’un long travail de recherche de sept ans qui a pour projet éditorial de déboucher sur trois tomes. Ce premier ouvrage réunit déjà vingt chercheurs et chercheuses intervenant depuis dix-sept universités ou centres de recherche (Université Grenoble Alpes, Université de Milan, Université d’Uppsala, Université de Montréal, Université Laval, Université libre de Bruxelles, Université Paris Sciences Lettres, CNRS, Université de Liège, Université Sorbonne Université, Université de Perpignan, Université de Novi Sad, Université Panthéon-Sorbonne, Faculté de philosophie de The New School for Social Research, Collège de France, Université de Cambridge et la Faculté de philosophie de la Pontificia Università Lateranense).
L’ampleur des énergies et des connaissances mobilisées — dont nous allons vérifier tout au long de cette lecture la pertinence, la nécessité et, surtout, l’efficacité en ce premier quart du XXIe siècle — est à l’image du projet qui est d’emblée fixé par le constat de l’Avant-propos de Jean-Marc Narbonne (pp. 9-30), dans lequel l’héritage de la pensée « critico-sceptique fondamentale » (p. 10) que notre occident culturel tire de la Grèce antique pose la question des conditions de réception de ce legs. Il est donc question dans ce premier tome d’aller au devant des critères de réception de la pensée de la Grèce antique par la modernité. Quatre grandes parties abordent cette vaste perspective herméneutique sur les conditions de formation antique du rapport moderne à la connaissance, selon autant de thèmes épistémologiques : Religion et approche critique du religieux (pp. 57-189), Savoir, paradoxes et scepticisme (pp. 193-281), Critique sociale et politique (pp. 285-389) et Licence politique et licence artistique (pp. 417-552).
Projet monumental, démarche critique, le livre réunit dix-neuf interventions qui permettent de réactualiser l’identité de la modernité à partir d’une enquête fondamentale portant sur le ou les comportements de la Grèce Antique. Nous allons donc traverser ce livre et plusieurs de ces textes pour tenter de comprendre en quoi la démarche envisagée permet de réviser l’identité de la pensée moderne à partir d’une revalorisation minutieuse et plurivalente (le mot est donné) de ce dont elle hérite, à savoir le bouillonnement continu, hétérogène, multiple et, il faut peut-être l’écrire, ante-monothéiste du rapport à la connaissance du panhellénisme.
Il semble en effet que la compréhension moderne des processus intellectuels de la Grèce antique ait longtemps dépendu des limites de forme de la pensée qui analysait ces processus, relevant d’une erreur dans la méthode rationnelle, et d’une une erreur d’ordre idéologique.
L’erreur d’une première modernité ayant eu à cœur de lire les anciens se donne particulièrement à voir avec un extrait de Hermotimos ou les sectes de l’auteur Lucien de Samosate (IIe siècle de notre ère), dont nous donnerons ici directement la synthèse qu’en propose Jean-Marc Narbonne :
« Un personnage, nommé « Hermotimos », s’astreint à une discipline de fer afin de maîtriser la philosophie et de parvenir au bonheur escompté. Il se trouve que son choix s’est porté sur le stoïcisme. Lykinos (prête-nom de Lucien dans l’essai), lui fait voir qu’on ne peut choisir une philosophie particulière avant de les maitriser toutes, l’embûche étant qu’une vie humaine entière ne peut justement pas suffire à une telle tâche. La multiplicité des doctrines philosophiques, qui toutes prétendent au vrai, empêche par conséquent tout choix réellement légitime et fondé. Alors quoi, la situation se trouverait-elle sans issue ? Nullement, et c’est à partir de là que Lucien, prêtant sa voix à la « Raison » personnifiée elle-même, va désormais prendre la parole et expliquer à Hermotimos ce qu’il convient de faire dans ces circonstances. Plutôt que de parcourir sans fin toutes les doctrines l’une après l’autre, argue-t-il, la seule voie envisageable ou le seul procédé probant consiste à développer une véritable méthode de critique et d’examen des données. »2
Utiliser les sectes ou doctrines philosophiques existantes comme autant de schémas structurels permettant d’accéder à la raison critique, voilà donc le projet que formule la démonstration de Lucien de Samosate. Les différentes traditions philosophiques, c’est là tout l’enjeu d’une culture de la complexification dans l’accumulation, étudiée par Elsa Bouchard :
« Au-delà du vocabulaire [de l’agôn], la démarche même des dialogues [socratiques], qui procèdent par essais et erreurs, avancées et retours en arrière, propositions et réfutations, repose essentiellement sur le principe de la confrontation et de la mise à l’épreuve. »3
C’est même un argument essentiel et si l’on cherche la cohérence ou l’homogénéité du platonisme de première main, par exemple, nous sommes souvent confrontés à des airs de paradoxe. Par exemple, comment est-il possible que Platon critique aussi durement le mythe et choisisse simultanément de recourir à son écriture dans le cadre de certaines démonstrations (nous pouvons par exemple penser au Timée) ? C’est qu’il convient de considérer la plurivalence comme un trait spécifique de la pensée panhellénique.
« L’écriture de Platon démontre clairement l’aspect cumulatif de l’agôn, qui a pour effet d’absorber les discours concurrents plutôt que de les éliminer. La variété extrême des dialogues platoniciens, tant du point de vue du fond que de la forme, peut être considérée comme une manifestation typique d’une écriture agonale. La polyvalence des compétences affichées par le personnage de Socrate dans ces dialogues s’explique de la même façon. »4
Ce n’est sans doute pas un hasard, dès lors, si le titre de ce vaste projet, pose la critique à partir de la reconnaissance de la pluralité intrinsèque de la pensée grecque ancienne comme objet central de l’épistémologie moderne : refuser une herméneutique trop préoccupée par ses propres obsessions idéologiques.
Rendre à la pensée de la Grèce antique sa liberté
Le siècle des Lumières, ou Aufklärung pour l’idéalisme allemand, a souhaité trouver dans quelques penseurs de l’antiquité grecque une certaine affinité avec les termes de leurs propres luttes. Xénophane de Colophon (pp. 121-141) en est pour deux raisons l’illustration parfaite : d’abord parce que ce philosophe et critique grec de la religion a montré que la représentation d’un dieu dépend des formes du peuple qui le projette, c’est-à-dire que les dieux anthropomorphique sont des créations de l’homme. On imagine fort bien en quoi les philosophes du XVIIIe siècle se sont sentis concernés par cette démarche critique, projetant sur la Grèce antique leur propre adversaire monothéiste. L’ensemble de l’étude de Simon Fortier tend à faire vaciller la pertinence d’une telle identification, notamment, et c’est là le second point, qui nous intéresse peut-être plus encore : l’intelligibilité de la démarche de Xénophane est un argument au crédit de cette polyvalence évoquée par Elsa Bouchard, dont nous proposons de réunir la dynamique et l’épistémè sous le terme de « plurivalence », à la suite de la lecture de l’Avant-propos.
Cet auteur nous permet de cerner un caractère essentiellement original de la tradition grecque et d’observer comme la lecture philosophique moderne, tendue vers un objectif polémique ou idéologique, a brutalisé sa lisibilité afin de la faire entrer dans une conception finie et arrêtée : celle de la lutte contre les « superstitions » et autres faiblesses de l’entendement propre à tout esprit religieux. Autrement dit les luttes et les arguments de Xénophane de Colophon subirent une translation pure et simple hors des contextes culturels et politiques de ses énoncés, de sorte que dans cet affrontement décisif entre raison calculatrice (connaissance par la science) et raison spéculative (connaissance par la foi), il devînt l’une des « preuves » au XVIIIe siècle de ce que le rationalisme passait nécessairement par une critique radicale du phénomène religieux. Dès lors il devient le parfait exemple d’une pensée à double-temporalité d’analyse et de réception des processus et phénomènes intellectuels à l’œuvre en Grèce antique.

Brandi par les lumières comme un « aufklärer » (p. 125- p. 140) ou sa préfiguration, Xénophane est même plagié par Voltaire (p. 125). Cependant le poète et critique semble surtout témoigner d’une tradition autre et « agonale » du rapport au divin, plutôt que d’un esprit critique et extraordinaire dans son époque (p. 129). Il semble vraiment qu’un Xénophane « aufklärer » soit le produit de Lumières trop hâtives (pp. 137-138), de même que l’a probablement été le Père de l’Église Clément qui citait déjà la préférence de Xénophane pour un dieu supérieur et unique. S’il a sans aucun doute tenu de tels propos, il en a tenu d’autres dans le même temps et dont la contradiction aurait pu être dérangeante pour une réception univoque de la pensée de Xénophane (essentiellement plurivalente). L’exemple de ce poète tend à montrer la dangerosité d’une approche de la Grèce antique à partir de nos propres clichés, convictions ou ambitions épistémologiques.
Il faudrait donc pour ce faire la lire pour ce qu’elle est et, comme nous y invite Lucien Jerphagnon, adopter une attitude critique radicale vis-à-vis des commentateurs dont les avis, du fait de la longue histoire herméneutique de ces textes, tendent à supplanter la réception originale et première du texte. Dès lors, la méthode revendiquée par l’excellent professeur tend à souligner la valeur de la démarche tout entière de l’ouvrage dont nous proposons une recension : pratiquer à partir des éléments textuels une herméneutique critique — et mesurée — en comparant entre elles, dans la mesure de la nécessité, les différentes traditions exégétiques.
« La tentation de donner une primauté absolue aux traditions, aux commentaires, et spécialement aux relectures contemporaines du texte, par des gens dont les vues nous plaisent, et ainsi de se donner chacun à soi-même une fête intellectuelle, qui consiste à « avoir compris que… ». Mais il suffit de rapprocher entre eux tous ces gens qui « ont enfin compris » pour s’apercevoir qu’ils ont compris des choses souvent très différentes et pas toujours conciliables, ou tout simplement qu’ils n’ont rien compris du tout.
Du coup on a envie de revenir à la nouvelle tentation, celle du « texte pur ». Mais comme on s’aperçoit alors, que c’est assez décevant et que l’on va à l’encontre de ce qu’ont pensé des gens plus proches que nous ne le sommes de la « mentalité de Platon », on a envie de revenir aux commentaires… Da capo.
Si bien que la position la plus sage consiste à tenir compte de tout ce dont nous disposons, en exerçant au maximum notre critique. »[Lucien Jerphagnon, Mes leçons d’antan, Platon, Plotin et le néoplatonisme, éd. Les Belles Lettres, pp. 24-25. On peut en consulter une recension à [cette adresse.[/efn_note]
La leçon qui fait comme un préambule à ce livre, qui est effectivement un vaste commentaire de texte du Parménide de Platon, pratiquement linéaire, appelle donc à un usage conjoint de l’esprit critique et de l’humilité. Humilité, par exemple, de concevoir que la pensée grecque est « agonale » plutôt que conflictuelle, envisager que les idées grecques puissent coopérer même lorsqu’elles nous paraissent, à nous modernes ou postmodernes, antinomiques. Humilité, aussi, d’envisager le rapport grec au divin comme parfaitement étranger à nos configurations signifiantes, et quel que soit le rôle qu’il ait joué dans la constitution de notre rapport au divin. Alors, seulement, et selon l’exemple de Lucien de Samosate que cite Jean-Marc Narbonne, nous pourrions approcher une compréhension plus juste de ce que la modernité doit à la pensée grecque.
L’autonomie de la pensée grecque
La troisième partie de l’ouvrage se consacre intégralement à la politique et Marc-Antoine Gavray interroge le sens d’une critique du « nomos »5 par les sophistes. Il faut envisager, nous l’avons vu, la pensée grecque comme une plurivalence dont le caractère « agonal » permet de comprendre l’extrême foisonnement et les nombreux raccourcis qui ont émaillé son/ses interprétation(s) depuis les temps archaïques jusqu’à nous — c’est-à-dire des premiers moments de la pensée grecque avec Homère et Hésiode, jusqu’à la postmodernité, en passant par l’immense chaîne des traditions qui ont glosé depuis lors en singularisant toujours plus ce dont elles héritaient en se définissant par rapport à ce qu’elles allaient transmettre. Il en va déjà ainsi de Platon qui critique vigoureusement les dieux de l’Illiade comme de Plotin lisant Platon dans le néoplatonisme, comme de Thomas d’Aquin lisant Aristote qui relisait Platon, etc., et tant d’autres jeux de parentés, jusqu’aux Lumières qui firent de Xénophane le champion d’une guerre du libéralisme culturel dressé contre le monothéisme, lui-même déjà considéré à tort, dans sa forme catholique romaine, comme le responsable d’un obscurantisme qui aurait duré tout le temps du moyen-âge, soit mille ans. Cette succession d’interprétations imposées sur l’histoire des idées, comme autant d’à-plats univoques et simples, ne tient pas face à une lecture critique des différents texte-sources.
Car une lecture est toujours notre lecture et en cherchant une objectivité qui soit la plus extérieure possible à ce qui caractérise les conditions de notre regard de chercheur, nous agissons encore dans les limites de notre lisibilité du phénomène. Prenons pour l’envisager l’exemple de la croyance, qui occupe à juste titre toute une partie de l’ouvrage. Comment décider des conditions de réception d’une forme de pratique et de sensation religieuses dont les critères d’expérience pourraient bien nous être absolument étrangers ?
« Parler de croyance en Grèce risque par anachronisme d’altérer l’appréhension du polythéisme grec et toute la plasticité qui le caractérise. Ne pas en parler mène à l’autre excès qui consiste à refuser aux Grecs toute intériorisation de la pratique religieuse, voire à affirmer « qu’ils ne croyaient pas à leurs dieux »6. De la même manière, l’usage du terme « théologie » ne pose aucun problème s’il est entendu au sens le plus littéral de « discours sur le divin ou sur les dieux ». Les représentations que les Grecs ont développées, tant dans des récits que par des hymnes ou dans la ritualité même des gestes du culte sont autant de « théologies ». Mais du singulier déterminé (la théologie) au pluriel indéterminé (des théologies) se dessine tout l’écart qui se marque entre « le discours raisonné de la foi » des traditions monothéistes (pour faire bref) et le chatoiement des représentations en milieu polythéiste. La multiplication des points de vue est une manière cumulative et non dogmatique de rendre compte de la complexité du monde dans sa relation à la sphère supra-humaine7. »8
L’assainissement du langage est un pré-requis méthodologique nécessaire pour l’ambitieuse démarche d’une clarification et d’un « nettoyage » de l’histoire des idées ou de l’histoire des concepts (hors de la dualité ordinairement reconnue comme celle de notre tradition de l’historiographie moderne, entre imagination et entendement). Il faut repenser jusqu’aux paradigmes de confrontations de l’histoire des idées, et c’est d’ailleurs l’objectif assumé de la deuxième partie, Savoir, paradoxes et scepticisme (pp. 193-281) qui termine avec une brillante étude de Stéphane Marchand sur néo-pyrrhonisme avec Sextus Empiricus, anti-rationalisme qui n’est pas un anti-intellectualisme :
« De fait, [Sextus] inaugure une nouvelle relation au logos. Sa définition du scepticisme , et surtout celle du dogmatisme, laisse penser qu’il aspire à un retour à un état prélogique, à un moment où l’on ne se pose plus la question de connaître, où on abandonne les thèses. En cela il est sinon antirationnaliste, du moins il participe d’un mouvement anti-intellectualiste qui joue la vie quotidienne contre les philosophes. »9
Autrement dit, s’il faut savoir, il ne faut pas croire à la valeur de son propre savoir, s’il faut articuler les structures de sens édifiées et accumulées, il ne faut pas y adhérer ou y attacher sa conviction. Ce que synthétise plus efficacement que nous ne le pourrons faire l’Introduction :
« […] Les scepticisme néo-pyrrhonien, contrairement à l’épicurisme, ne rejette pas la culture (paideia) scientifique. Il se sert au contraire de celle-ci (d’une manière non-dogmatique, c’est-à-dire sans rien croire des connaissances qu’il utilise) pour alimenter la critique thérapeutique qu’il opère contre la maladie du jugement. C’est en ce second sens, lequel montre que le scepticisme n’est pas un anti-intellectualisme, que le scepticisme néo-pyrrhonien peut être malgré tout rapproché du rationalisme critique. »10
Voilà encore une posture conforme aux recommandations de Lucien Jerphagnon : articuler à partir de ce qui a déjà été édifié sans s’arrêter à la finitude de son intelligibilité, et poursuivre plus loin — et nous retrouverons cela entre les différentes versions de la sophia, étudiées par Louis-André Dorion (pp. 193-215). Au fil de la lecture nous comprenons que la pensée grecque fonctionnait peut-être plus sur le modèle d’une fluctuation constante dans laquelle l’individu était libre de se positionner pour peu qu’il le justifiât dialectiquement de façon suffisante, et nous enrichirions la formule du fleuve héraclitéen d’une nouvelle intensité métaphysique. Ce n’est pas seulement la vie ou l’eau qui sont un flux perpétuel et changeant et dans lequel l’être ou le corps se baignent et se déplacent, mais aussi dans la pensée dans lequel se meut l’intellect. De là et si toute chose est fluctuante, la confrontation dogmatique semble difficile et la critique grecque du divin pourrait trouver une valeur toute différente de celle de la recherche de la vérité pour issue.
« Si les philosophes antiques ont élaboré une critique radicale de la conception traditionnelle des dieux, ce n’est donc pas pour en nier l’existence, mais plutôt pour en redéfinir la notion. »11
La critique théologique d’un Xénophane vise par exemple à la vérité (sur le modèle qui inspirera plus loin un Lucien de Samosate, c’est-à-dire la vérité comme méthode plutôt que comme acquis) ou à son examen, c’est-à-dire à la redéfinition méthodologique, non à la confrontation des principes comme l’auraient voulu les philosophes des Lumières. En un sens, mais nous ferions une nouvelle erreur méthodologique en nous satisfaisant d’une compréhension nietzschéenne de la pensée grecque, il s’agirait d’une pensée constamment maintenue dans la tension de la volonté de puissance. Une activité critique du « devenant » infini, même si elle s’exerce à l’intérieur d’une superficie finie : les chemins, itinéraires, parcours et expériences sont si nombreux que la limite de l’intelligibilité humaine s’en trouve dépassée. Voilà qui n’est pas loin d’une téléologie du savoir : une quête dont la dynamique permet de lier les hommes aux dieux/à Dieu. C’est l’objet de l’étude de Louis-André Dorion, Sophia divine et sophia humaine chez Platon, Xénophon et Aristote (pp. 193-215) où la conclusion nous invite à admirer la préfiguration de l’un des arguments les plus corrosifs de la pensée scientifique pour réduire la pensée religieuse au rang des superstitions et des « histoires de femmes » (qui est une catégorie dans laquelle Platon lui-même range le traitement des dieux par Homère) : l’incapacité cognitive de l’intelligence finie (humaine) à saisir les conditions de l’intelligence infinie (divine).
« [Xénophon] soutient […] que les hommes doivent se contenter de la sophia humaine et que c’est folie que de prétendre au savoir que les dieux se sont réservés ; [Aristote] s’oppose au contraire à tous ceux, y compris vraisemblablement Xénophon, qui invitent l’homme à renoncer à la poursuite de la sophia divine, et il exhorte l’homme à s’assimiler à la divinité par l’acquisition des connaissances qui ne sont plus considérées comme le privilège exclusif des dieux. Quant à Platon, elle est intermédiaire entre celles de Xénophon et celle d’Aristote, puisque dans l’Apologie, d’une part, Socrate se satisfait de la sophia humaine et ne semble pas encourager l’homme à se mettre à la poursuite de la sophia divine, mais que, d’autre part, dans les dialogues postérieurs à l’Apologie, Socrate conçoit désormais la philosophie comme l’aspiration au savoir divin, de sorte que le sage ne doit pas se contenter de la simple reconnaissance de son ignorance. »12
Socrate est le personnage ambivalent par excellence, nous dirions même intermédiaire, entre les deux rapports à la sophia divine d’une part et la sophia humaine d’autre part, puisque, comme le rappelle Sylvain Delcomminette, Socrate remet en cause la parole de la Pythie qui le décrète comme homme le plus sage en allant se confronter aux politiciens, aux artisans et aux poètes (pp. 146-147). C’est-à-dire que Socrate tente de faire mentir Apollon :
« Tout d’abord, Socrate commence par affirmer comme une évidence que les dieux ne peuvent mentir. Or cela est loin d’aller de soi dans la religion grecque, où les dieux manient le mensonge avec une grande dextérité — ce qui attirera précisément les foudres de Platon dans la République. D’emblée, donc, Socrate se fonde sur une conception de dieu qui s’éloigne de la représentation traditionnelle. Ensuite, ce postulat ne l’empêche pas de former le projet de réfuter l’oracle, et donc Apollon lui-même. Bien sûr, la mise en œuvre de ce projet le conduira bien plutôt à réfuter les autres hommes, et ainsi à manifester le caractère irréfutable de l’oracle (ἀνέλεγκτος, 22 a 8) ; mais qu’il ait pu le former montre que la seule autorité à laquelle il accepte de se soumettre est celle de la raison ou de l’intelligence (cf. Criton, 46 b), qui doit accorder sa caution aux paroles divines elles-mêmes. »13
La tourmente d’une redéfinition de la pensée grecque par la polyvalence et le mouvement va jusqu’à impliquer Socrate. La piété socratique est une façon de rendre hommage aux dieux par le biais d’une vie philosophique, préfigurant les épithètes de Jésus Christ comme « philosophe de la vie » ou « vrai philosophe »14. C’est en effet dans le contexte d’un « dieu des philosophes » qu’a pu se produire cette bascule vers une association entre vie philosophique et sens du divin.
« Dès l’Apologie, donc, la véritable piété devient la vie philosophique en tant que pratique de la dialectique qui explique qu’elle puisse tantôt être incluse dans la liste des vertus cardinales (par exemple en Protagoras, 330 b et Lachès, 199 d) tantôt en être omise (en particulier en République, IV, 427 e), dans la mesure où elle fait d’une certaine manière double emploi avec la sagesse (sophia) et la pensée (phronèsis). »15
Avec Socrate et le rapport à la piété, le principe du divin n’est plus seulement le dieu traditionnel ou même pluriel. Il incarne désormais un concept opératoire, à savoir un principe épistémologique et éthique « démythologisé » et « détraditionalisé », placé au fondement du savoir humain. Par sa conception dialectique du monde et son intervention dans cette « fluctuation » continue des potentiels (ce qui pourrait correspondre à ce que Jean-Marc Narbonne nomme du nom de « plasma », p. 466-470), le philosophe déforme et déplace le sens du divin, en l’enrichissant par accumulation.
« Lorsque le philosophe se l’approprie, le concept de dieu change radicalement de nature : il cesse d’être un concept d’objet, qui désigne immédiatement certaines entités dont le statut divin est d’emblée présupposé, pour devenir un concept opératoire, c’est-à-dire un concept qui cristallise certaines caractéristiques et exigences à partir desquelles seulement pourra se déterminer le type d’entité correspondant. Dans tous les cas que nous allons évoquer ce concept signifiera avant tout un idéal philosophique, que celui-ci soit éthique ou théorique ; mais dans la mesure où cet idéal varie selon chaque philosophe, le concept de dieu y prend également des figures très diverses. »16
C’est là peut-être la fameuse « hellénisation » métaphysique du judaïsme (alors encore monolâtre ou hénothéiste) qui donnera une si vive longévité aux monothéismes, lesquels ne se peuvent concevoir que pour post-hellénistiques qu’ils soient.
Une redéfinition des définitions grecques
La définition du « nomos » est un passage absolument fondamental de cet ouvrage de (re)définition de la pensée critique grecque. Le terme est lui-même présent dans trois des cinq titres de la deuxième partie : La critique sophistique du nomos, de Marc-Antoine Gavray ; La critique cynique du nomos et l’idéal de vie kata phusin, de Suzanne Husson ; La restauration du nomos dans la Politeia de Zénon et dans le stoïcisme orthodoxe, de Emmanuele Vimercati. Les deux autres titres ne sont absolument pas exempts de la notion et les études s’intéressent à la question de la règle : Égalité, liberté et contrainte dans la polis grecque, de Ivan Jordović ; Platon contre (et avec) Thrasymaque, de Dimitri El Murr. La première de ces deux contributions vise les conditions induites par les structures politiques et ses implications pour l’individu comme pour les sociétés, la seconde se penche longuement sur les textes platoniciens qui interrogent l’origine de la loi, de la justice et des autres structures épistémologiques qui justifient les institutions de la cité.
« Le nomos désigne tout ce qui est conforme à la règle, signification qui, selon les contextes, inclut l’usage, l’habitude, la loi (écrite ou non écrite, particulière ou générale, par opposition au simple décret). Dans toutes ses acceptions cependant, il revêt une orientation prescriptible, et pas seulement descriptive 17. Il ne renvoie pas simplement aux conventions, aux mœurs ou aux valeurs qui ont cours dans une société, c’est-à-dire à l’ensemble des habitudes qui se sont imposées avec le temps et qu’il est possible d’observer, à l’instar de ce qui relève du folklore. Il recouvre plutôt une dimension normative, qualifiant moins l’usage que le bon usage. Que ce soit comme convention ou comme loi, le nomos correspond donc à ce qu’il convient de faire dans un cadre donné : il est une règle qui s’impose à un groupe d’individus. »18
Il y a là le sens d’un « bon » choix, ou d’un choix favorable à ce qu’il convient de faire, plutôt que d’un édit de vérité ou une quelconque injonction. Les différentes écoles philosophiques (sophistique, stoïcisme, cynisme) saisies pour interroger les qualités et limites du nomos permettent de pénétrer dans le rapport dynamique des Grecs à leurs conceptions politiques, depuis l’extérieur des clichés et des fantasmes qui nous prédisposent déjà à une certaine réception de tel ou tel phénomène, telle ou telle préfiguration institutionnelle, etc. Le cynisme est par exemple une critique de la doxa, c’est-à-dire d’un système de valeurs basé sur l’opinion commune, c’est-à-dire une critique du nomos :
« Les cyniques opposent à la conventionnalité des lois et aux manières de vivre qu’elles imposent aux hommes une vie « kata phusin », conforme à la nature. La vie cynique, explique Suzanne Husson dans le chapitre qu’elle consacre à cette question, est d’abord et avant tout « une critique en action des pratiques sociales ordinaires et des représentations anthropologiques et morales qui les fondent. » (p. 367, nous soulignons). »19
Pour tout décisif qu’il soit dans la pensée grecque, l’activité du nomos consiste tout autant à être l’objet d’une mobilité, l’espace modifiable, altérable et processus d’une intelligibilité en mouvement. Il faut bien envisager comme chaque propos, chaque chapitre de cet ouvrage, c’est-à-dire chaque angle d’attaque critique du vaste édifice épistémologique qui constitue notre connaissance et notre compréhension, parfois dogmatique, de la pensée grecque, est une mise en perspective spécifiquement tournée vers la double-temporalité de ces problématiques (et c’est une confrontation que l’ouvrage de Jean-Marc Narbonne paru en 201620 pouvait déjà annoncer, et dont la nécessité se trouvait déjà plus que brûlante). Il en va ainsi pour tout. La question de la liberté d’expression, par exemple, objet si problématique aujourd’hui, pourrait bien correspondre dans ce faux jeu de miroirs biaisés à la parrhêsia étudiée par Sophie Aubert-Baillot.
« La question de la licence démocratique fait l’objet d’une étude plus circonstanciée par Sophie Aubert-Baillot, qui examine la nature et le sens de la parrhêsia (franc-parler, liberté de parole) à l’époque classique et hellénistique. Cette notion, dont Sophie Aubert-Baillot montre qu’elle a, à l’origine, le statut d’un droit des citoyens conféré par le régime démocratique, a d’emblée eu un sens moral ambigu : d’un côté, elle semble représenter le privilège de l’homme libre et éduqué (Euripide), d’un autre, elle est dénoncée (notamment par Aristophane) comme une liberté de dire n’importe quoi mise au service de l’intérêt personnel plutôt que de la cité. Cette ambivalence se maintient chez les orateurs du IVe siècle av. J.-C., où la parrhêsia renvoie tantôt à un acte doté d’une « force critique » qui, parce qu’il peut provoquer la colère ou la haine des auditeurs, « nécessite du courage de la part de celui qui l’emploie » (p. 449), tantôt à une flatterie qui se dissimule sous les dehors de la franchise. »21
Autre exemple à partir de la parrhêia, on trouve avec Épicure une préfiguration de la formule paulinienne sur l’usage de Satan par l’apôtre Paul22 :
« Chez Épicure et la tradition épicurienne, [la parrhêia] renvoie à une autocritique collective qui, sous la conduite d’un maître plein de discernement, vise à « procurer aux fautifs un bienfait grâce à cette correction » (p. 453). »23
Le rire, la provocation, la satire, la liberté poétique : des éléments absolument décisifs de la pensée critique
Le statut de la parrhêia est certes problématique au même titre que la liberté d’expression qui pose aujourd’hui les enjeux esthétiques, politiques et sociaux que l’on sait (que l’on songe aux propos de tel ou tel comique, à la discrimination de l’art moderne, ou même plus généralement à la logique mass-médiatique du phénomène de « buzz » où c’est la parole la plus brutale, la plus virulente ou la plus décalée vis-à-vis de la doxa — c’est-à-dire en un sens, la plus critique — qui sort du lot24), mais avant d’être provocatrice, pourrait-on dire aujourd’hui, « gratuitement » provocatrice, elle participe du principe de mutabilité de la fluctuation continue. C’est là l’objet de toute la quatrième partie de l’ouvrage25 que d’examiner et réfléchir à la vitalité de la sphère esthétique : sur quoi pourrait donc reposer, outre le caractère performatif de l’art, cette fluctuation continue de la pensée grecque ?
La liberté d’expression, que nous avons proposé comme pendant moderne à une compréhension possible de la parrhêia antique, est naturellement de la même famille que la liberté artistique, de même que le sont la liberté de l’imagination et celle de la fiction. Comme argument de spéculation la fiction pourrait bien s’entendre comme un mécanisme épistémologique fondamental : envisagerait-on que la poésie ait permis de répondre à des apories de l’entendement ? La « science-fiction » de Jules Vernes du XIXe siècle n’a-t-elle pas guidé ou au moins influencé la science de la conquête spatiale ? Plus tard, les fictions dystopiques de la deuxième moitié du XXe siècle n’ont-elles pas une valeur interprétative majeure dans la compréhension des phénomènes des réseaux sociaux avec, par exemple, l’œuvre de Georges Orwell ? Il serait plus que difficile de refuser sérieusement à la fiction une fonction épistémologique, soit par le biais de l’anticipation, soit par le biais de la compensation26.
« La liberté artistique ou poétique — la liberté d’expression en général et la liberté tout court — incarne une de nos valeurs les plus précieuses. La possibilité de laisser libre cours à son imagination, à sa fantaisie, à sa créativité, cette faculté par laquelle il est loisible de modeler ou de remodeler le monde selon ses désirs ou ses aspirations, compte parmi les expériences les plus enrichissantes de la vie humaine. La plongée dans la fiction est l’occasion d’un ressourcement radical, l’esprit pouvant expérimenter des conditions insoupçonnées, ne plus se contenter de « ce qui est » mais se projeter dans « ce qui pourrait être ». J’apprécie grandement l’expression forgée par Coleridge — et utilisée couramment chez les anglo-saxons27 —, de « willing suspension of disbelief »28, la suspension volontaire de l’incrédulité, c’est-à-dire l’opération par laquelle l’esprit se commande à lui-même le lâcher-prise vis-à-vis du réel pour s’accorder désormais le droit de rêver et de façonner tout autrement les choses. Le monde aperçu n’est plus alors notre monde, il est un monde autre, un hétérocosme reconstruit fictivement, hétérocosme étant justement le terme technique par lequel Baumgarten désignera plus tard l’univers poétique29. »30
L’image d’un hétérocosme n’est pas sans insister sur la valeur rhétorique du principe d’altérité, qui peut être au cœur d’un pan aujourd’hui majeur de la philosophie moderne, notamment porté par Paul Ricœur, entre le Même et l’Autre31 — et dont on trouve un certain jaillissement, là encore, dans le Timée32. La capacité à expérimenter ce qui est autre, à « lâcher prise vis-à-vis du réel » s’exprime aussi dans la théorie de l’ego expérimental de Milan Kundera33. L’égo expérimental est cette expérience d’un autre soi que le personnage de roman offre à l’auteur. La fiction est indiscutablement l’occasion d’un dépassement des contraintes, d’un certain cadre que l’on pourrait associer au « nomos », c’est-à-dire du principe de réalité. Nous pourrions penser dans cette perspective au champ métaphysique qu’offre au moins le premier opus de la trilogie cinématographique Matrix et l’une des très nombreuses injonctions du personnage initiateur Morpheus à l’adresse du héros Néo : « Don’t think you are, know you are. », « Ne pense pas que tu es, sache que tu es » ou, mieux encore, « Ne pense pas être : sois ».
La virtualité de la structure phénoménologique virtuelle de la matrice n’est pas différente de l’espace des potentialités offert par l’espace artistique dans la Grèce antique. La mesure de l’écart entre la matrice et la vie lucide permet la critique de l’une ou de l’autre de ces deux configurations existentielles (libre ou servile).
« Le problème posé est d’abord en effet celui des rapports entre la comédie ancienne et la démocratie, et plus particulièrement avec l’un des principes qui la fondent : le droit qu’a chaque citoyen de parler librement et d’exprimer ouvertement des critiques34. La question est de savoir ce que recouvre exactement un tel privilège et quelles limites les Athéniens avaient instaurées à la parrhêsia35. Cette interrogation est indissociable d’une réflexion sur les victimes désignées de ces railleries, puisque, comme le note avec raison J. Henderson36 en citant un passage de la Constitution des Athéniens du Pseudo-Xénophon37, la remise en cause de l’élite — qui forme l’objet essentiel des invectives comiques — renforce le peuple et sert finalement les intérêts de la démocratie. »38
Or cet écart entre la comédie ancienne et le cours ordinaire de la démocratie, alors même que la première appartient aux institutions structurelles de la seconde (de même que la matrice appartient aux conditions de l’organisation de la vie libre dans le film dont nous filons l’image), permet justement un « ressourcement » (nous reprenons le mot de Jean-Marc Narbonne) des possibilités individuelles et sociales à l’intérieur de l’espace fluctuant de la démocratie. Songeons aux romaines saturnales durant lesquelles maîtres et esclaves inversaient leurs rôles : qu’il s’agisse d’une fiction ou d’un rituel véritablement effectif, sa possibilité promet déjà une mobilité, une disponibilité critique allant d’un espace à l’autre. Les carnavals qui seront si célèbres à l’ère médiévale, et notamment dans l’art baroque, ne glorifient-ils pas la figure diabolique, avatar par excellence du principe d’altérité ?
Une perspective académique
Il faut convenir d’une certaine recrudescence de l’intérêt universitaire pour les objets religieux qui bénéficie, depuis les années 1990-2000, d’un prestige intellectuel sous l’angle strictement épistémologique jusqu’alors peut-être négligé ou peu convoqué. On s’intéresse aux structures de sens véhiculées par cette catégorie du savoir, et les monothéismes. Dès lors la question de la configuration rationnelle, soit sous un angle critique soit sous un angle d’édification épistémologique, relative aux différents champs religieux paraît essentielle. Le polythéisme comme le panhellénisme sont des configurations rationnelles très spécifiques, de même que le monothéisme, et tous trois portent des conditions de structuration du sens dont cet ouvrage permet d’affiner les perceptions, les organisations et les justifications.
Le fourmillement de la pensée religieuse grecque n’est pas réductible aux modes de l’affrontement desquels le moyen-âge et la modernité furent les arbitres, c’est-à-dire à la pensée spéculative ou la pensée calculatrice. Pour reprendre le mot de Hans Blumenberg, on pourrait dire de la pensée grecque qu’elle est « métaphorologique ». Par exemple, l’Aphrodite Areia de Sparte, ou « Aphrodite d’Arès » (p. 64) qui est une somme métaphorologique entre les attributs d’Aphrodite et les attributs d’Arès, fonctionnant selon le principe d’accumulation par la nuance, voire par celui de la nuance dans l’accumulation. Telle lecture que confirme la citation de Louis Gernet en 1932, selon laquelle « un dieu est « une système de notions » qui ne peut être appréhendé de façon statique et rigide39. « Tour à tour et sans cesser d’être la même, la notion peut se contracter ou se dilater. Sous les mêmes vocables, les dieux sont à la fois les numina particuliers et locaux dont la tradition civique commande le respect, et les personnages lointains qui sont évoqués par l’imagination artistique. »40 Nous ne parlerions plus forcément de « l’imagination artistique » pour désigner les traditions narratives et les représentations figurées, mais l’on peut encore pleinement souscrire à cette idée d’une contraction et d’une dilatation des figures supra-humaines honorées par les Grecs. Si, derrière le nom d’Athéna ou celui de Zeus, il n’y avait pas quelque chose de stable qui traverse les diverses manifestations locales de leurs cultes ou les différents récits qui les mettent en scène, alors le polythéisme serait un chaos indescriptible dont on comprendrait mal qu’il ait pu résister pendant mille ans […]. »41
Nous retrouvons des considérations philologiques que d’autres livres récents ont traité, comme la place des daimôn (p. 65) qui a fait l’objet d’un ouvrage de parution de thèse de Andrei Timotin, La démonologie platonicienne, histoire de la notion de daimôn de Platon aux derniers néoplatoniciens42, ou par exemple encore (pp. 64-65), sur la réflexion sur la plasticité du rôle du divin, l’ouvrage L’insoutenable divinité des anges43 de David Hamidović. Toute littérature scientifique qui soutient la nécessité, aujourd’hui, d’une telle entreprise critique.
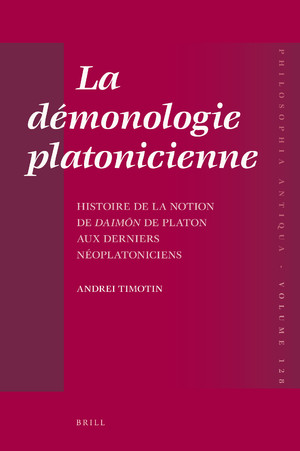
Les travaux de la recherche universitaire ont effectivement déplacé le rapport à l’antiquité grecque, cherchant à mettre à distance une perception excessivement romantique, ou poétisée, fantasme qui a longtemps influencé toute réception de la Grèce antique.
« Au seuil d’un travail collectif sur la « rationalité » antique, une mise au point s’impose sur les représentations grecques constituant le cadre de cette rationalité, et où la religion tient une place aussi fondamentale que difficile à appréhender. Les certitudes qui paraissaient avoir été acquises à ce sujet ont été sérieusement ébranlées au cours des trois dernières décennies de recherche. Cette mise au point est d’autant plus nécessaire que les chercheurs travaillant en dehors du champ de la religion, mais sur des thèmes qui la croisent en chemin, comme la politique, la société ou la littérature, ont besoin d’un temps d’adaptation un peu plus long, et continuent de travailler parfois en mobilisant d’anciens paradigmes en partie dépassés. »44
La littérature occidentale, par exemple, porte les conditions de sa propre conception depuis les grands textes fondateurs échafaudés dans l’Antiquité — ce que nous pourrions attribuer, avec le texte de Hans Blumenberg s’intitulant La raison du mythe45, à la considération des « textes rituels » dont dépendent les fondations d’édifices intellectuels et culturels fondamentaux, Bible, etc. Des mouvements alternatifs observés par la théorie de l’art moderne entre deux polarisations, le romantisme et le classicisme, peuvent être directement issus de traditions esthétiques et en particulier littéraires issues des premières structures métaphysiques, par exemple46. Il y a donc une nécessité presque décisive de se pencher sur les conditions de formation des premiers surgeons de la pensée religieuse, dès l’antiquité archaïque panhellénistique, dont les influences sur les différents monothéismes ne sauraient être contestées.
Les remarques sévères qui sont faites (p. 59) sur la valeur discutable de la qualité de « vraie religion » pour la mythologie grecque antique trouvent effectivement grâce auprès de travaux de philosophes comme Ernst Cassirer47 ou Hans Blumenberg une dignité phénoménologique et philosophique certaine. En effet, les travaux de ces deux philosophes tendent à donner au mythe une valeur de fondation épistémologique de premier ordre. Sans cette première unité des structures de sens que sont les discours mythiques, la métaphysique, les métaphores et les formes originales de la pensée grecque, il semble pertinent de songer que la culture occidentale ne serait jamais advenue avec une telle force. Même si la religion grecque s’est affaiblie à mesure que gagnait en fermeté le rationalisme grec, le second n’aurait jamais pu apparaître sans la matière nourricière de la première (ce qui est dit page 62).
Conclusion
Il y a une volonté d’actualisation et de défense d’une certaine forme de réalité du polythéisme envers et contre la fantasmagorie culturelle des civilisations qui lui ont succédées — de même que tout le « rationalisme » grec, et toute la culture politique, artistique (c’est le sens de la quatrième partie, qui ouvre, depuis les contraintes du nomos, le sens de la « licence » artistique en Grèce antique). Les structures religieuses sont autant de structures de sens ayant joué une fonction fondatrice ou génératrice de phénomène social et culturel, et ce qui vient après porte toujours « quelque chose » de ce qui fut avant. De même que le Moyen-âge fut longtemps le millénaire de « l’obscurantisme » sous le joug d’une Église romaine impitoyable et inquisitrice, reflétant mieux par ce visage les ténèbres de notre connaissance qu’une quelconque réalité culturelle, esthétique ou philosophique, il semble que la Grèce antique ait longtemps souffert de catégories lapidaires ou simplistes, à laquelle on l’assigna quand il fut temps d’organiser l’Histoire en grandes étapes.
« La vision presque « collectiviste » de la polis et de son système religieux est également tributaire de l’idée, tôt forgée dans l’imaginaire scientifique occidental, de l’apogée de la Grèce « du miracle » sous Périclès, et de son corrélat immédiat, le déclin inexorable qui s’ensuit après la mort du grand homme en 429 av. J.-C. Réduire les huit siècles d’histoire grecque à la pentékontaétie relève d’une étrange myopie, et plus encore quand on veut réduire toute la Grèce à Athènes, à sa démocratie et à son évolution spécifique. »48
Or cette vision tient plus du « merveilleux », de la vision émerveillée, procédant d’un regard comparatif jeté par les premiers modernes redécouvrant l’Antiquité grecque à partir de leurs frustrations et autres motifs polémiques, que du véritable sens scientifique. Que l’on songe simplement à « l’étude » de Michelet sur les sorcières, qui tient plus à la poétisation documentée qu’à un véritable essai de mythographe. Il y a eu longtemps dans la démarche scientifique philologique une tendresse et une affection poétisante de la Grèce antique, et jusqu’aux lectures infantilisantes selon lesquelles la Grèce aurait été une « enfance » de la civilisation — et c’est là un deuxième usage, tout aussi fautif scientifiquement que celui de l’argument polémique (Xénophane de Colophon), de l’intelligibilité de l’Antiquité grecque.
- Bernard Collette-Dučić, Marc-Antoine Gavray et Jean-Marc Narbonne, Remerciements, L’esprit critique dans l’Antiquité, tome 1 : Critique et licence dans la Grèce antique, éd. Les Belles Lettres, 2019, page 7.
- Ibid., Jean-Marc Narbonne, Avant-propos, page 28.
- Ibid., Elsa Bouchard, La mode agonal dans la pensée grecque, page 112.
- Ibid., Elsa Bouchard, page 112.
- Op. cit., Marc-Antoine Gavray, La critique sophistique du nomos, pp. 319-241.
- Note 53 de la page 77 de l’ouvrage : « Pour paraphraser le titre de l’article de Giordano, M., « As Socrates Shows, the Athenians Did Not Believe in Gods », Numen, 52, 2005, p. 325-355, sévèrement critiqué par Versnel, H.S., Coping with the Gods, 2011, p. 539-559. »
- Note 54 de la page 77 de l’ouvrage : « Un bel exemple est donné par les Questions grecques ou romaines de Plutarque où chaque interrogation donne lieu à une succession de possibilités formulées comme autant de nouvelles questions non exclusives les unes des autres : Scheid, J., « I. Rituels et exégèses : Les Questions romaines de Plutarque », Annuaire de l’École pratique des hautes études. Section des sciences religieuses, 99, 1990-1991, p. 273-278. Voir aussi Prescendi, F. « Des étiologies pluridimensionnelles : observations sur les Fastes d’Ovide », Revue de l’histoire des religions, 219, 2002, p. 142-159. »
- Ibid., Pierre Bonnechere et Vinciane Pirenne-Delforge, Réflexions sur la religion grecque antique : comment appréhender le polythéisme, page 77.
- Ibid., Stéphane Marchand, Méthode et savoir critiques dans le néo-pyrrhonisme, page 280.
- Ibid., Bernard Collette Dučić et Marc-Antoine Gavray, Introduction, page 37.
- Ibid., page 34.
- Ibid., Louis-André Dorion, Sophia divine et sophia humaine chez Platon, Xenophon et Aristote, page 215.
- Ibid., Sylvain Delcomminette, Le Dieu des philosophes, page 147.
- Parallèles étudiés notamment dans Philippe Capelle-Dumont (dir.), Philosophie et Théologie au Moyen-âge : Anthologie tome II, éd. du Cerf, 2009.
- Ibid., Sylvain Delcomminette, Le Dieu des philosophes, page 147.
- Ibid., Sylvain Delcomminette, Le Dieu des philosophes, page 144.
- Note 5 de la page 321 de l’ouvrage : « Voir Kerferd, G.B., Le Mouvement sophistique, 1999, p. 172. »
- Ibid., Marc-Antoine Gavray, La critique sophistique du nomos, page 322.
- Ibid., Bernard Collette Dučić et Marc-Antoine Gavray, Introduction, page 40.
- Jean-Marc Narbonne, Antiquité critique et modernité, éd. Les Belles Lettres, 2016.
- Ibid., Bernard Collette Dučić et Marc-Antoine Gavray, Introduction, page 42.
- Nous pensons à l’occurrence la plus connue des épîtres pauliniennes, en 1 Co 5,5, reprise par Jean Chrysostome, H I, 4, 20-29, dans ses Homélies sur L’impuissance du Diable, introduction, texte critique, traduction et note par Adina Peleanu, coll. Sources chrétiennes n°560, éd. du Cerf, 2013, page 141.
- Ibid., Bernard Collette Dučić et Marc-Antoine Gavray, Introduction, page 43.
- Voir la contribution de Suzanne Husson, La critique cynique du nomos et l’idéal de vie kata phusin, et en particulier pp. 365-367.
- Licence poétique et licence artistique, pp. 417-552, avec les contributions suivantes : La licence démocratique et son interprétation philosophique dans l’antiquité, de Bernard Collette-Dučić ; Parrhêsia critique et critique de la parrhêsia à l’époque classique et hellénistique, de Sophie Aubert-Baillot ; La défense de la liberté artistique et de la fiction : une nouveauté assumée dans la Poétique d’Aristote, de Jean-Marc Narbonne ; Critique et licence dans la comédie ancienne, de Ghislaine Jay-Robert ; Comédie ancienne, comédie nouvelle : un bilan à revoir, de Dmitri Nikulin.
- C’est d’ailleurs l’argument de Avia Kleinberg dans son essai The sensual God, 2015, Le Dieu sensible paru en français aux éditions Gallimard en 2018, où la pensée religieuse fonctionnerait « par lignes courbes » et la pensée scientifique serait, elle, « rectiligne ». Les deux se compléteraient pour embrasser l’intelligibilité du monde.
- Nous nous permettons de mentionner que toute la théorie littéraire moderne, et pas seulement anglo-saxonne, utilise abondamment cette brillante notion de Coleridge, comme formule fondamentale de la narratologie et des études littéraires. L’économie et l’équilibre de la suspension volontaire de l’incrédulité sont à la base du pacte de lecture qui unit l’auteur à son lecteur.
- Note 1 de la page 466 de l’ouvrage : « Coleridge, S.T., Biographia Literaria (1817), New York, Dutton, 1906, Chapter XIV. »
- Note 2 de la page 466 de l’ouvrage : Baumgarten, A. G., Reflections on Poetry : Meditationes Philosophicae de Nonnulis ad Poema Pertinentibus, trad. K. Aschenbrenner et W.B. Hilther, Berkely, Université of California Press, 1954, p. 55. Sur l’histoire de ce terme, cf. Abrams, M. H., The Mirror and the Lamp, New York, Oxford, 1958, p. 72-85. »
- Ibid., Jean-Marc Narbonne, La défense de la liberté artistique et de la fiction : une nouveauté assumée dans la Poétique d’Aristote, pp. 465-466.
- À ce propos, lire Soi-même comme un autre dans lequel la pensée de l’ « ipséité », c’est-à-dire de la mutabilité à l’intérieur du « même », épargnant la « mêmeté » de l’individu, c’est-à-dire ce qui ne change pas, éd. du Seuil, 1990.
- Sylvain Delcomminette évoque à ce propos dans Le Dieu des philosophes, page 149, une conception « cosmologique » (contre une conception « métaphysique ») du « Plato’s God », c’est-à-dire d’un dieu artisan (dèmiourgos) qui a conçu le monde avec « l’Autre » (les différentes strates de cieux) tournant par cycles autour du « Même » (le disque des terres).
- Voir le dictionnaire figurant à la fin de L’art du roman, éd. Gallimard, 1986.
- Note 13 de la page 490 de l’ouvrage : « Voir la définition que J. Henderson (« Attic Old Comedy, Frank Speech and Democracy », 1998, p. 255) donne de la parrhêsiaî : « the right of every citizen to voice Franke criticism ». »
- Note 14 de la page 490 : « Voir la réflexion de J. Henderson (« Attic Old Comedy, Frank Speech and Democracy », 1998) à ce sujet. »
- Note 15 de la page 490 : « Henderson, J., « Attic Old Comedy, Frank Speech and Democracy », 1998, p. 259.
- Note 16 de la page 490 : « Voir dans les textes donnés en annexes le n°8. »
- Ibid., Ghislaine Jay-Robert, Critique et licence dans la comédie ancienne, page 490.
- Note 11 de la page 64 de l’ouvrage : « Gernet, L., Boulanger, A., Le Génie grec dans la religion, Paris, Albin Michel, [1932], 1970, p. 222. »
- Note 12 de la page 64 de l’ouvrage : « Gernet, L., Boulanger, A., Le Génie grec dans la religion, Paris, Albin Michel, 1970, p. 230. »
- Ibid., Pierre Bonnechere et Vinciane Pirenne-Delforge, Réflexions sur la religion grecque antique : comment appréhender le polythéisme, pp. 64-65.
- Andréi Timotin, La démonologie platonicienne, histoire de la notion de daimôn de Platon aux derniers néoplatoniciens, éd. Brill, 2012.
- David Hamidović, L’insoutenable divinité des anges, éd. du Cerf, 2018.
- Ibid., page 57.
- Hans Blumenberg, La raison du mythe, éd. Gallimard, 2005 pour le français.
- Sans qu’il ne remonte, hélas, jusqu’à la source religieuse et, notamment, la tradition de l’apocalyptique juive, c’est le propos du livre de Mario Paz, La chair, la mort et le diable dans la littérature du XIXe siècle, Le romantisme noir, éd. Gallimard, 1999 pour le français.
- Qui écrivit une somme monumentale encore entachée d’anachronisme, notamment par l’une des voix importantes de son débat intérieur qu’est Schelling, parangon de la lecture romantique de l’Antiquité grecque, mais absolument édifiante pour la compréhension d’une philosophie du mythe comme « phénoménologie de la connaissance » (qui est un point attaqué par l’ouvrage dont nous faisons ici la recension) : La philosophie des formes symboliques, dont les trois tomes sont parus en français aux éditions de Minuit en 1972.
- Ibid., Pierre Bonnechere et Vinciane Pirenne-Delforge, Réflexions sur la religion grecque antique : comment appréhender le polythéisme, page 90.








