Du libéralisme au néo-libéralisme
L’ouvrage de la philosophe Barbara Stiegler1 s’inscrit dans une lignée de travaux récents portant sur les origines du néolibéralisme, et sur la prise de conscience, tardive, de l’importance qu’y joua en particulier un homme : Walter Lippmann. Plus précisément, Pierre Dardot et Christian Laval ont montré, dès 2009 dans La nouvelle raison du monde2, toute l’importance du « colloque Lippmann », qui se tint en 1938 à Paris, dans la genèse du néolibéralisme d’après-guerre ; pour leur part, Jurgen Reinhoudt et Serge Audier ont consacré en 2018 un ouvrage entier à l’analyse de cet événement, intitulé The Walter Lippmann Colloquium. The Birth of Neo-Liberalism faisant suite la monographie du même Serge Audier consacrée au Colloque Lippmann3.
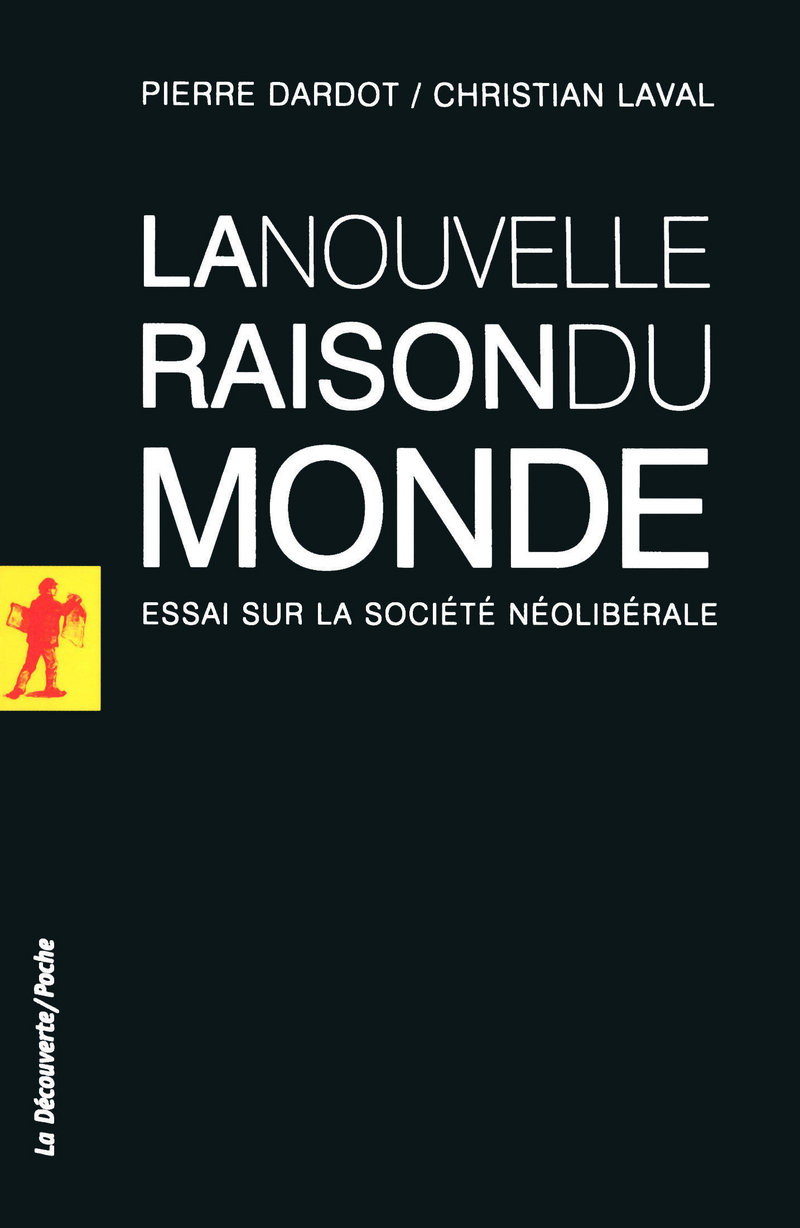
Barbara Stiegler complète ces études en ne se penchant plus sur le « pendant » ou sur l’« après », mais sur l’ « avant » : car si un événement scientifique est organisé dont l’objet est de renouveler le libéralisme à partir de l’œuvre d’un penseur, en l’occurrence La cité libre de Walter Lippmann, c’est que ce penseur jouissait déjà d’une forte réputation avant même le colloque de 1938. De quoi justifier, par conséquent, cette enquête de plus de trois cents pages.
Quel est au fond l’enjeu principal ? Il s’agit en réalité de lever un certain nombre de confusions qui assimilent, bien trop hâtivement, libéralisme, capitalisme, économie néoclassique et néolibéralisme. Plus particulièrement, on sait depuis les travaux de Michel Foucault que si le libéralisme classique se fonde sur un naturalisme spontané qui fait confiance aux penchants naturels pour assurer le bon fonctionnement du marché et de la société, le néolibéralisme, tout au contraire, n’hésite pas à recourir à l’artifice étatique pour réguler ces comportements. Faut-il pour autant en déduire que le néolibéralisme est un artificialisme ? Assurément non : et tout le travail de Barbara Stiegler de précisément consister à mettre en exergue ses racines biologiques issues de la révolution darwinienne.
De la société industrielle à l’adaptation
Walter Lippmann subit tout d’abord l’influence de Graham Wallas, qui fut le théoricien de la Great Society et dont il suivit le séminaire à Harvard en 1910. Pour ce dernier, la révolution industrielle a complètement chamboulé les relations de l’homme et de son environnement, engendrant un décalage sans précédent qui ne peut plus être comblé par une adaptation, lente, graduelle et progressive, à la manière de l’évolutionnisme darwinien. Et contrairement à Herbert Spencer qui concevait l’adaptation de manière passive et subie, c’est-à-dire purement mécanique, Wallas assume que la tâche de la civilisation consiste justement à modifier l’environnement, à créer des conditions qui correspondent aux dispositions existantes et actuelles de l’homme. Le volontarisme supplante la passivité, l’adaptation change de cible : non plus l’être humain et ses capacités, mais son milieu.
Voici un renversement de perspective qui retient toute l’attention de Walter Lippmann et justifie son projet d’une démocratisation de la société industrielle dont l’horizon est la coopération ; mais il convient à cette fin de cesser de prendre le travailleur pour une simple force de travail, ce qui n’est rien d’autre que de le réduire au statut de machine, et plutôt de l’envisager comme un collaborateur, comme un partenaire – une « partie prenante » dirait-on de nos jours – qui fait partie intégrante de la fabrique de l’intelligence collective. Mais ce programme revient à changer les mentalités des organisations industrielles : le rôle de l’éducation y est par conséquent prépondérant, mais non plus entendue à la façon des Lumières comme le processus de formation du jugement, mais bien comme l’acquisition d’une nouvelle façon d’agir et de se comporter dans la nouvelle société des grands ensembles industriels.
« La manufacture du consentement »
Aussi, si l’éducation devient une tâche prioritaire, alors il n’est guère étonnant que Walter Lippmann ait accordé un intérêt si prononcé pour les experts qu’il charge d’œuvrer à la « manufacture du consentement » (expression que Noam Chomsky reprendra plus tard à son compte). En effet, au sein d’un monde devenu complexe, le ressort démocratique de la représentation s’avère irrémédiablement dépassé en raison de son inefficacité : de telle sorte qu’une autorité indépendante et objective devient nécessaire pour informer les consciences et fournir aux décideurs l’ensemble des données requises à la bonne conduite du pays. En d’autres termes, la nouvelle démocratie que promeut Lippmann ne relève plus du politique, puisque la question de la souveraineté se trouve de fait évacuée : la source du pouvoir n’est plus le peuple, mais la science dont les résultats sont détenus et transmis aux élus par des experts.
Mais il ne suffit pas d’influencer les décideurs sur le fond : encore faut-il leur donner les armes nécessaires à la fabrique du consentement au sein du peuple. C’est la raison pour laquelle les sciences humaines occupent une place centrale dans ce dispositif ; citons ici Barbara Stiegler commentant Public Opinion (1922) :
« Il s’agit d’une nouvelle forme d’expertise, que seules peuvent fournir les sciences humaines en général et la psychologie en particulier. Son rôle d’indiquer aux dirigeants comment gouverner la masse statique, amorphe et hétérogène de la population, rigidifiée par ses stéréotypes, en la conduisant dans la bonne direction : celle d’une réadaptation à son nouvel environnement, mobile, imprévisible et mondialisé » (p. 65).
Aussi constate-t-on que la refonte du libéralisme, et sa mue en néo-libéralisme, procède moins d’une hégémonie des sciences économiques et de la théorie néo-classique, que d’une promotion des sciences humaines dont la mission n’est plus de rendre compte de l’action, individuelle et collective, que de transformer cette action afin de réadapter l’espèce humaine à son nouvel environnement. Plusieurs noms s’imposent ici, hélas absents de l’ouvrage de Barbara Stiegler : celui, en premier lieu, d’Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et père des relations publiques, qui inscrivit la manipulation de l’opinion dans son classique Propaganda (1928) ; celui également d’Elton Mayo, fondateur de la psychologie industrielle et de l’école dite des « relations humaines », qui vise à combler le hiatus séparant les compétences sociales des compétences techniques qu’il juge être à l’origine de la première Guerre Mondiale ; celui, encore, de Kurt Lewin, initiateur de la psychologie sociale et de la conduite du changement, dont l’analyse du fonctionnement des groupes sert encore de modèle à bien des consultants en management et en organisation. Tous s’inscrivent dans la filiation de Lippmann, d’ailleurs lui-même admirateur de Taylor, et cherchent à créer, par le ressort des sciences humaines, la figure ce que Saint-Simon nommait l’homme industriel, c’est-à-dire l’homme utile et adapté (ou adaptable) à la nouvelle société.
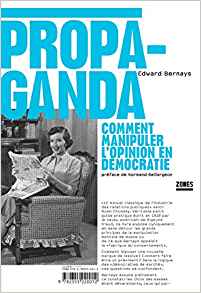
Certes, comme le note Barbara Stiegler, la position de Lippmann fut tout sauf constante au fil du temps. Plus particulièrement, notant la capacité d’attention limitée de l’espèce humaine – postulat que l’on retrouvera dès les années 1940 chez Herbert Simon, figure fondatrice de l’intelligence et des sciences cognitives –, et le nécessaire et irréductible décalage entre l’apprentissage et les évolutions socio-économiques qui en résulte, Lippmann en vint à douter de l’efficacité de l’expertise, de telle sorte que, dans une seconde phase, celle de The Phantom Public (1925), il préféra s’en remettre, dans la lignée des Lumières écossaises, à l’ajustement mutuel des intérêts, instruits ou spontanés ; et quand cet harmonieux rouage ne fonctionne plus, comme c’est le cas lors des crises, il convient alors de compter sur les leaders qui, par leur talent, parviennent à réunifier le tuf hétérogène des désirs individuels et à le convertir en une volonté générale provisoire. Anticipant l’ère des réseaux sociaux numériques, Lippmann peut alors définir l’opinion publique comme le followership, comme l’agrégation de suiveurs autour d’un personnage mobilisateur.
La remise en cause du politique
En outre, si l’espèce humaine ne peut, en raison de sa finitude cognitive, s’ajuster en temps réel à l’évolution de la société industrielle, cela signifie alors que son rythme d’adaptation sera graduel, incrémental, à la manière de l’évolution darwinienne. Pour la tradition néolibérale, il revient alors au droit d’assurer le perfectionnement progressif des règles ; Louis Rougier, cité par Barbara Stiegler, synthétise parfaitement :
« Être libéral […] [c’est] être essentiellement progressif dans le sens d’une perpétuelle adaptation de l’ordre légal aux découvertes scientifiques, aux progrès de l’organisation et de la technique économiques, aux changements de structure de la société, aux exigences de la conscience contemporaine » (p. 197).
Somme toute, le laisser-faire est une fiction métaphysique ; en réalité, le libéralisme n’a pu se développer et s’imposer qu’en raison de l’interventionnisme de l’État qui, par le droit, fixe le cadre et les règles du jeu. De ce point de vue, le droit lui-même change de nature : il n’est plus tant un ensemble de lois légitimes visant le bien commun, qu’un outil pragmatique d’adaptation de l’espèce humaine aux multiples évolutions de son milieu : telle est la thèse de La cité libre (1937) dont Hayek retint la leçon. Il s’ensuit assez naturellement une judiciarisation des rapports sociaux, processus au cours duquel les tribunaux se substituent au Parlement pour devenir le principal lieu de régulation du corps social, chaque décision constituant une petite étape dans le procès d’ajustement de l’homme à la société industrielle.
Quelles que soient les pistes envisagées, les postulats et les résultats, assurément, convergent. Du côté des conséquences, le gouvernement des experts, des leaders et du droit, remet radicalement en cause l’idée politique de démocratie en dépossédant les citoyens de leur capacité d’initiative et de délibération ; on pourrait encore le formuler en ces termes : c’est même le politique, comme instance du commun en quête de légitimité, qui s’éclipse au profit de la seule efficacité du droit et de la gestion.

Mais arrêtons-nous sur les assises de la pensée de Lippmann : si Barbara Stiegler fait état des évolutions politiques du penseur américain, elle met également en exergue le soin qu’il prit à fonder ses théories successives sur les acquis du darwinisme. C’est d’ailleurs ce qui lui permet d’affirmer, contre Foucault, que le néo-libéralisme est une nouvelle forme de naturalisme, non plus providentialiste comme chez Adam Smith, mais scientifique et biologique. Plus encore, l’interprétation du darwinisme est précisément la ligne de démarcation qui sépare Walter Lippmann et John Dewey, dont le débat fit grand bruit aux États-Unis : pour le second, l’évolution est le fruit de multiples interactions et rétroactions entre l’espèce humaine et son environnement, si bien qu’il faut laisser œuvrer l’intelligence collective, faire confiance à la créativité des peuples, et renouveler la démocratie sur ces bases ; pour le premier, l’incapacité biologique de l’espèce humaine nécessite l’encadrement des citoyens par un système procédural graduellement perfectible. D’un côté, une démocratie expérimentale qui laisse les possibles ouverts ; de l’autre, une démocratie technique dont le telos est déjà fixé à l’avance : l’adaptation à la société industrielle.
Conclusion
En guise de conclusion, nous dirons que l’ouvrage de Barbara Stiegler est important car il permet au lecteur francophone de prendre connaissance de la trajectoire d’un homme dont l’influence fut considérable non seulement en Amérique, mais également sur « les élites dans l’ensemble du monde » (p. 94). Mais il nous semble aussi que, peut-être paradoxalement, la force de cet essai est en même temps sa faiblesse : le fil resserré autour du personnage de Lippmann, et de son débat avec Dewey, isole le traitement de l’adaptation, ce nouvel impératif politique comme l’indique très à propos le sous-titre, de la problématique plus générale de la société industrielle. À ce titre, nous ne pouvons que regretter le silence complet de l’auteur sur le XIXe siècle et sur les premiers penseurs de l’industrialisme – Claude-Henri de Saint-Simon en particulier, dont l’influence aux États-Unis fut tout à fait notable – dont les schémas de pensée se trouvent pourtant très proches, et même annonciateurs, de ceux de Lippmann : retard de l’espèce humaine sur le nouveau mode de production, utilisation des catégories de la biologie pour penser la société, disparition de la politique au profit de la technique et de la procédure.
- Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Éditions Gallimard, « nrf essais », 2019.
- Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2010
- cf. Serge Audier, Le Colloque Lippmann. Aux origines du « néolibéralisme », Paris, Poch’BDL, 2012








