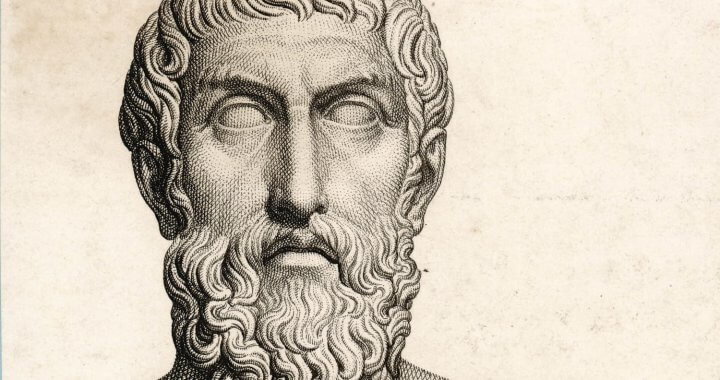Présentation d’une revalorisation de l’histoire
Lorsqu’Aurélien Robert intitule son ouvrage Épicure aux enfers. Hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen Âge, paru en février 2021, il s’agit d’un titre subtil. Nous ne pourrions pas écrire simplement ce qu’il faudrait écrire à propos de l’intrication entre le personnage « Épicure » et cette localisation « aux Enfers ». En effet, s’agit-il de la présentation, dans l’histoire des idées, de la progression d’un « personnage » Épicure, dans les différents cercles infernaux ? On sait qu’il se trouve présenté par Dante dans l’un de ceux-ci et l’auteur en parle. Ou bien s’agit-il d’une étude de la mythologie d’Épicure telle qu’elle apparaît au fil des âges ? S’agirait-il encore d’une exposition de la place des enfers dans la littérature épicurienne, comme les présentent régulièrement les Bibliothèques idéales[1] qui paraissent aux Belles Lettres ? Enfin, s’agit-il d’un récit, d’une explication narrative de la progression d’Épicure dans les imaginaires de l’Antiquité et du Moyen Âge, depuis ce qu’on appelle les enfers des bibliothèques jusqu’à la reconnaissance d’une vie en soi ? C’est là le premier des intérêts de cet ouvrage, et non des moindres : il traite de tout cela à la fois. La démarche de l’historien est ici particulièrement vivifiante en tant qu’elle commence par exposer l’extrapolation de la vie du philosophe jusqu’à une sorte de socle fantasmatique et, bientôt, mythique, c’est-à-dire tenant à l’ordre de l’imaginaire. Cela n’est vraiment pas sans nous rappeler la posture de l’ouvrage de Paulin Ismard[2], paru en 2013, inversant, en un sens, l’ordre hiérarchique entre l’événement et l’imaginaire qui se cristallise autour de l’événement. Nous y reviendrons. Un autre des intérêts de l’ouvrage ? Requalifier la totalité de la perception de l’histoire, au travers du cas particulier d’Épicure.
Le geste scientifique de l’auteur se déroule donc dans le feuillage serré de ces différentes préoccupations simultanées, et se découpe en cinq parties visant à faire état de la situation, extraire ses motifs et conditions, réajuster les raisons, pour tente enfin de proposer une silhouette peut-être plus « authentique » du philosophe antique. Nous n’allons pas faire une présentation complète du découpage des chapitres et nous contenter de faire la liste de ces cinq parties, car c’est la dynamique générale de l’ouvrage qu’il nous paraît nécessaire ici de montrer. Les cinq parties tendent donc à dresser un horizon chronologique qui, grâce au travail fort complet de l’auteur, et à une érudition historique qui propose une traversée des époques d’un genre différent de ceux que l’on peut croiser habituellement. Ce cheminement déconstruit, pour construire son exposé, la sédimentation de tout ce qu’on entend aujourd’hui dans la multitude du terme « épicurien », tant il est vrai que les termes « épicure » ou « épicuriens » sont passe-partout et ne veulent plus dire grand chose si ce n’est « apte au plaisir » ou « en recherche du plaisir ».
Partie I : L’épicurien hérétique : la première partie propose un inventaire des conditions antiques de formation du vaste malentendu — qui n’en est pas un du point de vue mythologique, du point de vue des imaginaires — sur la philosophie épicurienne, à partir du triomphe implacable de la religion chrétienne. Une récapitulation des principes philosophiques d’Épicure, de ses modes de diffusion et de sa logique « religieuse » — nous pourrions dire « pédagogique », dans le plus pur style panhellénistique ou, du moins, celui que nous connaissons des grandes écoles comme l’Académie ou le Lycée, avec une dimension éso et une autre exo.
Partie II : Figures de papier : le philosophe, le poète et le quidam : cette deuxième partie expose en trois chapitres les différentes fécondités de la philosophie d’Épicure dans les trois monothéismes de l’Occident, chrétien, juif et musulman. Le passage est particulièrement intéressant du point de vue de l’enrichissement doctrinaire des trois pratiques. L’épicurisme n’était plus une réalité tangible mais simplement, nous dirions aujourd’hui, un épouvantail :
[…] On ne trouve aucune trace de condamnation pour épicurisme au Moyen Âge, ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, ni dans l’islam. C’est que les références à l’école du Jardin ne servaient plus à décrire une communauté constituée autour de principes de la philosophie épicurienne, mais à jeter l’anathème sur un ou plusieurs personnages, le plus souvent contemporains, grâce aux représentations déjà attachées à ce nom, devenu symbole de l’hérésie depuis des siècles. Ce n’est donc pas l’étiquette, en tant que telle, qui a été changée au Moyen Âge, même si elle a été codifiée de manière plus stricte grâce à ce que nous avons appelé le portrait biblique de l’épicurien. C’est son usage qui a évolué. Il ne s’agissait plus d’employer le terme « épicurien » à des fins simplement apologétiques, ni même à des fins strictement hérésiologiques, puisqu’il n’existait plus aucune secte épicurienne. À quoi servait-elle précisément ? Essentiellement à faire peur. À défaut de condamner les épicuriens, de leur faire des procès, il fallait que les gens puissent les identifier et s’identifier à eux, les reconnaître, jusqu’à avoir peur d’en faire partie. Car en dehors du cas orléanais, ce n’est pas le bûcher que devaient craindre ceux que l’on taxait d’épicuriens. Ils devaient appréhender les peines de l’enfer.[3]
Il n’est pas inintéressant de constater que les mêmes processus d’ingénierie sociale sont toujours à l’honneur aujourd’hui. Seulement, ce n’est plus le groupe des « épicuriens » qui doit en subir les retombées sur le quotidien de ses membres, et ceux-là font même plutôt partie, dans l’acception populaire de la dénomination, d’une franche popularité. Le travail des figures, des imaginaires et des symboles a donc une fonction prescriptive et permet de faire histoire.
Partie III : Le moment pastoral : ici, sans doute, sont portés les coups les plus durs à la mythologisation (moderne) de la Grande Église[4]. Le « moment pastoral » et sa relation à l’épicurisme doit peut-être sa vigueur à la réactualisation de sa téléologie par le christianisme lui-même au début du millénaire — ainsi que de tout son système cosmologique. En ce sens, toute éthique qui ne serait pas conforme à l’éthique chrétienne dérange, et tout ce qui permet d’identifier le chrétien par le non-chrétien, et la vie éthique par la vie dissolue, encourage à produire des discours, des sermons, des prêches qui édifient peu à peu, dans le rejet, la singularité et l’originalité supérieure de la vie chrétienne. Toutes les figures antiques n’ont pas souffert de ce fonctionnement de l’activité pastorale, et le Moyen Âge chrétien bouillonnait de la plurivalence des figures qui le précédaient. On sait par exemple que son Énéide, en tant qu’elle annonçait Auguste, et pour les chrétiens, Jésus, valut à Virgile d’être considéré comme le plus « chrétien des païens », outre d’être le « prince des poètes » pour Dante. Deux personnages antiques qui ont donc deux places bien différentes, du point de vue des grands systèmes d’imaginaire en vigueur, dans la synthèse de Dante. Nous touchons là au cœur, au nœud entre philosophies, doctrines, mythologies, et figures historiques.
Partie IV : Sauver Épicure : peut-être la partie la plus intéressante pour l’historien, avec certains des quelques très grands noms aujourd’hui connus de l’activité intellectuelle médiévale[5] ; mais aussi avec une sorte de « découverte » de la dynamique de ces grands noms, précurseurs ou, loin des mythologies qui fétichisent la modernité, déjà investis dans un travail encyclopédique tourné vers l’érudition. Autrement dit, Abélard et Malmesbury, par exemple, travaillaient déjà avec sincérité à l’essor d’une libération de l’homme. Simplement, pour eux, cette libération pouvait — devait — passer par le christianisme. C’est un lieu commun que d’écrire, en 2021, que le Moyen Âge n’a pas été obscurantiste et que l’Europe n’a pas sommeillé dix siècles durant dans l’illusion béate et l’ombre féroce d’une Église machiavélique[6]. En fait, une telle conception de l’histoire est absolument conforme aux théories du complot, et l’Église a longtemps apporté bien plus qu’elle ne retirait, de sorte que ce fut sans doute l’un des secrets de sa longévité comme institution — peut-on en dire autant des États modernes ? Leurs formes institutionnelles dureront-elles mille ans ? Lorsque ces deux auteurs s’intéressent à Épicure, alors même que l’assise doctrinaire de son hérésie est déjà bien installée, ce n’est pas pour le poursuivre, mais pour tenter de le comprendre, et peut-être même le réhabiliter. En effet, Aurélien Robert écrit que :
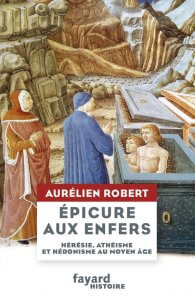
L’œuvre de Guillaume de Malmesbury est principalement consacrée à l’histoire de l’Angleterre, à ses rois, ses papes ou ses saints. Il a même rédigé une Historia novella, dans laquelle il raconte de grands événements de son époque. En marge de ces textes d’histoire politique et religieuse, il s’est aussi intéressé à l’histoire de la philosophie antique. En plus de quelques compilations d’auteurs anciens, c’est dans son Polyhistor, aussi appelé dans certains manuscrits Des propos et des actes mémorables des philosophes, qu’il résume la pensée de nombreux philosophes grecs et latins. On ne peut pas dire qu’il s’agisse à proprement parler d’une histoire de la philosophie antique, puisque le Polyhistor est conçu comme un recueil de citations et d’exempla censés illustrer les principales vertus nécessaires à la vie chrétienne. Si l’ensemble a une vocation historique et encyclopédique, il est avant tout tourné vers des considérations éthiques. Il s’agissait d’édifier les chrétiens par les exemples païens et l’argument général prend, comme chez Pierre Abélard, des allures d’arguments a fortiori : si les païens ont pu concevoir une telle sagesse, les chrétiens le peuvent aussi et doivent même s’y atteler avec encore plus de force et d’opiniâtreté. Comme chez Abélard, lorsqu’il est question d’Épicure, tous les jugements rapportés par l’érudit anglais sont positifs.[7]
On aurait donc une apologétique chrétienne qui attire à elle tous les imaginaires possibles et tous les arguments favorables à une exhortation à la vertu chrétienne. Agissant en somme dans la logique inverse de celle du poète italien, il est question ici de prendre tout ce qui peut promouvoir, s’intéressant moins à ce qui diffère qu’à ce qu’il y a de commun. Sauver Épicure, conformément aux raisons qui justifient qu’il soit nécessaire de le sauver, procède donc d’une dynamique complexe et plurielle, et l’essentiel de ce sauvetage ne se doit pas, selon Aurélien Robert, à ceux qui se prétendent les libérateurs, mais bien au Moyen Âge.
Partie V : Épicure et l’aristotélisme latin : peut-être la partie la plus intéressante pour le philosophe médiéviste, cette fois, en tant qu’on y trouve de larges morceaux de bravoure sur le travail, par les philosophes médiévaux, de l’aristotélisme, dans une reprise de l’épicurisme. Épicure et Aristote ayant tous deux fondé le sens de l’homme sur la quête du bonheur, il est presque naturel que les deux systèmes philosophiques entrent en une interaction si fine et en de si nombreux poins qu’un chapitre entier y soit consacré — et puis Lucrèce a sans doute participé à ce mélange. Il faut dire aussi que la philosophie médiévale redécouvre Aristote par le biais de la scolastique, lorsque les bibliothèques musulmanes entrent en contact avec la pratique ecclésiastique occidentale. On trouvera simplement très intéressant de voir, là encore, mais sur le plan de la philosophie pure, de quelle façon Lucrèce posait déjà la question que les Lumières saisiront, Rousseau et Kant en tête, sur la question du bonheur. De même, sur ce que nous pourrions bien considérer comme une sorte d’anticipation des réflexions sur le contrat social et le sens de ce qui fait le collectif (pp. 236-262).
Quelques remarques sur la prescription
Le ton de l’auteur est immédiatement drôle, et pour autant très respectueux du matériau qu’il cherche à saisir, de sorte que l’historiographie de la réhabilitation d’Épicure comme philosophe, est à la fois une apologie du philosophe et un acte militant sur le plan méthodologique. Aurélien Robert revendique d’opérer une sorte de dissection, distinguant deux puis trois figures d’Épicure : la figure dite populaire, la figure dite pastorale et, enfin, la figure philosophique. À quoi il faudrait poursuivre le geste de décomposition de l’ancien membre de l’École française de Rome, et adjoindre l’idée de plusieurs figures pastorales, l’une érudite et l’autre à des fins de propagande ; adjoindre aussi la figure de l’épicurisme, nettement distincte de la figure d’Épicure lui-même, qui est là encore dégradée en nuances nombreuses ; distinguer l’usage de l’histoire de l’imaginaire et de l’histoire de la philosophie — ou des concepts. Autrement dit, la notion est grandement stratifiée et un tel livre trace l’ébauche d’un travail nécessaire de démystification, de découpage, de tri, d’assainissement, c’est-à-dire au fond, un authentique travail d’historien, minutieux et respectueux. Cela n’interdit pas quelques énoncés franchement critiques, mâtinés d’humour, comme, par exemple :
On ne peut nier, en effet, que les épicuriens ont été méprisés pendant le Moyen Âge. Comme Dante, nombre d’auteurs les qualifiaient d’hérétiques, d’impies, d’hédonistes, ou encore de porcs.[8]
La liste est sans aucun doute avérée et dénote de l’amplitude des saisies de ces deux figures d’un imaginaire prolixe (Épicure et épicurisme), mais la familiarité du dernier terme pour évoquer un auteur aussi complexe et, surtout, aussi important, n’est pas sans rappeler des raccourcis terminologiques tout à fait actuels dans des débats qui devraient n’avoir pas lieu, qui ont déjà eu lieu pour d’autres catégories de personnes il y a un siècle, et qui montrent encore une fois que le rejet et l’incompréhension cultivent des jardins hélas fertiles. Pour l’écrire de façon synthétique, la propagande est un vieux réflexe humain, et l’un des projets de ce livre consiste à faire le tri, à partir de la décomposition des conditions formelles des imaginaires hérétiques autour de l’épicurisme et d’Épicure. Outre l’innovation méthodologique, qui utilise l’herméneutique pour défaire patiemment le nœud polémique d’un syncrétisme plurifactoriel (psychologique, politique, théologique, cosmologique, philosophique, historique), ce livre est décisif en ce qu’il porte, dans la pluridisciplinarité intrinsèque à son objet, l’impératif de l’étude des imaginaires.
Une nuance
L’auteur évoque une « concurrence » ressentie comme une menace de théologie potentielle par le judaïsme et le christianisme. L’époque des trois siècles de charnière (disons, allant du premier avant au deuxième après Jésus-Christ) est un immense bouillonnement intellectuel, philosophique et proto-religieux puis franchement théologique, de sorte que toutes les doctrines s’affrontaient et se défendaient ; comme l’épicurisme, certes, mais aussi comme toutes les formes de gnose, l’école d’Alexandrie, les péripatéticiens, déjà en bien des sens distincts des aristotéliciens, et, parmi celles-ci, bien sûr, le christianisme, et toutes s’arrachant par lambeaux à la fois au judaïsme et à l’hellénisme. Toutes ces écoles s’interpénétraient et c’est un lieu commun que de l’écrire. Certaines écoles ont particulièrement influencé, en creux ou en plein, les premiers penseurs du christianisme, appelé assez rapidement à dominer l’Antiquité.
Dire ou écrire que l’enjeu était théologique serait un non-sens, et l’auteur l’écrit d’ailleurs lui-même : les grecs et les latins ne pensaient pas exactement en termes d’orthodoxie ou d’hétérodoxie, et encore moins en terme hérétique. Il écrit aussi que le conflit entre épicurisme et chrétiens aurait pu trouver ses racines dans des préoccupations communes mais des pratiques différentes — nous y reviendrons —, c’est-à-dire que les chrétiens faisaient littéralement sécession de la pratique religieuse romaine, essentiellement publique. Chacun sait, aujourd’hui, que l’intime conviction religieuse, ce qu’on appelle la foi, est une innovation monothéiste, probablement plus chrétienne que juive[9], et que les citoyens romains incorporaient les gestes rituels religieux à la pratique citoyenne globale. L’exclusivité monothéiste, qui suppose un dieu jaloux, met donc les chrétiens en porte-à-faux et les marginalise, sans pour autant désigner particulièrement les épicuriens qui vivaient dans leur microcosme, parfaitement capables de s’adapter aux impératifs de la vie civile romaine.
En revanche, l’épicurisme, comme tout système philosophique, plus ou moins exclusivement, prescrit une pratique philosophique en conformité vis-à-vis d’une conception du monde, ce que la pratique philosophique peut appeler parfois un péri phuseos, de l’expression grecque littérale (Περὶ Φύσεως), « Sur le/À propos du monde ». Autrement dit, le philosophe, comme nombre de ses prédécesseurs (et de ses successeurs), réfléchissait à la place de l’homme dans le monde[10]. Le De rerum natura de Lucrèce n’échappe pas à cette logique et dans une période de grand recherche du sens et de la fonction des hommes et des femmes dans le monde, monde qui, en prime, traverse de très grands bouleversements structurels, toute réflexion sur le sens du monde, et de l’individu, est vue par toute autre réflexion comme une menace (comme autre système). Autrement dit, la menace qui a peut-être pu rendre l’épicurisme suspicieux aux yeux des premiers auteurs doctrinaires chrétiens, nous paraît moins avoir été théologique que cosmologique. La nuance pourrait bien n’être qu’un détail mais l’ouvrage est si précis et si complet que nous avons pensé intéressant de déplacer ainsi le point de vue sur le problème dans l’Antiquité.
Conclusion : une apologétique du médiéval
En fin de compte, l’ouvrage nous permet de disqualifier l’une des mythologies modernes les plus féroces, celles d’un humanisme ayant sauvé l’Europe de l’Église volontairement obscurantiste et malveillante. L’activité des clercs n’était ni homogène ni uniforme et, surtout, ne poursuivait pas un but qu’elle aurait su ou cru faux. La « renaissance » comme catégorie de l’histoire est un mythe, une facilité, une réduction des mécanismes à l’œuvre dans l’histoire des idées, qui permet de rendre l’enchaînement des événements — ou des imaginaires soulevés et constitués par la stratification de ces événements — représentable. Autrement dit, de constituer une pédagogie et une compréhension transmissible de processus extrêmement vastes et complexes. Il ne serait pas inintéressant, à notre sens, d’étudier les liens génétiques, sur le plan de la mécanique de l’activité de l’esprit, entre ce que nous identifions comme le « mythe » et ce que nous admettons comme l’ « histoire ».
Peut-être pourrions poser cette interrogation sous le scalpel d’un découpage de cette phrase, fort célèbre, « l’histoire est écrite par les vainqueurs » — dès lors est-elle écrite par des mythographes qui cherchent à promouvoir leur propre légitimité en même temps que de faire l’apologie et la justification de leurs actes[11], voire de leurs programmes.
Le retour d’Épicure à la Renaissance est un mythe. Le Moyen Âge n’a pas été cette époque intermédiaire qui aurait jeté un voile d’obscurité sur l’Antiquité avant que celle-ci ne soit pleinement retrouvée, pour ainsi dire intacte, par les humanistes. Le Moyen Âge n’a pas occulté l’épicurisme, parce qu’il n’a jamais cessé d’en parler. Il en a même trop parlé. En effet, si les théologiens médiévaux n’ont pas inventé la figure de l’épicurisme hérétique, athée et hédoniste, puisque celle-ci existait dès les premiers siècles de notre ère, ils sont responsables de sa très large diffusion, hors des débats de l’apologétique et de l’hérésiologie des premiers chrétiens, et, par suite, de sa transformation en image populaire. Mais ce discours anti-épicurien, omniprésent dans la théologie médiévale, en cache un autre, plus discret, plus positif aussi, sur le philosophe Épicure. C’est ce double discours que nous voulions faire apparaître dans ces pages, afin de mieux comprendre comment on pouvait à la fois blâmer les épicuriens et les condamner à l’enfer, tout en reconnaissant, dans un autre cadre, la bonté d’Épicure et la grandeur de ses idées, en particulier dans le domaine de l’éthique. D’un côté un portrait de l’épicurien rapporté à des figures séculaires et clairement identifiables, de l’autre un philosophe dont on essayait de reconstruire la vie, l’œuvre et la pensée dans les témoignages anciens disponibles à l’époque.[12]
Cette critique de la Renaissance, ou, au moins, de son autocentrisme, n’est pas sans nous rappeler l’ambition de réajustement auquel tenta de procéder l’Institut Warburg[13], fondé par l’historien de l’art Aby Warburg, à savoir la déqualification d’une « vie posthume » plutôt que d’une « renaissance » des ouvrages et des idées dont ceux-ci sont les supports et les transfuges. Épicure permet donc de voir de quelle façon il faut — ou il faudrait encore — réhabiliter le Moyen Âge contre une pré-modernité avide de sa propre gloire et qui ne paraît pas hésiter, parfois, à s’attribuer des mérites qui ne lui appartiennent pas dès lors que l’on se documente un peu. L’ouvrage entier d’Aurélien Robert paraît donc une documentation allant dans le sens d’une reconnaissance des trésors de l’activité médiévale, que ceux-ci vissent le jour sous le régime de l’Église ou non. Et l’auteur de finir sur une série de phrases lapidaires à l’endroit des humanistes :
Alors, peut-on dire que les humanistes ont sorti Épicure des enfers ? Ce n’est pas le cas et certains l’ont même plongé doublement en enfer. […] L’usage de l’Antiquité, de sa littérature et de ses mythes ne signifie donc pas nécessairement un progrès sur le plan des idées. Il s’agit parfois d’une simple manière de répéter une chose banale sous un habit neuf. En ce qui concerne Épicure, aucun doute, c’est bien le Moyen Âge qui l’a sorti des enfers.[14]
[1] — À ce jour, les Bibliothèques idéales sont au nombre de cinq et nous espérons qu’elles continueront d’être éditées dans l’avenir, en tant qu’elles jettent une ligne scopique exhaustive sur l’aspect dont elles portent chacune le nom. Bibliothèque classique idéale, de Homère à Marc Aurèle, dirigée par Catherine Lecomte Lapp et Eric C. Lapp, en 2007 ; Bibliothèque humaniste idéale, de Pétrarque à Montaigne, dirigée par Jean-Christophe Saladin, en 2008 ; Bibliothèque classique infernale, l’au-delà de Homère à Dante, dirigée par Laure de Chantal, en 2016 ; Bibliothèque idéale des philosophes antiques, de Pythagore à Boèce, dirigée par Jean-Louis Poirier, en 2017 ; Bibliothèque idéale mythologique, dirigée par Laure de Chantal et Jean-Louis Poirier, en 2019.
[2] — Paulin Ismard, L’événement Socrate, Paris, Flammarion, 2013.
[3] — Aurélien Robert, Épicure aux enfers. Hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2021, p. 129.
[4] — Dans un même registre, il faudrait lire notamment la contribution de Simon Fortier, Xénophane de Colophon et l’approche critique du religieux, in Bernard Collette-Dučić, Marc-Antoine Gavray et Jean-Marc Narbonne (dir.), L’esprit critique dans l’Antiquité. I, Critique et licence dans la Grèce antique, Paris, Belles Lettres, 2019, pp. 121-141. Le principe anachronique a longtemps été servi avec complaisance par les modernes, en guise de pratique de l’histoire et Simon Fortier le démontre admirablement, à partir de l’usage fait, par les Lumières, du philosophe antique Xénophane de Colophon.
[5] — Très contemporaine, cet grand intérêt pour les travaux de la philosophie médiévale se manifeste un peu partout, en France, aujourd’hui. Que l’on songe simplement aux travaux de traduction en français — et donc de mise à disponibilité scientifique — de certains scolastiques par Alain Boureau, avec notamment les écrits de Richard de Médiavilla, Pierre Jean de Olivi, deux scolastiques très importants pour l’appréhension médiéval du diable, de l’apocalypse et des démons en général. Mais on doit songer aussi l’activité de Hervé Pasqua, et notamment aux enregistrements audio de certains de ses cours que l’on peut trouver, « grâce » aux mesures de confinement, intégralement et gratuitement sur YouTube (Maître Eckhart et Nicols de Cues – Deux philosophes de l’Un).
[6] — S’il fallait encore s’en convaincre aujourd’hui, lire à ce propos toute l’œuvre de Jacques Le Goff, mais notamment Pour un autre Moyen Âge : temps, travail et culture en Occident : 18 essais, Paris, Gallimard, 1977 et, surtout, L’Imaginaire médiéval, Paris, Gallimard, 1985, qui pose le Moyen Âge comme un imaginaire absolument moderne. Il est paru tout récemment un excellent essai qui programme, en fait, une mise en crise radicale de la pratique qui a longtemps faite de l’histoire comme principe de vérité sur les événements : Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ?, Paris, Le Seuil, 2014.
[7] — Ibid., p. 195
[8] — Ibid., p. 16
[9] — Il est plus que difficile de parler d’une homogénéité de la pratique judaïque du monothéisme, sachant la connaissance que nous avons du lent processus de « monothéisation » du culte de YHWH. Lorsque les chrétiens « arrivent » dans l’horizon politique et religieux, le judaïsme est déjà vieux de plus d’un demi-millénaire. Quand bien même nous nous focaliserions sur l’époque en question, le judaïsme avait sans doute d’autres préoccupations que de se défendre de l’épicurisme, qui n’était qu’un péri phuseos comme un autre.
[10] — On compte les traces d’un grand nombre de péri phuseos chez les pré-socratiques, parmi lesquels Anaximandre, Héraclite, Parménide, Xénon, par exemple, et Platon lui-même s’y adonna. Le système philosophique s’adonne ainsi à la tentative de médiation entre l’homme et le monde, c’est-à-dire à lui assigner un sens et une fonction dans l’ordre cosmologique. La pratique philosophique est une relation à la nature, au monde, aux dieux.
[11] — C’est un travail déjà entamé, en fait, par Hans Blumenberg, et, pour n’évoquer que le plus direct de ses ouvrages sur cette question spécifique, notamment dans Préfiguration. Quand le mythe fait l’histoire, Paris, Seuil, 2016. D’une façon plus générale — plus systématique —, il défend les mêmes choses dans son ouvrage Arbeit am Mythos, 1979, encore non traduit en français mais que l’on peut trouver en anglais, sous le titre Work on myth, Cambridge, MIT press, 1985.
[12] — Ibid., p. 311
[13] — Institut auquel on doit notamment l’incroyable ouvrage collectif Saturne et la Mélancolie, par des auteurs non moins remarquables que le sont Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Paris, Gallimard, 1989 pour l’édition française (version anglaise parue en 1964, qui est la première forme complète parue de l’ouvrage). Une réédition, en anglais, de l’ouvrage vient d’avoir lieu sous la direction de Philippe Despoix et Georges Leroux en novembre 2019 : Saturn and Melancholy, Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art, Montréal, McGuill’s Queen University Press, 2019.
[14] — Ibid., p. 318.