On s’attend en découvrant l’ouvrage à assister à l’exercice classique du dialogue entre un philosophe et un physicien. A la lecture cependant, ce dialogue paraît très particulier : le physicien évoque Derrida, Deleuze, Artaud, la philosophie analytique et ne semble en appeler qu’en passant à sa discipline (bien que ses développements fournissent une inspiration forte à ses propos). L’objet du livre1 est ainsi de part en part philosophique et c’est sous cet horizon là qu’il doit être lu.
Espacement, contingence
La pensée de Nancy et Barrau s’inspire en effet – on pourrait dire touche et est touchée – par une ligne de tradition que nous rappellerons d’abord par quelques considérations générales.
Si l’on considère que la philosophie est naturellement amenée à tenter de se ressaisir elle-même comme philosophie, si la raison semble vouée à se demander en quoi elle est la raison, rendre compte de ce qui fait l’intelligibilité de l’intelligible – se demander en somme en quoi la pensée pense et expose le pensable en tant que tel, alors quelque chose se brise quand se mouvement de totalisation s’expose à son tour comme tel et, s’exposant, se disloque.
La pensée de Nancy est à la fois une pensée du sens et une pensée du concret. Sens et concrétude y sont pensés dans l’impulsion d’un monde ou d’un monder (non, comme chez Heidegger – ou même, d’une certaine façon, chez Fink pour qui le « jeu du monde » dans son caractère libre et infondé, reste, d’une certaine façon, envisagé dans l’horizon d’une ontologie classique). La mondanité (il faudrait dire : la mondialité) n’est pas un élargissement de l’horizontalité (ou du principe d’horizontalité) mais son dessaisissement. Le monde est « l’il y a » se déployant : originairement pluralisant et pluriel, pluralisation et prolifération en laquelle nous sommes toujours déjà nous-mêmes étendus et répandus. Il est monde en tant même qu’il est contingence absolue, contingence de « l’il y a » – de l’il y a du tout qui est d’abord il y a d’un « ceci », de l’il y a comme régime de la manifestation. L’ouverture à l’être est tout autant fissure originelle de sa compacité, fragmentation, gratuité, donc, du même coup, mutité (« Nous sommes ainsi nous-mêmes la non-coïncidence du monde avec lui-même2 »
Ce « là », qui est toujours ce « là » « ici » ce « là » singularisé et particularisé – factuel autant que factice – qui est toujours celui-là – celui-là qui pourrait être n’importe quel autre en tant même qu’il est irréductiblement celui-là – cette singularité irréductiblement insistante – dérange même l’organicité mystérieuse cette ouverture-là. Le « là « qui est là est « celui-là » – désigné et soustrait par sa singularité même du registre de la parution : c’est bien ça qui est le monde – ou plutôt la mondialité se donne bien par ça. La singularité de ce qui a lieu se noue à la singularité de celui à qui cela arrive : c’est parce que rien ne lie l’apparition au point d’où elle s’ouvre – rien ne me lie à ce qui m’arrive – que c’est bien cela qui arrive.
Le monde ainsi, en tant que monde, en tant que le tout (toujours multiple, ouvert, intotalisable) de l’apparaître, est concret, c’est-à-dire qu’il ne s’explicite pas de son propre déploiement. Il est immédiatement là . L’intelligibilité n’est pas libre et ouverte, ni souveraine. Comme intelligibilité, comme sens, elle est aussi sens de, sens a, se perd, s’englue dans ce qu’elle ouvre et qui toujours aussi s’y dérobe et résiste. « (…) le monde dérobe et déporte de manière vertigineuse la consistance de sa réalité « en soi ». Il n’est ni réel au sens d’une extériorité objective, ni irréel au sens d’un rêve. Plus que « réel « ou « irréel », il a l’effectivité de l’interaction et de l’entrelacs entre « nous » et « lui »3 » Ainsi, l’intelligibilité ouverte au sein de la pulsation du sens est elle-même, pour Nancy, une intelligibilité obscure.
Il s’agit bien aussi cependant de penser le paraître, la passibilité du paraître dans l’être, le jeu de l’être dans le paraître. . « L’être est lui-même paraître, il l’est intégralement. Rien ne précède ni ne suit le « phénomène qui est l’être même4» Mais il ne paraît pas à une conscience ou un sujet : il comparait. L’être se creuse de lui-même, la parution (donc aussi la négativité) est l’être s’étant ou se faisant. Non qu’il n’y aie de nécessité que l’être paraisse : l’être n’est au contraire pensable que comme passibilité à lui même, passibilité enfouie en la sensibilité . Le paraître est gratuit, froissé par le fond insaisissable de l’être s’espaçant et se « touchant » en lui – fond qui n’est que toucher et espacement. « Le réel ne dissout pas tout en irréalité, mais il ouvre sur la réalité de son insupposition5» La mondialité se dévoile alors, une fois déconstruite toute structure monde, comme jeu, comme contiguïtés multiples. Cette dislocation est duale puisqu’il s’agit à la fois d’y voir insister une pluralité (le monde est mondes, pluralité de trajets, de parcours, de perspectives) et le spectre ou la trace de l’Un – pas même un, donc.
Plus d’un/Moins d’un
Il n’est pas question de substituer le multiple à l’un mais de montrer que l’un est lui-même auto-division : que la pensée de l’un est pensée de plusieurs uns et pensée de moins d’un, car l’un s’échappe à lui-même en se posant, se défait, se soustrait. L’un n’a lieu qu’en se dédoublant. Arithmétiquement même, passer de l’un au deux affecte aussi le sens de l’un ; « S’il est impossible en effet qu’un être soit sans être un, il est possible en revanche, il est peut-être même nécessaire que l’un comme l’être relèvent d’une autre logique de l’Un6» L’Un se posant se retire non seulement à notre prise, mais à lui-même. L’Un s’excédant n’est plus qu’unicité d’impulsion ou de pulsion. Il est en se différant de soi, non pas retiré en lui-même comme un point mais transport du point hors de lui-même, spatialisation, autodifférenciation du point. Ainsi ce « plus d’un » reconnu comme « irrelevable, n’est pas le pur arasement du nihilisme, mais le rythme de l’enchainement ou de la répétition : « « Plus d‘un » c’est alors la multitude moins comme prolifération que comme efflorescence, comme surabondance et pour finir comme excès de sens7.» Le monde est bien un – mais un comme un jet, une éjection vers un dehors toujours plus vaste, toujours retiré à l’assurance d’une unité de dessein L’Un donne l’énergie de poussée d’expulsion de l’être. De fait, plus d’un est aussitôt « moins d’un », car les singularités proliférantes ne sont pas des Uns, l’Un pluriel ne devient pas une nouvelle instance judicative.
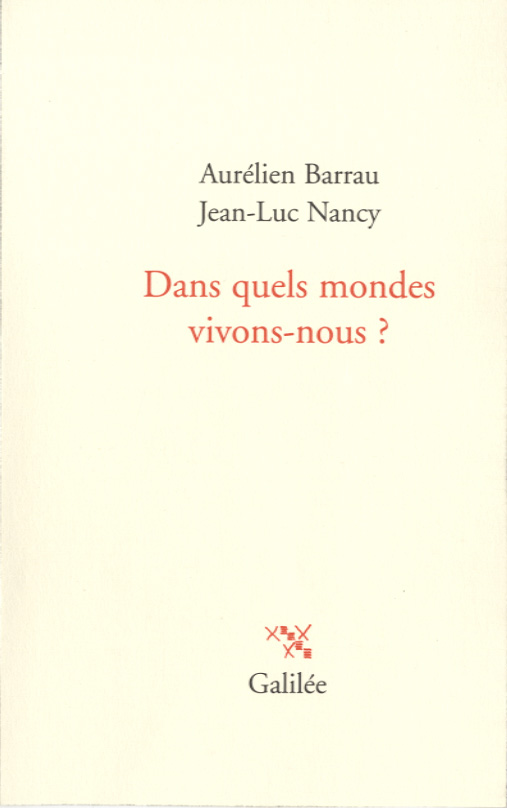
Plus d’un apparaît aussi selon Aurélien Barrau comme un schème sous-jacent de la philosophie analytique : plus d’un monde possible, plus d’une description. En quelque sorte, philosophie analytique et philosophie continentale se rencontrent au sein du besoin de révoquer l’ordre de l’un. Que traduit en fin de compte la pulsion d’unification en science, sinon la prolifération de plus en plus d’objets possibles, la nécessité de ménager de plus en plus de jeu dans l’unité. Les symétries sont autant de matrices brisées et « une méta-structure de diversité semble s’inscrire dans la structure du multivers8» Plus encore que la profusion des théories, c’est la co-présence de modèles s’appliquant aux mêmes phénomènes. La nécessité d’unification vient de ce que certains lieux obéissent à des règles relevant de deux modèles distincts, et il faut bien réussir – formellement, par des outils mathématiques – interprétés dans un sens physique – permettant de les traduire l’une dans l’autre.
L’unité traduit de fait une reconnaissance de pluralité dans l’unité même, la reformulation d’une unité plus vaste où ressaisir les uns qui se divisent sous les perspectives. La pulsion de la physique contemporaine vers l’unité est articulée à la mise à jour d’une vaste diversité : il s’agit par exemple de comprendre les types d’objets qui peuvent se former grâce à une matrice théorique qui dévoile à son tour la possibilité d’autres types d’objets, ou d’appliquer différents prismes à une réalité. Une réalité peut être envisagée dans différentes configurations d’individuation (pour prendre un terme simondonien) selon le système d’interactions qu’on considère ; différentes équations pourront décrire le comportement d’un électron selon qu’on le considère dans son rapport au noyau atomique, dans la construction des molécules – même si des situations limites font se toucher les domaines, et si des phénomènes complexes attestent de l’intrication de ces niveaux (ainsi, des architecture macro-moléculaires mobilisent des géométries qui ne s’élucident qu’à des niveaux quantiques). Il y a ainsi multiplication et contamination des plans : l’intelligibilité produit de la diversité autant que de l’unité, effrite l’un autant qu’elle ne l’appelle (les paramètres libres du modèle standard appellent à leur tour à une reprise théorique invitant à l’élargissement de ce modèle, etc.).9
Struction/Instruction.
Ce jeu de l’un se divisant et s’estompant se laisse appréhender comme une techno-logie de la pluralité des mondes dans le monde. La technique en effet ne vient pas du dehors à la nature, mais est coextensive de la manifestation qui est composition et réticulation. Au plus proche de Heidegger, mais en décalage avec lui, ce n’est pas, cette dimension originairement technique et prothétique de l’ouverture de/à l’être mais son interprétation en un schème constructif que la déconstruction défait : l’hypertrophie du motif de la construction conduit à un accent mis sur la destruction qui l’habite et joue en elle, car la construction, originellement mobile, volatile, multiple n’est qu’un pan de ce jeu originaire de construction/destruction qu’est l’être s’ouvrant, que Nancy qualifie de struction. Ainsi « La simultanéité non coordonnée des choses ou des êtres, la contingence de leurs coappartenances, la dispersion des profusions d’aspects, d’espèces, de forces, de formes, de tensions et d’intensions (…) » De cette façon l’espace cesse d’être horizontal : il n’est plus borné par l’horizon d’un inconnu, mais un feuilleté en un enchevêtrement d’appartenances.
La struction avère en quelque sorte un hors temps au sein du temps qui interdit tout rassemblement dans l’horizon d’une présence – même de recueil.
Bien sûr, il faut être prudent avec de telles affirmations : si l’ontologie au sens de la fondation absolue et de l’exposition du fondement comme fondement, de l’exposition et de l’explicitation du sens du sens semble achevée – si toute étreinte d’ensemble de la raison et du réel semble dénouée (ou accomplie ?), on ne peut pas pour autant faire ce qu’on veut avec le réel : on le rencontre d’une certaine façon, des descriptions et des explications sont meilleures que d’autres – certaines sont simplement hors de propos… Autrement dit encore, il y a des formes, des configurations, des affinités dans le réel, mais elles ne rendent pas raison d’elles-mêmes ; – la pulsation du sens qui ménage l’intelligibilité est béance du paraître et de ce qu’il paraît.
Cette struction ouvre alors du même coup la question – que Barrau tente avec Derrida d’extraire à rebours du schème de l’ordre et de l’ordonnancement – du chaos comme tel, précisément difficile à appréhender pour une pensée philosophante qui se veut toujours prise, saisie, ordonnancement, et tend, dès qu’elle thématise le chaos, à occulter ou refouler ce qui en fait le caractère abyssal. Ainsi Deleuze et Guattari font bien fond sur le chaos, mais sur un chaos posé par la pensée, tenant paradoxalement lieu de fondement, de réserve virtuelle sur laquelle la pensée tisse des trajets, à laquelle la pensée soutire de nouvelles constructions – un chaos générateur, producteur auquel la pensée s’abreuve en s’y exposant, y abandonnant ses délimitations. Ce chaos ressource pour la pensée n’est alors pénétré comme tel par la pensée, ni à proprement parler, la pénètre : se nourrissant du chaos, la pensée ne se laisse pas disloquer par lui, ne se risque pas encore à penser au risque du non-sens et de la mutité, aux lisières de l’articulable. La pensée deleuzienne ne pense pas le point même du sens – sa pulsion à même son estompement, son hésitation, ne laisse pas au sein même de la pensée le fantôme, la dépossession. La pénétration de la pensée par le chaos est bien envisagée par la lecture que propose Derrida de la question de la Chôra – ou simplement de Chôra sans genre – de Chôra qui co-appartient, comme son envers, à toute ordonnancement et le disloque de l’intérieur en tant même qu’elle l’ordonne.
Mais sans doute aussi, le rapprochement du Chaos et de la Chôra est problématique – précisément parce qu’il ne saurait y avoir d’expérience du sans fond, de l’abîme, qu’il est en quelque sorte nécessaire pour que le sans fond affleure que celui-ci soit décelé au sein même se l’articulation et de la présentation telle qu’elle s’ordonne – toute contiguïté est déjà façon, sinon de structurer, du moins de tracer un chemin. Ici, Aurélien Barrau pourrait invoquer les intéressantes explorations post-déconstructrices menées par Benoit Goetz ou Catherine Malabou, qui compliquent et radicalisent le geste derridien en récusant la thématique du lambeau, de l’informe, de la pulvérisation pour tenter de penser de concert la Bildung et sa béance interne – autre nom de son impulsion métamorphique, la dislocation comme composition et configuration et comme jeu de déplacements. Il y a précisément, pour toucher le fond de chaos, nécessité de penser l’ordonnancement à même son auto-dislocation : de l’instruction au sein de la struction.
Pour prolonger
On pourra en fin de parcours se demander cependant ce qu’apprend cet ouvrage à qui connaît déjà Deleuze, Derrida, Nancy. Sans doute le mot, struction, posé sur l’inhérence de la construction et de son auto-déconstruction, prolonge et spécifie-t-il de façon intéressante la thématique de la déconstruction. Sans doute aussi la pensée de Nancy fonctionne-t-elle par reprise, déplacements imperceptibles, glissements ; par un rythme lent de répétition et pas par cumul.
En ce sens, l’ouvrage est tout à fait nancyen – peut-être même trop pour un livre qui se présente comme un échange. On reconnaît bien la prose singulière de Nancy –son écriture, disons, hégélienne. De la même façon que la construction et la temporalité du phrasé de Hegel rythme l’esprit s’appréhendant et se déployant – bouleversant ainsi dans la pulsation même de son écriture les catégories de pensées toujours rouvertes par l’acte pensant qu’est la phrase – la prose pensante de Nancy est en effet un déploiement du sens se faisant en écart avec soi-même, somatisant ses sauts, ses glissement de proche en proche qui ne sont ni des déductions ni des associations, l’espacement des concepts dans la langue qui les rencontre et les déborde. Elle propose un rythme singulier d’écriture, conjuguant lenteur et vitesse, sachant s’arrêter assez tôt pour sauter par-dessus un raisonnement dont la longueur serait fatalement déperdition, dérive. En quelque sorte, la langue du philosophe se tient ici au niveau de cet Un qui se défait et se dédit et reflète la pulsation de sa déhiscence.
L’écriture qu’on pourrait qualifier de derridienne d’Aurélien Barrau est cependant elle-même bien proche de cette prose singulière de Nancy : peut-être, pour que la résonance soit plus forte, aurait-on pu espérer plus de contrastes dans les styles.
- Jean-Luc Nancy, Aurélien Barrau, Dans quels mondes vivons-nous ?, Galilée, 2011
- p. 16
- p. 15
- p. 97
- p. 92
- p. 33
- p. 28
- p. 65
- On évoquera brièvement pour l’exemple la théorie dite standard, qui lie électromagnétisme, force nucléaires faibles et forte. La force électromagnétique est dite de portée infinie (on peut l’observer à l’échelle macroscopique) tandis que la force faible a une influence uniquement à l’échelle microscopique, au niveau du noyau atomique). Cependant, la force faible a une intensité croissant selon les niveaux d’énergie : à certaines échelles d’énergie, force faible et électromagnétisme deviennent similaires. À de telles échelles, la théorie électrofaible prédit une expression unique des deux forces.
Il s’agit de comprendre la brisure de symétries qui, à des niveaux d’énergies plus faibles, annule la force faible pour des distances supérieures à celle du noyau atomique sans annuler l’électromagnétisme. Pour le dire vite, on considère les particules dites de champ, dont l’action consiste essentiellement à transmettre les forces (les photons liés à l’électrodynamisme, les bosons intermédiaires à la force faible, et les gluons à la force forte) pour comprendre à partir de leur description mathématique quel processus peut amener une telle brisure de symétrie, en l’élaborant d’abord mathématiquement une structure formalisant cette brisure, puis en esquissant une « phénoménologie » de cette formalisation. Ainsi, une autre « particule » – plus précisément un « champ scalaire » appelé boson de Higgs – a été introduite pour comprendre comment les bosons intermédiaires peuvent acquérir cette masse non-nulle qui cantonne l’interaction faibles aux très petites distances. Le principe est bien, donc, de construire et de manifester l’unité d’un phénomène corrélant une stabilité structurelle mathématiquement élaborée et une stabilité phénoménale expérimentalement attestable. Il faut bien voir ici qu’en physique contemporaine, les particules désignent des ensembles structurés de paramètres définis par leurs comportements en réaction à d’autres paramètres : lorsqu’on dit qu’un neutron ou un proton est constitué de trois quarks, il s’agit d’isoler des sous-ensembles de propriétés stables auxquels la description mathématique peut mieux s’appliquer et dont la combinaison des paramètres rend compte des propriétés des neutrons ou des protons (ceux-ci étant à leur tour utilisés sous ce niveau de description lorsqu’il s’agit de s’intéresser à des interactions atomiques). La théorie procède ainsi d’abord à une mise en forme transcendantale-mathématique d’un magma de données dont l’objectivité est constituée sur différents plans : il s’agit en effet d’une part de modéliser mathématiquement la brisure de symétrie, d’autre part d’interpréter ce modèle en y associant un phénomène, et enfin d’objectiver expérimentalement ce phénomène – constituant les conditions expérimentales dans lesquels il peut bien se manifester – sur un certain plan, par une certaine coupe de la réalité – comme un phénomène. Le but n’est pas seulement de décrire plusieurs niveaux avec les mêmes équations, mais d’avoir quelque chose comme une « ontologie » derrière la théorie, c’est-à-dire de constituer des « phénomènes » qui peuvent lui être associés, de la considérer comme puissance d’extraction d’objectivité.








