Nous avions précédemment recensé, pour Actu Philosophia, l’ouvrage de Barbara Stiegler intitulé Il faut s’adapter. Essai sur un nouvel impératif politique[1] : dans cet essai, la philosophe justifie la critique du néolibéralisme de Walter Lippmann au nom du pragmatisme de John Dewey gros, selon elle, d’une démocratie directe fondée sur l’intelligence collective. Elle souligne également que la querelle, loin de se réduire à un débat politique, possède une dimension proprement épistémologique qui porte sur l’importation du darwinisme en sciences humaines et en philosophie. De telle sorte, au fond, que le néolibéralisme et le pragmatisme, en dépit de leurs différends, se rattachent à cette même matrice qui, au progrès moderne tout empreint de téléologie, substitue la factualité de l’évolution.
Tout l’intérêt de l’anthropologie philosophique allemande réside précisément dans le fait de vouloir fonder des sciences humaines et une philosophie sur des connaissances scientifiques, et plus particulièrement biologiques, qui contredisent l’hypothèse de la sélection naturelle. Il en ressort, fort logiquement, une vision du monde et de l’homme qui rompt tant avec le néolibéralisme qu’avec le pragmatisme. De ce point de vue, ce que Barbara Stiegler mettait en scène comme une dualité, dont on pourrait penser à lecture des analyses de la philosophe qu’elle épuiserait tous les possibles, prend la forme d’un système unifié et cohérent quand on quitte le contexte américain.
Voilà en particulier ce qui nous est donné à lire et à découvrir dans la somme d’Arnold Gehlen intitulée L’homme. Sa nature et sa position dans le monde, récemment traduite et présentée par Christian Sommer et publiée aux Éditions Gallimard[2]. Oui, il s’agit bien d’une somme : presque six cents pages d’une écriture toujours dense, souvent technique, parfois absconse, qui, il faut l’avouer, ont de quoi décourager le lecteur, même courageux. Fort heureusement, la présentation de Christian Sommer, qui expose le contexte ainsi que les grandes lignes de l’ouvrage, est claire et pédagogique. Par ailleurs, Gehlen propose, dans une longue introduction de cent pages, une synthèse de son ouvrage qui récapitule ses thèses, son argumentation et son cheminement. Ainsi guidé, le lecteur possède une idée assez nette du contenu de l’ouvrage avant d’entrer dans le vif du sujet.
L’idée d’une anthropologie philosophique
La finalité de l’anthropologie philosophique est de mettre en exergue la position spécifique de l’homme dans le monde, et de le faire à partir de l’homme lui-même : non pas à partir de Dieu comme c’est le cas dans la tradition monothéiste, ni à partir de l’animal comme le modèle de Darwin y invite. D’ailleurs, Gehlen note, à propos de l’évolution, qu’elle est « un concept hypothétique qui bascule bien trop facilement dans la métaphysique » (page 35). Remarque qui concerne très certainement plus Ernst Haeckel, connu pour sa loi de la récapitulation selon laquelle l’ontogenèse reproduit les différentes étapes de la phylogenèse, que la théorie de Darwin dont l’effort constant fut justement d’expurger la compréhension du vivant de tout relent métaphysique.
Comment, donc, penser l’homme ? À partir de quel « seul et unique point » ? Quelle est cette « anthropologie élémentaire » (page 37) ? Voici le point de départ de la réflexion de Gehlen :
« la nature a attribué à l’homme une position spécifique, autrement dit elle a pris, dans l’homme, une direction de l’évolution présente nulle part ailleurs, encore jamais esquissée, elle s’est plus à créer un nouveau principe d’organisation. Ce principe implique l’homme trouve dans sa pure existence un problème, que son existence, de façon tout à fait élémentaire, devienne à elle-même son propre problème et sa propre aptitude : pour lui, vivre l’année d’après relève déjà d’une aptitude considérable pour la réalisation de laquelle il doit faire usage lui-même de toutes les capacités humaines » (page 41).
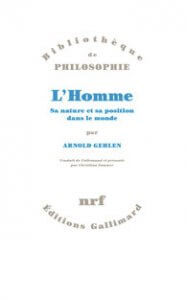
Pour Gehlen l’homme est une exception, dans la mesure où « sa structure physique contredit diamétralement toutes les lois organiques régissant le monde animal » (page 41). Précisons alors ce que Gehlen retient des études biologiques de son temps (celles de Louis Bolk, d’Otto Schindewolf, d’Adolf Portmann, tous penseurs, d’une manière ou d’une autre, de la néoténie humaine) : « D’un point de vue morphologique, en effet, l’homme, contrairement à tous les mammifères supérieurs, est principalement déterminé par des déficiences et autres inadaptations, non-spécialisations, primitivismes, c’est-à-dire par un état d’immaturité » (pages 61-62). Sans protection naturelle, dépourvu d’organes défensifs et offensifs, faible et même impuissant à sa naissance, l’être humain aurait disparu depuis bien longtemps s’il avait dû vivre dans des conditions naturelles. C’est précisément en ce point qu’apparaît la singularité de sa position dans le monde :
« La tendance de l’évolution naturelle vise, en effet, à adapter des formes hautement spécialisées d’un point de vue organique pour les intégrer dans leurs milieux respectifs entièrement déterminés […]. L’homme, au contraire, sous l’aspect morphologique, ne dispose pour ainsi dire d’aucune spécialisation. Il est constitué par une série de non-spécialisations qui apparaissent comme des primitivismes du point de vue de la biologie de l’évolution […] » (page 62).
L’anatomie de l’homme démontre par conséquent que son apparition se produit à rebours de l’évolution, qu’elle circule à contre-sens du courant de l’histoire : non point vers le développement d’organes spécialisés lui permettant de s’adapter à un milieu en occupant une place spécifique dans l’ensemble des relations du vivant, mais tout au contraire par le réfrènement de ce mouvement de différenciation.
La spécialisation comme événement
Mais soyons encore plus précis : qu’appelle-t-on au juste « spécialisation » ? « Il faut comprendre par « spécialisation » la perte de la plénitude des possibilités inhérentes à un organe non spécialisé au profit du surdéveloppement de certaines de ces possibilités, qui l’emportent sur d’autres » (page 132). La spécialisation est un événement, elle est en cela irréversible : l’approfondissement d’un caractère, sa pleine actualisation, mettent fin à l’existence des possibles ou, plutôt, empêchent des gestes ou des comportements qui auraient pu apparaître de se manifester. Perçue dans le cadre de la théorie de l’évolution comme un avantage sélectif, c’est-à-dire comme une positivité associée à la survie, la spécialisation devient, du point de vue de l’anthropologie philosophique, une diminution, non pas de ce qui est, mais bien de ce qui pourrait être ou eût pu être. Elle introduit dans le corps une hypertrophie localisée en dotant un organe particulier d’une capacité étrangère aux autres parties ; à rebours, la non-spécialisation préserve l’équilibre général de l’organisme en entretenant une règle de proportionnalité entre ses parties.
Quelle est alors la conséquence générale de ce dénuement biologique, de cette incapacité naturelle à la survie ? « […] il compense ce manque par sa seule aptitude au travail ou par son talent pour l’action, c’est-à-dire par ses mains et son intelligence […] » (page 62). En d’autres termes, puisque que l’homme ne s’adapte pas à ces conditions d’existence par le biais d’une spécialisation, il lui revient de prendre l’initiative et d’agir : d’aménager son milieu, voire de le transformer, afin de pouvoir y vivre. Toutes ses caractéristiques – perception, mouvement, langage, pensée, imagination, etc. – sont orientées vers cette tâche. Ceci implique également que l’homme ne se trouve guère dépendant du lieu, qu’aucun lieu ne revêt la force d’une fatalité ; tout au contraire, il se trouve en mesure de s’établir partout où les conditions élémentaires de la vie sont présentes. Comme le résume Christian Sommer dans sa présentation, « la négativité de la déficience de l’homme conduit à la positivité de son action » (page 16).
Le principe de délestage
Se pose toutefois un problème : la situation d’ouverture au monde dans laquelle l’homme se trouve, du fait même de sa non-spécialisation, entraîne une « charge fondamentale » et une « sur-stimulation » (page 65) : puisqu’il est attentif au moindre signal, puisqu’il est sensible aux moindres impressions, l’être humain court le risque de tomber dans l’inaction, paralysé qu’il pourrait être par la profusion d’informations qu’il reçoit et capte de son environnement. Il se trouve ainsi dans une situation paradoxale dans laquelle son ouverture au monde lui impose d’agir en même qu’elle l’empêche de le faire spontanément.
C’est la raison pour laquelle Gehlen introduit ce qu’il nomme le « principe de délestage », dont il affirme qu’il « est la clef pour comprendre la loi structurelle régissant l’ensemble des attitudes humaines » (page 66). Plus loin, l’auteur assimile le délestage à « une réduction […] du contact immédiat avec le monde » (page 69), confirmant ainsi que l’homme ne pourrait agir sans une sélection des impressions qui permette, dans un second temps, de les ordonner et de les rendre intelligibles. Ce principe de délestage différencie d’ailleurs fortement l’homme de l’animal, dans la mesure où ce dernier demeure captif de l’immédiateté, d’une part en raison de l’adéquation de sa spécialisation au milieu, d’autre part du fait du rôle fondamental des pulsions, tandis que le premier crée une distance entre son environnement et lui-même. Le langage constitue assurément l’opération de délestage la plus fondamentale car, par lui, « la chose réelle se trouve neutralisée et mise à distance : une fois la pensée libérée, le mot forme un « monde intermédiaire », il nous est désormais plus proche que la chose et brise la force suggestive de l’impression optique » (page 350). Ainsi le langage, en objectivant les impressions et les perceptions, interrompt l’ensorcellement provoqué par la situation d’ouverture au monde et émancipe l’homme de l’immédiateté.
Conclusion
Tirons, pour clore cette recension, deux conséquences de ce principe de délestage. La première mène à cerner la nature de l’institutionnalisme de Gehlen. Pour ce dernier, en effet, la nécessaire maîtrise de l’excédent impulsionnel, qui n’est autre que la face interne du dénuement biologique externe, c’est-à-dire du risque permanent dans lequel vit l’homme, conduit à définir ce dernier comme « un être de discipline » (page 97). Ainsi la situation néoténique implique-t-elle d’instaurer des contraintes afin de canaliser et d’orienter cette structure impulsionnelle. L’éducation et les institutions jouent de ce point de vue un rôle fondamental, la première par l’apprentissage voire le dressage de l’attention, qui conduisent à former des habitudes, les secondes par les règles et les normes qu’elles dictent à la vie collective. De ce point de vue, la thèse de Gehlen mérite d’être bel et bien replacée au sein d’un courant conservateur – avec le juriste Carl Schmitt notamment – qui postule la nécessité des institutions (et d’institutions stables et fortes) pour éviter le surgissement de l’état de nature, c’est-à-dire du chaos.
Venons-en, alors, à la seconde conséquence : elle concerne cette fois-ci « la racine commune de la connaissance et de l’action » (page 74). La position spécifique de l’homme amène à reconnaître qu’il n’y aurait pas d’un côté la vie contemplative et de l’autre la vie active : toutes deux sont toujours déjà impliquées et à l’œuvre dans tout agir, en raison de la constitution fondamentale, bio-anthropologique, de l’homme. C’est ainsi que Gehlen cherche à dépasser tous les dualismes hérités de la modernité, voire de la métaphysique : ni mécaniste, ni vitaliste, son effort de conceptualisation cherche à retrouver l’unité de l’homme à travers une théorie de l’action qui ménage une place au corps et à la pensée, aux fonctions inférieures et aux fonctions supérieures, à l’individu et à la collectivité. C’est seulement de ce point de vue qu’il faut entendre la sentence selon laquelle « la culture est la « seconde nature » » (page 68).
[1] On pourra également lire l’entretien avec Barbara Stiegler autour de ce même livre.
[2] Arnold Gehlen, L’homme. Sa nature et sa position dans le monde, Traduction Christian Sommer, Paris, Gallimard, 2011.








