De prime abord, le titre, La grande soif de l’Etat. Michel Foucault avec les sciences sociales, peut surprendre le lecteur1 : Michel Foucault (1926-1984) n’avait-il pas fait l’économie d’une théorie de l’Etat ? Dès lors comment Arnault Skornicki va-t-il rapporter « la grande soif de l’Etat » à l’œuvre foucaldienne ? Quelle orientation va-t-il donner au dialogue entre Foucault et les sociologues comme Weber, Bourdieu, Elias ou Thompson ? Si, au XXème siècle, Foucault s’est distingué comme un penseur des relations de pouvoir (relations induisant une discipline intériorisée via des dispositifs matériels que l’on connaît : école, prison, caserne, usine, et hôpital), et non comme un théoricien de l’Etat à proprement parler, il entreprend pourtant de faire la généalogie de l’Etat moderne. Dans La grande soif de l’Etat. Michel Foucault avec les sciences sociales, Arnault Skornicki nous montre avec beaucoup d’intelligence qu’on peut lire « une théorie de l’Etat en creux chez Michel Foucault ». Comment faut-il l’entendre ? Quel est exactement cette théorie de « l’Etat en creux » ? Nous verrons tout d’abord qu’Arnault Stornicki défend l’idée d’une « théorie non systématique et inachevée de l’Etat » chez Foucault en faisant dialoguer ses textes avec ceux des sociologues comme Max Weber ou encore Pierre Bourdieu. D’autre part, il montre que « la généalogie de l’Etat moderne chez Foucault est compatible avec la sociologie ». Dès lors, les concepts de biopolitique ou de gouvernementalité apparaissent comme des outils pour saisir l’étatisation des rapports de pouvoir, et donc les processus de monopolisation politique.
Despote masqué ou libérateur potentiel, la notion d’Etat a suscité depuis le XVIIIème siècle beaucoup de théories unificatrices, souvent en forme d’utopies positives (proposant un modèle social à édifier), ou critiques (dénonçant un modèle de domination). Cette incessante quête d’une « théorie de l’Etat » a alors été suspendue au profit d’un ensemble d’approches plus casuistiques et plus analytiques qui renoncent aux controverses sur l’essence de l’Etat et s’attachent davantage à ses activités, c’est-à-dire à l’Etat saisi dans ses actions. L’objectivation des pratiques de pouvoir s’efforce alors de renouveler la réflexion dans ce domaine longtemps saturé de conflits idéologiques. Or Michel Foucault s’inscrit dans ce renouvellement et propose une posture philosophique originale à l’égard du pouvoir : il ne cherche pas à en faire quelque chose comme une substance, comme un fluide plus ou moins maléfique qui se répandrait dans le corps social, avec la question de savoir s’il vient d’en haut ou d’en bas. Mais le projet du philosophe est simplement d’ouvrir une question générale qui est : Que sont les relations de pouvoirs ? Comment cela se passe-t-il, par quels instruments ?
Dans ses cours au Collège de France (1978), Foucault avait analysé la rupture qui s’était produite entre la fin du XVIème siècle et le début du XVIIème siècle et qui avait marqué le passage d’un art de gouverner hérité du Moyen Âge, dont les principes reprennent les vertus de morale traditionnelle et l’idéal de mesure, à un art de gouverner dont la rationalité a pour principe et champ d’application le fonctionnement de l’Etat. Or comment faut-il entendre cette « raison d’Etat » ? C’est là l’un des enjeux majeurs : celle-ci n’est pas à entendre comme la suspension impérative des règles préexistantes mais comme une nouvelle « matrice de rationalité » qui n’a à voir ni avec le souverain de justice ni avec le modèle machiavélien du Prince. Donc, il faut l’entendre comme l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses et les tactiques qui vont permettre une forme complexe de pouvoir ayant pour principale cible la population, pour forme majeure de savoir l’économie politique et pour instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité. On comprend alors tout l’intérêt de faire dialoguer Foucault avec les sociologues comme Weber, Bourdieu, Elias ou Thompson. Car c’est bien dans ce dialogue que l’on voit apparaître la gouvernementalité au sens proprement foucaldien comme une ligne de force qui, dans tout l’Occident, n’a pas cessé de conduire la prééminence de ce type de pouvoir nommé « gouvernement » sur les autres types de pouvoir, savoir la souveraineté, la discipline. Comme le souligne Arnault Skornicki, parler de gouvernementalité, c’est pour Michel Foucault mettre en lumière un changement radical dans les formes d’exercice du pouvoir par une autorité centralisée, mutation qui résulte d’un processus de rationalisation et de technicisation. Or la nouvelle gouvernementalité de la raison d’Etat s’appuie sur deux grands ensembles de savoirs et de technologies politiques, une technologie politico-militaire et une « police ». Et c’est au croisement de ces deux technologies que l’on trouve le commerce et la circulation inter-étatique de la monnaie.
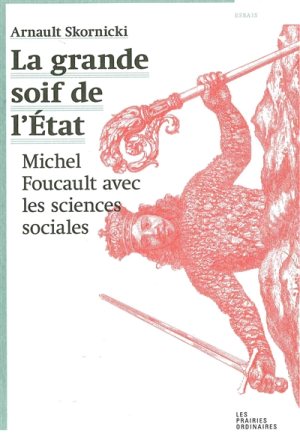
À ce titre, on rappellera l’importance que fut pour Michel Foucault sa lecture du livre II du Capital de Karl Marx. En effet, Foucault y trouve à l’œuvre plusieurs idées essentielles : d’abord, il n’y a pas un mais des pouvoirs ; ensuite, ces pouvoirs ne dérivent pas d’un pouvoir central ; de plus, ces pouvoirs n’ont pas pour fonction primordiale d’empêcher, ils sont producteurs d’une efficience, d’une aptitude, ils sont les producteurs d’un produit. La discipline d’atelier, la discipline dans l’armée, illustrent cette positivité du pouvoir. Or l’on peut regretter que cette question de la discipline au moins en tant que concept, notamment du point de vue de l’arraisonnement disciplinaire du temps, ne fasse pas l’objet d’une confrontation approfondie entre plusieurs des auteurs convoqués dans le livre, ne serait-ce que dans son seul rapport à la question de l’Etat. Car Foucault cherche à comprendre de quelle manière les « disciplines » deviennent à un certain moment des formules générales de domination. Le moment historique des disciplines est bien pour lui ce « moment om naît un art du corps humain, qui ne vise pas seulement la croissance de ses habileté, ni non plus l’alourdissement de sa sujétion, mais la formation d’un rapport qui dans le même mécanisme le rend d’autant plus obéissant qu’il est plus utile et inversement. » Or c’est bien cette « anatomie politique » qui investit tout espace clos qui puisse permettre la gestion des individus dans l’espace, leur répartition et leur identification.
Si l’on s’en tient au seul cas de Max Weber qu’Arnault Skornicki cite à de nombreuses reprises dans son livre, le concept de discipline fournit un point de confrontation en soi. La définition foucaldienne articulée au double principe de docilité et d’utilité est en effet substantiellement différente de celle de Weber, qui dans Economie et Société définissait la discipline, distinguée au passage du pouvoir et de la domination, comme une chance de rencontrer chez une multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, automatique et schématique, en vertu d’une disposition acquise. Le concept de discipline implique alors, on le voit, une disposition acquise de l’obéissance d’une masse dépourvue de critique et sans résistance. À travers les points communs comme les différences perceptibles concernant l’individualisation et la résistance, notamment, se joue quelque chose de la conception de l’Etat (autrement dit de l’étatisation des rapports de pouvoir). Plus largement et en tant que phénomène social, la discipline apparait comme l’énigme fondatrice et centrale posée aux sciences sociales en général.
Dans ses cours sur « la raison d’Etat » qui datent des années 1980, Foucault avait prolongé et déplacé ses analyses du pouvoir disciplinaire telles qu’il les avait effectuées dans Surveiller et punir. Dans le chapitre « méthode » de la Volonté de savoir, il s’était délibérément éloigné des conceptions appropriatives du pouvoir, pour l’envisager sur un mode relationnel et productif dont le « bio-pouvoir » est devenue la forme accomplie. Rappelons à notre lecteur que Foucault appelle « bio-pouvoir » les techniques spécifiques du pouvoir s’exerçant sur les corps individuels et les populations, hétérogènes aux mécanismes juridico-politiques du pouvoir souverain. Foucault ne s’accommode pas du pouvoir dans sa forme coercitive et cherche à déréifier le politique. Le philosophe critique les approches qui ne voient dans le pouvoir qu’une instance répressive et dont Marcuse est la figure emblématique. Car si le pouvoir ne s’exerçait que de façon négative, il serait fragile. S’il est fort c’est qu’il produit des effets positifs au niveau du désir et du savoir. Le pouvoir, loin d’empêcher le savoir, le produit. Si on a pu constituer un savoir sur le corps, c’est au travers d’un ensemble de disciplines militaires et scolaires. C’est à partir d’un pouvoir sur le corps qu’un savoir physiologique, organique était possible selon Michel Foucault.
Pour comprendre le déplacement que Foucault opère dans ses analyses du pouvoir, il faut le resituer dans la critique du marxisme qui se développe durant la période post soixante-huit. Pour Michel Foucault c’est le développement de luttes concrètes, leur origine et leur condition de développement qui ont d’abord transformé la réflexion sur le sujet. Pour le philosophe, le XIXème siècle a surtout été marqué par des luttes contre l’exploitation économique et sociale, tandis que la seconde moitié du XXème siècle l’est par des luttes à l’égard du pouvoir et chaque lutte se développe sur un foyer particulier de pouvoir. L’analyse foucaldienne des rationalités spécifiques des pouvoirs relève d’un nouveau mode d’investigation qui, plutôt que d’étudier le pouvoir du point de vue de sa rationalité interne, utilise les résistances aux pouvoirs (celle des femmes aux hommes, des enfants aux parents, des malades mentaux à la psychiatrie ou encore des mœurs aux administrations…) comme « catalyseur ». Le point commun de toutes ces luttes est qu’elles s’insurgent contre le gouvernement par l’individualisation, gouvernement qui se manifeste non seulement par la violence économique ou idéologique, mais aussi par l’inquisition scientifique et administrative. Cette dernière forme, peut-être la plus insidieuse du pouvoir, prétendrait alors déterminer l’identité des individus, les classer et les répertorier, afin de mieux les contrôler de manière continue et permanente. Or c’est bien cette alliance des dispositifs du savoir et du pouvoir qui permet de transformer les individus en « sujets », en les constituant comme objets de « prise », « cas » auxquels peut s’appliquer le pouvoir de la norme, prégnant dans la rationalité étatique depuis la Renaissance. Si Michel Foucault se démarque d’une conception centralisatrice et unilatéralement autoritaire du pouvoir, il ne s’identifie pas à un libertaire anti-étatiste rappelle Arnault Skornicki. Au contraire, Foucault rappelle à diverses reprises que s’il tient à « faire l’économie d’une théorie de l’Etat », c’est en fait l’économie d’une certaine théorie de l’Etat, d’une théorie essentialiste. Depuis Naissance de la clinique (1963) ses travaux sur la médecine, la maladie mentale ou le système pénal, « cela a toujours été le repérage de l’étatisation progressive, morcelée à coup sûr, mais continue ».
Ainsi Michel Foucault, rappelle Arnault Skornicki, n’envisage-t-il pas l’Etat comme « une sorte d’universel politique » dont il faudrait analyser en lui-même la nature, la structure et les fonctions et à partir de là déduire l’ensemble des caractères de chaque formation sociale. Il se refuse bien plutôt à attribuer à l’Etat une unité, une individualité et une fonctionnalité absolue. Car Foucault voit moins en l’Etat une cause qu’un effet, moins un acteur autonome qu’un agrégat de résultantes. Face aux conceptions dominantes, anthropomorphistes ou mécanistes, qui attribuent à l’Etat soit une volonté consciente, soit un rôle instrumental (au service d’intérêts économiques et idéologiques), l’originalité de Foucault, selon Arnault Skornicki, est bien de proposer un modèle d’analyse fondé sur les techniques de gouvernement, les actions et abstentions, les pratiques qui constituent la matérialité tangible de l’Etat : « L’Etat n’est pas un universel ; ce n’est pas en lui-même une source autonome de pouvoir ; ce n’est rien d’autre que des faits : le profil, la découpe mobile de perpétuelles étatisations, de transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui bouleversent, qui font glisser insidieusement, les centres de décision, les formes et les types de contrôles, les rapports entre pouvoirs locaux et autorité centrale ». Dès lors, on comprend que l’Etat n’est rien d’autre que l’effet mobile d’un régime de gouvernementalité multiple. Et cette approche anti-essentialiste de Michel Foucault renvoie alors à une approche matérielle des pratiques étatiques, des actes par lesquels s’opérationnalise le gouvernement des sujets et des populations. Il se désintéresse des idéologies pour s’attacher aux instruments, aux procédures et aux rationalités politiques qui les sous-tendent.
Dans ce dialogue entre Foucault et les sociologues, on voit apparaître l’idée d’une instrumentation de l’action publique, très révélatrice d’une théorisation du rapport entre gouvernant et gouverné. Chaque instrument est une forme condensée de gouvernementalité, c’est-à-dire d’un savoir sur l’exercice du pouvoir social. Envisager l’action publique sous l’angle de l’instrumentation permet de mieux caractériser les styles de gouvernement, autant que pour celle des transformations contemporaines de l’action publique. L’instrumentation est dans ce sens une activité gouvernementale spécifique reposant sur des théorisations (implicites ou explicites) des rapports politiques et du rapport à la société. Elle est également un indicateur des problèmes de régulation que l’action publique s’efforce de résoudre. Quelles sont les formes condensées et finalisées de savoir implicites à l’action législative et réglementaire, à la planification, à la contractualisation… ? On remarquera que l’intérêt d’une approche d’instruments est de compléter les regards classiques en termes d’organisation, de jeux d’acteurs et de représentations qui dominent aujourd’hui largement la sociologie politique. Elle permet de poser d’autres questions et d’intégrer de façon renouvelée les interrogations traditionnelles nécessaires. Quel que soit le modèle d’analyse retenu, la question de « la crise de l’Etat », ses reconfigurations et les argumentaires prolixes sur la recherche d’une nouvelle gouvernance, se retrouvent toujours à un moment ou à un autre sur le problème de l’articulation des niveaux de régulation multiples et sur les possibilités de recours à des instruments de régulation de deuxième degré ou « méta-instruments ».
Or on sait que dans son cours Naissance de la biopolitique, Michel Foucault avait fait état de l’absence d’une gouvernementalité proprement socialiste demeurant à inventer. L’enjeu est d’autant plus important que c’est précisément de ce double point de vue socialiste et libertaire que sont émises des critiques à l’égard de Foucault, en tant qu’il aurait contribué à un mouvement de « déconstruction » ayant sapé jusqu’aux points d’appui d’une critique sociale fédératrice et efficace. On comprend ainsi pourquoi La grande soif de l’Etat d’Arnault Skornicki s’achève sur la question du socialisme. Cette dernière vient en effet clore toute une réflexion sur « l’horizon antipastoral et la politique de l’émancipation », en évoquant la possible figure d’un Foucault « libertaire et socialiste », projeté au-delà de lui-même.
Enfin, un point important du livre d’ Arnault Skornicki porte sur la figure de l’Etat de droit : celle-ci apparaît à plusieurs reprises avant de faire l’objet de développements dans le dernier chapitre, sous un titre, « L’Etat de droit n’est plus ce qu’il était » dont le sens conserve une part d’équivoque au-delà du glissement qui s’est opéré entre sa définition première ou fondamentale (le bornage de la volonté du souverain par des lois préexistantes encadrant son action, par opposition au despotisme) et la réélaboration hayekienne dans le cadre du néolibéralisme, la figure repoussoir étant cette fois l’Etat planificateur. Outre les définitions données par Foucault et abstraction faite du contexte d’énonciation, on peut considérer que l’ébauche de généalogie à laquelle il se livre établit une définition proprement sociologique (et non juridique) de l’Etat de droit en tant que « réalité de transaction entre gouvernants et gouvernés », pour reprendre une expression qu’il utilise dans un autre contexte. Dans cette optique, au lieu d’envisager l’Etat de droit en tant que vocable du lexique juridique, il faut prendre acte de son appropriation sociale élargie depuis le début des années 1980 pour le considérer comme une catégorie investie de sens et mobilisée dans l’espace public par les acteurs savants mais aussi « profanes », d’où des critères de définition évolutifs et, partant, inégalement exigeants (de même que pour la « démocratie »). Une telle perspective n’est non seulement pas exclusive, mais est tout à fait compatible avec l’idée selon laquelle « Foucault refuse de poser la question du pouvoir en termes de droit et récuse la problématique même de l’Etat de droit.
Dès lors, on comprend que La grande soif de l’Etat. Michel Foucault avec les sciences sociales n’est pas à proprement parler un livre sur Michel Foucault mais bien sur l’Etat et la possibilité toujours vivante de le théoriser en en faisant une généalogie. Or l’approche généalogique n’est pas un simple empirisme. Ce n’est pas non plus un positivisme au sens ordinaire du terme. Il s’agit bien plutôt de faire jouer des savoirs locaux, discontinus, disqualifiés, non légitimés, contre l’instance théorique unitaire qui prétendrait les filtrer, les hiérarchiser, les ordonner au nom d’une connaissance vraie. Ainsi la généalogie va-t-elle dégager de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons. Dès lors, l’Etat ne nous apparaît plus comme un froid Léviathan, un grand appareil répressif, mais comme l’effet et l’opérateur de gouvernementalités multiples, de rationalités hétérogènes et de dispositifs variés.
La généalogie que Foucault caractérisait dès l’ouverture de son texte « Nietzsche, la généalogie, l’histoire » comme « grise », « méticuleuse », « patiemment documentaire » fait écho dans le livre d’Arnault Skornicki à la socio-politique de Gérard Noirel. Mais d’autres aspects encore vont justifier cette confrontation avec la socio-histoire, d’autant plus que celle-ci, malgré une apparente proximité avec la généalogie (l’ambivalence du rapport entre genèse et généalogie entretenant la confusion), cite en référence beaucoup plus volontiers Elias ou Bourdieu que Foucault. Cette proximité a priori plus grande qu’avec la sociologie historique de Charles Tilly, tient à des préoccupations générales, comme l’importance accordée aux relations de pouvoir (en particulier à distance), à la contingence du cours historique ou à l’étude de problèmes empiriques précis. Elle se retrouve au niveau de l’étude de l’État, la socio-histoire insistant sur la critique de la réification des entités collectives.








