Arnaud Sorosina : Le Scorpion de l’histoire. Généalogies de Nietzsche (partie I)
L’esthétique comme condition sine qua non de l’histoire de l’art
Parce que nous avons choisi de lire ce brillant ouvrage à partir des éléments de connaissance qui sont les nôtres, et à partir, aussi, de notre propre pratique universitaire — quoi qu’en eût dit Nietzsche lui-même — c’est surtout la première partie qui va nous occuper pour notre focalisation, en tant que nous y avons trouvé bien des préoccupations communes aux nôtres. En effet, l’histoire de l’art ne saurait, nous dit Arnaud Sorosina, être pour Nietzsche pratiquée depuis l’extérieur de l’expérience artistique. Pour en saisir le sens et la stratification, il faut être soi-même artiste, c’est-à-dire préoccupé par les enjeux et par les unités combinatoires qui s’expriment dans le maillage de l’histoire de l’art. Dans une telle perspective historique, par exemple, les imaginaires ont autant de valeur que les faits, et c’est alors le pathos avec lequel est/sont envisagé(s) ce ou ces objets (imaginaires ou « réels », si les faits du passé peuvent avoir un quelconque caractère « réel »), qui devient l’enjeu de l’historien (-philologue-poète-scorpion).
En faisant valoir l’universalité dans le particulier, le poétique de l’histoire prétend sauver l’Historie de sa condition de reptile condamné par Schopenhauer à « ramper sur le sol de l’expérience pour avancer ». Mais surtout, suppléant à sa déficience scientifique au moyen du regard poétique, cette poétique de l’histoire aurait au principe de son fonctionnement un goût sélectif, un sens des affinités électives qui lui dicterait le choix de ses objets. Chez le philologue-poète, la pitié le cède à une communauté de sensibilité pour la grandeur, un pathos historique qui sympathise, non pas avec des événements, mais avec des personnalités. On apprendra ainsi que l’étude de l’histoire grecque n’a pas à s’intéresser à des faits, mais a pour objet la reconstitution compréhensive des personnalités dont la valeur transcende l’historicité de leurs faits et gestes.
C’est en ce sens que Nietzsche oppose au déguisement chrétien de ses contemporains l’historiographie d’esthète que lui a inspirée L’Œuvre d’art de l’avenir, animée par « une sympathie [Mitgefühl] plus fervente » que la sympathie purement passive qui endort les forces de renouvellement en présentant toute histoire comme un enchaînement nécessaire de phénomènes, de bruit et de fureur.[1]
L’impératif de ce que Nietzsche appelle une « sympathie plus fervente » est un refrain qui, aujourd’hui, pourrait bien n’être pas nouveau du point de vue universitaire, et c’est sans doute l’une des grandes victoires intellectuelles — esthétiques — de notre époque, de cette fameuse « seconde modernité » (peut-être depuis la parution de L’anthropologie structurale, de Claude Lévi-Strauss en 1958[2]) : on ne peut juger un système que depuis la sympathie, au sens étymologique, à ce système, qui serait une sympathie active — comme Nietzsche distingue par exemple le nihilisme passif, par apathie face aux événements, du nihilisme actif, qui participe à la destruction. Comme on ne peut parler de théologie sans sympathie pour le fait théologique ou l’intelligence de la foi, de même, on ne saurait parler d’art en le méprisant, pas plus qu’on ne le pourrait en le réduisant à un strict phénomène marchand. Du moins, pas pour en parler avec pertinence. La compréhension d’une structure phénoménale, quelle qu’elle soit, ne peut se faire qu’en sum-pathos, c’est-à-dire en éprouvant une communauté de sentiments ou d’impressions. Or, a fortiori, il est impossible de se prétendre capable d’étudier en toute extériorité une structure phénoménale érigée en édifice herméneutique complexe aux enjeux stratifiés comme, par exemple, le sont la science, la religion, la morale ou la culture. C’est exactement la notice défendue par Nietzsche, d’après Arnaud Sorosina :
Dans la fuite des phénomènes contempler l’éternité : c’était là résumer la tâche que se fixe Nietzsche dans La Naissance de la tragédie, où il n’est plus question de raconter l’histoire des faits, fussent-ils les hauts faits de l’épopée, mais d’examiner comment au sein de l’histoire des phénomènes, une classe de phénomènes (les phénomènes proprement esthétiques), dont la signification échappe à l’empiricité, peut apparaître puis disparaître. Seule l’histoire de l’art peut nous révéler un domaine qui, au sein de l’histoire, peut nous arracher à la souffrance historique. Mais seule une histoire artistement élaborée, un art de l’histoire, peut nous prémunir contre une approche empirique qui ravalerait son objet au rang des faits agrégés le long du continuum temporel comme les perles d’un collier. L’histoire de l’art ne saurait être écrite que par un artiste, en vertu de la conception nietzschéenne de la transitivité des propriétés esthétiques : l’adéquation du sujet et de l’objet n’est pas ici une adaequatio rei et sensus, ou du moins elle n’en vient à être telle que d’avoir été d’abord une adaequatio rei et sensu. C’est l’intellect d’un être sentant qui s’exprime dans l’esthétique de La Naissance de la tragédie, où la perception du sens métaphysique de l’art délègue au concept la formulation d’une intuition esthétique purement individuelle.[3]
Cette fonction que Nietzsche fixe à l’histoire de l’art recoupe exactement la fonction de conjuration de l’effroi (celui-ci entendu comme germe primordial de la conscience) à laquelle œuvre pour Blumenberg, comme pour Cassirer, le mythe. Chez le premier, cela prend la forme spécifique du rituel, par le truchement de la répétition paraphrastique ; chez le second, le mythe est un édifice préthéorique mobilisant les formes symboliques[4] — et la « délégation au concept [de] la formulation d’une intuition esthétique purement individuelle » est presque exactement l’énoncé de la fonction que Blumenberg prête à la métaphore[5] : dépasser l’inconcevable par le potentiel plurivalent de l’esthétique. Là encore, les traditions se croisent, et sur un objet très semblable : produire, à partir de l’épistémologie du phénoménal de l’activité de l’esprit, les conditions formelles de ce que l’ontologie a de possible — et d’« inachevable » (ou infini), en tant que, historiquement, les concrétions de l’activité de l’esprit (les objets culturels) font progresser la masse des signes à interpréter, à partir d’une raison finie[6]. C’est du reste une similarité entre les traditions qui ne cesse pas de se manifester ; ainsi à quelques lignes de là :
C’est sur ce point que Nietzsche est fondé à qualifier sa philosophie de « platonisme inversé », dans la mesure où il ne s’agit pas de se détourner des phénomènes esthétiques pour retrouver dialectiquement l’Un-originaire, mais tout au contraire de comprendre comment le phénomène assure la rédemption des souffrances attenantes à cette unité originaire : « plus on est loin de l’étant véritable, plus pur, plus beau, meilleur c’est. La vie dans l’apparence comme but ». Plus pur, plus beau, meilleur — certainement pas plus vrai ! La vérité métaphysique demeure l’étant « véritable », mais puisque celui-ci est souffrance, le monde de la représentation nous en délivre par le plaisir, mais plus noblement encore que l’apollinisme, le monde de la vision artistique tragique (dionysiaque) parvient à nous faire vivre cette souffrance tout en nous sauvant de sa douleur — raison pour laquelle l’art n’est pas uniquement une puissance d’illusion, un paradis artificiel, mais l’unité du phénomène et de la chose en soi dans le phénomène esthétique —, la chose en soi n’étant pas, naturellement, l’objet d’une intuition immédiate, quoiqu’elle soit appréhendée comme Idée, c’est-à-dire comme objectivation la plus adéquate du Vouloir.[7]
Ici, le vocabulaire est prodigieusement kantien et post-kantien, et mène jusqu’à la polarisation autour du problème de la chose en soi, cette fois placée au cœur de l’activité artistique, et non plus envisagé pour motif du conflit entre monisme et dualisme, entre connaissance et réalité. Le statut de la représentation[8] comme médiation dans les théories de la connaissance n’est plus tant l’enjeu du problème de la chose en soi, que ne l’est pour Nietzsche celui d’un certain existentialisme, de l’efficience existentielle des historicités en histoire de l’art. Pour l’écrire autrement, l’enjeu des historicités trouve dans l’histoire de l’art, comme art de l’histoire, un sens anthropologique de premier ordre et ce n’est pas sans rappeler l’une des injonctions nietzschéennes, qui limite l’accès à l’art aux seuls artistes tout en exhortant chaque être à cultiver l’artiste en lui. Encore une fois, le statut de l’accès à ces historicités, et la capacité du sujet à les revaloriser dans l’exercice qu’il fait d’elles, rejoint des thématiques abordées par d’autres traditions, de façon plus complète après Nietzsche, et Nietzsche a peut-être posé, parmi les premiers, le problème de l’activité esthétique dans l’édification du savoir, et notamment du point de vue du concept.
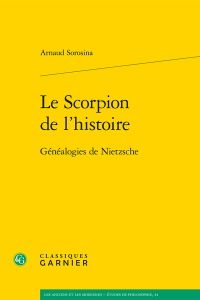
De l’art de l’histoire à la philosophie de l’histoire, de la philosophie de l’histoire à la puissance de l’histoire
Comme nous le précisions en début de recension, notre lecture est perspective, et non une synthèse ou une fiche de lecture. Nous ne prétendons pas rendre compte de façon exhaustive de l’excellent ouvrage dont il est ici question mais, simplement, en présentons le caractère qui nourrit nos propres réflexions. Ce faisant, nous tâchons d’encourager les lecteurs à s’en faire par eux-mêmes une idée exhaustive (ou non, nous y revenons en toute fin de recension). Pour autant, il paraît raisonnable de rappeler que nous avons focalisé notre lecture sur le problème de la philosophie de l’histoire en tant qu’elle suppose une réflexion sur les formes de la connaissance, esthétiques et conceptuelles, historiques, religieuses, philosophiques et, de tout cela, politique. La première partie, donc, dans l’horizon dialectique dans lequel s’inscrit l’essentiel de notre discussion, s’intéressait particulièrement aux liens entre esthétique et conscience, autrement dit, entre art et histoire. Bien entendu, l’homogénéité de la recherche présente à peu près toujours la simultanéité des trois champs que nous dégageons ici : art de l’histoire, philosophie de l’histoire et puissance de la philosophie.
Le livre d’Arnaud Sorosina, donc, est un chariot tiré par plusieurs chevaux qui se répondent les uns les autres au fil des l’avancée — nous pourrions utiliser l’image de spirales qui se déploient en continu, simultanément les unes aux autres et chaque intersection dialectique implique d’avoir saisi les enjeux de chacune de toutes les courbes qui sont impliquées dans le nœud. Prenons l’exemple d’un nœud sur lequel nous retrouverions la corde fondamentale d’un art de l’histoire, et de la philosophie de l’histoire :
Historische Philosophie, historisches philosophiren : Nietzsche intronise ces deux formules dans les deux premiers paragraphes d’Humain, trop humain et n’y recourra plus. On peut hasarder une hypothèse : lui qui connaît son Schopenhauer comme tout grec digne de ce nom connaît son Homère, ne peut avoir oublié qu’il s’agit là, à l’origine, d’une expression par laquelle son ancien maître se moque de la connaissance historique du monde, en particulier des théodicées de l’histoire de l’idéalisme allemand — l’odyssée de la conscience schellingienne et bien entendu la phénoménologie de l’Esprit hégélien.[9]
Ces lignes, d’apparence si simples, sont en fait l’occasion pour l’auteur d’intégrer la posture nietzschéenne dans un contexte polémique très virulent, de sorte que l’on parvienne, au travers des systèmes de Schopenhauer, Hegel ou même Descartes (pour se contenter de ne parler que des lignes de crête de la philosophie moderne), jusqu’à ce moment qui singularise la posture de la philosophie de l’histoire chez Nietzsche. Il y est question, comme l’expose clairement l’introduction (pp. 17-21), de l’histoire comme il est dit que la pratiquait la double posture de Proust : à partir d’une étude du passé (retrospective) pour être libre de/vers l’avenir (prospective).
L’historicisation montre ainsi comment chaque chose est conditionnée par son opposé — mais toujours dans le même sens dans la mesure où tout ce que nous valorisons comme « positif » a un fondement historique « négatif » : le bien est conditionné par le mal (la morale par la cruauté), le beau par le répugnant (la beauté artistique par les sensations, les pulsions, voire les viscères), la vérité par l’erreur (la logique par l’illogique attenant aux nécessités vitales).[10]
L’auteur nous montre ici de quelle façon le sujet s’empare de l’histoire, à partir d’une conscience esthétique de sa propre singularité dans l’histoire — nous pourrions parler ici d’existentialisme, si nous en restions à l’usage théorique de sa logique que font Kierkegaard, Pascal ou Nietzsche lui-même, en tant que le sujet tend à s’émanciper pour devenir l’esprit libre (à la manière proustienne : rétrospective en vue d’une prospective des conditions maximales de l’existence). Car le motif (somme toute, téléologique) de l’historicisation est une perspective existentielle individuelle, mais en vue du collectif, en tant qu’il mène à un criticisme radical. Sur ce point encore, la posture de Nietzsche n’est pas sans nous rappeler le constructivisme cassirérien enchâssé dans une méthode digne de la psychanalyse (si l’on nous permet cette espèce de barbarisme) :
L’esprit libre n’est pas capable de faire table rase du passé pour agir sans détermination aucune : lui aussi, plus que quiconque d’ailleurs, se sait du nombre des « héritiers de toutes ces situations, concrétion de ce passé tout entier » dont il ne s’agit aucunement de se « désolidariser par décret ». Ce qu’il peut faire en revanche, c’est travailler à refonder les instincts hérités en leur opposant des pratiques concurrentes qui produisent une déshabituation progressive, à la manière dont l’usage nouveau d’un organe modifie son aspect jusqu’à changer l’organe lui-même en changeant sa fonction. Il faut alors s’attaquer d’abord aux instincts les moins enfouis, car leur rigidité fossile est moins contraignante que celle des instincts, rendus invulnérables par leur invétérations vénérables, en vertu de l’évolution lamarckienne qui autorise à rétroagir sur le passé proche plus aisément que sur le passé lointain, enfoui dans de plus profondes stratifications héréditaires.[11]
Nous retrouverions donc, lecteur de Cassirer, la logique selon laquelle la conscience, comme production qui est le produit (formule de fondation de la philosophie néokantienne de Marbourg), se construit à partir de l’usage qu’elle fait du langage pour se réaliser elle-même, en instance de distanciation entre sujet et monde des objets[12]. Le travail archéologique interne, donc (ou paléontologiste, même), permet pour Nietzsche de construire la part d’indétermination du sujet qui le conduirait à devenir un esprit libre. Et l’on voit bien ici de quelle façon la pratique esthétique de l’histoire — comme un art de la pratique historique — est un existentialisme, c’est-à-dire une philosophie de l’histoire, du sujet comme du groupe.
La « sous-titrologie » que nous proposons comme herméneutique des véritables titres (explicites) des différentes partie de l’ouvrage de Arnaud Sorosina s’appuie sur les fonctions que nous croyons avoir dégagées à la lecture du texte complet, de bout en bout, mais aussi en recroisant certaines de ses parties entre elles. L’histoire à contre-temps, la philologie comme poétique de l’histoire (l’art de l’histoire), La recherche du temps perdu, philosopher historiquement (la philosophie de l’histoire) et Le temps retrouvé, la généalogie de l’avenir (la puissance de l’histoire). Ce n’est qu’une seule et même démonstration qui fonctionne comme les cercles complets d’un escalier en colimaçon — comme la plupart des bons ouvrages de philosophie. C’est dans la troisième partie que le lecteur pourra trouver des approches des enjeux tardifs de la philosophie nietzschéenne. L’ensemble de l’ouvrage propose une recomposition chronologique des grands moments de l’activité philosophique de Nietzsche, non sous la forme d’une généalogie mais en suivant plutôt l’idée d’une détermination progressive, d’une émancipation de plus en plus joyeuse vis-à-vis des anciens systèmes.
Nietzsche, anti-chrétien, messianique et criticiste
L’un des ouvrages les plus connus de Nietzsche, s’il était possible de l’établir, pourrait finalement être son Ainsi parlait Zarathoustra. Nietzsche y manie l’art et le sens de l’histoire à des fins de philosophe philologue, n’établissant peut-être pas un cosmos mais traçant clairement la trajectoire de l’individu moderne dans le chaos de la modernité, sur fond de messianisme en quête de vérité. Or la vérité de cette trajectoire humaine se trouverait peut-être dans les concrétions signifiantes que l’on appelle « culture » — une autre façon de répondre à « Qu’est-ce que l’Homme ? », et on retrouve encore — et toujours — Cassirer dans un sillage, voisin ou direct, des préoccupations de Nietzsche[13]. Il s’agirait donc ici de signes qui changent de supports :
Ce qui est authentiquement historique ne saurait être perçu par les sens, et de ce point de vue, même les événements que l’on considère comme de grands moments de l’histoire ne changent en réalité pas grand-chose à ce qui est essentiel, à savoir les valeurs et les types moraux : « Qu’importe qu’une ville soit momifiée et qu’une statue soit couchée dans la boue ! », clame Zarathoustra. Qu’importe donc Herculanum, Pompéi, la Révolution française ou la victoire prussienne de 1871 ! Plus même : les Révolutions changent d’autant moins la face de l’histoire qu’elles perpétuent les anciennes valeurs en changeant simplement leur signe, déplaçant leur siège du corps de l’Église ou du roi vers celui du peuple […].
Si les révolutions véritables sont en réalité imperceptibles, c’est qu’elles transforment le monde en le réévaluant, transformation qui n’a pas lieu à cor et à cri au moyen de changements constitutionnels et politiques mais par une longue et patiente Züchtung qui change la manière d’évaluer des corps habités par de grandes pensées : « Ce sont les paroles les plus silencieuses qui soulèvent la tempête. Les pensées qui viennent sur des pattes de colombes mènent le monde. » Or Zarathoustra est conscient qu’il n’est pas encore le corps supérieur où cette pensée prend corps : ses fruits sont mûrs, mais il n’est pas mûr pour ses fruits. Aussi ne revendique-t-il pas encore, à la fin du livre II, la paternité de la pensée du retour : il attend des disciples plus dignes de sa grande pensée que lui-même, mais doit d’abord lui-même s’en rendre digne.[14]
Il n’est pas question ici de se demander si Zarathoustra et Nietzsche ont quelque chose à voir l’un avec l’autre, s’il y a ou non identification du philosophe dans le prophète ou s’il ne s’agit que d’un pur ego expérimental, pour emprunter la remarquable formule de Kundera[15]. C’est le geste philosophique du point de vue de la détermination du sens de l’histoire qui intéresse ici Arnaud Sorosina, et nous avec. D’une façon générale, tout le livre aborde successivement tous les aspects de la problématisation de son propre titre, instituant sa justification en constituant son élaboration, de sorte que l’on suit comme une enquête — herméneutique — au cours de laquelle des éléments de réflexion s’ajoutent peu à peu dans l’esprit du lecteur. Nous assistons donc à une dotation méthodologique qui nous est donnée, avec bienveillance et pédagogie, souvent même avec humour et cette férocité ironique qui caractérise Nietzsche, et par laquelle on s’élève doucement mais sûrement jusqu’à la compréhension, par une illustration patiente, de ce qu’est la pratique du sens de l’histoire, pour Nietzsche.
Conclusion
À ce stade, nous savons que la littérature universitaire n’est que très rarement, sur des malentendus la plupart du temps, élevée au rang de littérature commune. Les livres comme Le Scorpion de l’histoire mériteraient pourtant de connaître un destin semblable à ce qui se faisait dans les années soixante-dix à propos de la littérature universitaire, en tant que ses conclusions et son cheminement mêmes, sont susceptibles d’apporter à chacun des éléments de réflexion sur son propre rapport à son histoire autant qu’à l’histoire. À ce titre donc, ouvrage de philosophie, certes, mais que l’on peut lire comme on lit un roman, c’est-à-dire de bout en bout, ou que l’on peut lire par petites touches, par spirales, par « instants », tant chaque unité de l’ouvrage est signifiante en soi.
[1] — Arnaud Sorosina, Sympathie, justice et probité historique, dans Wagner, la poétique de l’histoire, le mythe, dans Poétique (1873-1876), in op. cit., pp. 208-209.
[2] — Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958. Il s’agit d’une sorte de condensé méthodologique de sa pratique du mythe en particulier, et de l’ethnologie en général, mais on peut très bien lire cette méthode à l’œuvre dans l’édition monumentale de ses quatre volumes de Mythologique, réédités par Plon en 2009.
[3] — Arnaud Sorosina, De l’histoire de l’art à l’art de l’histoire, dans Esthétique (1869-1[8]72), dans L’histoire à contretemps. La philologie comme poétique de l’histoire, in op. cit., page 100.
[4] — Cassirer écrit ainsi : « Seul le va-et-vient entre le représentant et le représenté produit un savoir sur le moi et un savoir d’objets, idées ou réels. », Philosophie des formes symboliques, t. III, La phénoménologie de la connaissance, Paris, Minuit, 1972, page 230.
[5] — Hans Blumenberg, Paradigmes pour une métaphorologie, Paris, Vrin, 2006 pour l’édition française. Le contenu de la citation suivante est exactement étudié par Hans Blumenberg dans Naufrage avec spectateur, Paris, L’Arche, 1994.
[6] — Là encore, ce ne sont pas nos idées mais celles de Cassirer, qui écrit : « Le vrai royaume des esprits est précisément le monde spirituel créé par l’homme lui-même. Qu’il ait pu créer un tel monde, c’est là le sceau de son infinité. », Débat sur le kantisme et la philosophie, (Davos, 1929), Paris, Beauchesne, 1972, page 41.
[7] — Ibid., page 101.
[8] — La question de l’efficience des systèmes représentationnels, depuis la sémantique générale d’Alfred Korzybski, mêle la philosophie et l’histoire de l’étude poétique (théories littéraires). Nous pensons ici à l’activité du groupe Poetik und hermeneutik, auquel participait Blumenberg, avec Jacob Taubes, Odo Maquard ou encore Hans Robert Jauß, auteur de ce qui a été traduit en français sous le titre Pour une herméneutique littéraire, Paris, Gallimard, 1988.
[9] — Arnaud Sorosina, op. cit., page 223.
[10] — Ibid., pp. 230-231
[11] — Ibid., page 283.
[12] — Voir supra, note 22.
[13] — « La culture désigne, pour Cassirer, la totalité, toujours ouverte, des formes que l’expérience humaine assume au cours de son histoire ; dès lors, la tâche qui s’ouvre à cette investigation philosophique [celle de l’étude des formes symboliques] devient donc immense et même écrasante. […] Cette mise en forme symbolique ou discursive des contenus de l’expérience humaine n’est jamais une entreprise unilatérale dont l’esprit aurait une fois pour toutes l’initiative et qui reposerait en définitive sure des structures internes immuables et indépassables. Bien au contraire, la conception fonctionnelle des formes symboliques qui émerge de l’œuvre de Cassirer fait apparaître que toute mise en forme (Gestaltung) d’un contenu particulier de la culture humaine, dans sa complexité historique propre, implique une structuration progressive et corrélative du sujet et de l’objet. », Jean Seidengart, Présentation à Jean Seidengart (dir.), Ernst Cassirer, de Marbourg à New-York, Paris, Cerf, 1990, page 10.
[14] — Arnaud Sorosina, L’histoire, de la tragédie à la farce, dans Prospective (1881-1885), dans Le temps retrouvé. La généalogie de l’avenir, in op. cit., pp. 487-488.
[15] — Milan Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986.








