Ce livre a d’abord été la thèse de doctorat de l’auteur, qui –si nos informations sont exactes – s’intitulait « Bergson et l’ontologie de la volonté. Essai sur la structure du bergsonisme et sur sa relation aux philosophies de Schopenhauer et de Nietzsche », (soutenue le 6 décembre 2005, à l’université Lille 3 Charles-de-Gaulle, sous la direction de Frédéric Worms).
L’ouvrage se propose de cerner comment Schopenhauer, Nietzsche et Bergson, que l’on peut réunir sous l’étiquette commode de « philosophes de la vie », ont effectivement transformé des notions philosophiques décisives telles que la volonté et la réalité (et d’autres encore comme on va le voir), et ainsi comment ils ont changé la façon même de pratiquer la philosophie.
La vie non comme adaptation mais comme accroissement de soi
Le point de départ du rapprochement entre les trois philosophes est une position que l’on peut leur considérer commune : que la vie, fondamentalement, est vouloir. « Les raisons pour lesquelles les trois auteurs assignent une essence volitive ou volitionnelle à la vie […] sont, à vrai dire, assez aisées à saisir. […] Dans les trois cas, il s’agit de s’opposer à une conception […] selon laquelle la vie est uniquement conservation de soi, ou adaptation à des circonstances extérieures. » 1
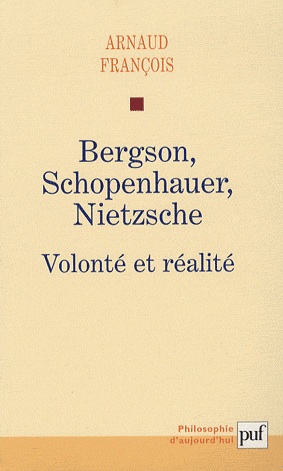
Bergson et Nietzsche ont tous les deux visé de leurs critiques les théories de Darwin et de Spencer, y décelant, surtout chez ce dernier, des préjugés finalistes inaperçus : l’évolution de la vie aurait pour fin de s’adapter aux circonstances. Nos trois auteurs opposent à cette interprétation une conception selon laquelle « la vie ne s’en tient pas aux formes qu’elle a déjà revêtues, mais aspire à prendre des formes supérieures » 2.
A partir de cette communauté philosophique, Bergson se distingue, selon Arnaud François, par l’introduction d’un troisième terme, entre volonté et réalité, celui de conscience. Le dernier chapitre du livre tirera les conséquences de cette valorisation de la conscience par Bergson : à savoir que la conscience, fondamentalement, est un acte, et que c’est l’acte du temps lui-même, entendu comme élan vital. Là résiderait l’audace et l’originalité de Bergson : à savoir que le temps est un acte, c’est-à-dire une création –et c’est « un des apports les plus originaux et les plus irréductibles du bergsonisme » 3. Au contraire, pour Schopenhauer, une prise de conscience ne peut être que détachement par rapport aux impulsions tyranniques du vouloir ; et pour Nietzsche, la conscience n’est pas du tout essentielle à la volonté de puissance et à cette forme particulière qu’en est la vie.
Arnaud François se concentre donc sur Bergson, mais non pour lui donner raison en dernière instance, comme s’il arbitrait un « match de pugilat » 4 contre les deux autres auteurs. Il étudie les rapprochements et les différences entre ces auteurs. « C’est dans l’éloignement même entre les trois doctrines, conçu comme constitutif de la force probante de la démonstration, que nous considérerons leurs analogies. » 5
La volonté
Le premier chapitre étudie, dans l’ordre chronologique des auteurs, leur refonte du concept de volonté. L’apport d’Arnaud François quant à Schopenhauer est ici de lier vouloir et souffrance, de façon à séparer le vouloir de toute compréhension en terme de volonté visant une fin ou de désir tendant vers un objet. Pour Schopenhauer, si la volonté ne veut rien, c’est que la volonté ne peut plus se définir par rapport à son objet. Le vouloir n’est donc, paradoxalement, en manque de rien. Le vouloir est en son fond souffrance : c’est là, comme on sait, le fondement, selon Schopenhauer, de son pessimisme. Plus profondément, comme l’a montré Clément Rosset, que François convoque ici, la nouveauté introduite par Schopenhauer est l’intuition d’un monde absurde [Selon Rosset (cf. Ecrits sur Schopenhauer), le pessimisme de Schopenhauer est l’aspect le plus périssable de son œuvre, tandis que sa vraie nouveauté est d’avoir thématisé, avant Sartre et Camus, l’absurdité de l’existence. ].
Reprenant les résultats d’un article consacré à l’Anti-Œdipe [L’article, intitulé « De la volonté comme pathos au désir comme production : Schopenhauer, Nietzsche, Deleuze » est disponible à cette adresse : [http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?article105 [/efn_note], Arnaud François montre que cette conception nouvelle du désir a influencé jusqu’à Deleuze et Guattari dans leur conception du désir comme production : le vouloir ne vise aucune fin, il est pleinement lui-même. La souffrance schopenhauerienne est ainsi ambiguë : elle est bien un mal, en tant qu’elle est douleur, mais elle est surtout affectivité, passivité, et c’est là l’originalité de la doctrine du Monde comme volonté et comme représentation : c’est que je ne désire qu’en étant affecté de passivité, et non en étant activement en recherche d’un objet. Réfutation de tout finalisme, et donc de tout absence d’étonnement devant l’ordre du monde, « au profit d’un étonnement qui est cette fois fondé, et qui porte, comme le dira plus loin Bergson, sur la « création sans cesse renouvelée que le tout du réel, indivisé, accomplit en avançant. » » 6
Or, et c’est là le tour de force accompli par Schopenhauer, et qui aura des répercussions décisives chez Nietzsche : « la passivité dont il s’agit chez Schopenhauer n’est pas exclusive d’une activité, mais elle en est au contraire la condition, et c’est l’opposition même de l’activité à la passivité, opposition classique entre toutes, qui est à réexaminer. Plus précisément encore, le pâtir qu’est la Volonté ne s’oppose pas à un agir, mais il est l’agir lui-même, authentiquement conçu. » 7
Arnaud François cerne alors par contraste l’originalité de l’élaboration par Nietzsche du concept de volonté de puissance : il conteste d’abord que la même volonté se retrouve partout dans la nature, et il en conteste l’unité. Il n’y a, pour Nietzsche, que des volontés de puissance, et celles-ci sont en conflit. Plus encore, l’élaboration de la volonté de puissance se fait par un réseau complexe, toujours multiples, de commandements et d’obéissances qui aboutissent à une interprétation, c’est-à-dire à une configuration pulsionnelle qui tend à se maintenir et à s’accroître 8.
Les liens et les différences avec la théorie bergsonienne sont alors à déterminer. Déjà dans l’Essai, Bergson affirme que le problème de la philosophie morale est de savoir comment avoir prise sur la volonté. Comme le montre Arnaud François, Bergson conçoit le vouloir comme élan, et comme élan vers l’avenir, vers l’avant : « La « tension » […] est la condition même de la création, comme acte consistant à donner un contenu à l’avenir comme tel » 9. Cette tension est reliée par Bergson à la notion médicale de tonus, d’où l’attention aux études sur la psychasténie, c’est-à-dire « l’absence de force de l’âme » (P. Janet). Elle est ouverture à l’avenir qui se fait à partir de la pression du passé.
Bergson accorde une telle place à la volonté qu’il en fait la faculté maîtresse de l’esprit, et qu’il la relie même à une intuition supra-intellectuelle qui culmine dans l’émotion, en tant qu’aspiration à un degré supérieur de vie (ce qui nous rapproche de Schopenhauer et Nietzsche, sur une thématique de l’extase devant ce qui, dans la vie, dépasse la vie même). Le point culminant de cette ligne est bien la mystique même, si le mystique éprouve au plus haut point sa passivité face à Dieu, son activité face aux hommes 10
La réalité
Le second chapitre part de la récusation, chez nos trois auteurs, des fausses notions que sont le néant et le possible, ce qui aboutit à une interprétation de la réalité en tant que plénitude à laquelle rien ne manque, et qui ne se constitue pas comme réalisation d’un modèle préétabli. Si le vivant, et plus généralement, la réalité ne manque de rien, on est alors reconduit à comprendre comment du nouveau peut apparaître : c’est la notion de création qui est à penser.
Schopenhauer et Nietzsche semblent tirer des réfutations mentionnées qu’il n’y a que de la nécessité, quoi que cette nécessité ne soit pas d’ordre légal ni causal, mais soit la nécessité où toute chose est de tirer à tout moment le maximum de conséquence de ce qu’elle peut. Bergson quant à lui tient au contraire qu’il y a de la liberté, chaque fois que nous nous efforçons d’agir, et au plus haut degré quand nous sommes personnels dans nos actes ou nos créations.
La liberté est-elle un mystère ou le fait le plus clair qui soit ? C’est cette question qui justifie une confrontation très détaillée entre Schopenhauer et Bergson : il en ressort que tous deux –thèse capitale – renversant une position habituelle en philosophie, incluent le vouloir dans l’être lui-même et non seulement dans le faire. Ainsi, si l’on entend par nécessité « le caractère impérieux avec lequel s’impose une poussée affective ou une émotion pourtant créatrice, alors on est effectivement fondé à dire que Schopenhauer et Bergson, chacun à sa manière, récusent la vieille opposition de la liberté et de la nécessité. » 11
La position de Nietzsche apparaît encore plus surprenante, lui qui peut à la fois combattre sans cesse le libre-arbitre – comme notion morale visant à rendre l’homme responsable de ses actes pour pouvoir l’en blâmer et le châtier – et, dans le même mouvement, exalter l’esprit libre, la liberté comme conquête. Ce que donne ainsi à penser Nietzsche, c’est à ne jamais considérer la liberté comme un donné, mais comme un effort (point commun avec Bergson), ce que résume la formule du Zarathoustra : « Vouloir libère » 12.
L’étude précise de la notion d’actualisation permet enfin de penser la réalité comme réalisation de soi : quoi que cette notion soit d’abord bergsonienne, Arnaud François en trouve des ressemblances dans la notion de destin chez Nietzsche, autrement dit dans l’injonction à devenir ce que l’on est : non à se fixer des buts pour vivre, mais à vivre pour réaliser pleinement ses potentialités 13.
La vérité
Il s’ensuit nécessairement une réélaboration de la notion de vérité, qui ne pourra plus être la simple adéquation du sujet et de l’objet. S’il n’y a que la réalité comme vouloir, alors ce qui connaît n’est pas d’une nature différente du connu. Refusant le donné d’une réalité en soi, nos trois auteurs sont conduits à se placer directement au cœur de la réalité, par un effort que Bergson caractériserait comme intuition et sympathie. « Vérité et réalité, dans le bergsonisme comme dans le platonisme, en viendraient à coïncider : mais alors que dans le platonisme, elles coïncident dans l’immuable, dans le bergsonisme, elles coïncident dans le mouvant, c’est-à-dire dans l’expérience elle-même » 14
Or, si Schopenhauer pour sa part s’efforce de déchiffrer le vouloir comme un texte, donc de l’interpréter, Nietzsche lui aussi transpose la question de la vérité en question de l’interprétation, mais il va jusqu’à récuser la validité même de la notion de vérité. L’interprétation permet de refuser complètement l’autonomie du sujet pensant par rapport à l’objet pensé, et à faire ainsi de toute interprétation une forme d’affirmation vitale, qui peut prendre une forme soit morbide, soit saine. Nietzsche reconduit donc le problème de la vérité vers celui de la santé : ce qui compte n’est plus le caractère vérace d’un énoncé, mais sa valeur pour la vie.
Arnaud François étudie de façon approfondie l’intuition chez Bergson et montre l’insistance de ce dernier à détacher la connaissance pragmatique ordinaire, voulue par l’intelligence, de la connaissance spéculative, proprement philosophique, permise par l’intuition : d’où le refus des problèmes tout faits, issus de nos besoins matériels, et la définition de la tâche du penseur comme dénonciation des faux problèmes et position des vrais problèmes. En cela consiste l’intuition comme méthode. Nietzsche est ici proche de Bergson, qui parle davantage d’impulsion ou d’inspiration au lieu d’intuition, tout en insistant sur la nécessité de se placer directement dans la chose, à la façon d’un artiste, et non d’en produire une représentation adéquate. C’est pourquoi Nietzsche et Bergson ont eu à cœur de rénover le mode d’expression philosophique, afin de rendre le saisissement qui assaille le penseur, quand la pensée surgit en lui, comme un éclair : « Si le discours philosophique ne « porte » pas, comme de l’extérieur, sur la réalité, mais est partie intégrante de la réalité elle-même, si, par ailleurs, celle-ci est en création perpétuelle de soi, alors le discours philosophique est lui aussi créateur, ce qui toutefois ne peut devenir intelligible qu’une fois la création déplacée de la solution au problème » 15
La conscience et le temps
Le dernier chapitre, comme nous l’avions mentionné, va marquer le plus fortement les divergences qui séparent finalement Bergson de Schopenhauer et Nietzsche, à savoir sa conception de la conscience et du temps et en réalité, du temps comme conscience. « La durée n’est pas une synthèse entre des moments déjà constitués, mais elle constitue ces moments comme tels, dans l’acte même par lequel elle les retient et les prolonge les uns dans les autres […] Et c’est pourquoi, selon une des thèses les plus difficiles, mais en même temps les plus essentielles du bergsonisme, la conscience ne « dure » pas, comme si la durée était un prédicat ou un attribut de la conscience : la conscience est durée. » 16
C’est ce point qui marque une « bifurcation » essentielle de la part de Bergson. Schopenhauer pour sa part refuse de considérer le temps comme un attribut essentiel de l’en-soi du monde, la volonté –et c’est pourquoi, selon lui comme selon l’Ecclésiaste, rien ne peut apparaître de nouveau sous le soleil, puisque le changement, la nouveauté, ne sont que des illusions du vouloir lui-même, et qui cachent l’éternelle répétition du même.
Nietzsche pour sa part refuse à la conscience tout statut absolu, en faisant un phénomène proprement relationnel, émergeant au sein de la communauté humaine pour répondre aux besoins de communication. Elle n’est ainsi que la partie la plus superficielle de notre activité vitale. « La conclusion de Nietzsche est que la conscience constitue un développement « superficiel » de la volonté de puissance, et même un développement « maladif ». » 17
Mais Nietzsche, malgré cette dévalorisation de la conscience et de l’illusion d’unité qu’elle produit, continue malgré tout à concevoir un temps en général, un temps homogène que Bergson a dénoncé comme une « idole de langage ». Au contraire, l’auteur de l’Evolution créatrice (et mettre cela en pleine lumière nous semble le plus beau résultat d’Arnaud François) conçoit le temps chaque fois comme un acte : « C’est parce que le temps est l’objet d’un acte – ou plutôt : parce qu’il est lui-même un acte –, lequel consiste à retenir ses propres moments tout en les constituant comme moments, que le temps est conscience » 18
Il n’y a donc plus pour Bergson de temps en général, comme c’était le cas auparavant dans la tradition philosophique, mais un acte que le sujet effectue pour lui-même, ce qui fait du temps une conscience. Sans doute est-ce là le point le plus étonnant du bergsonisme : quoi de plus donné, de plus évident, et à la fois de mystérieux, que le temps ?
Puisque ce point est crucial, la question que l’on peut poser à Arnaud François serait celle-ci : La présence du temps à la conscience est-elle oui ou non, une donnée immédiate ? A partir de son livre même, on peut répondre ceci : si l’on comprend le temps comme un acte, alors sans doute la question est mal posée, car l’acte est toujours à faire, et n’est pas de l’ordre du donné (quoique la durée comme conscience soit en fait ce qui se donne le plus immédiatement à nous –mais à condition de faire un effort de réflexion et d’action pour se placer dans cet immédiat). La conséquence du bergsonisme serait ainsi de résoudre (ou de dissoudre ?) l’antique question augustinienne « qu’est-ce que le temps ? ». Peut-être faudrait-il répondre ainsi : quand je contemple le temps, je ne le sais pas, mais quand j’agis ou je pense, je me place dans ce temps, entendu comme durée, et en tant qu’il s’ouvre à moi, je le saisis.
En-dehors de l’histoire de la métaphysique heideggérienne
La conclusion du livre confronte enfin nos trois auteurs à l’histoire de l’ontologie de Heidegger, en montrant comment Schopenhauer, Nietzsche et Bergson ne s’inscrivent pas dans la lignée de la différence de l’être et de l’étant, en ce qu’ils sont profondément des penseurs de l’immanence : leur originalité tiendrait ainsi à penser à même la réalité, à partir d’elle et d’elle seule, en forgeant des concepts qui ne sont pas plus que l’étant qu’ils ont à comprendre. Ces trois penseurs constituent ainsi une lignée qui échappe à l’histoire de la métaphysique : « leurs philosophies contiennent même, par avance, une contestation des présupposés théoriques sur lesquels cette histoire s’appuie » 19, en ce qu’ils récusent justement toute notion d’être. Ils ne constituent donc pas une ontologie qui manquerait la différence ontologique : cette différence, par avance, ils la refusent. On ne pourrait, en conséquence, même plus parler d’une ontologie de la volonté.
Les qualités remarquables de cette étude sont donc de proposer des confrontations entre trois auteurs proches autour de concepts précis, de définir ainsi « l’air de famille » qui invite à les ranger dans la même lignée philosophique (« philosophes de la réalité »), et de tracer du même coup leurs divergences, c’est-à-dire de marque la spécificité de chacun. Les comparaisons des doctrines et des questionnements se font soit par le détail de l’une d’entre elle, ou la comparaison à deux ou trois, tout en restant centrées sur Bergson : Arnaud François écrit ainsi d’un seul tenant une comparaison entre Bergson et Schopenhauer et entre Bergson et Nietzsche. Des trois, c’est Schopenhauer qui reste le plus métaphysicien, mais peut-être le plus singulier des métaphysiciens 20, tandis que Nietzsche et Bergson assument pleinement la dimension créatrice, artistique, de la philosophie.
Et s’il respecte la lettre de ces penseurs, Arnaud François en respecte aussi l’esprit : nous voulons dire par là qu’il ne leur cherche pas des querelles doctrinaires ni n’est intéressé par des questions de réfutations; il ne cherche pas à savoir qui a le plus raison, mais il se tient à cette exigence de concevoir ces textes philosophiques non comme des doctrines mais comme la présentation d’un problème qui se pose et auquel une solution ne peut être apportée que par une création de concept. Cette création, qui est aussi bien, pour le penseur, re-création de sa pensée, de sa philosophie, c’est à dire de sa façon de vivre la vie.
- Pages 9-10.
- Page 12.
- Page 270.
- L’expression est de Gérard Lebrun dans l’introduction de L’envers de la dialectique. Hegel à la lumière de Nietzsche.
- Page 14.
- Page 29.
- Page 32. Sur le même thème du pâtir comme agir fondamental chez Nietzsche, on pourra consulter le livre de Barbara Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ, PUF, coll. Epiméthée, 2005
- Cf. pages 35 à 48. Il nous semble que sont repris ici des résultats établis par Wolfgang Muller-Lauter, dans Physiologie de la volonté de puissance, notamment pour ce qui concerne les notions de hiérarchie, de conflit et d’interprétation.
- Page 58.
- Page 73.
- Page 111.
- Ainsi parlait Zarathoustra, « Aux îles fortunées », cité par Arnaud François.
- En complément, on peut se reporter à l’article d’Arnaud François « Y a-t-il une théorie de la pulsion chez Bergson ? Pulsion et actualisation », dans le recueil La pulsion (Jean-Christophe Goddard dir.) chez Vrin. L’élan vital n’est-il pas le nom bergsonien de la pulsion ?
- Page 161
- 17] page 239.
- Page 243.
- Page 265.
- Page 269.
- Page 282.
- « Calme bloc ici bas chu d’un désastre obscur », dirait Mallarmé – à ceci près que le système schopenhauerien est certes un bloc, mais certainement pas le plus calme qui soit ! , et le désastre obscur étant en l’occurrence la ruine de toute représentation d’ordre et de finalité dans le monde.








