Le livre d’Antoine Grandjean consacré au philosopher kantien et intitulé Critique et réflexion1 se présente comme une contribution majeure au problème du statut du discours kantien et, plus généralement, au sens général du transcendantal. Nous avons affaire avec ce livre à un grand livre, affrontant comme telles les objections du postkantisme, sans mépris ni dogmatisme excessif, à l’aide d’analyses d’une très grande clarté, parvenant la plupart du temps à emporter l’adhésion du lecteur. Il serait fort difficile de résumer d’un mot la thèse de cet ouvrage, mais l’on peut toutefois cerner les principales articulations que Grandjean propose afin de contrer les critiques que le postkantisme avait adressées au prétendu aveuglement kantien quant au statut de son propre discours : puisque le statut du discours est au centre de l’œuvre, il convient dans un premier temps de faire œuvre réflexive et d’interroger le sens que revêt la réflexion dans la pensée kantienne : le discours peut-il se réfléchir lui-même et, le cas échéant, peut-il rendre compte de ce qu’il est ? Montrant que le discours – ou le philosopher – n’obéit pas aux formes du discours objectivant, Grandjean s’interroge alors sur le type de preuves que peut recevoir un discours qui ne peut rendre compte de lui-même et cela constitue la deuxième partie de l’ouvrage, qui est en tout point magistrale. Enfin, Grandjean tire les conséquences quant à l’impossibilité de fonder le fondement de la philosophie critique, et en analyse les impacts dans une troisième partie dense et d’une très grande originalité.
Loin donc des discours convenus, critiquant – trop facilement – l’aveuglement kantien ou, inversement, louant excessivement la lucidité critique, l’auteur creuse son sillon avec courage et détermination, affrontant ce que l’on pourrait appeler les « vrais » problèmes que soulève le kantisme, se tenant assez loin d’un certain nombre d’ornements superficiels ou de combats de chapelle, offrant ainsi au lecteur une véritable réflexion sur ce que philosopher veut dire. En outre, se dessine tout au long du parcours auquel nous convie l’auteur une idée tout à fait originale au sein du débat contemporain, en ceci que Grandjean maintiendra et défendra la systématicité de la pensée kantienne pour mieux l’ouvrir à la différence et à l’altérité ; autrement dit, la systématicité kantienne sera présentée comme cela même qui rend possible l’accueil de l’altérité et de la différence, incitant donc à revoir le préjugé selon lequel la systématicité est un synonyme de clôture radicale.
A : Répondre aux accusations postkantiennes
Il convient tout d’abord de saluer la qualité du prologue qui fixe historiquement le problème, rappelant en creux combien les lecteurs contemporains de Kant avaient immédiatement perçu les problèmes que soulevait l’entreprise critique du point de vue logique et combien nous nous en sommes éloignés par de vaines sophistications plus idéologiques que techniques. Certes, Grandjean n’est pas le premier à rappeler les objections de Schulze, Fichte, Hegel et Schelling, et il n’est qu’à songer aux célèbres Leçons de métaphysique allemande de Rivelaygue, au Kant aujourd’hui d’Alain Renaut, ou au bel ouvrage d’Isabelle Thomas-Fogiel, Critique de la représentation pour en avoir de solides aperçus2. Mais l’originalité de Grandjean est de monter la communauté de vues, en dépit de la diversité des analyses de détail, de tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont critiqué le philosopher kantien : tous considèrent que Kant a philosophé au-delà de lui-même ou, pour le dire plus simplement, qu’il ne disposait pas des moyens qu’exigeait son propre philosopher. Par conséquent, les critiques que vont adresser Hegel, Fichte et Schelling sont moins des critiques de doctrines particulières que des conséquences du refus du philosopher kantien. Chez Hegel, par exemple, « La suppression de l’inconnaissabilité de la chose en elle-même n’est elle aussi qu’une conséquence de l’avènement du nouveau philosopher. »3 Idem chez Fichte où « la conscience immédiate du moi comme activité est la saisie elle-même génétique du principe de toute genèse, dont l’autoposition est le fondement de toutes les positions subséquentes, de sorte que la question d’une chose elle-même4 cesse de se poser. »5
Ce que donc cherche à montrer Grandjean à partir de l’étude, rapide mais ferme, du postkantisme, c’est l’unité de la critique adressée à Kant : ce dernier ne s’est pas compris lui-même, c’est-à-dire qu’il n’a pas compris le statut de son propre philosopher, et que cela explique sa difficulté à fonder aussi bien la philosophie critique que la philosophie transcendantale (que Grandjean distingue avec raison). Il s’agit alors de comprendre Kant mieux qu’il ne s’est compris, à l’instar d’un Heidegger déclarant chercher à comprendre les Grecs mieux qu’ils ne s’étaient eux-mêmes compris : mais que signifie mieux comprendre Kant qu’il ne s’est lui-même compris ? A cela, Grandjean répond fort nettement : « Comprendre Kant mieux que lui-même ne l’a fait, c’est alors comprendre que la méthode critique est impropre à une saisie authentique du thème transcendantal, impropriété dont dérivent les impasses doctrinales du kantisme. »6 En somme, les errements doctrinaux du kantisme sont interprétés comme les indices, voire comme les symptômes du péché originel kantien, à savoir cette incapacité à rendre compte du statut du philosopher.
Toute l’entreprise de Grandjean va alors consister à montrer, non pas que les postkantiens ont eu tort de ne pas voir l’effort fondationnel déployé par Kant, mais bien plutôt de ne pas comprendre que l’absence de fondement est une exigence de la philosophie critique et de la philosophie transcendantale. Ce que n’ont donc pas compris, selon Grandjean, les postkantiens, c’est l’impossibilité de droit de donner un fondement à la philosophie kantienne ; l’idée est d’emblée intéressante car cela revient à dire que le postkantisme s’est fourvoyé en identifiant le système à une auto-fondation : le système kantien est à la fois parfaitement systématique et en même temps parfaitement non fondable, et c’est cette simultanéité-là que les postkantiens, selon Grandjean, n’ont pas comprise.
B : De quoi peut-il y avoir réflexion ?
Puisqu’il est question du statut du philosopher, la première opération à interroger est celle de la réflexion : de quoi peut-il y avoir réflexion ? Avant toutes choses, note Grandjean, il convient de distinguer nettement réflexion critique et réflexion transcendantale : tandis que la première relève de l’origine, et discrimine entre l’intellectuel et le sensitif, la réflexion transcendantale est de l’ordre de l’intentionnalité, c’est-à-dire de la destination : intelligible ou sensible. Bref, la réflexion transcendantale se demande à qui est donné l’objet tandis que la réflexion critique se demande d’où il provient. Cette dernière discrimine de ce fait entre les sources de la donation de l’objet, tandis que la critique transcendantale se demande ce que l’esprit rend possible en guise d’expérience, sensible ou intellectuelle.
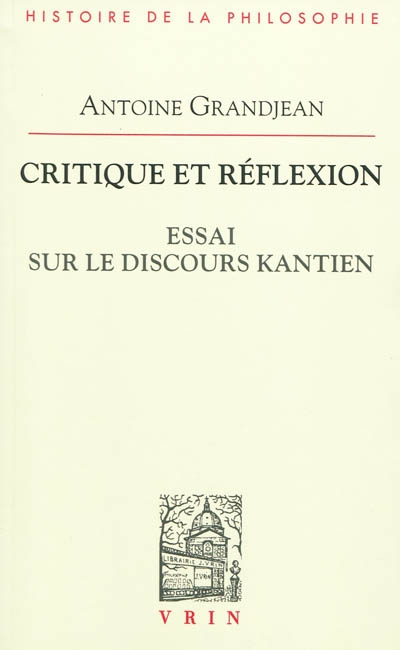
Mais une fois que l’on a dit cela, on n’a finalement pas dit grand-chose ; encore faut-il comprendre pour quelle raison il est intéressant de poser cette distinction entre l’interrogation portant sur la provenance et celle portant sur la destination, en dépit de leur fréquente confusion. Là encore, la réponse de Grandjean est fort intéressante : elle consiste à établir l’asymétrie entre la dualité des sources et l’unité de la destination. C’est une même connaissance d’objet qui peut être obtenue en dépit des sources hétérogènes de sa donation. « Tout le propos de Kant va à dire que l’hétérogénéité radicale des sources de la connaissance n’implique pas l’hétérogénéité des deux connaissances et des deux domaines d’objets. »7 Pour le dire clairement, qu’il y ait une donation sensible et une donation intellectuelle de ce dernier ne signifie que la connaissance de celui-ci sera elle-même scindée : l’unité cognitive demeure possible du point de vue transcendantal en dépit de la scission génétique dans l’ordre critique. Cette interprétation que Grandjean propose quant à la différence entre geste critique et geste transcendantal me semble tout à fait opératoire, et justifie tout à fait la distinction opérée par l’auteur.
Une fois posée et justifiée cette distinction, il demeure une interrogation centrale qui est celle conférée au titre de la partie ; de quoi y a-t-il réflexion ? Car une chose est de dire que le geste critique et le geste transcendantal ne renvoient pas à la même chose, une autre est de cerner l’objet de la réflexion. Autrement dit, ce n’est pas parce que diffèrent le geste critique et le geste transcendantal que l’on doit en déduire la plurivocité de l’objet de la réflexion ; et, à cet égard, Grandjean se veut sans ambiguïtés : quel que soit le type de réflexion, il est toujours question de ramener à l’unité discursive le divers, que cela soit direct ou non. Universellement, donc, la réflexion vise à assurer l’unité d’un divers éclaté, soit par découverte des catégories comme agents de l’unité synthétique, soit par retour à la source comme source unique, soit par comparaisons. Cela présente une conséquence immédiate quant au Je : le Je est bien davantage celui-là même qui opère l’unification, donc celui par lequel il y a réflexion, que le réfléchi en tant que tel, ce qui signifie en creux que la réflexion, loin de mener à la découverte d’un ego fait de ce dernier un opérateur logique sans lequel nulle réflexion ne serait possible ; il devient une présupposition logique sans laquelle l’unification du divers perdrait aussitôt toute forme de sens.
C : Le sujet introuvable
Si l’on regarde ce qui vient d’être dit, et si l’on suit Grandjean dans ses analyses, une chose est désormais certaine : la réflexion ne renvoie pas au transcendantal comme tel : elle renvoie à l’unité et non au sujet. Il y a, de ce fait, une absence réflexive de ce dernier, sur laquelle Grandjean va grandement insister afin de justifier l’inanité des critiques du postkantisme adressées au kantisme. Pour le dire d’un mot, il s’agit de comprendre que le transcendantal comme le sujet ne peuvent en aucun cas devenir l’objet d’une réflexion ni, d’une manière plus générale, être objectivables : de ce fait, ne pouvant être objectivables, il devient absurde de reprocher au kantisme de ne pas rendre raison de leur fondement, puisque l’on ne peut rendre raison que de ce qui est objectivable. La subjectivité, explique donc Grandjean, est reconstruite à partir de ce qu’elle rend possible si bien que le sujet est toujours absent ; le criticisme est « réflexion d’une absence, d’un jamais donné là, cela permet déjà de dire que le transcendantal n’a rien d’un objet. »8 Il convient de prendre la mesure de cette analyse : l’impossibilité d’objectiver le transcendantal, loin de grever le kantisme, désigne une propriété intrinsèque du transcendantal et immunise celui-ci contre les accusations habituelles ou, pour le dire plus clairement, ce qui était jadis considéré comme un défaut du philosopher kantien se trouve désormais caractérisé comme la marque même de la bonne compréhension par Kant des propriétés du transcendantal tel qu’il l’avait élaboré.
Cette analyse, qui se refuse à considérer comme possible l’objectivation du transcendantal, repose sur une caractérisation du geste critique par la discursivité : pour le dire plus clairement, la réflexion kantienne est systématiquement discursive, et jamais intuitive aux yeux de Grandjean ; de ce fait, on ne comprend pas le kantisme si l’on s’obstine à lire la réflexion kantienne à l’aune de la réflexion cartésienne ou même husserlienne qui sont de type intuitif et qui font l’économie de la patience discursive : cette discursivité de la réflexion telle que l’établit Grandjean me semble constituer le point le plus important et le plus décisif de ses analyses : sans elle, toute la démonstration de l’ouvrage s’effondre, car c’est en elle que se jouent tout à la fois la spécificité kantienne et la cohérence de son œuvre. En outre, cela prépare la conclusion et l’ouverture à la différence, puisque cette médiation discursive implique, comme le souligne fort bien l’auteur, que le philosopher kantien est « un philosopher de la distance et du détour, donc un philosopher de la finitude, au sens subjectif du génitif. »9
Il ne reste plus à l’auteur qu’à présenter la psychologie rationnelle comme ce moment décisif quant à la clarté du statut du transcendantal, puisque la psychologie rationnelle n’a d’autre dessein que celui de discriminer entre le « Je » et le « Je pense », cherchant à objectiver le Je comme tel, comme si ce dernier était homogène à un simple objet. Et si elle ne peut y parvenir c’est parce qu’il est impossible de réfléchir le transcendantal, en ceci qu’il n’est pas donné : il ne provient de rien, « le philosopher ne pouvant qu’aller de la transcendantalité du transcendantal à sa subjectivité. »10 Bref, la réflexion cherche désespérément un sujet comme tel, et ne découvre jamais que la mise en abîme de la possibilité : c’est la transcendantalité du transcendantal, la possibilisation de la possibilité qui lui est offerte. Et pourquoi cela ? Toujours en vertu de cette discursivité de la réflexion. « C’est parce qu’il ne pense pas la réflexion sur le mode de l’intuition que Kant peut assurer un statut cohérent à son propre discours sous ce titre. »11
D : Comment prouver une connaissance transcendantale ?
D’une certaine manière, tout est dit en première partie : la non homogénéité du transcendantal avec les objets suffit à désactiver les critiques du postkantisme contre l’aveuglement du philosopher, tandis que l’insistance sur la nature discursive de la réflexion permet de justifier cette hétérogénéité. La deuxième partie de l’ouvrage ne fait que confirmer cette hétérogénéité et s’interroge quant au type de preuve que peut recevoir le transcendantal : puisque le philosopher kantien ne saurait réfléchir son propre fondement, il lui faut élaborer une nouvelle approche probatoire de son acte réflexif, qui ne peut être celui classique d’une démonstration directe. Pour le dire plus simplement, l’impossibilité pour le transcendantal de rendre compte de lui-même s’ajoute à la nature discursive de la réflexion, si bien que si preuve du transcendantal il y a, elle ne peut elle-même être qu’indirecte, et discursive.
Mais que faut-il prouver ? Prouver le transcendantal, c’est prouver la transcendantalité d’une proposition transcendantale, donc parvenir à prouver qu’une proposition est la condition de possibilité de cela même qui est présupposé. Il convient donc de se demander comment on peut prouver la transcendantalité d’une proposition. La seule solution, note Grandjean, est la preuve apagogique négative (modus tollens) en ceci qu’elle est doublement indirecte : elle conclut de la fausseté de la conséquence à la fausseté du principe ; c’est ce que les mathématiques nomment habituellement la preuve par l’absurde. Seul ce type de preuves convient pour prouver le transcendantal, bien que Kant déclare par ailleurs n’admettre, de manière générale, que les preuves ostensives : mais ces dernières ne conviennent nullement lorsqu’il est question de la transcendantalité d’une proposition, puisque toute preuve ostensive dériverait la vérité des principes de l’entendement de l’unité de l’aperception elle-même, ce qui n’a aucun sens dans l’économie de la Critique. Par conséquent, en dépit de son caractère foncièrement insatisfaisant, la preuve apagogique négative demeure le seul mode probatoire du transcendantal.
Si l’on suit bien les analyses que développe admirablement Grandjean, on arrive à une conclusion stupéfiante, quoique pleinement justifiée dans l’économie de l’exposé : le philosopher kantien est toujours second. S’il est impossible de réfléchir le transcendantal, c’est d’abord parce que le discours transcendantal n’est jamais premier ni fondateur : il est second, en ceci qu’il est ce qui survient après qu’a eu lieu l’expérience. Cette analyse, surprenante prise dans l’instant, est cohérente dans l’ensemble de la démonstration : le philosopher kantien n’est pas fondement, il est condition de possibilité de l’expérience, et ne se trouve convoqué comme tel qu’après que l’expérience aura été possible. Il n’y aurait là circularité vicieuse – la connaissance du transcendantal comme condition de l’expérience ne serait possible qu’à partir de l’expérience – que si l’expérience objectivante et le transcendantal étaient du même ordre ; or, toute la thèse de l’ouvrage consiste à montrer au contraire que nous avons là affaire à deux ordres hétérogènes, qui ne sauraient être pensés dans l’univocité de la terminologie du fondement. Il y a donc bien circularité mais celle-ci ne devient jamais vicieuse car le départ et l’arrivée se trouvent soigneusement maintenus dans des ordres différents, la connaissance d’objets ne pouvant être comprise de la même manière que la connaissance transcendantale.
E : Conséquences du raisonnement sur l’expérience : limites et difficultés du kantisme
Au fond, l’idée essentielle de Grandjean consiste à relativiser le transcendantal : le transcendantal n’est pas un fondement absolu auquel la réflexion donnerait accès, mais il est ce qui, relativement à l’expérience, s’avère nécessaire bien que relevant d’un ordre différent, soit non-objectivable. L’ensemble de l’ouvrage défend fort bien cette idée, et sauve le philosopher kantien d’un certain nombre d’accusations dont on a quelque peu oublié à quel point elles étaient ruineuses. Mais le prix à payer d’un tel sauvetage est fort élevé, et j’aimerais évoquer ici, sous formes de simples hypothèses, quelques problèmes créés par la solution qui me semblent presque pires que les accusations postkantiennes dont Grandjean cherche à exonérer Kant.
Le premier problème porte sur les concepts : Hegel avait reproché à Kant de les trouver tout faits dans la logique, comme s’il s’agissait d’une découverte empirique fort peu critique. Pour contrer cela, Grandjean dégaine la discursivité de la réflexion et fait de celle-ci cela même qui crée les concepts, en ceci que la réflexion logique se trouve assimilée à une opération produisant les concepts. L’empiricité de la découverte dénoncée par Hegel se trouve désactivée par la discursivité de la réflexion, devenue comme telle productive : cela a un sens dans la mesure où le philosopher est second et, à cet égard, c’est bien la réflexion sur l’expérience qui révèle rétroactivement les concepts. Mais en quoi la rétroactivité de la découverte constitue-t-elle une « production » ? Il faudrait, pour ce faire, admettre que la réflexion fait sienne la spontanéité de l’entendement, ce que Grandjean prouve à partir de La religion dans les limites de la simple raison selon laquelle l’entendement est le pouvoir de réfléchir. Et de cette affirmation – curieusement absente de la Première Critique – Grandjean produit le syllogisme suivant : l’entendement est un pouvoir de réflexion, or l’entendement est l’exercice de la spontanéité, donc la réflexion participe de la spontanéité et est, à ce titre, productrice. En apparence, le syllogisme est tout à fait juste puisqu’il épouse la forme suivante : A est B, or A est C, donc B est C. Mais du point de vue matériel, la majeure exprime-t-elle une définition ou une propriété ? Si la réflexion n’est qu’une propriété de l’entendement et non sa définition, alors rien ne prouve que tout ce qui convient à l’entendement convient à l’une de ses propriétés, si bien que cette redéfinition des concepts ne vaut que si la déclaration lapidaire de la Religion est interprétée comme la définition de l’entendement et non comme une de ses propriétés, ce sans quoi il n’y aurait aucune raison de faire de la réflexion une production de concepts. L’absence de référence aux trois Critiques, ainsi que la fragilité du raisonnement, me semblent inciter à une certaine prudence quant aux analyses menées en ce domaine.
Une autre difficulté me semble résider dans la troisième partie, à la fois excellente et fort problématique. Grandjean tire toutes les conséquences de l’impossibilité de fonder le transcendantal, et fait de celui-ci un fait. « Le transcendantal est un fait irréductible, il n’a d’autre ratio que cognoscendi, à savoir le fait de son conditionné qui permet d’établir son quoi et de « décrire son comment sans jamais dévoiler son pourquoi. »12 Dans un premier niveau de lecture, on se dit que le meilleur moyen de répondre aux accusations postkantiennes quant au fondement est encore de neutraliser le problème en expliquant que la nature du transcendantal est telle que la question du fondement n’a pas à être posée. D’où la remarque suivante, fort éclairante : « La critique que les postkantiens adressent de manière répétée à cette factualité qu’ils interprètent comme résiduelle est donc la revendication indue de ce qui réintègrerait le transcendantalisme au sein d’une psychologie métaphysique dont nous avons montré qu’il fallait précisément en sortir pour que le transcendantal puisse apparaître thématiquement. »13 Si nous admettons cette analyse, cela exonère Kant des critiques postkantiennes ; mais à quel prix ! Si vraiment l’analyse est juste, si donc le transcendantal est cela même qui se découvre en position seconde vis-à-vis de l’expérience qui est première, et si par ailleurs, le transcendantal est présenté comme un « fait » que l’on ne peut qu’admettre, voire constater, alors ce n’est plus le transcendantal qui est problématique mais l’expérience qui revêt un halo tout à fait mystérieux. En effet, si l’on suit bien Grandjean, le geste kantien peut se résumer à cet ordre-ci :
1) Je connais des expériences, sensibles comme intellectuelles.
2) Je m’interroge sur la possibilité de telles expériences et je produis alors une réflexion critique en ceci que je m’interroge sur la provenance des objets sensibles et cognitifs dont je dispose.
3) Cette réflexion critique identifie la réflexion transcendantale comme possibilité même des expériences que j’ai faites.
4) Or ce discours critique ne saurait être rendu possible ni être justifié par la réflexion transcendantale, et ce en raison de la nature même du transcendantal.
5) Par conséquent, il faut admettre le transcendantal comme un fait dont on ne saurait rendre raison, c’est-à-dire qu’il s’agit là d’une facticité, ce que Grandjean admet du reste volontiers : « La factualité de la structure de possibilisation de la connaissance doit donc être pensée comme facticité. »14
6) Le résultat ultime de la réflexion critique ne peut donc être que cette irréductible facticité du transcendantal.
Admettons la validité générale de cet enchaînement : cela pose un problème du point de vue de l’expérience car au fond si le philosopher est second, c’est donc que le conditionné est premier, c’est-à-dire que l’expérience comme telle est première en tant que fait primitivement rencontré : il y a une expérience, et nous essayons d’en rendre compte. Or, si c’est la réflexion qui, comme le prétend l’auteur, produit les concepts et les catégories, cela revient à dire qu’il existe une expérience pré-catégoriale, que l’on est en droit de trouver surprenante au moins dans le cadre de l’expérience perceptive. En effet, dans une optique cognitive, on peut comprendre qu’il faille reproduire la démarche critique et ainsi passer par la médiation de la réflexion ; mais dans le cas d’une expérience perceptive immédiate, comment puis-je percevoir quoi que ce soit sans l’aide d’un concept ? Si je dis par exemple : « je vois passer un chat », je dois non seulement disposer d’un concept empirique mais surtout de la catégorie d’unité sans laquelle je ne pourrais tout simplement pas le percevoir : faut-il que j’effectue alors une réflexion pour disposer de ce concept, c’est-à-dire que je réfléchisse l’expérience première pour produire mon concept d’unité ? Le dilemme est ici total car les deux termes de l’alternative paraissent douteux : soit j’ai besoin d’un concept obtenu par réflexion pour percevoir, auquel cas avant que ne soit effectuée la réflexion, il y a une expérience muette, ce qui ne correspond pas à la lettre kantienne, soit inversement je perçois immédiatement un chat, mais alors je n’ai pas besoin de la réflexion pour produire l’unité, auquel cas c’est l’analyse entière du rôle de la réflexion discursive comme production de concepts qui devient douteuse.
Naturellement, on pourrait répondre que la priorité logique n’est pas la priorité chronologique, et c’est d’ailleurs ce que propose Grandjean en distinguant la modalité interne à l’expérience et la question modale du transcendantal comme tel : à ce titre, le fait de l’expérience serait premier chronologiquement mais pas logiquement ; toutefois, si la réflexion est réellement productrice de concepts, c’est donc que, avant la réflexion, l’expérience ne saurait être pensée – ce qui va de soi – mais surtout qu’elle ne saurait être identifiée, notamment dans la perception. A cela, peut-être pourrait-on répondre qu’il n’y a pas besoin de concepts a priori pour percevoir, mais cela contredirait explicitement les exemples de Kant – celui de la perception de la maison mobilisant l’unité et celui de la perception de la transformation d’eau en glace mobilisant la causalité – consacrés à l’analyse de la perception. Bref, le problème peut ainsi se laisser résumer : tout se passe comme si les concepts, puisque secondairement produits, ne pouvaient s’appliquer à ce qui est premier, à savoir au conditionné, ce qui rend tout à fait incompréhensible le sens de l’expérience perceptive.
Enfin, il faut interroger le sens de cette facticité que révèle Grandjean. Certes, l’économie de l’ouvrage interdit de voir dans la factualité du transcendantal qui se redouble en facticité un problème car ne pas rendre raison du transcendantal ne signifie pas que l’on ne puisse pas le prouver : de ce fait, la factualité-facticité du transcendantal n’est pas un synonyme d’arbitraire. Le problème se situe donc bien ailleurs, à savoir dans l’expérience elle-même : si le transcendantal est bien factice, si donc il pouvait être autre – et Grandjean indique que Dieu n’est rien d’autre que le nom de cette autre possibilité de la connaissance – alors cela signifie que l’expérience, particulièrement l’expérience possible, se trouve singulièrement douteuse. Tout l’édifice kantien qui, rappelons-le, servait à justifier la possibilité de jugements synthétiques a priori en vue de garantir la connaissance contre Hume, se trouve emporté sinon dans le scepticisme, à tout le moins dans un dualisme véritatif, au sein duquel la connaissance humaine occupe une place bien peu honorifique ; en somme, le prix à payer pour sauver Kant des accusations postkantiennes consiste à rendre purement contingentes toutes les vérités que je tirerai de l’expérience possible, ce qui constitue un tribut que l’on peut légitimement juger exorbitant.
Conclusion : de l’utilité problématique du kantisme
L’idée générale du livre peut ainsi se laisser exprimer : la condition de possibilité de toute objectivation est elle-même inobjectivable. Cette idée, quoique simple, constitue une réponse convaincante aux accusations postkantiennes et la démonstration de l’auteur est remarquable. Cela a des conséquences également visibles sur l’interprétation qu’en a faite Heidegger et qui, à la lumière des analyses de Grandjean, se trouve établie à plusieurs reprises comme fondamentalement erratique. « Heidegger, écrit Grandjean, se trompe en lisant dans l’ « humanisation » du transcendantal une relativisation de la finitude. Il s’agit précisément de la radicaliser par redoublement. Heidegger se méprend en croyant que Kant « recule » dans la deuxième édition et que, pour sauver la raison pratique, il veut sauver la raison comme telle, et donc aussi son usage théorique, en relativisant la portée de la sensibilité. Au contraire, le sort de la rationalité théorique est strictement solidaire de celui de la sensibilité. »15 En outre, la toute dernière partie de l’ouvrage, à la fois contre le néokantisme et l’interprétation heideggérienne, établit, là aussi de manière convaincante, que la nouveauté kantienne réside dans ce que ni Heidegger ni les néokantiens n’ont vu, à savoir une « téléologie de la liberté. La Critique est une métaphysique, mais cette dernière n’est pas une ontologie. Elle est polarisée par cette instance méta-physique, donc aussi bien méta-ontologique, qu’est la liberté. »16
Mais, du fait même que Grandjean semble avoir raison quant à son interprétation générale, se trouve posé le problème de l’applicabilité de la philosophie kantienne : une métaphysique non ontologique n’est-elle pas une métaphysique qui peine à s’inscrire dans l’être ? Au fond, la question lancinante que l’on se pose à la lecture de cet ouvrage, dont je redis combien il est déjà indispensable et brillant par bien des aspects, est celui de l’utilité de la philosophie kantienne : à lire Grandjean, on se prend à penser que les écrits kantiens constituent un immense gâchis, c’est-à-dire désignent une machinerie intellectuelle géniale dont les décrets d’application sont introuvables. Les postkantiens, en insistant sur la difficulté du fondement, ratifiaient implicitement que la doctrine comme telle s’appliquait, et que les errements doctrinaux étaient dus à l’aveuglement du fondement ; mais ce faisant, ils admettaient l’existence d’une doctrine et donc d’une application.
La neutralisation des critiques postkantiennes que cherche à établir Grandjean me semble en réalité se payer d’un prix inassumable, celui du rétablissement d’une circularité intégrale du sujet, dont les facultés ne semblent en fin de compte ne s’appliquer qu’à lui-même, sans que ce « lui-même » ne désigne d’ailleurs un Moi. Le sujet transcendantal se présente comme une gigantesque auto-affection permanente, échouant à chaque instant à rencontrer l’être, y compris l’être du Moi : cela est particulièrement sensible dans le cadre moral, puisqu’il est celui qui produit la loi et celui qui est affecté par cette dernière, Grandjean notant que « La métaphore de la voix dit la réceptivité qu’éprouve le sujet empirique à l’égard de lui-même comme raison pratique pure. »17, et cela est vrai a fortiori dans le cadre du jugement réfléchissant, par lequel le sujet réfléchit ses propres facultés, menant à une auto-affection du Gemüt. Ce que Grandjean établit donc, sans pour autant le thématiser comme tel, c’est la parfaite impossibilité pour le sujet transcendantal, parce qu’il est transcendantal, de rencontrer l’être, fût-il le sien propre, si bien que l’ouvrage nous présente à la fois un sujet parfaitement enfermé en lui-même (cet enfermement est pudiquement décrit comme une téléologie de la liberté), n’ayant affaire qu’à lui-même, et qui, de surcroît, présente un fonctionnement absolument contingent, c’est-à-dire factice, donc incapable de garantir au-delà de lui-même les vérités qu’il prétend établir, exception faite toutefois de l’absoluité de la loi morale. La question mérite donc d’être clairement posée, avec toute la violence qu’elle suppose : à quoi sert à une philosophie qui n’aurait que cela à proposer18 ?
- Antoine Grandjean, Critique et réflexion. Essai sur le discours kantien, Vrin, Paris, 2009
- cf. Jacques Rivelaygue, Leçon de métaphysique allemande, tomes I et II, Grasset, 1990, Alain Renaut, Kant aujourd’hui, Champs-Flammarion, 1999, Isabelle Thomas-Fogiel, Critique de la représentation. Etude sur Fichte, Vrin, 2000 et aussi Jules Vuillemin, L’héritage kantien et la révolution copernicienne, PUF, 1954
- Grandjean, op. cit. p. 38
- Grandjean rebaptise « chose en soi » « chose en elle-même.
- Ibid., p. 48
- Ibid. p. 57
- Ibid. p. 73
- Ibid. p. 104
- Ibid. p. 104
- Ibid. p. 116
- Ibid. p. 120
- Ibid. p. 180
- Ibid. pp. 185-186
- Ibid. p. 195
- Ibid. p. 217
- Ibid. p. 268
- Ibid. p. 234
- Cela signifie que le rapprochement permanent opéré à l’égard de Descartes ne semble pas pertinent, car ce dernier a à cœur de systématiquement appliquer ses concepts, en vue d’améliorer disciplinairement les sciences, la mathématique, la médecine, et même la morale. Rien de tel ne semble permis par la pensée kantienne.








