Antoine Compagnon occupe la chaire de littérature française moderne et contemporaine au Collège de France ; il fut professeur à la Sorbonne et professeur de littérature française et comparée à l’université Columbia. Grand spécialiste de Montaigne, Baudelaire ou encore Proust, il allie la plus haute exigence universitaire à un naturel de transmission qui fit de son ouvrage Un été avec Montaigne1, publication de ses chroniques radiophoniques, un succès d’édition rare. Il se distingue aussi en tant qu’écrivain.
Les antimodernes – de Joseph de Maistre à Roland Barthes2, paru une première fois en 2005, est une œuvre à l’image de l’histoire intellectuelle d’Antoine Compagnon : elle s’ouvre sur un portrait conceptuel et stylistique des antimodernes, ces écrivains et penseurs à la modernité ambivalente, ni réactionnaires ni franchement conservateurs, mais à la sensibilité subversive proche paradoxalement du révolutionnaire et s’imposant pourtant en contre (contre leur temps, contre le destin de l’Occident, contre les vainqueurs et les idées victorieuses, contre in fine le plat paradis du Bien), et l’œuvre se poursuit par un travail historique sur les grands Antimodernes, à l’image des travaux universitaires de l’auteur.
Antoine Compagnon montre, dans une première partie de l’ouvrage (baptisée Les idées – les deux cents premières pages environ), qu’il y a six grands thèmes constants du courant antimoderne ayant émergé au lendemain de la Révolution. Dans une deuxième partie de l’ouvrage, l’étude d’Antoine Compagnon se centre sur les grandes figures de l’antimodernité (Les hommes): Chateaubriand, Joseph de Maistre, Bloy, Péguy, Benda, Barthes, etc. La première partie est d’une lecture enthousiasmante, les clés du système antimoderne et donc du système moderne sont dévoilées avec une clarté et une précision remarquables : Antoine Compagnon déploie un style sous influence et tout est formule frappante et bien balancée. La deuxième partie est plus universitaire dans son style, descendant dans l’histoire concrète et de détail, dans les œuvres et les pages précises, elle perd en densité, éclaire moins la scène de l’histoire politique et littéraire d’un jour nouveau, mais gagne peut-être en argumentation et précisions concrètes. Nous retenons, quant à nous, la première partie comme modèle de l’enthousiasme qui manque tant au savoir universitaire quand il s’écrit et à la pose scientifique ou encore à l’esprit de sérieux des intellectuels européens. Transmettre c’est emporter avec soi au sein de sa passion, c’est rendre affectif le savoir précis et rigoureux. Antoine Compagnon témoigne là de son génie professoral.
L’auteur cherche à définir les constantes affectives, intellectuelles et rhétoriques de l’antimoderne. Présentons donc les six constantes qui caractérisent l’antimodernité :
« Pour décrire la tradition antimoderne, une figure politique ou historique est d’abord indispensable : la contre-révolution. En deuxième lieu, il nous faut une figure philosophique : on songe naturellement aux anti-lumières, à l’hostilité contre les philosophes et la philosophie du XVIIIe. Puis il y aurait une figure morale ou existentielle, qualifiant le rapport de l’antimoderne au monde : le pessimisme […]. Contre-révolution, anti-lumière, pessimisme, ces trois premiers thèmes antimodernes sont liés à une pensée du monde inspirée par l’idée du mal. C’est pourquoi la quatrième figure de l’antimoderne doit être religieuse ou théologique ; or le péché originel fait partie du décor antimoderne habituel. En même temps, si l’antimoderne a de la valeur, s’il compose un canon littéraire, c’est parce qu’il définit une esthétique : le sublime. Enfin l’antimoderne a un ton, un style, une voix, un accent singulier ; on reconnaît le plus souvent l’antimoderne à son style. Aussi la sixième et dernière figure de l’antimoderne sera-t-elle une figure de style : quelque chose comme la vitupération ou l’imprécation. » 3
A. L’événement-symbole fondateur : des révolutions et de leur prédestination
L’événement inaugural qui ouvre la Modernité et qui n’est bien sûr qu’une vague précédée de lames de fond historiques et philosophiques, c’est la Révolution française. Ce que prétend initier la Révolution en son acte politique et symbolique, c’est avant tout la table rase du passé et cette table rase, même si, bien entendu, comme tout phénomène historique elle peut être replacée dans une tradition intellectuelle déjà bien ancrée (celle des Lumières) et dans une multitude d’événements français, américains, anglais, etc., institue bel et bien un monde nouveau et un homme nouveau. De la même manière, si ce monde et cet homme nouveaux sont déclarés, il faudra le temps plus long de l’histoire pour qu’ils adviennent véritablement et s’inscrivent eux aussi dans une tradition culturelle vieille de plusieurs siècles désormais et de milliers de grands hommes. Mais dans la crise révolutionnaire, son acte et sa symbolique, une rupture sans précédent est déclarée : l’homme est l’acteur de l’histoire et l’immanence égale et indifférenciée est son horizon.
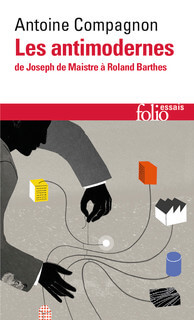
Ainsi, s’il y a toujours une tension entre la jeunesse qui a soif et croit dans l’innovation, et l’âge qui sait la force de ce que l’histoire et les ainés conservent, ou encore entre la tendance morale progressiste et la tendance morale conservatrice, désormais un monde nouveau est lancé, c’est la jeunesse qui a pris le pouvoir. La tension demeure mais elle n’est plus strictement la même, car un monde vient de gagner qui n’avait jamais gagné pleinement, une force qui était en contre prend le pouvoir et pose désormais l’autre force en contre. Antoine Compagnon cite Thibaudet :
« les idées de droite, exclues de la politique, rejetées dans les lettres, s’y cantonnent, y militent, exercent par elles, tout de même, un contrôle, exactement comme les idées de gauche le faisaient dans les mêmes conditions au XVIIIe ou sous les régimes monarchiques du XIXe. » 4
C’est bien sûr à gros traits que le portrait est dessiné, mais l’idée est là : certaines valeurs comme l’égalité et la haine de la hiérarchie, la haine de la violence des aristocrates et de l’aristocratie elle-même, ont désormais gagné et vont innerver toutes les idées et les valeurs à venir, rejetant hors de la scène les valeurs aristocrates habituelles. Hors de la scène dominante politique et morale, certes, mais pas philosophique et littéraire : continue de se discuter dans certaines œuvres ce qui au sein de la société ne se problématise jamais, à savoir la valeur même des valeurs modernes selon la méthode nietzschéenne, leur gain, leur fécondité, leur vérité, leur beauté, etc.
B. L’Antimodernité est par essence ambivalente : gros de la modernité, l’antimoderne pleure son antique liberté
L’édition de 2016 en poche folio essais accentue l’analyse de l’ambivalence des antimodernes dans une postface prenant acte de l’actualité concrète du monde mais surtout du paradoxe moderne de l’antimoderne : ces individus de génie comme Baudelaire ou Chateaubriand qui sont avant tout modernes, car marqués par leur temps au sein de leur individualité même, sont le contraire des individus sans individualité d’Amiel, ils sont plutôt des individus très individualisés et libres. C’est l’angle avec lequel nous aimerions présenter cet exaltant ouvrage : l’essence même de l’antimoderne nous apparaît comme l’essence de l’Occident intellectuel, fondé sur un conservatisme culturel porteur d’institutions, d’arts et de sciences d’une grande fécondité civilisationnelle, et pourtant porteur tout autant d’une volonté de table rase et d’homme nouveau, ce fol espoir d’un nouveau monde et d’une posthistoire que porte la modernité.
L’antimoderne est l’enfant bâtard des deux mondes, fidèle à son ancestrale mère et à son père moderne, voulant continuer de téter le sein nourricier tout en profitant du monde nouveau que voilà. Si c’est ce paradoxe ou ce fait culturel s’imposant aux yeux de qui observe le temps long de l’histoire occidentale qui nous intéresse, c’est qu’il nous semble s’agir de notre condition, non plus moderne, mais de notre condition antimoderne. Comment ne pas vouloir jouir de la liberté individuelle qui est la nôtre et des promesses de l’homme nouveau, de son monde et de ses technosciences, et comment ne pas regretter tout autant la tranquillité du conservatisme, de ses solides institutions ancrées et éprouvées, ainsi que de sa communauté rassurante ? L’individu d’aujourd’hui, moderne par nécessité, le sait bien : il veut être libre, socialement et familialement, et ne cesse de s’émouvoir de la volatilité et de la fluidité de tout lien. Il veut la solidarité mais ne peut payer le prix de l’étouffante communauté, il veut la richesse affective mais ne peut promettre l’inconditionnel, il veut la fraternité mais ne se comporte jamais qu’en lointain cousin, incapable désormais d’amour du prochain sinon dans des formules purement morales et orales, moyennant dorénavant son canapé et une place dans son auto, il veut l’égalité aussi bien sûr mais n’a jamais autant pensé à soi, ce petit soi fat désormais reconnu roi, enfin et dans une synthèse tragique et pathétique, il veut la liberté mais elle lui pèse cette liberté et c’est le dernier homme, l’homme fatigué qui vit aujourd’hui au sein du nouveau monde.
Avant tout moderne donc, mais vitupérant contre les effets et les excès de la modernité, révélant que la tradition des lumières et des révolutions ouvrent une religion fondée sur une nouvelle conception du bien (avec la matrice de l’égalité en tête) aveugle à ses postulats et à l’histoire, à la force du passé et de la lente élaboration des cultures. L’antimoderne vient semer le doute et permettre la critique : il est la conscience réflexive de sa culture et sa véritable « déconstruction critique » pour parodier le lexique de l’adversaire5.
C. La lucidité moraliste des Antimodernes contre le fol espoir moderne : une anthropologie face à une autre
Citons avec A. Compagnon et non sans délectation les noms convoqués :
« Qui sont les antimodernes ? Balzac, Beyle, Ballanche, Baudelaire, Barbey, Bloy, Bourget, Brunetière, Barrès, Bernanos, Breton, Bataille, Blanchot, Barthes… Non pas tous les écrivains français dont le nom commence par un B, mais, dès la lettre B, un nombre imposant d’écrivains français. (…) les modernes en délicatesse avec les Temps modernes ».
Ceux, en somme, qui n’épousent pas leur temps, ses croyances et ses tabous fondateurs. Ceux qui questionnent le nouveau jardin d’Eden de l’Occident moderne, la Révolution française, et son péché originel dans la Terreur et les décapitations, notamment celle de l’Ancien Dieu laissant dorénavant un Dieu sans tête qui peut prendre toutes les têtes. Ceux qui peuvent faire un pas intellectuel en arrière quand résonnent les dogmes trinitaires de l’époque : égalité, liberté, tolérance. Et ainsi ceux qui peuvent étudier la force matricielle et génératrices desdits dogmes : comment brosser des galeries de portraits dans nos romans sans voir les nouveaux bigots prêchant l’égalité et la nouvelle morale et restant aussi creux et pourri de cœur que les contemporains de Blaise Pascal – quoi qu’ils en disent ? Ceux qui restent sensibles aux vérités cruelles sur l’humanité, dont la veine anthropologique reste de ce moralisme si typiquement français où La Rochefoucauld, Pascal, La Bruyère, La Fontaine et Molière nous montrent sans arrêt les Tartuffes et les messieurs Jourdain, les corbeaux et les renards, l’amour-propre et l’intérêt partout, le masque même à soi-même, en bref la réalité humaine telle que nous la connaissons encore aujourd’hui, vaine et pleine d’elle-même, au grand cœur parfois peut-être, mais au grand jour, intéressée et peut-être capable de désintérêt (par définition silencieux). Cela n’implique pas de renoncer au progrès ou, plus exactement, de se demander ce qu’il en est de la perfectibilité et de son lien aux conditions historiques et morales des civilisations, mais c’en est fini aussi que de croire au progrès comme à la Providence. L’antimoderne est bien entendu moderne, il est le véritable postmoderne en ce qu’il cherche à digérer la modernité pour la dépasser sans la caricaturer.
L’antimoderne, d’ailleurs, se rit bien du moderne, car ce dernier aime « dénoncer » à tout va, dont dénoncer ses propres dogmes ayant pris un autre visage ; quand l’antimoderne seul peut assumer les contradictions de son paradigme culturel : si le progrès moral ou culturel est un dogme, non seulement on ne regarde plus de haut les autres cultures mais aussi son propre passé et la grandeur des civilisations historiques, mais on peut même se payer le luxe de discuter des valeurs et des idées dans leur caractère éternel et non plus indexées à la religion de l’époque. C’est pourquoi, les bigots modernes, ces bonnes femmes moralisantes et dégoulinantes du Bien (qui sont bien sûr tout autant des hommes) leur tombent souvent dessus pour critiquer moralement leurs œuvres.
Finissons avec la parole du maître :
« Celui qui a suffisamment étudié cette triste nature, sait que l’homme en général [c’est-à-dire l’homme de Rousseau et des déclarations de l’homme], s’il est réduit à lui-même, est trop méchant pour être libre. »6
D. Le système affectif de l’Antimoderne : que les idées sont peut-être affaire d’une certaine complexion
Les Antimodernes se plaisent à un certain tempérament moral : ils vitupèrent avec style, ils désespèrent et font de leur pessimisme moral une esthétique supérieure (l’esthétique du sublime, relève Antoine Compagnon), ils provoquent intellectuellement en faisant encore parler avec fécondité des concepts hérétiques comme le péché originel. Ce qui est certain, c’est qu’à bien les lire, si tant est qu’on puisse enlever ses lunettes de modernes (geste intellectuel de décentrement culturel d’une grande difficulté), un jour se lève en soi, cette lumière, c’est celle de la réflexivité face à son époque et à sa propre religion morale et ontologique, mais aussi face à la force de l’histoire humaine toute entière. L’antimoderne, in fine, est bien le moderne en liberté selon le mot d’Antoine Compagnon, celui qui pense véritablement et ne fait pas que répéter et gueuler avec le troupeau, que ce troupeau soit le logiciel moderne ou le désormais troupeau du logiciel contraire. La postface d’A. Compagnon est la clef, mais l’introduction l’était déjà : l’antimoderne est ambivalent, il pense véritablement, il se trompe véritablement ; il n’est ni le moderne, ni son strict envers, et il peut redevenir moderne s’il faut concrètement rappeler le gain moderne de la liberté et de la tolérance. A nouveaux frais, toujours penser. « Malheur à moi ! je suis nuance. », écrivait Nietzsche dans Ecce Homo, est aussi une clef philologique, non seulement des antimodernes, mais aussi du livre d’Antoine Compagnon.
« Le vrai contre-révolutionnaire a connu l’ivresse de la Révolution. (…). Les antimodernes ne sont pas n’importe quels adversaires du moderne, mais bien les penseurs du moderne, ses théoriciens. » 7
Ce que montre magistralement A. Compagnon, c’est que les Antimodernes sont les véritables penseurs de la modernité ; non seulement ils en sont les enfants, mais ils en sont la conscience réflexive : des enfants ingrats mais lucides, des enfants qui épousent d’abord la cause de leurs parents, pleinement attachés à eux dans cet amour quasi mystique qu’est celui du tout-petit, avant d’ouvrir leurs yeux propres déçus qu’ils sont du crépuscule de leurs idoles et de leurs mensonges. C’est en croyant faire leur bien qu’on leur répète chaque jour que des fadaises, comme tous les contes en narrent, existent8. La chair du Christ pend sur la croix et le sacrifice des têtes aristocrates décapitées à la chaine n’a pas métamorphosé la chair concrète en chair idéale. Le Bien n’a jamais commis que les pires atrocités, il enferme dans des camps et censure tout autant qu’il soit chrétien ou démocrate. La démocratie n’a pas rencontré un peuple de dieux et ses refoulés viennent sans cesse nous hanter sous la figure des populismes et des curés modernes. « Qui veut faire l’ange fait la bête », prévenait Pascal, le chrétien le plus augustinien et le plus moderne en même temps – l’essence de l’ambivalence moderne se révèle chez Pascal : naturalisant tout le monde humain, révélant la nécessité du mal inscrit dans l’égoïsme naturel du Moi (de l’intérêt à la vanité), Pascal maintient l’exigence d’une transcendance, celle-ci ne peut être que radicalement séparée du mondain. Le geste moderne par excellence… La conversion de l’antimoderne est douloureuse, l’Idéal se jette dans le spleen, dans le mal, dans l’ennui, dans le pathétique et la réalité. Le moderne devient antimoderne pour sauver l’idéal, il devient à la fois conscience de lui-même et des apories structurelles de la Modernité. Il est le seul à pouvoir la penser, la tragédie ou le drame se nouant en ce que la meute des modernes, au lieu d’en prendre acte et de penser, veut la lui boucler. La censure, comme la moralisation des débats et des arts par ceux qui ne savent pas penser, est aussi ironiquement une constante dans l’histoire des idées qu’aucun progrès ne saurait éradiquer.
L’antimoderne ne peut être qu’un converti à partir du moderne : s’il veut être cohérent, il lui faut avoir vécu les apories et savoir que désormais revenir en arrière n’est pas souhaitable. « Je plaide une cause où tout se tournerait de nouveau contre moi, si elle triomphait », admettait Chateaubriand. C’est que l’antimoderne prend le ton de la vitupération mais ne plaide aucune cause en réalité, il est le miroir réflexif de l’époque, sa vocation n’est pas de s’engager dans la réalité. Il sait bien ce que l’engagement des écrivains et des artistes veut dire : l’arrêt de la pensée contemplative et du miroir, l’acceptation de s’aveugler pour que le Bien advienne9. Il assume qu’écrire c’est déclarer : je ne sais plus vivre, ma pensée ne peut plus devenir action, ma pensée ne veut plus rien, alors plutôt que de se tourner sur elle-même, elle sera miroir. L’antimoderne sait que son discours n’est pas un appel véritablement réactionnaire, c’est une réaction qui n’entraine pas un monde, mais qui entraine un ralentissement et une conscience de ce que les forces idéelles et matérielles de l’histoire en marche portent en elle de conséquences sur ce que nous sommes, notre ethos, nos mentalités et nos mœurs, notre métaphysique et nos croyances. En un mot, l’antimoderne est une figure de la conscience de soi, et ses effets sont ceux d’un ralentisseur et d’un appel, espérons-le, à la Politique c’est-à-dire au pouvoir des hommes de faire aussi l’histoire et de n’en être pas simplement le produit ou pire l’idiot utile.
Conclusion
Antoine Compagnon cite Roland Barthes :
« Barthes déclarait en 1971 que son vœu était de se situer à l’arrière-garde de l’avant-garde, et il précisait aussitôt le sens de cette proposition équivoque : […] être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort ; être d’arrière-garde, c’est l’aimer encore. »
La souffrance esthétique et morale de l’antimoderne, dite ici en peu de mots, est le contraire d’une posture, elle est la conscience de notre condition moderne fort concrète et quotidienne.
Poursuivons avec Burke dans ses Réflexions sur la révolution de France écrites en 1790 (p. 200) qu’Antoine Compagnon cite :
« On n’est pas réduit à la simple alternative entre la destruction absolue ou la conservation en l’état. … Je ne puis concevoir comment des hommes peuvent en arriver à ce degré de présomption qui leur fait considérer leur pays comme une simple carte blanche où ils peuvent griffonner à plaisir. Libre au théoricien tout baigné de bons sentiments de souhaiter que la société à laquelle il appartient soit faite autrement qu’elle ne l’est, mais le bon patriote et le vrai politique cherchera toujours à tirer le meilleur parti des matériaux existants. S’il me fallait définir les qualités essentielles de l’homme d’État, je dirais qu’il associe à un naturel conservateur le talent d’améliorer. En dehors de cela, tout est pauvre dans la conception et dangereux dans la réalisation. » 10
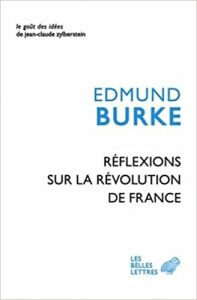
Si nous prenons l’espace de cette longue citation pour conclure, c’est qu’elle condense certes la définition du bon politique mais aussi de l’antimoderne ambivalent et véritable moderne. L’antimoderne n’est pas le tranchant réactionnaire qui inverse la figure du moderne et en a la sensibilité tout autant outrée, il n’est pas le tranquille conservateur entérinant idéologiquement ses intérêts de classe et ses intérêts de confort psychologique idéel. Encore moins est-il le demi-habile moderne qui, fat et présomptueux, croit que ses bonnes idées et ses bons sentiments peuvent constituer un projet politique et anthropologique et peuvent faire table rase du passé et de l’altérité, sans voir les raisons véritables des effets maudits. En bref, l’Antimoderne assume les contradictions du réel, de notre affectivité, du rapport de nos idées au réel, et il espère avec Brunetière :
« Croyons fermement avec lui [avec Schopenhaueur] que la vie est mauvaise ; et ainsi nous l’améliorerons ».
La gaya scienza, à nouveau frais…
- Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne, Équateurs, 2013
- Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005, réed. Folio essais, 2016
- Ibid., pp. 23-24.
- Ibid., introduction, page 15. La citation provient de Les Idées politiques de la France de Thibaudet, p. 32 dans l’édition citée
- « les antimodernes, ce sont des modernes en liberté », p. 19
- Joseph de Maistre, Du pape, in Textes choisis, p. 153
- A. Compagnon, op. cit., p.24
- La souffrance morale et métaphysique de l’antimoderne naît de l’échec des promesses de la modernité. Car l’antimoderne est souvent un converti : il a d’abord voulu, comme Baudelaire et Chateaubriand, sauver les hommes, il a d’abord voulu croire en eux, voulu se battre pour eux physiquement ou intellectuellement, voulu mener des révolutions et des communes, voulu éduquer les peuples et leur expliquer leur bien. Alors, il est déçu : le mal existe et la corruption est générale !
- L’antimoderne, c’est l’anti-écrivain engagé, le monde ne l’intéresse plus, les effets concrets des belles idées tout comme les actions réelles des belles âmes le convainquent chaque jour plus qu’il faut bien plutôt se désengager et n’être que miroir contemplatif voire épistémique.
- Ibid., p. 63








