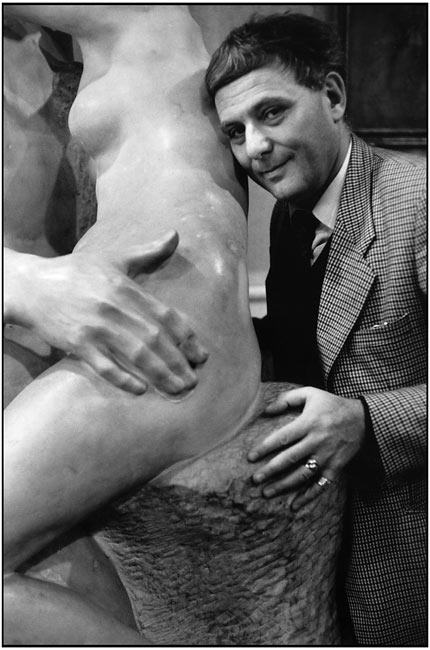Introduction : qu’y a-t-il de réellement philosophique chez Sollers ?
Philippe Sollers, infatigable contempteur des « philosophes », à ses yeux trop sérieux et trop tristes, vient de se voir néanmoins dédier un recueil d’une collection philosophique aux PUF dirigé par Anne Deneys-Tunney1. Il n’est pas évident, de prime abord, qu’un débat d’ordre philosophique puisse réellement se mettre en place autour d’un romancier peu prompt à aborder avec bienveillance les philosophes – exceptions faites de Nietzsche et d’un certain Heidegger, celui qui écrase la complexité du monde sous le terme « planétaire » – ou qui ne les aborde que sous l’angle d’un certain stylisme. Plus étonnant encore, dans son introduction, l’éditrice ne semble pas percevoir l’étonnement qu’il peut y avoir face à cette introduction de Sollers dans un cadre philosophique et prévient plutôt les accusations de l’ère du temps contre Sollers lui-même : Sollers, dit-on, serait misogyne, réactionnaire, convenu, autant d’accusations graves qu’il convient très vite de déminer en montrant qu’on sait que toutes ces attaques existent : « Marginal ou au centre ? Infâme misogyne ou libérateur de l’amour ? D’avant-garde ou réactionnaire ? Vulgaire ou raffiné à l’extrême ? Scandaleux ou convenu ? »2 Bien évidemment, ces précautions d’usage disparaîtront bien rapidement et il sera admis que Sollers est subversif – donc sauvé –, et il ne sera plus jamais question des questions purement rhétoriques de l’introduction ; dès la page 13, le Sollers scandaleux est exalté et salué dans son écriture : « C’est peut-être cela le premier scandale de l’œuvre de Sollers. D’avoir osé affirmer dans la construction et l’écriture de ses romans que l’œuvre ne provient jamais du sujet créateur « pur » – d’un individu isolé, artiste unique – mais bien au contraire de son ouverture au monde et à l’histoire d’une certaine tradition ; que celui qui parle, parle toujours ou écrit toujours à travers et à partir d’autres textes (…). »3
Si donc dimension philosophique il y a, elle se situera dans l’illustration de l’impossibilité du sujet législateur que mettra en scène l’écriture, le sujet écrivant n’étant jamais pleinement maître de son écrit, celui-ci charriant force traditions et autres textes dans son geste même. Mais il apparaît aussitôt, à peine a-t-on présenté cette lutte sollersienne contre le sujet maître de soi et transparent à soi, que surgit le spectre du Sollers « réactionnaire », c’est-à-dire tout simplement attaché à la tradition : chez ce dernier, l’instrument de la subversion n’est autre que la tradition, la mise à mort du sujet par la littérature n’est jamais qu’un moyen pour que prime la sédimentation des grands textes sur la fiction de l’auteur démiurge absolu et esseulé. Le passé est toujours là, et bien aveugle serait celui qui croirait s’en affranchir en constituant un point de rupture radical. Il est dommage que ce paradoxe fondé sur l’exaltation d’une tradition littéraire prenant valeur subversive ne soit absolument pas perçu par l’éditrice qui en reste à la seule dimension subversive, ne voyant pas bien que celle-ci procède de celle-là. En d’autres termes, Anne Deneys-Tunney considère que se jouent avec le registre de la citation ou de la tradition d’un côté et celui de la subversion de l’autre deux moments différents, ce qu’elle appelle un « mode double »4 alors qu’il est absolument indubitable que s’opère chez Sollers un mode simple où l’éclatement du sujet n’est jamais que l’effet de la tradition présente sous forme intertextuelle, tradition qui lui vaut précisément de fréquentes accusations à l’encontre de sa prétendue réaction.
A : La question de la vie
Une des thématiques récurrentes de ce recueil n’est autre que celle de la vie : l’écriture de l’auteur, la rapidité, son style parfois oral ancrent son œuvre dans ce que beaucoup des auteurs appellent la « vie » et déclinent selon différents modes. L’écriture chez Sollers, explique ainsi l’éditrice, « est comme branchée directement sur la vie, dans la vie : l’art, la pensée, la vie (ce que Philippe Sollers appelle « l’art de vivre »). »5 Cette vie, ici curieusement définie par l’art, la pensée et… la vie, résulte sans aucun doute de la rapidité de son écriture, de son rythme, qui n’est pourtant pas nervosité mais vivacité. De la même manière, Philippe Forest reprend cette thématique pour penser la manière dont l’œuvre se pense elle-même : « L’œuvre littéraire devient à elle-même son propre objet, de telle sorte qu’elle expose le drame de cette situation mentale d’où procède la fiction même de la vie. »6 L’idée de Forest est intéressante en ceci que, prenant acte de cette insertion de l’œuvre dans la vie, il en déduit que la vie elle-même s’apparente à la fiction : l’œuvre ne se peut inscrire dans la vie qu’à la condition de faire de la vie une œuvre elle-même et de renoncer à la saisir comme pure objectivité. S’inscrire dans la vie, c’est déjà construire cette dernière, s’insérer dans ce que nous en faisons et non dans un milieu qui s’impose à nous. Cela peut être rattaché à la notion de tradition littéraire par laquelle le choix des grands textes – grands textes précisément utilisables car toujours vivants – décide de notre rapport à cette vie que nous recréons.

C’est sans doute l’éditrice qui tire avec le plus de clarté les conséquences de ce rapport à la vie dans ce qui est à n’en pas douter le meilleur article du recueil avec celui de Roland Barthes – en tout cas du point de vue philosophique –, à savoir l’entretien que lui accorde Sollers : il faut montrer, affirme celui-ci, que la vie elle-même se déroule comme un roman. « A partir du moment où on a pris une certaine forme de perception, un certain angle, la vie devient romanesque. Il ne s’agit pas d’écrire des romans sans vivre. Il faut vivre les romans qu’on écrit. »7 Ainsi se crée une certaine continuité entre la vie et le roman lui-même, Sollers ayant toujours critiqué la position de retrait du romancier qui ne surgit fugacement que lorsque paraît son livre : chez l’auteur de Paradis, au contraire, écrire, c’est montrer la viabilité de ce que l’on écrit, donc se montrer, paraître comme étant un personnage de son propre roman et non comme un lointain et mystérieux démiurge8.
C’est sans doute ce que comprit de manière très précoce Roland Barthes dont l’un des articles consacrés à Sollers se trouve reproduit à la fin du recueil : Barthes considère que Sollers a révélé la dimension suspecte de la phrase, et l’a fort logiquement déconstruite ; mais la valeur de l’article de Barthes réside bien moins dans ce qui pourrait n’être qu’une énième forme d’éloge de la subversion du langage que dans la révélation du critère face auquel la phrase se trouve marquée de suspicion : elle n’est suspecte que face à ce que Barthes appelle « la parole vivante » : « De l’absence de ponctuation, on induit une absence de phrases. Et c’est vrai ; on commence à entrevoir la signification suspecte de la Phrase, c’est-à-dire : qu’elle est un artefact linguistique ; qu’il n’est pas sûr que dans la parole vivante il y ait des phrases (…). »9 C’est donc bien la parole comme vie qui impose une certaine relativisation de bien des modes de discours dont surgit soudainement toute l’artificialité, toute la mise en scène et ce alors même qu’ils se prétendent représentatifs de l’être. En doutant de la phrase, Sollers rétablit ainsi les droits de la vie, de la parole comme vitalité, face au travail parfois compassé de la représentation.
On pourra toutefois regretter que ces belles analyses n’aient pas donné lieu à l’un des paradoxes réels de l’œuvre de Sollers à savoir ce rapport à l’oralité qui semble en permanence rétablir les droits de la voix comme lieu par excellence de la vie, qui se détermine au moment précis où se forme l’aventure Tel Quel et où Jacques Derrida, participant à celle-ci, tente au contraire de faire de l’oralité le lieu de l’illusion par excellence de la clôture du sens et de la maîtrise de ce dernier. Sans doute eût-il été bon, dans un recueil qui se veut philosophique, de ménager une place aux rapports étonnants des textes sollersiens et derridiens, partageant la même aventure mais défendant des thèses parfois étonnamment distinctes.
B : La guerre des sexes : le sexe comme savoir
Outre le sujet et la vie, l’autre thème éminemment philosophique charrié par Sollers nous semble être la question de la guerre des sexes : à l’instar de la lutte des classes chez Marx, elle structure tout rapport humain et, contrairement à la lutte des classes ne peut ni ne doit se résorber dans une abolition des sexes. Il y a de l’irréductible chez Sollers, de l’indesconstructible également, et ce n’est autre que la différence sexuelle, ce qu’exprime fort bien l’éditrice à partir d’une analyse du Secret qui « raconte l’odyssée du sujet masculin dans ses rapports au sexe, à la langue, à la voix, toutes choses qui constituent, au sein de la lutte des sexes qu’il dit indépassable, comme une utopie des sexes. »10 Sans doute avons-nous là le thème le plus important de son œuvre, le plus abouti, le plus pensé, le plus décisif.
Cette importance de la guerre des sexes fait du sexe le lieu par excellence du savoir puisque c’est en lui que se révèle la vérité des rapports humains. Le sexe est, chez Sollers, savoir et révélation, mais savoir qui semble se jouer d’abord du côté masculin : ce sont des femmes – et non la femme, concept par trop écrasant que récuse Sollers, et qui explique que l’un de ses plus grands romans se soit appelé Femmes et non Les femmes – qui apprennent à des hommes ce qu’il y a à savoir et non des hommes qui présentent à des femmes une quelconque trace de connaissance ; prenant le contre-pied parfait d’un Raymond Abellio pour lequel les femmes manquaient le temps, Sollers considère à l’inverse que ce sont des femmes qui apprennent à des hommes le sens du temps – ce que magnifie un de ses derniers romans, les voyageurs du temps, sorte de méditation gnosticisante autour de femmes, du temps, et de la déchéance mondaine – et ce que confirme l’éditrice : le savoir des femmes consiste « dans la révélation d’un autre rapport possible au temps. »11 Mais il s’agit là d’une sexualité apprivoisée, maîtrisée, et non du sexe comme tel : en dépit de scènes presque pornographiques qui jalonnent ses romans, Sollers révèle en creux le fait que si le sexe est savoir, il est aussi néant : la grande affaire de la sexualité, c’est son manque de sérieux, aime à répéter Sollers. Dès lors, la révélation du temps qui se joue dans le sexe est peut-être – c’est là une hypothèse qui ne figure pas dans le recueil – la découverte de la fin de l’urgence, la possibilité d’un pur otium sexuel où l’on ne ferait l’amour que pour jouir de la possibilité de la futilité, de la soustraction à tout assujettissement de l’urgence ou de l’imminence : une sexualité sans but – c’est-à-dire sans subordination à la procréation ni à la jouissance comme telle – mais comme moyen d’éprouver une dilatation du temps, voilà peut-être le sens ultime de la sexualité sollersienne.
Hélas, si la sexualité peut révéler cette dilatation du temps, la réalité demeure celle de la guerre des sexes, laquelle éveille rien moins que les passions les plus médiocres de l’Homme. Sollers précise, dans l’entretien, ce qu’il entend par cette guerre : « C’est une réalité, indépassable. Sauf si on sait se servir de la guerre pour utiliser la force de l’adversaire et que ça tourne à autre chose qu’au ressentiment et à l’esprit de vengeance. Au fond, c’est très ennuyeux la guerre des sexes : c’est ce qu’elles disent. »12 C’est peut-être dans ce genre de phrases que certains peuvent être agacés par Sollers car cela revient très exactement à affirmer que si la guerre des sexes est une donnée presque nécessaire de l’ensemble de l’humanité, seuls quelques êtres singuliers – dont Sollers évidemment – parviennent à tourner cette guerre en art chinois, en utilisation de la force de l’autre à son propre profit, c’est-à-dire en connaissance. Il y a un côté to the happy few chez Sollers qui se présente toujours – la vie poursuit le roman ou l’inverse… – comme celui qui a compris et expérimenté ce que la plèbe peine à comprendre ; si celle-ci devra se contenter de la guerre stérile et pétrie de ressentiment, lui et quelques autres auront su s’élever à la révélation du savoir caché dans le sexe.
C : Pourquoi le recueil déçoit
L’idée de départ de ce recueil était bonne, mais le résultat est, dans l’ensemble, plutôt décevant et ce à plusieurs égards. D’abord, la dimension philosophique des articles est très peu présente et bien des articles ne soulèvent aucune question philosophique ou, pire encore, ne font rien de philosophique à partir du matériau textuel qu’ils analysent. La notion de sujet aurait gagné à être bien davantage creusée, tout comme eût été sans doute indispensable un article consacré aux rapports de Sollers à Derrida. D’autre part, il y a parfois une sensation étrange voulant que l’on cherche à meubler le recueil : pas moins de trois articles d’Anne Deneys-Tunney structurent l’ensemble, soit presque la moitié (3 / 8), auxquels s’ajoute l’article de Roland Barthes qui est une reprise. Par conséquent, outre l’éditrice, seuls quatre contributeurs actuels ont accepté d’y écrire et cela confère à l’ensemble une impression poussive, comme si le projet n’avait guère convaincu.
Outre ces manques, ne figure aucune forme de questionnement quant au statut de ce recueil : Sollers a toujours pris soin de prétendre que s’il se montrait, c’était pour se mieux dissimuler. Dans de telles conditions, ne faudrait-il pas interroger ce que signifie obtenir un entretien de la part de Sollers, l’entretien étant le lieu par excellence du dévoilement, et donc pour Sollers de la dissimulation ? Peut-être même faudrait-il aller plus loin : que vaut la parole d’un homme qui prétend occulter ce qu’il est en se montrant ? Aucune interrogation de ce genre n’encadre l’entretien mené comme s’il allait de soi qu’en lui se révélait quelque vérité sollersienne. En d’autres termes, l’esprit même sollersien se révèle singulièrement absent de la façon même dont est conçue la possibilité de dire ou d’écrire quelque chose de vrai à l’égard de l’auteur étudié, et cela pose de graves problèmes méthodologiques et logiques.
Enfin, et c’est peut-être là le regret majeur, l’entretien, quoiqu’intéressant en tant que Sollers y affirme ses thèses, est assez mal mené : les réponses très courtes de Sollers ne constituent jamais l’occasion pour Deneys-Tunney de rebondir ou de demander des précisions, ce qui eût été appréciable compte-tenu du fait que Sollers développe toujours très peu sa propre pensée et en reste à de vagues allusions. Parfois, certaines contradictions ou nuances eussent même été nécessaires, comme après ce passage où Sollers commente la première phrase de Femmes, essentialisant les femmes au mépris de toutes ses mises en garde quant à ce genre de pratiques : « C’est très biblique, d’une certaine façon. Donc automatiquement on tombe sur le problème de la reproduction de l’espèce et du moment clé qui s’est produit dans la dernière phase du XXè siècle, dont je témoigne à longueur de temps. Je suis le seul à le faire. Il n’y a pas un seul romancier capable de dire ce que signifie la prise en main par la technique du continent féminin. Comme c’est étrange. Vous voyez bien que tous les préjugés remontent au XIXè siècle. Je suis le seul romancier, en somme, qui décrit l’arraisonnement de la substance féminine par la technique. C’est-à-dire finalement la fabrication du corps humain qui commence à ce moment-là, et qui est maintenant en croissance exponentielle ; on en sera bientôt à l’utérus artificiel. Je suis le seul à avoir mis l’accent sur ce qui est essentiel pour la grande majorité des femmes. »13 Ce genre d’affirmations mériterait à tout le moins que l’on s’y arrête, que l’on évalue réellement aussi bien le fait que Sollers soit le seul à avoir compris cela, ce qui suppose une grande connaissance du roman contemporain, et que la « substance féminine » soit réellement arraisonnée par la technique. Or, de tout cela, il n’est guère question dans l’entretien qui n’est qu’acquiescement et confirmation, subordination et, le cas échéant, contrition.
Conclusion : une bonne idée qui s’avère décevante
En dépit de quelques articles livrant çà et là une ou deux clés de l’œuvre de Sollers, et malgré l’excellente analyse de Barthes quoique limitée aux premiers romans et, en particulier, à H, on est donc un peu déçu à la fin de la lecture de cet ouvrage ; beaucoup de louanges, peu de recul, manque de distance, insuffisance philosophique constituent la trame générale du recueil et ne sont pas à la hauteur de l’œuvre qu’ils prétendent étudier. Peut-être touchons-nous là du doigt aussi ce qui grève tout rapport à Sollers depuis plusieurs décennies déjà, à savoir ce détestable choix binaire entre la révérence dévote d’un Gérard de Cortanze et l’accusation excessive d’un Naulleau revanchard. L’analyse rationnelle et dépassionnée de l’œuvre sollersienne n’est pas encore venue.
- Anne Deneys-Tunney, Philippe Sollers ou l’impatience de la pensée, PUF, coll. débats philosophiques, 2011
- Anne Deneys-Tunney, « Philippe Sollers ou l’hybris du dire. Vers l’œuvre totale », in Anne Deneys-Tunney, Philippe Sollers ou l’impatience de la pensée, op. cit., p. 11
- Ibid. pp. 13-14
- Ibid. p. 17
- Ibid. p. 26
- Philippe Forest, « Quelques tableaux pour une exposition », in Philippe Sollers, op. cit., p. 39
- « Entretien avec Philippe Sollers », in Ibid, p. 168
- On sait combien Sollers aime à railler les figures presque saintes de Modiano et Le Clézio n’apparaissant sous forme de « processions » chez Gallimard que lorsque paraissent leurs derniers ouvrages et redisparaissant aussitôt comme si l’auteur des romans se devait d’être spectral pour être respectable.
- Roland Barthes, « Par-dessus l’épaule », in Ibid., p. 199
- « Philippe Sollers ou l’hybris du dire », art. cit. p. 24
- « Philippe Sollers et le XVIIIème siècle », in Ibid., p. 137
- p. 176
- pp. 164-165