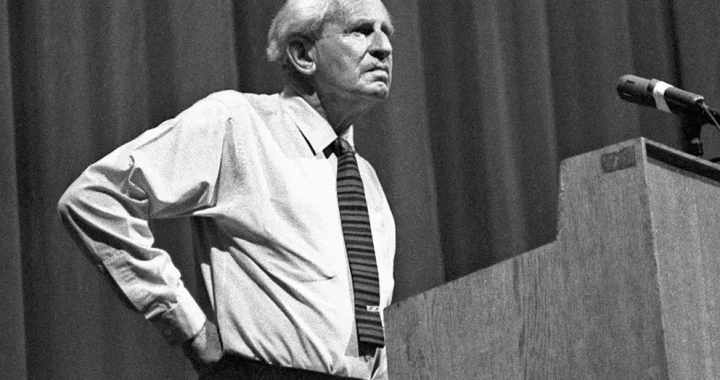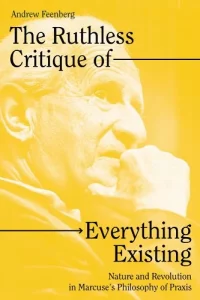 Le philosophe Andrew Feenberg est connu dans le domaine francophone pour la traduction de son livre Philosophie de la praxis : Marx, Lukács et l’École de Francfort[1]. Il prolonge aujourd’hui ses réflexions à travers un autre ouvrage qui vient de paraître en anglais : The Ruthless Critique of Everything Existing. Nature and Revolution in Marcuse’s Philosophy of Praxis. Ce nouveau texte est consacré à la pensée de Herbert Marcuse, dont il a fait la connaissance en tant qu’élève en 1965, alors que le philosophe était professeur à l’University of California de San Diego. L’ouvrage se veut alors profondément personnel, et Andrew Feenberg mêle des anecdotes avec son ancien professeur à des analyses poussées de sa pensée.
Le philosophe Andrew Feenberg est connu dans le domaine francophone pour la traduction de son livre Philosophie de la praxis : Marx, Lukács et l’École de Francfort[1]. Il prolonge aujourd’hui ses réflexions à travers un autre ouvrage qui vient de paraître en anglais : The Ruthless Critique of Everything Existing. Nature and Revolution in Marcuse’s Philosophy of Praxis. Ce nouveau texte est consacré à la pensée de Herbert Marcuse, dont il a fait la connaissance en tant qu’élève en 1965, alors que le philosophe était professeur à l’University of California de San Diego. L’ouvrage se veut alors profondément personnel, et Andrew Feenberg mêle des anecdotes avec son ancien professeur à des analyses poussées de sa pensée.
L’ensemble peut se lire comme une introduction à l’ensemble de l’œuvre de Marcuse, puisqu’il discute aussi bien les premiers textes sur Hegel, Marx et Heidegger, que les œuvres d’après-guerre qui l’ont fait connaître au grand public : Éros et civilisation (1955) et L’homme unidimensionnel (1964). Mais plus qu’une introduction, le livre d’Andrew Feenberg se veut une actualisation de la pensée de Marcuse dans le contexte de la crise écologique. Feenberg rappelle ainsi que Marcuse, dans les années 1970, a consacré quelques textes au mouvement écologiste naissant[2], et qu’il reste utile aujourd’hui pour penser la problématique environnementale dans la perspective d’une théorie critique de la société.
Une philosophie de la pratique
L’interprétation que le jeune Marcuse, dès les années 1930, donne de Marx et de Hegel doit beaucoup à Heidegger, et plus précisément au concept de monde, tel qu’il est développé dans Être et temps (1827). L’ontologie heideggérienne permet de penser l’existence comme une relation au monde qui fait sens. Le monde n’est pas pour nous un ensemble de choses juxtaposées les unes à côté des autres, et qui s’articulent entre elles selon un pur rapport causal. Le monde est l’objet d’une intention concrète qui n’est pas purement théorique, mais pratique : un « souci » qui donne une signification aux choses et qui rend notre existence inséparable de cette objectivité investie de sens et d’activité. Dans la perspective du jeune Marx des Manuscrits de 1844, ce rapport au monde repose sur les besoins humains et sur leur exigence de satisfaction. Le travail devient alors l’activité principale par laquelle l’existence, individuellement et collectivement, est mise en relation avec le monde, lui-même compris comme « nature » : l’exigence de satisfaire les besoins vitaux de l’existence implique une transformation pratique de la nature qui n’est autre que le travail. Tel est le sens de la philosophie de la praxis du jeune Marx, selon Marcuse.
L’être humain et la nature, unis par le besoin et la satisfaction obtenue par le travail, sont maintenant la forme concrète de la « vraie » unité du sujet et de l’objet. (p. 37)
Comme l’explique Feenberg, la théorie jeune marxienne de l’aliénation constitue une perturbation de ce rapport pratique au monde : l’aliénation marque une séparation du travailleur par rapport à la nature, elle désigne une scission par laquelle l’existence ne parvient plus à se reconnaître dans les produits de son travail, parce que ceux-ci ne lui appartiennent pas et parce qu’elle ne parvient plus à satisfaire ses besoins. Toute la relecture de Hegel à laquelle Marcuse se livre dans sa thèse – L’ontologie de Hegel et la théorie de l’historicité, initialement dirigée par Heidegger – cherche à comprendre les fondements ontologiques d’un dépassement de cet état d’aliénation. C’est le concept de possibilité réelle qui, chez Hegel, permet cela.
Par différence avec la possibilité logique, qui recouvre tout ce qui est pensable et qui peut facilement tomber dans les rêves utopiques, la possibilité réelle s’enracine dans l’état de choses existant : elle désigne ce qui, ici et maintenant, dans une société donnée, est réalisable. Dans une perspective marxiste, la possibilité réelle renvoie aux conditions existantes qui pourraient satisfaire les besoins et qui pourtant ne sont pas mises en œuvre. Selon Marcuse, les sociétés capitalistes ne satisfont pas les besoins de l’humanité, mais elles auraient les moyens de le faire et de supprimer l’état d’aliénation qu’elles engendrent. Là est la contradiction qui se loge au cœur du système capitaliste – interdire le bonheur qui est pourtant à portée de main – et qui exige sa négation.
Andrew Feenberg n’esquive pas la difficulté que pose la définition des besoins. Car si la critique du capitalisme doit être menée depuis le point de vue des possibilités réelles de la satisfaction des besoins, alors la question qui ne manque pas de se poser est celle de la détermination des besoins légitimes à partir desquelles cette critique peut être conduite. Feenberg souligne que l’appropriation de la psychanalyse freudienne par Marcuse, notamment dans Éros et civilisation, lui permet de penser la sublimation des besoins primaires en désirs (d’art, de connaissance, de religion, de politique…). Cette élaboration culturelle des besoins ne résout cependant pas le problème, il l’aggrave même, en montrant que ce ne sont pas uniquement les besoins primaires liés à la survie qui constitue la base d’une critique des sociétés capitalistes. Finalement, comme l’admet Feenberg, c’est aux luttes sociales qu’il revient de déterminer les besoins légitimes sur lesquels s’appuie la critique sociale. On admettra certes le caractère insatisfaisant d’une telle réponse, mais il faut aussi reconnaître son mérite : la prise en compte de la dimension sociale et historique dans la détermination des besoins.
Un rapport esthétique à la nature
Cette philosophie de la praxis, centrée sur la satisfaction des besoins humains par le travail, n’est-elle pas synonyme d’une dévalorisation de la nature non humaine et d’un recentrement exclusif sur l’humain ? La grande force de l’analyse d’Andrew Feenberg consiste à montrer qu’il n’en est rien. Il est certain que, par le travail, les hommes se rapportent à la nature pour satisfaire leurs besoins. Mais à ce constat il faut ajouter trois choses.
D’une part, c’est en tant que vivant que les hommes se rapportent à la nature qu’ils travaillent, ils appartiennent donc eux-mêmes à la nature qu’ils transforment. D’autre part, s’il est vrai qu’ils travaillent la nature non humaine pour se satisfaire, alors cela signifie qu’ils ne peuvent exister sans la nature et que toute domination excessive de celle-ci (destruction, épuisement des ressources, pollution, perturbation des équilibres écosystémiques de la planète) s’avère indissociable de conséquences néfastes pour les êtres humains eux-mêmes. Enfin, l’élaboration des besoins en désirs sublimés (c’est l’apport de Freud) introduit une pluralité de rapports à la nature et rend notamment possible une relation esthétique, dans laquelle c’est la beauté, et non l’usage de la nature, qui devient prépondérante. Le rapport esthétique au monde devient ainsi le moyen d’une véritable libération de la nature.
La beauté artistique joue maintenant un nouveau rôle. Elle n’est plus limitée à un domaine séparé d’idéaux irréalistes, sans conséquences pour le monde réel. Bien plutôt, ses idéalisations consistent en la saisie imaginative des potentialités qui peuvent orienter les pratiques techniques (p. 176).
C’est notamment cette dimension esthétique que Marcuse met en avant dans ces textes sur l’écologie des années 1970, car elle permet de comprendre comment la nature peut à la fois être respectée pour elle-même et satisfaire nos besoins (en l’occurrence le besoin esthétique). S’il y a là assurément un thème romantique – ce que ne nie pas Feenberg –, on aurait tort de limiter Marcuse à cet aspect. Sa philosophie accorde une place essentielle à l’esthétique, mais elle ne valorise pas la posture de l’esthète. L’émotion ressentie face à la beauté de la nature constitue un cas particulier de non-instrumentalisation qui dessine un horizon normatif pour inventer un nouveau rapport à la nature en général. Tout le potentiel écologique de la pensée de Herbert Marcuse se situe dans cette exigence de réinvention, qui consiste moins à esthétiser l’ensemble de nos relations au monde qu’à se servir de l’expérience esthétique pour modifier les autres rapports pratiques à la nature. Mais comment comprendre cette réinvention ?
La critique de la raison instrumentale
 La dimension esthétique est tout à fait fondamentale, aux yeux de Marcuse, pour inventer un autre rapport à la nature que celui instauré par la raison instrumentale. Comme l’avaient déjà souligné Adorno et Horkheimer dans La dialectique de la raison (1944), la raison instrumentale ne se contente pas de soumettre les êtres de la nature à la finalité humaine : par la science et par la technique, elle construit une vision du monde adéquate au capitalisme en abordant les objets uniquement du point de vue de leurs relations abstraites (quantitatives et causales). Marcuse retient de l’ouvrage Histoire et conscience de classe (1923) de Georg Lukács l’idée d’une proximité très forte entre la science moderne et la soumission de toute chose au principe de l’échange des marchandises : c’est un même monde qui, d’une part, a vidé le monde de ses qualités pour ne plus connaître que des équations mathématiques et des relations causales, et, d’autre part, qui a réduit l’ensemble des êtres à l’abstraction marchande. Telle que la présente Andrew Feenberg de manière convaincante, l’intérêt de cette thèse – pour excessive qu’elle soit, à bien des égards – est néanmoins de réinscrire la technique et la science dans les rapports de pouvoir de nos sociétés capitalistes modernes. La technique, pas plus que la science, ne sont des activités neutres : ce sont des pratiques sociales qui, comme toutes les autres, ont une fonction à jouer dans les rapports de domination.
La dimension esthétique est tout à fait fondamentale, aux yeux de Marcuse, pour inventer un autre rapport à la nature que celui instauré par la raison instrumentale. Comme l’avaient déjà souligné Adorno et Horkheimer dans La dialectique de la raison (1944), la raison instrumentale ne se contente pas de soumettre les êtres de la nature à la finalité humaine : par la science et par la technique, elle construit une vision du monde adéquate au capitalisme en abordant les objets uniquement du point de vue de leurs relations abstraites (quantitatives et causales). Marcuse retient de l’ouvrage Histoire et conscience de classe (1923) de Georg Lukács l’idée d’une proximité très forte entre la science moderne et la soumission de toute chose au principe de l’échange des marchandises : c’est un même monde qui, d’une part, a vidé le monde de ses qualités pour ne plus connaître que des équations mathématiques et des relations causales, et, d’autre part, qui a réduit l’ensemble des êtres à l’abstraction marchande. Telle que la présente Andrew Feenberg de manière convaincante, l’intérêt de cette thèse – pour excessive qu’elle soit, à bien des égards – est néanmoins de réinscrire la technique et la science dans les rapports de pouvoir de nos sociétés capitalistes modernes. La technique, pas plus que la science, ne sont des activités neutres : ce sont des pratiques sociales qui, comme toutes les autres, ont une fonction à jouer dans les rapports de domination.
Le mérite du livre d’Andrew Feenberg tient notamment aux deux concepts de nature que la conception marcusienne de la raison instrumentale lui permet de mettre au jour : la nature en tant qu’elle fait l’objet d’une expérience riche de significations (le « monde » de Heidegger) ; la nature comme objet des sciences, qui apparaît en rupture avec l’expérience et qui trouve son prolongement dans les technologies qui dominent les naturalités humaines et non humaines. C’est depuis l’expérience concrète de la nature qu’une transformation du rapport aux êtres naturels peut se jouer, puisque cette expérience, conformément à ce qu’a montré la philosophie de la praxis, comprend la vie humaine comme étant indissociable de la vie de la nature. Loin de devoir être opposée à la vision scientifique et technique de la nature, Feenberg montre ainsi que cette expérience peut être une ressource pour la faire évoluer.
Il n’y a pas de retour possible à la nature, mais il est peut-être possible d’aller vers elle. Cela exigerait une transformation de la forme de rationalité qui préside aux médiations technologiques, c’est pourquoi Marcuse en appelle à un nouveau concept de raison. (p. 167)
Ainsi, loin d’en appeler à un retour à une nature sauvage, désinvestie de toute action humaine, c’est à une modification profonde des sciences et des techniques que nous invite Marcuse. D’après Andrew Feenberg, c’est précisément ce qui est en jeu dans la question environnementale actuellement : des sciences et des techniques qui lient la connaissance et la vie, qui ne conçoivent plus seulement la nature comme un objet à connaître, mais comme un monde à habiter. On comprend ainsi, à lire The Ruthless Critique of Everything Existing, que nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un rapport à la nature qui n’est plus celui de la raison instrumentale et qui libère en même temps les humains et les non-humains.
***
[1] A. Feenberg, Philosophie de la praxis : Marx, Lukács et l’École de Francfort, Montéral, Lux, 2016.
[2] Les lectrices et lecteurs français pourront lire H. Marcuse, « L’écologie et la critique de la société moderne » (1979), in Sommes-nous déjà des hommes ? Théorie critique et émancipation, tr. fr. F. Ollier, Alboussière, Archives du futur, 2018, p. 343-357 ; et les textes rassemblés par C. Fourel et C. Ruault dans « Écologie et révolution », pacifier l’existence. André Gorz/Herbert Marcuse : un dialogue critique, Paris, Les Petits matins, 2022.