Introduction
Après un premier livre sur Renan[1] puis sur Mallarmé[2], André Stanguennec propose un troisième ouvrage pour les éditions Honoré Champion qui reprend à nouveau l’œuvre de Mallarmé, mais dans une féconde évaluation réciproque avec Novalis. Cette mise à l’épreuve propose de remonter aux principes mêmes des pôles créatifs des deux poètes, de reconstituer leurs projets déclarés ainsi que d’éprouver leurs concrétisations respectives dans les thématiques abordées par leurs poésies. Ce n’est donc pas une simple comparaison ou juxtaposition de motifs communs ou opposés entre ces auteurs : Stanguennec tente un dialogue interprétatif transversal qui confronte de façon systématique leurs inspirations et aspirations respectives pour les évaluer ; car il s’agit dans cet ouvrage d’instaurer la richesse d’un dialogue poétique concret – selon une croissance simultanée – afin de créer une « intersubjectivité imaginaire dont l’interprète prend le risque » (p. 12).
L’enjeu n’est pas donc pas d’assimiler Novalis à Mallarmé ou inversement, dans la mesure où la langue et le contexte les séparent irrémédiablement ; ni même de les opposer outrancièrement, puisqu’on ne sait même pas si Mallarmé a pu lire Novalis. Il ne s’agit pas d’un ouvrage où l’on s’enlise dans de marécageuses élucubrations psychanalytiques, où l’on part vers les examens géologico-sociologiques conditionnant la pétrification indistincte d’une œuvre dans une époque ossifiée, où toute forme de génie est mesurée selon l’énoncé de journal, assimilé à un petit effet de surface ; ce n’est pas là non plus l’interminable relevé statistique minutieux, daté, des propositions relatives et autres comparaisons d’occurrences d’un auteur à l’autre, mais bien le questionnement conceptuel vivant propre à leurs œuvres dont le jaillissement, la conflagration et l’aboutissement sont présentés significativement avec brio par Stanguennec.
Ainsi, d’une façon générale, le problème que se posent à leur manière Novalis et Mallarmé se rapporte plus ou moins directement aux termes du projet lié à l’accomplissement du romantisme. Est-ce celui du Werther du jeune Goethe ? celui décrit par Walter Benjamin dans Romantisme et critique de la civilisation ? ou de l’Absolu littéraire analysé par Nancy et Lacoue-Labarthe ? En cela, l’ouvrage ne tranche pas explicitement, mais donne tout de même de solides éléments pour ne pas réduire le romantisme de Novalis à une inauguration enthousiaste mystique en réaction contre le protestantisme, et celui de Mallarmé à un geste d’abandon plus ou moins amer qui se refuse cependant au positivisme.
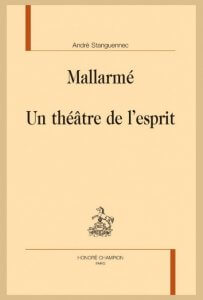
Le cœur de la confrontation se joue donc au niveau du type de vision poétique créé et offerte : si le poète est un être fini, peut-il prétendre à une vue et un langage de la Totalité qui dépasse et en même temps rend raison de sa condition ? Là où Novalis annonce que «… lorsque dans les contes et les poésies On apprendra l’histoire des cosmogonies, C’est là que s’enfuira devant un mot secret Le contresens entier de la réalité » (Hymnes) comme résolution du divin et de l’humain dans un embrasement sacré, Mallarmé prône le respect d’un mystère sans foi, symbole qui veut dépasser « l’accablante sensation de fini » tout en « se séparant du temps indéfini » en acceptant de demeurer fictif ; ne reste alors selon Mallarmé, qu’une sorte de création poétique qui constate : « de l’Infini se séparent et les constellations et la mer, demeurées, en l’extériorité, de réciproques néants, pour en laisser l’essence, à l’heure unie, faire le présent absolu des choses. » (Igitur). Au final, du mysticisme solitaire de Novalis chantant qu’« Un petit nombre seulement Sait le mystère de l’amour, Eprouve l’insatisfaction Et la soif éternelle », à l’athéisme républicain de Mallarmé, de l’espoir de rédemption gnostique à l’ennui des angoisses agnostiques, l’expression poétique s’offre chez tous deux sous cette même augure d’une menace, du « risque de tomber pendant l’éternité ».
Ce livre se compose donc en deux parties : la première est consacrée au contexte général dans lequel se développèrent les œuvres de Novalis et Mallarmé, et plus précisément à la question de savoir selon quels langages poétiques ils s’exprimèrent. La seconde partie s’intéresse aux thématiques principales qui animèrent ces œuvres : l’amour, la mort, la religion chrétienne et la politique. En cela, dans cet ordre thématique, on peut dire que l’organisation de la deuxième partie l’ouvrage est majoritairement tributaire de Novalis plus que de Mallarmé dans la mesure où, selon Stanguennec, « le rêve, l’amour, la mort elle-même, <sont chez Novalis> telles expériences extatiques qui nouent le passage réciproque ou l’interaction entre l’esprit et la nature » (p 70). Mais cette partie reste cependant très équilibrée et analyse avec autant de soin les deux auteurs.
- Première partie : contexte historique et langage poétique
Dans quel contexte apparaissent les œuvres de Novalis et Mallarmé ? Si évidemment ces œuvres ne sont pas réductibles à une époque, et ne sont pas qu’une réponse aux préoccupations de celles-ci, elles ont cependant constitué une part de leurs langages, de leurs valeurs et donc de leurs tensions vers l’excellence de l’Art à travers elle. Le contexte politique oppose fortement Novalis à Mallarmé : quand le premier milite pour la « réinstauration d’une relation d’amour religieux entre le souverain et ses sujets » (p. 17), Mallarmé, agnostique et de conviction républicaine, sera un « critique attentif à l’écart entre le républicanisme (…) et leur trahison dans les pratiques sociales bourgeoises » (Ibid.). Mais, bien que pour des motifs et des raisons très différents, tous deux ressentent cependant une crise globale : Novalis avec celle du Protestantisme qui a « brisé un Tout indéfectible, divisé l’indivisible Eglise et criminellement arrachés de l’universelle communion chrétienne et dans laquelle seule pouvait se faire la renaissance authentique et durable » (p. 17). Et du côté de Mallarmé, la fin du XIXème siècle n’est plus préoccupée, selon Stanguennec, par une Raison métaphysique dont on critique l’impuissance (p.18) ; ce qui est en jeu est bien plutôt la raison positiviste qui acquiert d’autant plus de puissance qu’elle se détourne de tout Absolu et méprise les dogmes et pratiques catholique.
De ces différentes fractures, Stanguennec résume leurs manières respectives de produire leurs œuvres : « tandis que Novalis irait de l’épistémologique au poétique, Mallarmé irait plutôt du poétique à l’épistémologique » (p. 19), mais avec ce souci commun et constant à travers leurs travaux de réunifier les divorces respectifs de l’expérience sacrée et des données scientifiques ; même si, chez Mallarmé cela prend la simple forme d’un « « Soi » immanent à la réalité humaine et naturelle » (ibid.), mais avec toujours ce souci d’une recherche d’autonomie de l’Art dans l’interprétation du réel à travers ses scissions (p. 22).
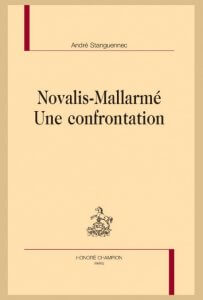
Ainsi donc, si l’enjeu est de réconcilier ces crises, ou du moins, d’apercevoir et de diagnostiquer ces scissions pour y remédier par un type de production poétique, selon quels pouvoirs le langage peut-il chez Novalis et chez Mallarmé prétendre pour se mettre à l’œuvre ?
Novalis considère, selon Stanguennec, que le langage est une totalité vivante, qui, comme tout organisme, ne vise qu’à se développer et à se mouvoir par soi, à jouer de soi en toute autonomie : « le propre du langage, à savoir qu’il n’est tout uniment occupé que de soi-même, tous l’ignorent » (p. 23). Aussi, le langage poétique de Novalis est-il d’emblée, non point seulement autoréférentiel comme un simple jeu d’osselet, mais « tautégorique » (p. 24), dans une symbolisation qui se désigne et lie concrètement sa réalité créée, évoquée et invoquée par la réflexivité même du mot poétiquement prononcé : la poésie de Novalis a pour but de libérer cette charge en la disant et en la développant dans l’articulation de cette force propre au langage qu’il faut déplier : c’est alors que peut se réaliser la romantisation dont « la formule (logos du logos) renvoie à la réflexion en quelque sorte transcendantale du langage sur lui-même en vue d’expliciter ses plus originaires conditions de possibilité » (p. 24).
On voit là évidemment la principale différence entre Novalis et Mallarmé : pour ce dernier, la contingence des liens entre sons et sens est devenue une simple nécessité d’usage (p. 38), mais c’est aussi là un aspect du « hasard » que Mallarmé va chercher à exploiter, à régler en calculant ses chances jusqu’à l’abolir. Le langage n’est donc plus vivant mais cependant, il joue en lui-même dans sa constitution – « le langage se réfléchissant » – et la poésie de Mallarmé cherche en ce sens, une certaine originelléité de la langue, les soubresauts de son éclosion, car, « à toute la nature apparentée et se rapprochant ainsi de l’organisme dépositaire de la vie, le Mot présente, dans ses voyelles et ses diphntongues, comme une chair ; et dans ses consonnes, comme une ossature délicate à disséquer » (p. 39). Selon Stanguennec, Mallarmé postule par fiction que l’on peut trouver une langue originelle (p. 39), quand Novalis réalise ce geste de retour en réfléchissant les enjeux originaires de la langue même pour retrouver « l’unité originelle dans la Nature » (p. 26).
En cela, Novalis se reporte directement – selon Stanguennec – à Leibniz chez qui « l’âme imite dans son département et dans son petit monde où il lui est permis de s’exercer, ce que Dieu a fait dans le grand » (p. 27). Ceci posé, le but est donc de parvenir ou tendre vers la synthèse suprême du logique et de l’imaginatif par le poétique, ou d’effectuer « l’unité de l’entendement et de l’imagination » (p. 29). Mais, paradoxalement, Novalis ne croit qu’à une expérience jamais vraiment réalisée, toujours en suspens, et c’est pourquoi cette unité jamais atteinte ne peut être qu’aperçue originairement et approchée : d’où, selon Stanguennec, sa reprise leibnizienne de l’analyse combinatoire et du calcul infinitésimal : ce sont deux modes d’expression convergentes de l’ « âme du monde » qu’il s’agit de « mixer » par une activité performative, poético-philosophique. (p. 31). Mais Novalis conçoit la Création comme une Chute de Dieu, une déchéance, et en cela il n’est pas réductible à Leibniz, car « la nature est une ville pétrifiée » (fragment 65 III), même si certaines de ses parties ou quartiers sont appelées à revivre (p. 33).
Dans cette convocation des mathématiques commune aux deux poètes, Stanguennec note ici cette différence capitale : Mallarmé s’intéresse davantage aux analogies du calcul qui probabilise les réussites ou les échecs, mais dans un monde rêvé en évolution permanente (p. 45), alors que Novalis ne fait que constater une sorte de Kénose du Monde dont les calculs combinatoires ne font que compter les faillites ou émergences avortées. Cependant, comme l’origine latine que son nom d’auteur indique, Novalis a encore espoir de les faire revivre par la culture du langage, car s’il est réellement ce sol divin déchu, même si « le sol est pauvre : il faut que nous semions richement pour n’avoir que de minces moissons qu’importe, tant qu’une seule éclot » écrit-il en exergue de l’Athenaüm en 1798 (p. 35). Même si sa perspective reste très chrétienne, Novalis avait lu Les dieux de la Grèce de Schiller (1788) : il y avait trouvé l’expression de la nostalgie de l’unité sacrée à présent perdue, et la tension vers un renouvellement de la visée d’une unité à venir dont l’Art serait l’organe (p. 79). Novalis estime que les fragments, à la manière de « grains de pollen » symboliques, ont, en raison de leurs caractères condensés et énigmatiques, les meilleures chances de féconder l’esprit du lecteur ; tandis que, dans un tout autre registre, Mallarmé est d’avis qu’une sorte de calcul de probabilités appliqués aux formes, rythmes et rimes des vers, peut assurer une maîtrise savante des effets de sons et de significations (p. 49). En cela, Mallarmé reste fidèle à son maître Edgar Poe pour qui « tout hasard doit être banni de l’œuvre moderne et n’y peut être que feint » (p. 49). Mais pour quelle raison autre que la perfection de l’artifice artistique ?
Là-dessus, Stanguennec résume les ambiguïtés de Mallarmé : si l’on en croit la relation entre Mallarmé et René Ghil, le premier aurait déclaré au second : « Non, Ghil, l’on ne peut pas se passer d’Eden ! » (p. 44). Et cependant, cette conservation du paradis n’est pas celle d’un rêve ou d’un espoir de retrouver par la poésie un Originel sacré ; et si Mallarmé sera obsédé par le calcul des probabilités avec sa préférence physique au « jet » des atomes, ces « dés » de la création éternelle restent une pure fiction – tout comme l’Eden -, et le jet « jouée » des mots poétiques n’est qu’une suite du pro-jet des formes essayées ou « stérilisées » (p. 48) qui accepte la rupture épistémologique entre les domaines : « La Terminaison de toutes les branches du savoir humain a dépouillé, au commencement du siècle, son vieil aspect occulte ; et les termes de l’alchimie se virent remplacés par ceux de la chimie, la cabale ne prêtant plus une de ses formules aux mathématiques. Tout cela eut lieu simultanément » (p. 36).
Ici, au-delà de l’énorme différence avec Novalis, Stanguennec tente une explication de Mallarmé sous les auspices du kantisme : le résidu d’Eden mythique serait pour Mallarmé une sorte de nécessaire focus imaginarius, « le Tout absolu de la transposition poétique est en effet projeté « pour étaler la pièce principale ou rien ». Ce besoin est celui de viser et de signifier en Idée le Tout qui n’est rien, c’est-à-dire aucune « des choses si elles s’établissaient solides et prépondérantes », mais qui n’est pas « rien du tout » (p. 55). Ainsi, même s’il y a rupture épistémologique, il peut y avoir encore quelques échos ou affinités entre l’évolution de la Nature et les formes de l’esprit, donc une traduction possible par le langage poétique. Là encore, la différence d’orientation est patente : « elle est tautégorique et mystiquement fusionnel chez Novalis tandis qu’il reste fictif comme symbole allégorique et critique chez Mallarmé, à la manière du « tout se passe comme si » » (p. 59). Mallarmé passe directement, si l’on peut dire, de l’aveu métaphysiquement agnostique à l’usage substitutif du symbole fictionnel, pure création humaine, sans prétendre pouvoir bénéficier du relais de l’extase (p. 60-61).
On l’aura compris si l’on suit Stanguennec, Mallarmé ne cherche pas la mystique mais une simple auto-critique prudente et consciente du caractère éminemment « re-présentatif » (allégorique) du symbole (p. 81), alors que Novalis veut une poésie qui interprète des signes inscrits dans la nature (p. 78) : « Cette grande écriture chiffrée qu’on rencontre partout dans les limailles qui entourent l’aimant et dans les étranges conjonctions du hasard. On y pressent la clef de cette écriture singulière et sa grammaire… l’art fait partie de la nature et il est la nature qui se contemple, s’imite et se forme elle-même… » écrit-il dans Les disciples à Saïs (p. 76). Vis-à-vis de l’interprétation criticiste de Mallarmé « qui n’entend rien aux arts magiques », le poète est au sens de Novalis, « le magicien », c’est-à-dire le poète unifiant science pratique et religion de la nature. Il exprime donc avant tout un corps naturel spiritualisé ou, selon un ordre inverse, un esprit naturellement incarné (p. 79).
Stanguennec s’engage à partir de là dans de savantes comparaisons avec Spinoza, Fichte et Bergson pour expliquer le mysticisme de Novalis et sa mécanique, son système, toujours par contraste avec Mallarmé qui lui, envisage de créer un symbolisme propre. Encore une fois, il ne s’agit pas de pénétrer le sens du Monde par une intuition affective-sensible et de la mettre en une forme idéale (selon le mode romantique) ; il ne s’agit pas d’avantage de s’en tenir aux signes abstraits des notions scientifiques et philosophiques qui s’enseignent et que l’on doit apprendre (ce n’est pas un rationalisme dogmatique) ; en fait, pour Mallarmé, il s’agit plutôt de conférer à ces notions – qui débouchent toutes sur la seule pensée d’une Idée d’Absolu inconnaissable – de symboliser cette idée et chaque notion dépendante d’elle en la sensibilisant par un emprunt aux images particulières du monde. Il s’agit de jouir des notions mais non de les épouser (p. 83). Mais Mallarmé n’en reste cependant pas à un dandysme de collection facile : « la poésie consistant à créer, il faut prendre dans l’âme humaine des états, des lueurs d’une pureté si absolue que, bien chantés et bien mis en lumière, cela constitue en effet les joyaux de l’homme : là, il y a symbole, il y a création et le mot poésie a ici son sens : c’est en somme la seule création humaine possible » (p. 85). Malgré tout, là où Novalis appelait à la fusion tout autant que l’extase mystique corps et âme, on ne peut ici s’empêcher de considérer par contraste la poésie de Mallarmé comme un égotisme, dans la mesure où il déclare lui-même : « la divinité qui jamais n’est que Soi » (p. 86)
- Deuxième partie : les expériences ou correspondances thématiques
- L’amour
Comme indiqué en introduction, ces expériences sont les moments clés, les lieux privilégiés, les climax respectifs où, selon Stanguennec, vont se jouer la rencontre ou la bifurcation entre l’esprit et la nature, où se produiront donc l’expression poétique même lors de leurs évocations, évocations qui, comme nous l’avons vu précédemment, ne seront donc pas de simples désignations, mais pour Novalis, le mode mystique fusionnel du langage tautégorique, et pour Mallarmé, le jeu d’un retour originel fictif sans hasard possible, ou bien encore la conversion du Hasard en Nécessité.
Aussi, quand il est question d’amour, plutôt que d’éliminer le hasard, le projet philosophique et poétique de Novalis fut selon Stanguennec « de multiplier les cas de collisions, d’entrechoquer les singularités et de provoquer des rencontres accidentelle » (p. 98). En remontant poétiquement aux paroxysmes de la division, origine de l’amour comme reconnaissance de la différence, l’unité mythique d’origine se révèle de façon dialectique chez Novalis, enrichie de ce que la séparation des savoirs a pu apporter de connaissances nouvelles (p. 105) : alors la bien-aimée se révèle élue parce qu’une en l’Un que l’on rejoint par l’amour, et alors, « Ma bien-aimée est l’abrégé de l’univers, et l’univers est le prolongement de ma bien-aimée » (p. 99). Stanguennec commente ainsi : « c’est bien l’expérience d’une véritable religion des âmes qui se construit, unissant l’âme de Novalis à l’âme du monde par l’intermédiaire de l’âme de Sophie : « j’ai de la religion pour Sophie, pas de l’amour. Un amour absolu, indépendant du cœur, fondé sur la foi, est religion » » (p. 102).
Si l’amour chez Novalis procède d’une unité religieuse, l’athéisme de Mallarmé rend bien évidemment cette question et cette expérience plus complexe, et ce d’autant plus qu’il cherchera moins une union que ce que Stanguennec appelle « la conquête d’un équilibre entre trois instances séparées, la mystérieuse Dame-Nature ou la Notion en pensée, l’épouse (Marie) et l’amante (Méry) » (p. 107), en plus du spectre de son jeune fils Anatole décédé prématurément. A l’inverse, dans cette expérience, Mallarmé n’est cependant pas scientiste puisque sa négation de la transcendance divine engage une réflexion de type néokantienne sur les limites de sa condition, donc de ses capacités à aimer. Ainsi, Mallarmé reconstitue une unité formelle selon Stanguennec où « le soi de l’âme aimante et de la femme aimée (ou la déesse Nature) ne font qu’un ou sont deux dimensions d’un Même » (p. 125). L’amour trouve alors la focale organisatrice de la connaissance et du monde, non pas comme objet absolu, mais Idée régulatrice des concepts inconditionnés. Comme l’écrira Mallarmé, « j’y crois et il faut qu’il n’en existe rien pour que je l’étreigne et y croie totalement » (cité p. 133). L’amour apparaît donc dans une sorte d’artifice nihiliste, Mallarmé renonçant à l’extase mystique dans son projet de poésie critique, à jamais distanciée d’une intuition pénétrante de l’Absolu (p. 136) toujours plus lointain en tout, tout en jouissant de jouissances fantomatiques.
2. La mort
L’amour de Novalis pour la jeune Sophie fut brutalement interrompu par le décès prématuré de celle-ci. Stanguennec commente ainsi : « Sophie fut consciente de sa mort et, grâce à l’amour de Novalis, en opéra la transfiguration pensée dans l’universalité d’une religion de la transcendance, avant de mourir. Le très jeune Anatole Mallarmé, au contraire, ne fut jamais conscient de sa mort, que lui cachèrent aussi bien sa mère que son père. Et, du point de vue de l’exigence d’une transfiguration, Mallarmé, en tant que qu’homme du discours et de la conscience de l’universel, souffre de n’avoir pu éclairer son enfant sur le sens pensé de sa mort, ce qu’il aurait sans doute fait » (p. 149)
Si pour Novalis « la mort est transformation – suppression du principe individuel – qui établit à présent une nouvelle liaison, plus solide et de meilleure qualité » (p. 143), il y a tout de même quelques éléments de rapprochement chez Mallarmé, notamment en lisant Igitur dont le suicide – lequel était pour Novalis « le commencement réel et le début de toute philosophie » (p. 144) – signifie bien la mort du moi empirique réel au bénéfice du Soi pur impersonnel producteur de l’Idée ou Fiction : il est « moi projeté absolu » (p. 157) ; ce n’est évidemment pas une vision de la mort novalisienne qui fusionne, mais il y a tout de même selon Stanguennec une même forme de réconciliation de l’universel et du particulier justifiant un rapprochement entre la romantisation qui articule le fini à la totalité avec Mallarmé (p. 153). Là-dessus, nous regrettons quelque peu l’absence de reprise ou de convocation critique de Walter Benjamin et de son livre mentionné en introduction, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand ; nous aurions beaucoup aimé connaître l’interprétation de Stanguennec, notamment à propos de la distinction entre la réflexion de fichtéenne d’avec celle de Novalis : « l’infinité de la réflexion revendiquée par les romantiques puise son caractère propre : la dissolution, face à l’Absolu, de la forme de la réflexion. La réflexion s’élargit sans limite et la pensée formée dans la réflexion devient une pensée sans forme qui se tourne vers l’Absolu » (p. 63).
3.La religion
Dans cette optique de la romantisation, même si les différences sont évidentes comme on l’a déjà vu plusieurs fois, il est possible, selon Stanguennec, de repenser le problème de la religion chez les deux auteurs par un rapprochement, certes prudent, mais selon des éléments essentiels. Car la visée mallarméenne du « Livre total » permet à la poésie d’opérer la synthèse de la religion – culte d’une « divinité » créatrice, sacrée mais finie, comme en témoigne son livre Les dieux antiques – et des savoirs de la nature (comme production évolutive de formes disant le devenir et le jeu finalement « entropique » de cette divinité immanente). « Cette synthèse confirme que la comptabilité, selon le poète français, du « positif » et de l’ « orphique », en une relation de réflexion autocritique dans l’écriture de cette nouvelle visée » (p. 191). Stanguennec voit ici une nouvelle correspondance avec cette « poésie universelle progressive » exigée par les romantiques allemands. Jamais achevée, la synthèse mallarméenne, comme la synthèse romantique, est toujours à reprendre, et l’on sait que, mis à part l’ultime poème cosmogonique, « Le coup de dé », sorte de « fragment exécuté », Mallarmé ne laissera qu’un monceau de « Notes en vue du Livre » au milieu desquelles il relève qu’ « un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant » (p. 191). C’est en tant qu’échec que l’œuvre fragmentaire de Mallarmé deviendrait en quelque sorte fragment novalisien, lequel n’était d’ailleurs pas loin du « Livre total », ou du moins, en avait les prétentions : « mon livre doit devenir une Bible scientifique – un modèle réel et idéal – et un germe de tous les livres » (p. 163).
La forme fragmentaire n’est donc pas une simple stylisation de la pensée, mais l’annonce religieuse qui se doit de « marquer par lui l’écart entre la partie réelle et le tout idéal que l’on vise, de marquer aussi la rupture avec le modèle de la belle continuité du livre classique sur le mode narratif de la ligne refermée avec nécessité » (p. 178). La différence étant que Mallarmé ne croit plus aux effets moraux du Livre, c’est tout au plus un ultime accomplissement culturel dont il relève trois phases dans la beauté, si l’on en croit ce qu’il dit dans une lettre à Lefébure du 27 mai 1867 : « 1. Vénus de Phidias, unique et immuable 2. Beauté mordue au cœur par la chimère, mystère qui est condition de son être 3. Beauté de science de l’homme, beauté de Vénus retrouvée « ayant su l’idée du mystère dont la Joconde ne savait que la sensation fatale » (p. 186).
L’ultime thématique abordée par Stanguennec dans le quatrième chapitre concerne la politique, mais elle est à notre avis complètement tributaire et en grande partie réductible aux éléments déjà abordés dans la religion ; pour être exhaustif dans la confrontation, on y trouve un Novalis rêvant d’un patriotisme dont les principes sont la religiosité qui « mélange le monde divin et la vie » (p. 209), et un Mallarmé perdant peu à peu ses espoirs en une religion civile républicaine fondée par la poésie face à l’informe « foule démocratique » (p. 221 et p. 223).
Conclusion et perspectives critiques
Au terme de ce livre, alors même que le fourmillement de références aurait perdu ou noyé n’importe qui devant la convocation de ces deux géants de la pensée poétique que sont Novalis et Mallarmé, nous ne pouvons qu’admirer et saluer le délicat travail de synthèse effectué avec élégance et netteté par Stanguennec. La première partie du livre surtout est une superbe leçon qui met en lumière la singularité des intentions poétiques, sans céder au sociologisme ou psychologisme en vogue pour au contraire développer un propos sérieux aux raisonnements et conceptions clairs, solides et pédagogiques. Étant donné l’ampleur du projet et du corpus des deux auteurs, André Stanguennec a efficacement restreint son propos à leurs textes principalement critiques ; or, s’ils sont inhérents et structurellement constitutifs du projet romantique de Novalis (en tant que logos du logos, réflexion de la réflexion), on ressent une certaine distance quand ils sont extraits de Mallarmé. Pour pallier à celle-ci, Stanguennec a effectué quelques petites incursions dans le corpus poétique, sans pour autant s’engager sur ce trop vaste terrain de l’interprétation. Ce n’était pas l’objet de toute façon. Cet ouvrage n’est pas pour autant une simple introduction, mais une véritable initiation puisqu’il replace l’ensemble des projets poétiques dans leurs systèmes respectifs, et explicite cette organisation sans défigurer Novalis et Mallarmé ; aussi, cette articulation thématique est essentiellement une mise en perspective analysant leurs inspirations revendiquées.
De façon plus générale, on peut dire que ce livre est à la fois en deçà et au-delà d’ouvrages sur la poésie comme le Contre un Boileau de Philippe Beck, ou les débats entre François Leperlier avec Destination de la poésie et Pierre Vinclair avec Prise de vers : quand certains de ces livres se perdent parfois dans l’amalgame de synonymes et d’images ou les vapeurs d’incantations de l’irréalisé, la solidité critique et conceptuelle de l’ouvrage de Stanguennec permet donc, dans un second temps, une interprétation des œuvres strictement poétiques et des enjeux de la création en Poésie, justement parce que ce propos nous a cultivé pour apprécier pleinement la poésie de Novalis et Mallarmé.
Dans une époque de renonciation générale, qui prend plaisir à thématiser celle-ci ou à la déplacer avec cynisme, lire ici le souvenir vivant d’une poésie affrontant les enjeux supérieurs de l’Absolu est enthousiasmant et salvateur, tant la poésie et la philosophie sont actuellement ravalées soit au rang de distractions dispensables, soit au prétexte d’érudition académique. Et après la lecture de ce livre de Stanguennec, nous ne pouvons-nous empêcher de penser que nous sommes toujours avec Novalis et Mallarmé face à certains dilemmes énoncés par Horkheimer : « … Reconnaître que la pensée est limitée, ce n’est pas poser des domaines dans lesquels il faudrait s’abstenir de s’en servir : ce point de vue du positivisme est en réalité lui-même contradictoire. Le fait que nous ne savons pas tout ne signifie nullement que ce que nous savons soit l’inessentiel, et que l’essentiel soit ce que nous ne savons pas.
Ces sophismes, au moyen desquels le positivisme a consciemment fait la paix avec la superstition et déclaré la guerre au matérialisme, font apparaître la dévalorisation de la pensée théorique par Bergson et le développement de l’intuitionnisme métaphysique moderne comme la conséquence du positivisme (…) Le matérialisme, lui non plus, ne croit pas que les problèmes de la vie soient résolus par la seule théorie ; mais il lui paraît tout aussi impensable que « le sens de la vie » puisse devenir « clair au terme d’un doute prolongé » Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6. 521)[3]… »
Autrement dit, quelle pensée promettent et engagent Novalis et Mallarmé ? Si l’on a lu Stanguennec, si l’on veut lire ensuite ces poètes comme une véritable pensée vivante à l’œuvre et non comme un petit délassement privé, nous ne pouvons pas réduire Novalis à un fanatisme superstitieux au spiritualisme bêtement syncrétiste ; nous ne pouvons pas non plus réduire Mallarmé à un progressisme platement positiviste : mais leurs fréquentations montrent les risques, les pôles et dérives possibles cartographiés à travers leurs Odyssée poétiques respectives dont Horkheimer nous semble résumer plus haut les enjeux.
L’Art poétique produit un monde, en ce sens qu’il fait voir, qu’il crée une ouverture vers la Totalité, indiquant ainsi une forme d’accomplissement. Le poète peut évidemment orienter cette ouverture à travers son expression selon qu’il appelle à constituer ou renoncer à cette vue de la Totalité. Ce que produit la poésie, c’est donc un langage mettant en jeu la vision de la Totalité : elle la produit par projection, comme lien et désignation extérieure ou propre à la Totalité, ou bien, produit un geste de renoncement à la Totalité. Cette vision par projection est l’Art poétique même dont le dépôt immédiat est généralement et historiquement une référence ou une construction mythique. Le mythe porte en lui la garantie et la destruction de la vision de la totalité exprimée poétiquement, que ce mythe soit d’ailleurs objet de foi ou pure fiction.
De Novalis à Mallarmé, est-ce que la Totalité qu’ils expriment comme langage poétique est une ouverture vers une Vue Absolue encore féconde ou bien le simple témoignage d’un sens de la vie ou de la civilisation irrémédiablement relative, finie, limitée et aux destinées supérieures à jamais perdues ? Nous pensons l’avoir compris avec Stanguennec : comme athée, Mallarmé va simuler l’Absolu (p. 110), jouir de ses échos culturels fictifs ou égarés ; Novalis va tenter de le pénétrer tout en pleurant l’unité mythique irrémédiablement perdue pour mieux espérer une régénérescence chrétienne jamais atteinte : dans les deux cas, le partiel reste, mais la poésie peut encore donner une certaine expérience du Tout, donc une valeur absolue. Elle n’est cependant plus exprimée en tant que Vue car elle est en définitive simplement crue ou postulée comme fictive ou à venir ; elle peut encore être expérimentée comme mystique, fusion inconnaissable, infinie incorporation chez Novalis, ou simple jeu imaginaire chez Mallarmé. Dans les deux cas, ils semblent éprouver l’infinie nostalgie d’un Absolu périmé qu’ils symbolisent avec acharnement selon différentes modalités. Mais peut-être que cette poésie n’est plus à lire que comme une simple discipline d’autolimitation, puisque, si l’on en croit Mallarmé, « le caractère essentiel de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de l’idée en soi ».
[1] André Stanguennec, Renan, de l’idéalisme au scepticisme, Paris, Champion, 2015.
[2] André Stanguennec, Mallarmé, un théâtre de l’esprit, Paris, Champion, 2017.
[3] Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, « Matérialisme et métaphysique », p. 129-132








