Les éditions Gallimard ont publié en poche, en folio-essais plus précisément, un cours d’Alain Finkielkraut dispensé à Polytechnique, intitulé Nous autres modernes1. Alain Finkielkraut y interroge ses principaux sujets de préoccupation, la démocratie et la démocratisation, la modernité et ses ravages, la technique, la techno-science, et la littérature.
I°) Objet et présupposés de l’ouvrage : la modernité historiale
Pour ceux qui en douteraient encore, ces cours témoignent d’un fait évident, mais pourtant mal interprété : l’auteur de prédilection pour Finkielkraut, ce n’est ni Levinas, ni Arendt, ni Péguy, c’est Heidegger. L’ensemble du cours repose très essentiellement sur une appréhension heideggérienne de l’histoire et de l’histoire des idées, de sorte que se trouve établie une correspondance parfois excessive entre un développement philosophique historial et son incidence sur la réalité historique qui lui est contemporaine. Tout se passe comme si, dans ce cours, le présupposé jamais établi comme tel était celui d’une histoire déployant un concept historial, comme si au fond l’histoire n’était jamais rien d’autre que la conséquence d’une idée philosophique donnée et aussitôt déployée dans l’être historique.
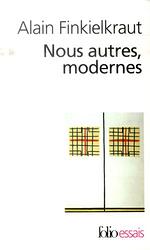
Ainsi, l’homme moderne comme processus historique trouverait son acte de naissance dans une pensée, chez Pic de la Mirandole pour être plus précis ; proposant une lecture très classique de Pic, Finkielkraut fait de ce dernier celui par lequel l’homme s’affranchit de l’hétéronomie, du divin et de la tradition : et s’affranchir de la tradition, telle est la modernité aux yeux de Finkielkraut. « Pic de la Mirandole met dans la bouche de Dieu une splendide déclaration d’indépendance humaine. »2 D’une certaine manière, tous les présupposés des cours que nous avons sous les yeux sont là : il semble suffire que Pic affirme un jour, dans un ouvrage remarquable, l’Oratio de hominis dignitate, l’autonomie humaine pour qu’aussitôt cela se traduise dans les faits et que voie le jour une nouvelle race humaine affranchie de ses chaînes et du poids de la tradition. Tout se passe au fond comme si, chez Finkielkraut, le pouvoir du dire était tel qu’il charriait avec lui l’évolution immédiate de l’être. Ainsi, « dire, comme le Dieu de Pic de la Mirandole, que l’homme est ontologiquement libre, c’est retirer, du même coup, tout fondement ontologique à la hiérarchie entre les êtres humains. (…) ce Dieu humaniste ne donne rien à personne ou plutôt il donne à tout le monde le rien, l’indétermination, la non-coïncidence avec sa place ou son rang social. »3 Mais rationnellement parlant, dire cela, ce n’est justement rien d’autre que poser une pensée, et l’on ne voit pas bien pourquoi l’affirmation de cette pensée devrait être aussitôt suivie de son application dans le réel.
Ce présupposé lourd, à savoir cette incidence presque immédiate du discours philosophique sur l’être historique hypothèque d’emblée la pertinence des cours, dont on peine à saisir l’objet : est-ce une histoire des idées, une histoire du monde, ou une ressaisie des idées à travers une histoire réduite à l’état de pantomime de la pensée ? Fondamentalement, nous aurions tendance à retenir la troisième possibilité, c’est-à-dire celle voulant que l’histoire ne soit jamais autre que le déploiement d’une pensée, de telle sorte que la compréhension d’une pensée permette la compréhension du développement historique en tant que ce dernier n’est autre que le déploiement de celle-là. Nous sommes en somme en permanence dans l’historial, c’est-à-dire dans l’événement de pensée par lequel il y a précisément histoire, et cette senteur heideggérienne, nous la retrouverons tout au long de ces cours consacrés à la modernité.
Initialement, le cours est conçu comme une vaste méditation tournant autour d’une remarque de 1977 de Roland Barthes déclarant : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne. » Et cette remarque devient l’occasion d’interroger le sens de la modernité, d’interroger la pertinence même de ce concept, mais, je le rappelle, avec en toile de fond une idéologie de l’historial si aiguë que l’histoire moderne ne pourra jamais être appréhendée que comme ce qui a été rendu possible par la pensée moderne, dans un processus causal et immédiat tout à fait problématique car jamais interrogé.
Cela étant, la thèse générale de Finkielkraut procède d’une tension entre la modernité et le passé ; être moderne, c’est au fond s’affranchir du passé, être un incessant et éternel commencement. « Le Moderne, écrit Finkielkraut, c’est celui à qui le passé pèse. »4 Cette définition du Moderne permet de comprendre rapidement que la Modernité n’est pas ce qui, aux yeux de Finkielkraut, constitue le summum du désirable : et la référence insistante à la déclaration de Barthes affirmant que l’être-moderne l’indiffère désormais tend implicitement vers le mot d’ordre, de sorte que le revirement barthésien est à interroger en tant que nous devons l’adopter, semble glisser Finkielkraut. L’histoire, pour le Moderne, c’est le lieu où le progrès est indéfiniment possible en tant qu’elle porte en elle la marche incessante de la Raison ; le passé devient en effet pesant en vertu de son retard dans l’ordre de marche de la raison, si bien qu’être moderne, c’est être en perpétuelle quête de l’avenir comme réalisation par principe et par essence préférable de la raison. Bref, le Moderne c’est la figure de l’ingrat que Finkielkraut avait édifiée dans un beau livre paru en 1999 5.
Cette dénonciation par Finkielkraut de la conception moderne de l’histoire, c’est-à-dire de l’histoire comme réalisation de la raison, ou pour le dire simplement, de l’histoire comme progrès nécessaire, permet d’éclairer un point qui pourrait être encore opaque : avoir comme présupposé l’idée selon laquelle l’histoire n’est que le déploiement de certaines idées, ce n’est pas penser que l’histoire incarne la marche de la raison : tout au contraire, la voie de l’historial qu’emprunte Finkielkraut consiste à penser l’histoire comme lieu de réalisation immédiate des idées, tout en remarquant que la réalisation historiale de ces idées ne saurait être confondue avec la réalisation de la raison : seul le Moderne croit que se confondent Histoire et développement rationnel, mais cette croyance du Moderne me semble désigner précisément ce que refuse Finkielkraut. De là cette impression de discontinu qui s’opère dans la description que fait l’auteur du déploiement historial : au lieu que la Raison se développe patiemment dans l’Histoire, il s’agit de repérer quelques dates clés où tout bascule, en vertu de la pensée de certaines personnes ou d’un événement idéologique précipitant le cours du monde. 1977 revêt de la sorte chez Finkielkraut le statut soudain d’un point d’inflexion : en 1977 tout change. Le modernisme n’est soudainement plus un impératif, et à ce dernier se substitue l’égalité des conditions comme impératif catégorique. 1977, c’est le moment où intervient la révolution démocratique, pensée en termes tocquevilliens.
II°) La révolution démocratique
La méthode de Finkielkraut est telle que tout paraît soudain dans ses analyses ; là où Tocqueville décrivait la lente maturation du procès démocratique, Finkielkraut isole des dates précises et en fait des points brutaux d’inflexion historique. 1977, par exemple, apparaît comme le moment charnière où se jouerait en France l’égalisation démocratique et l’inversion du modernisme. « Les Modernes naguère exaltaient les masses et dénigraient la culture de masse. »6 Naguère, cela signifie avant 1977. Les Modernes s’exaltaient de ce nouveau peuple, affranchi et massifié, et se méfiaient de la culture elle-même massifiée, y voyant une forme suprême de bêtise ; soudain, au nom de la révolution démocratique, la Modernité s’inverse : « La critique de la bêtise est ici renversée de l’élitisme : là où l’avant-garde voyait les ravages de l’aliénation, c’est le travail de taupe de la révolution démocratique qui s’impose au regard. »7 La révolution démocratique emporte avec elle la notion de culture véritable et impose la même culture pour tous, c’est-à-dire le degré zéro de l’élévation spirituelle. Il y a là une description menée avec bonheur de l’impératif moderne saisi dans son surgissement initial maintenant une certaine suspicion à l’encontre de la culture massifiée, et du rouleau compresseur démocratique, égalisant jusqu’aux savoirs des individus, promouvant la haine de la distinction. Là où la culture de masse était initialement pensée comme aliénation de l’individu, la révolution démocratique promeut l’égalisation à un point tel que toute culture authentique paraît authentiquement suspecte.
L’analyse est ici subtile car elle revient à dire que le projet même de la modernité porte en lui sa propre destruction : pour réaliser le dessein des modernes il faut être anti-moderne, telle semble être la conclusion de Finkielkraut. En d’autres termes, la fidélité au projet moderne originel impose le rejet de la modernité qui est la nôtre. « comment, lorsqu’on est attaché à la promesse moderne de ne laisser personne à la porte du monde hérité, ne pas être anti-moderne ? »8 Telle est la question que soulève l’auteur et qui ne saurait être évacuée aisément tant il est vrai que l’accomplissement de la modernité semble menacer la modernité elle-même. Cette question, qui demeure posée, ne reçoit pas vraiment de réponse ad hoc dans les cours, mais il est vrai que la logique de la pensée ici déployée suggère de développer un anti-modernisme pour sauver une certaine modernité c’est-à-dire pour sauver la démocratisation de l’héritage humaniste.
La deuxième partie de l’ouvrage s’appuie sur les analyses de Leo Strauss, particulièrement sur Le libéralisme antique et moderne afin de cerner le sens du libéralisme, d’une part, et de l’humanisme d’autre part. Le libéralisme, note Finkielkraut à la suite de Strauss – et de bien d’autres – a fortement évolué quant à sa signification, rappelant ainsi que jusqu’au XIXème siècle, liberaliter portait une valeur de contemplation désintéressée. Nous retrouvons là toutes les analyses de Strauss sur l’éducation contemplative libérale, et il est inutile de s’y appesantir. Vient ensuite la distinction de trois humanismes :
– un humanisme galiléo-cartésien qui progresse en révoquant la domination de l’erreur.
– Un humanisme classique, où l’on s’humanise par le contact avec les œuvres du passé.
– Un humanisme romantique substituant à la rationalité dévorante l’enracinement humain.
Il serait intéressant de confronter cette description des humanismes avec les analyses de Stéphane Toussaint, que nous avions présentées ici : https://actu-philosophia.com/spip.php?article21 et là : https://actu-philosophia.com/spip.php?article28 Mais au-delà de cette comparaison probablement féconde, il faut ici mesurer combien Finkielkraut s’avère heideggérien : l’humanisme galiléo-cartésien désigne au fond la technique comme accomplissement de l’essence de la métaphysique cartésienne, et il n’est pas rare de lire, dans les lignes consacrées au premier humanisme, que Descartes met fin à la considération de la poésie, comme si une œuvre intellectuelle décidait du sort immédiat de la réception de tout un art, et tout le discours sur le poème comme arrachant la Vérité au concept rationnel se trouve ici convoqué. Cela est prévisible, cela est décevant. Finkielkraut est plus convaincant lorsqu’il décrit la tension de la modernité comme celle de Descartes et Cervantès. Mais en réalité, au fur et à mesure que l’on progresse, la modernité semble de plus en plus fuyante : si clairement circonscrite par le refus du passé au début des cours, elle semble désormais agitée d’une tension technico-littéraire, dont on peine à comprendre le lien avec le rejet du passé.
Mais tout n’est pas si simple. Tout se passe comme si Finkielkraut essayait de créer une dialectique de la modernité tout en ayant toujours déjà décidé de favoriser l’un des deux termes. La modernité étant traversée par une tension, il est possible d’en sauver une partie. En outre, cette Modernité fuyante dont il cherche à recréer l’immanente tension semble ici appréhendée comme spécifique de notre époque contemporaine ; toutefois, si le concept même de Modernité est dialectique, la logique de Finkielkraut devrait affirmer la nécessaire équivocité de la modernité dans son déploiement historique si bien que l’on s’étonne de voir réservée l’équivocité à notre époque alors qu’elle est portée en son concept depuis les origines. C’est ce que Compagnon avait du reste relevé dans sa critique : « « La bataille des Modernes et des Modernes fait rage. » D’accord, sauf qu’il n’en a jamais été autrement et que le mot moderne, en français, a toujours été équivoque : moderne est le bourgeois qui croit au progrès, à la machine, et moderne est le poète – Baudelaire, dont Finkielkraut ne parle pas – qui résiste au progrès et se moque du bourgeois. Moderne est le bourgeois et moderne est l’antibourgeois, ou l’antimoderne. »9
III°) Limites et apories
Fondamentalement, Finkielkraut n’est pas un moderne au sens qu’il donne initialement à ce terme : nul plus que lui ne célèbre la grandeur du passé, sa beauté et sa nécessité ; il n’est qu’à regarder les titres de ses ouvrages pour s’en apercevoir : L’ingratitude, Le mécontemporain, La défaite de la pensée, La mémoire vaine, l’imparfait du présent, autant de titres déplorant l’ingratitude à l’égard du passé et posant l’insatisfaction générée par ce présent précisément ingrat ; l’avenir, quant à lui, est porteur de menaces. Le seul ouvrage dont le titre était implicitement un futur charriait le danger de l’antisémitisme : l’antisémitisme qui vient. Ainsi, il ne fait aucun doute que Finkielkraut est d’abord un conservateur au sens noble du terme et s’il cherche à sauver la modernité c’est pour en préserver l’héritage humaniste bien que cet héritage apparaisse comme trop révolutionnaire à ses yeux : la liberté affirmée par Pic fascine et effraye à la fois notre auteur.
Mais il y a plus : ce livre est totalement menacé par ses présupposés heideggériens. Pensant le concept pour comprendre l’histoire en tant que celle-là applique fidèlement celui-ci, Finkielkraut évacue néanmoins la référence à la raison universelle pour introduire la multiplicité des pensées. Fort bien. Mais de la multiplicité des concepts naissent plusieurs histoires, et cette multiplicité des histoires crée une superposition historique parfaitement déroutante : la modernité devient elle-même multiple – bien plus que dialectique – et l’on est comme confronté à un emboîtement de modernités, dont chacune contredit l’autre. Mais si l’on devrait logiquement se retrouver confronté à cet emboîtement de modernité, ce n’est pourtant pas ce que décrit Finkielkraut : la modernité se déploie chez lui sous forme linéaire, sans que cette linéarité ne soit celle du progrès rationnel. Autrement dit, ses présupposés entrent en contradiction avec ses analyses : lorsqu’il affirme, dans la quatrième partie, que le XXIème siècle sera de moins en moins occidental et de plus en plus moderne, il décrit là la marche inéluctable et linéaire de la modernité, comme si cette modernité était univoque : mais cette univocité du déploiement de la modernité est proprement incompréhensible au vu de l’analyse de la tension de son concept, sachant que le concept décide de l’être historique chez Finkielkraut. En d’autres termes, ce que l’auteur ne semble pas penser, c’est la nature contradictoire de l’être historique et cette absence de prise en compte de la contradiction de l’être historique entre violemment en contradiction avec ses présupposés historiaux.
En outre, mais cela est peut-être une qualité, Finkielkraut semble au fond hésitant : d’un côté, il loue l’introduction moderne de la liberté, de l’affranchissement à l’égard des contraintes héritées, mais de l’autre, il maintient un certain amour du passé, il aime ce qui est mort pour reprendre une célèbre formule, si bien que sa propre position à l’égard de la modernité est plus ambiguë que nuancée : rejetant par-dessus tout la table rase, quelle qu’elle soit, il hésite à louer le conservatisme, et la tension qu’il croit voir dans la Modernité entre table rase et conservatisme, entre Descartes et Cervantès semble au fond traduire sa propre indécision à l’égard de ce vaste mouvement qu’il décrit dans son cours. Il faudrait ainsi sauver de la Renaissance la liberté sans reprendre l’affranchissement à l’égard de la tradition, sauver de la démocratie la démocratisation sans tomber dans l’égalisation des conditions, et ainsi de suite : mais les analyses de Finkielkraut semblent précisément avoir pour objet de montrer que la démocratie mène inéluctablement à cette égalisation des conditions, de même que l’analyse de la liberté pichienne a été présentée comme indissociable de sa rupture avec la tradition. Dans ces conditions, la possibilité de sauver la liberté sans reprendre du même geste l’affranchissement hiératique et pétri d’hybris ne se comprend pas ; idem pour la démocratie.
En définitive, Finkielkraut est certainement un extraordinaire chroniqueur du monde, qu’il décrit souvent avec bonheur ; mais lorsqu’il cherche à l’expliquer, il est moins convaincant : ses analyses qui tendent à décrire des processus qui se veulent nécessaires sont mêlées à l’idée que tout pourrait être autre qu’il n’est : un fatalisme explicatif – la démocratie ne pouvait mener qu’à cela, Tocqueville l’avait dit ; la liberté pichinienne est une ingratitude et gouverne l’actuelle ingratitude des Contemporains, etc. – se combine avec un optimisme littéraire, débouchant sur l’étrange affirmation selon laquelle si certaines idées mènent nécessairement à de détestables conséquences, il convient toutefois de sauver lesdites idées. Y compris la modernité.
- Alain Finkielkraut, Nous autres, modernes, Ellipses, 2005, réed. Folio-essais, 2008
- Je cite dans l’édition de 2005, chez Ellipses : p. 16
- Ibid. p. 23
- Ibid. p. 30
- cf. Alain Finkielkraut, L’ingratitude, Gallimard, 1999
- Ibid. p. 59
- Ibid. p. 62
- Ibid. p. 83
- Antoine Compagnon, La bataille des Modernes, in Le Monde, 7 octobre 2005








