Ce livre de Sylvaine Gourdain, L’Ethos de l’im-possible, Dans le sillage de Heidegger et de Schelling1 demande non seulement une lecture attentive (il est précis, riche, et englobe un large corpus) mais une relecture de même acabit. Par conséquent ma recension, tout en suivant le fil des chapitres, se permettra de faire des surjets et des rappels, pour éclairer l’espace du livre, qui n’est autre que le champ de l’éthique elle-même. Mes remarques critiques seront moins des critiques que de libres réflexions de lecture qui, quelquefois divergentes, n’en seront pas pour autant incompatibles avec la méthode de lecture de l’auteure ni à son but initial, presque initiatique (on ne lit pas Schelling pour rien !) : parler d’éthique en respectant le sérieux du concept. Ce concept vient de loin : ἦθος signifie la manière dont l’homme répond à l’urgence de son séjour sur terre, en prenant ses dispositions pour s’installer, autrui et lui, conformément aux exigences de l’essentiel. Une telle « éthique » ne s’inféode pas à la notion de loi, juridique, politique, religieuse : Schelling et Heidegger se gardaient de proposer des normes et des valeurs. Toutefois, leur œuvre résonne d’injonctions qui, pour n’être que des invites, n’en sont pas moins éthiques au sens où Aristote ou Spinoza méditaient la correspondance de nos actes, individuels ou communautaires, à l’être présent à notre pensée. L’ethos s’élève non sur un système législatif, mais sur une ontologie, dont les congruences philosophiques des deux penseurs inspirent l’auteure pour élaborer les siennes. Soulignons d’emblée sa démarche originale. Au lieu de répéter une topologie sémantique, elle exhume la positivité des situations qui présentent l’effectivité. Elle montre comment l’éthique répond à l’appel non du concept d’effectivité, mais de l’effectivité même. Nous sommes à mille lieues des commentaires classiques : la bibliographie abonde en articles d’auteurs jeunes, souvent de langue allemande, offrant une lecture variée de Heidegger et de Schelling.
INTRODUCTION : APRES LE TRANSCENDANTAL
L’exergue annonce le concept central : cette qualité du réel d’exclure le possible avant de poser la différence entre possible et nécessaire. L’être est d’abord absolument anti-possible (un-möglich), sombre lieu en face du possible, antipolis en face de polis comme Antibes l’est à Nice : l’im-possible (le tiret le distingue de l’impossible) est devant le simplement possible (möglich). Schelling fait usage du préfixe « un -» dans un contexte d’antithèse, non d’opposition. Ce concept ancien-nouveau d’im-possible, l’auteure le reçoit explicitement d’un tiers, d’un penseur illuminé par ce « bel aujourd’hui » dont se targue la collection où elle édite son livre : Jacques Derrida. Car il faut un médiateur pour ouvrir un livre qui rassemble plusieurs maîtres, il faut un esprit qui offre des concepts opératoires pour faire jouer les protagonistes. Il ne s’agit donc pas ici de comparer directement deux penseurs, ni de pointer l’influence de l’aîné sur le plus jeune, mais d’élaborer un véritable traité ontologique sous-tendu par une figure du réel qui en soit la figure même, dans sa dureté, sa proximité, son urgence. Ainsi s’exprime Derrida, dont il faut attendre la page 333 pour entendre les harmoniques partagées par Schelling et Heidegger :
Si l’être, comme l’Ereignis advenant de façon toujours imprévisible, est l’im-possible même, alors la parole qui doit tenter de le dire, la pensée qui doit tenter de l’accueillir, doit elle aussi se faire im-possible, afin de cor-respondre à lui. Atteindre l’im-possible ou du moins y tendre, tel est l’ethos requis par cette pensée, et cette im-possibilité s’illustre par excellence à travers l’amour. [En note :] … Pour Derrida – et nous pourrions ajouter, pour Heidegger – l’éthique doit traverser une aporie, subir une épreuve, renvoyer à l’im-possible même.
On reconnaîtra là :
1°) l’imprévisible (unvordenklich) de Schelling, que notre auteure traduit littéralement : « imprépensable », qui constitue l’expérience immédiate de l’ethos. Le langage en témoigne (on ne peut pas penser à tout, qui aurait pensé que… et autres réflexions sur l’événement quand il se donne comme pur événement, dans une simplicité qui déconcerte, qui désaccorde).
2°) l’Ereignisde Heidegger. Pour présenter le duo Schelling-Heidegger, l’auteure préfère le sens obvie d’événement, Geschehen, ce qui se passe. Partir de la signification d’appropriation aurait réduit l’interprétation de l’événement à l’ouverture (Erschlossenheit), alors que ce qui s’avère plus profond chez Heidegger, ce fut l’exigence de penser la relation bijective et aporétique entre appropriation et désappropriation de l’être, en soulignant la dimension privative autant que donatrice de l’événement (cf. note p. 333-334).
Voici donc justifié le titre du livre : « l’ethos de l’impossible ». Car c’est dans la sphère de l’événement inopiné, hors de tout contrôle technique, que règne l’expression de la liberté humaine, l’éthique. On comprendra vite que Heidegger aura avec Schelling ce point commun de ne pas piéger la liberté dans la sphère de la subjectivité ou de la pensée qui se pense elle-même en mettant le réel en second, ni de la réduire à la condition du devoir. Depuis l’Antiquité, imprévisibilité est liée à liberté, et liberté à éthique. Mais la référence biblique dans laquelle baigne Schelling ajoute lui un appel intérieur qui invite à agir en conséquence, appel qui dépasse la sphère pratique pour exiger l’engagement de tout notre être, y compris la pensée. Schelling se situe dans ce lignage et Heidegger dans le sillage de Schelling. La séparation aristotélicienne entre penser et agir est donc à leurs yeux obsolète, puisque l’usage de la liberté ne peut dissocier rapport à l’acte et réflexion (Besinnung). L’auteure est partie de ce refus de couper en deux le champ de l’humain, tant chez Schelling que chez Heidegger, et du projet de faire de l’ethos la porte d’entrée privilégiée (p. 11) non seulement d’une confrontation universitaire entre les deux penseurs, mais d’un dépassement du transcendantal qui, à l’inverse, soumet le comportement, la décision morale, au connaissable : voilà justifié le titre du chapitre : après le transcendantal. Les « conditions de possibilité » qui définissent le transcendantal sont donc refusées comme est écartée toute idée de hiérarchie, lorsqu’on met l’éthique au centre du propos. Sylvaine Gourdain donne immédiatement des exemples – autant ceux de Schelling et du dernier Heidegger, que ceux de Derrida – de cet avènement imprévisible que seul comprend l’éthique : le don, le pardon, l’hospitalité, l’amitié.
En revanche, la finitude, cet existential heideggérien, est ici mise en perspective avec l’« impuissance originaire » dont part Schelling, pour montrer sa paradoxale plénitude, car seule intronisée à l’avènement du sens de la vie, toujours en mouvement. Et ce paradoxe d’une force de la faiblesse est indissociable d’un autre paradoxe : l’im-possible, trait de l’être premier, est l’origine du possible, de manière inconditionnée. Car au « möglich » qui sort de « l’un-möglich » propre à la présence rude et incontournable du réel, peut : mag répondre le « peut » (kann), la puissance de donner un visage au monde. Si beaucoup d’auteurs comptent Heidegger au nombre des penseurs du Destin (Geschick) en valorisant sa dette envers Hölderlin – et la dette de Schelling envers Spinoza pourrait renforcer ce trait – Sylvaine Gourdain prend le chemin opposé, qui mène avant tout destin, dans le tréfonds de l’être. Schelling montre à Heidegger, sous le fond(s) (Grund) de la réalité comme le fond(s) de l’homme, un même non-fond (Ungrund) qui exclut de la morale tout fondement catégorial. Mais l’essence de cet Indifférencié donne à tout ce qui est la structure alternative de la liberté, qui l’est pour le bien comme pour le mal.
Par là, « c’est toute la pensée de l’être qui est une pensée de l’ethos » (p. 17). Montrer que l’essence de cet im-possible est aussi « l’espace aimant de la phénoménalité, c’est-à-dire l’origine de ce qui accorde l’être à tout ce qui est » (p. 21) aide, dit Sylvaine Gourdain, à contourner l’impression que Heidegger est penseur de l’angoisse. Le compagnonnage entre Heidegger et Schelling, mettra en effet à jour, tant la pensée schellingienne de l’événement que la pensée heideggérienne de l’amour.
Notre auteure collecte ainsi les textes où Schelling et Heidegger parlent du Mal et en en décrivent les figures : rage de détruire, refus de penser, individualisme imperméable à autrui – maladie du Soi (Eigensucht), aveuglement qui épuise la Nature en se barricadant derrière le calcul, réseau technologique mondial. Sylvaine Gourdain souligne l’originalité de Heidegger, qui, comme Schelling, refuse de réduire le mal à une privation (ce qui firent les métaphysiciens), quoique le second refuse de mettre l’homme à l’origine de l’activation du mal par faute originelle. Elle fait ainsi glisser les concepts de l’un sur les concepts de l’autre, au lieu de pointer de simples influences ou des lectures communes aux deux penseurs. Si bien que ce qu’on pourrait croire être un contresens – notamment le rapprochement du retrait de l’Ereignis en un site inapparent qui bannit la puissance (Macht), avec l’impuissance divine qui s’abaisse dans son humanisation christique – devient une découverte pertinente pour saisir une communauté de structures de pensée, structures que chacun peut, comme l’auteure le fait, se réapproprier au-delà des parentés sémantiques. Heidegger connaissait mieux Schelling qu’on ne le croit : elle recense et exploite les moindres remarques sur Schelling, et les citations (explicites ou implicites) que Heidegger en fait. Schelling et Heidegger se « révèlent » ainsi réciproquement, en exposant la lumière de l’un sur l’obscurité de l’autre. Cette méthode d’histoire de la philosophie est plus féconde que la traditionnelle narration des métamorphoses d’une pensée au contact d’une autre. Elle permet d’éviter les découpages éculés du corpus heideggérien selon des époques, coupes qui exagèrent le fameux Tournant, ou en se demandant s’il y en eut un ou deux, etc. La méthode de Sylvaine Gourdain pointe, au contraire, les intuitions qui jaillirent, chez Heidegger, de la conjonction de sa propre préoccupation (envisager la philosophie comme une tâche) avec sa lecture émerveillée de Schelling. Preuve de l’efficacité intellectuelle de l’humeur, de la « Stimmung » !
I. FIGURES ET METAMORPHOSES DE L’IMPREPENSABLE, TÂCHE DE LA PENSEE
L’Ereignis heideggérien est relié à l’Urereignis schellingien de sa Philosophie de la Révélation, concept théologique d’acte fondamental intelligible (au sens intuitif que Schelling lui donne), à savoir : le choix d’Adam et d’Eve de pénétrer le mal comme le bien, la chute. Plus que la proximité théologique des deux exégètes luthériens que furent Schelling et Heidegger, c’est l’identité du Principe qui compte ici : une décision. Le fait premier (Tatsache) est un acte (Tat) (p. 24). L’essence humaine qualifiée de catastrophique par Heidegger entre en phase avec l’acte d’un double ratage du « commencement » à la fois préhistorique et historiquement déterminant, à savoir : le commencement pervers (Adam plagie le בראשית, le « au commencement » divin) – et le commencement erratique de la pensée occidentale. Dans les deux cas, ce ratage (p. 26) tient au choix d’un pouvoir sur la liberté, qui implique la coexistence du bien et du mal, et non un accueil de la liberté en vue d’un pouvoir pour le seul principe du bien. L’apôtre l’avait déjà dit : la conscience morale est « le lieu même où se répète et se manifeste l’événement originaire de la chute » (p. 27). Pour Schelling, les dieux sont ainsi les figures figées de ces potentialités aliénantes. De son côté, Heidegger pourchasse l’idolâtrie dans les figures divines elles-mêmes (son intérêt pour les dieux de Hölderlin obéira à une toute autre logique que religieuse, sans la supprimer). Pointer l’oubli de l’Être au début de la philosophie signifiait pour lui : dénoncer l’oubli du vrai Dieu dans l’ontothéologie mais aussi dans l’opposition conceptuelle entre foi et athéisme.
Le problème qui a explicitement occupé Schelling et Heidegger fut le rapport de l’Existence (que Schelling appelle déjà das Dasein) à son Fondement (der Grund) premier, qui est donc infondé lui-même. L’auteure montre que les deux penseurs ont détaché ces mots de leur acception métaphysique – qui oppose existence à l’essence – et de la tradition subjectiviste, qui croit fonder l’existence singulière sur un Moi humain pensant. La Bastille à prendre était le sujet transcendantal, posé sur le Possible à titre de condition d’une connaissance a priori, et l’acte révolutionnaire était la quête de l’attitude à avoir devant l’événement pur, l’Imprévisible.
La rupture philosophique qu’opérèrent Heidegger et Schelling chacun en leur temps – l’un contre Kant et Fichte, l’autre contre Husserl – consista donc à réunir la contingence absolue de l’existence et l’origine propre au fondement de l’être sous le concept de « commencement » intuitionné dans un Avant asymptotique. Nous lisons p. 24 :
La fin du transcendantal, chez Heidegger, signifie en tout premier lieu que la pensée ne peut pas, d’elle-même, fonder le commencement, car elle se trouve toujours déjà impliquée dans un événement qui la précède et l’intègre en lui.
Heidegger radicalise l’Origine : désormais, le « Geschehen originaire engage d’emblée et pour toujours la pensée et l’existence de l’homme » (p. 24). Dépassant le cadre de production d’effets ou de causes en un temps T., ce sens événementiel initiatique d’Ereignis ménage un lien immédiat avec Schelling, qui lui donnait déjà un rôle central dans sa Philosophie de la Révélation. Le moment mémorable et immémorial à la fois de la faute originelle installait l’histoire humaine. La notion centrale, pivot de l’éthique, l’imprépensable unvordenklich constitue une tautologie réale (c’est comme ça, A est A) distincte de la tautologie logique.
Remarquons pourtant que le souci de la logique est présent ici. D’une part dans le nouveau principe d’identité de Schelling, qui fait jouer à la copule un rôle transitif (l’imprépensable est en fait le pensable premier, comme le bien est le mal, etc.). D’autre part, dans le passage de la « résolution » existentiale à une sagesse qui apprend à se tenir de la façon la plus juste face à un événement, la notion de nécessité réapparaissait. Elle caractérise en effet une situation qui fait question, qu’il nous faut (muß) approprier, avec la distance intelligente d’une « Muße » ludique (σχολή, loisir, Spiel) qui est tout sauf facultatif ou contingent. Heidegger détruit en effet le préjugé moderne opposant, en grammaire comme en éthique, « sollen » (devoir moral dévolu à la liberté) et « müssen » (contrainte matérielle) ! Il aurait fallu développer cette innovation éthique, celle du paradoxe d’un choix forcé…
Quoi qu’il en soit, nous entrons dans la sphère typiquement schellingienne d’un « événement-limite, entre suprahistoire et histoire » (p. 25), où la conscience morale (Gewissen) assume la conscience dite psychologique (Bewußtsein), non l’inverse, et doit se garder de la voluntas comme de l’intentionnalitas. Notre auteure rend ainsi suspecte la traduction d’Ereignis par « appropriation », et de Eigentlichkeit par « propriété ». Heidegger, lecteur d’un Schelling bibliste, dénonce précisément toute « appropriation », comme si le réel était un bien sans propriétaire. La propriété privée n’a pas de sens, qu’elle touche les choses ou la liberté. De plus, quoique Heidegger s’exprime en existentiaux, puis en concepts, non en termes théologiques, c’est une grande vertu de Sylvaine Gourdain de ne pas en avoir fait un schibboleth fondamental. Le concept philosophique de saisie originaire (Anfang) et le concept théologique d’un mouvement de chute (Urzufall) figurent sur le même tableau, comme chez Jérôme Bosch : les hommes qui, ayant voulu posséder la liberté, sont victimes de leur autotromperie et investissent leur effort intellectuel dans un nouveau commencement de la pensée – jouxtent ceux qui, coupés de Dieu par leur mauvais départ, espèrent un retour réconciliateur. Car tous se savent êtres errants et non seigneurs : nous appartenons à la Liberté. Une note, p. 48-49, mérite de se trouver dans le corps du texte, tant elle révèle que, chez Heidegger, le renoncement conjoint au transcendantal et au transcendant ne se fait pas contre le sacré, mais pour redonner au sacré la couleur de sa liberté originelle :
En cela, nous nous opposons à la thèse d’Emilio Brito… : « Heidegger échoue… à s’élever jusqu’à la vraie notion de la Liberté immémoriale », parce qu’il « ne parvient pas à penser un Dieu transcendant à l’Evénement ». Nous pensons qu’au contraire, Heidegger réussit bien à penser cette liberté originaire, mais que celle-ci ne prend pas la forme d’un Dieu transcendant. L’Ereignis du es gibt n’est pas engendré par un Dieu, car il repose sur un Abgrund,… mais la Lichtung est bien une figure du « libre », de la liberté imprépensable, depuis laquelle le es gibt se donne, selon des « époques » différentes, que l’on ne peut jamais prévoir à l’avance, puisqu’elles adviennent toujours librement.
Du diptyque des Recherches sur la Liberté humaine et de la Philosophie de la Révélation surgit une image éthique, révélatrice du « fond de l’affaire » : l’Amour qui porte la liberté au-delà de l’identification de l’individu à son fondement abyssal. Car l’Amour convie l’homme à sortir de soi, à ex-sister. On notera que la recherche de notre auteure ne débouche pas sur des catégories historiques, malgré la temporalité du concept d’événement, car celui-ci est imprépensable, et qu’elle évite des existentiaux censés remplacer les catégories parce qu’ils pèchent encore par une adhérence à l’ipséité transcendantale qui observe une réduction non sur la conscience certes, mais sur l’être-là. L’auteur aurait dû insister sur la faculté rédemptrice de désappropriation (Enteignis), qui trouve son pouvoir éthique en se désappropriant dans une image qui montre l’occultation irréductible qui la traverse (p. 30). Cette intrication très forte de l’image (Bild) et de l’Ethos suppose une réhabilitation de la Perte. Tant l’intérêt de Schelling pour la mythologie (et ses figures divines) que la passion de Heidegger pour Hölderlin prouvaient que ce qu’on appelle la philosophie romantique allemande, forte de son compagnonnage avec la littérature de l’époque, a réussi à dégager un rapport cohérent entre l’image et l’éthique, qui permet de redonner leur plein sens moral à des études qui auraient pu n’être qu’historiques, comme les travaux de Schelling sur l’histoire des religions. L’auteur montre très bien comment, chez Heidegger aussi, l’image immémoriale de l’errance originelle éclaircit la figure de l’être et trace un chemin aux décisions.
Cette innovation va de pair avec une critique du rationalisme dialectique. La dualité Ereignis / Enteignis est le repoussoir, chez Heidegger comme chez à Schelling, de la dialectique hégélienne : la temporalité n’est plus succession, mais pulsation binaire. Remercions Sylvaine Gourdain d’avoir souligné la portée éthique de ce choix d’une dualité non dialectique, dans l’interprétation de la parole d’Anaximandre : à la liberté schellingienne pour le bien ET pour le mal correspond la confrontation entre la justice définie comme harmonie contrapunctique qui s’adapte au séjour terrestre (Fuge) et l’injustice définie comme disharmonie du raidissement (Unfuge). Le mal est recouvrement de l’ex-sistance par l’in-sistance, même si les termes grecs ignorent tant la charge chrétienne du péché que la pression juridique romaine.
Heidegger justifiait ainsi sa propre archéologie sémantique d’un sens plus ancien de l’Ethos, certes grec, mais parent, par exemple, d’un lointain taoïsme (le « Tao »). D’aucuns pourraient en conclure que Heidegger troquait la morale contre la sagesse, et les règles de l’éthique contre des conseils d’art de vivre bien. Mais ce serait méconnaître la continuité heideggérienne d’une quête du bien, depuis sa jeunesse kierkegaardienne hostile à une morale médiatisée par la théologie théorique, jusqu’aux derniers écrits inspirés par l’Extrême-Orient, que Sylvaine Gourdain met habilement en rapport avec des textes de Schelling. Ce qui révèle l’irisation de différentes Stimmungen, l’une issue de l’exigence de pratique de la justice, l’autre référée à la vertu, c’est-à-dire à une attitude personnelle.
Heidegger dépasse ainsi la colère nietzschéenne contre la réduction de la morale à un ensemble de règles imposant à l’individu la dictature d’un sujet médiocre, impersonnel, irresponsable, repéré dans Être et Temps à travers le pronom allemand et français « On » (« Man »). Mais ce cocktail d’humeurs morales se sépare de la doctrine de Schelling, car élaborant le principe de responsabilité sans imputer à l’homme la catastrophe qui lance le destin de l’humanité vers la perte de son essence : l’acte intelligible qu’est la chute n’est pas, pour Heidegger, chose du passé, mais escalade présente, qui s’actualisera dans un avenir explicitement destructeur. Un des points forts du livre de Sylvaine Gourdain est de montrer que Heidegger, qui rendit possible une éthique de la responsabilité sans recourir à une faute de l’homme, a ainsi accompli l’avancée la plus importante par rapport non seulement à Schelling, mais à la morale en général. L’humeur qui consiste à se sentir coupable est ainsi, finalement, radiographiée sans complaisance : c’est une des ruses de la volonté de domination pour rapporter tout ce qui est à une propriété humaine. Une ruse de la déraison, en quelque sorte – la déraison de l’autofondation.
Mais sa recherche est plus fondamentale encore : elle pose qu’il n’y a pas d’éthique sans ontologie en mettant le doigt sur le problème qui agitait Heidegger au sortir de son grand exercice phénoménologique de 1927 : se détacher de la préséance husserlienne de la possibilité sur l’effectivité. Schelling l’aide à cela, et ainsi à persister dans son remplacement de la phénoménologie du « Bewußtsein » par celle du « Dasein » en suivant le fil du « Sein », qui sonne dans les deux termes. S’il peut, en effet, détacher le « Sein » (écrit désormais Seyn, selon l’orthographe de Luther et de Schelling) de la subjectivisation introduite par « Bewußtsein », c’est, qu’il découvre qu’avec Schelling, on baigne dans la réalité de l’être, dans la « Wirklichkeit » (cf. p. 42), qu’il s’agisse de l’Origine ou de la Chute originelle – lieu de ce que Schelling appelle le « Dasein ». L’antienne heideggérienne du « déjà là » (immer schon da) trouve donc son site chez Schelling, ainsi que le constat des limites de la raison quand il faut penser l’être en tant qu’être comme Cela qui était, est et sera toujours avant. Notre auteure fait comprendre le détachement de Heidegger, émule de Schelling, à l’égard du concept de fondement, qui se dit aussi « Grund » (ratio, fundamentum mais qui est réfuté par le « Fond » schellingien, lequel échappe justement à tout fondement par la pensée. On anticipe toute pensée anticipatrice en trouvant quand on ne peut anticiper : quand on cherche à fonder le « il est » : un fondement qui n’est pas libre d’être ou non fondement, ne fonde rien.
Pour Schelling, la chose se formule en termes théologiques : Dieu est, en tant que lui-même, libre par rapport à son propre être, il est à la fois Liberté et liberté de ne pas être libre. « Dieu est » signifie : « Dieu est libre d’être ». « Il est » (signification du Tétragramme) indique en lui le « Seigneur de l’être ». Dieu pose l’être, en lui et hors de lui, non en vertu d’un être antérieur disponible comme d’une valeur fixe, mais du fait que le fondement réel, ce n’est pas « l’être », mais la Liberté, qui ne fonde rien. Si bien que, pour Schelling suivi par Heidegger, « Grund » signifie, en fait, « Ungrund », non-fondement. La liberté n’est pas un attribut de l’être, mais l’être même. « Liberté » est le Nom philosophique de l’être.
Pour Heidegger, bien que la définition du fondement comme liberté courre déjà dans les textes postérieurs à 1927, l’auteur montre que le contexte conceptuel de ce principe-là exclut de réduire Dieu à une fonction de moyen terme entre l’être et la pensée : de même que Dieu ne souffre pas de nom commun, de même l’Abîme est un nom propre. Au lieu d’un Ungrund, fondement qui se nie lui-même, on aura donc une kyrielle de noms propres, au premier chef Abgrund, Sol Abyssal, Espace Libre (Freie), Clairière (Lichtung)…
C’est là que notre auteure introduit le concept le plus important de son livre : l’Espace (Raum). Son exposé des Weltalter montre la métamorphose que Heidegger a apportée à la conception schellingienne du Devenir : l’origine a désormais une identité spatiale. Le Lieu (der Ort), contenant l’union première de l’être et de la pensée, est l’espace vide, le site de jeu entre réalité impensable et pensable, indicible et dicible. Le commencement de la pensée est donc en phase avec l’activité de l’être. La Genèse est chez lui la Chose Originelle (Ur-sache), le « phénomène primaire » – comme on parle de la Forêt Primaire, « Urphänomen ». Le lien entre ethos, lieu, et jeu entre visible et invisible, a frappé Heidegger dès qu’il s’est intéressé à la peinture (1930) et ainsi ravivé ses intuitions fortes sur le rôle de l’imagination dans la tenue de l’existence. Mais ce qui est original, c’est de relier cette constellation-là à un contexte bien plus tardif (1964), abandonnant le référentiel historique pour une quête – sur un mode oriental – de la provenance de toute pensée : non plus comme lumière issue de l’obscur, mais comme lieu ambigu où l’Obscur s’obscurcit. On aurait tendance à pointer là l’influence du Tao et du Zen sur le vieil Heidegger. Mais Sylvaine Gourdain émet une hypothèse plus solide, plus vraisemblable, pour rendre compte de ce déplacement d’intérêt, du commencement (historique) vers l’origine (onto-logique) : celle de son souvenir fidèle des visions de Schelling. C’est grâce à Schelling que Heidegger a transporté son âme vers les secrets d’Orient, non l’inverse. A la dualité dévoilement / recouvrement – présente depuis le début – s’ajoute la pensée du Jeu, qui tresse les semblables et les dissemblables en un Même, impliquant le Lieu que crée ledit Jeu. Et ce lieu, Heidegger l’a entrevu dans sa lecture de Schelling – j’ajouterai, conjointe à celle des Hymnes de Hölderlin.
Le halo schellingien s’étend sur l’ethos heideggérien pour susciter une ontologie toute nouvelle de l’espace, qui n’a plus rien à voir ni avec les formes a priori ni avec le vécu phénoménologique, car marquée du sceau de l’imprévisible, autrement dit de l’impossibilité d’un quelconque prédonné. Le phénomène n’est plus le fondement, mais le fondé, et le fondé est l’étant précaire, conduit sur un sol mouvant. On lit p. 46-47 :
Dans le texte de 1964 [il s’agit de La fin de la philosophie et la tâche de la pensée], comme déjà dans les années 1930 [Contributions à la Philosophie et L’origine de l’œuvre d’art], la Lichtung est considérée comme la possibilité de la phénoménalité, non au sens d’une possibilisation comme Ermöglichung, mais au sens d’un Gewähren [accorder] : la Lichtung est l’« ouverture [Offenheit] qui accorde un laisser paraître et un montrer »… Mais, à la différence des années 1930, la Lichtung est désormais pensée selon un modèle plus spatial, … elle désigne maintenant « le lieu du paisible, qui rassemble en soi ce qui seul accorde la non-occultation »… elle est « l’élément au sein duquel il y a originairement l’être aussi bien que la pensée et leur co-appartenance ». … Autrement dit, la Lichtung est « une Ur-sache », un « Ur-phänomen », qui « accorde » le jeu et le litige (Streit) entre voilement et dévoilement : la Lichtung ne s’identifie plus au conflit, comme dans les années 1930, mais le précède. Elle désigne donc le lieu, le cadre ou le milieu au sein duquel un certain dévoilement est possible, le dévoilement consistant lui-même en une tension toujours en mouvement entre dévoilement et voilement. … La lumière [Licht] a besoin d’une Lichtung [clairière] qui la précède pour pouvoir rayonner et éclairer. C’est pourquoi la Lichtung est nommée « le libre [das Freie] », « l’ouvert libre [das freie Offene] ».
L’auteur insiste à raison sur le sens du dévoilement : ce sens n’est pas la vérité, mais la liberté de l’ouvert : la réalité est un lâcher d’étant (das Seinlassen von Seiendem). L’être est laisser-être, laisser-faire l’étant, permission d’être. Si toute éthique doit remplir deux conditions, se fonder sur la liberté et enjoindre un engagement, nous sommes bien ici en présence des deux. Mais l’engagement lui-même est pénétré de liberté : se laisser aller avec confiance au sein de l’étant (sich einlassen). Le double sens de « lassen » (faire faire et laisser faire) empêche de glisser dans la passivité : la Liberté engage de facto la pensée dans un aménagement de l’étant. L’auteure insiste sur cette révolution de l’éthique qui consiste à supprimer le clivage aristotélicien et kantien entre théorie et pratique. La morale à venir, si l’on veut sauver le séjour humain sur terre, sera un fait ontologique global ou elle ne sera pas.
Pourquoi ? Parce que l’homme n’a pas la liberté comme on a une propriété. Avoir, c’est tenir (haben, halten), et c’est la Liberté qui tient l’homme L’ethos naît d’une « tenue » (Verhalten) qui ne dépend pas de nous. Cette tenue se produit (geschieht) dans l’espace ; oui, le nom spatial de la liberté est l’espace, espace de cette révélation et de cette création dont parle Schelling. L’auteur cible très bien la métamorphose de la pensée heideggérienne, qui, dans Être et Temps, rattachait la conscience morale à l’assomption personnelle de l’union des trois extases du temps et, peu à peu, par souci du rapport humain à son habitat terrestre, fonde l’ethos non plus sur la temporalité, mais la spatialité, quitte à nommer le jeu entre être et pensée : jeu spatio-temporel (Zeit-spiel-raum). Le Temps, révélateur de l’être du Dasein, est, de Beiträge à Zeit und Sein, accueilli dans l’Espace.
Cette nouvelle pensée du Séjour retourne à la « présence » (Anwesenheit propre à l’événement de ce qui se donne, au « il y a », au temps présent : Devenir et Histoire se tournent vers l’avenir de la Terre, figure s’il en est de l’Imprépensable ! Cette notion qui guidait Schelling dans sa méditation sur la seigneurie de l’être, évacuait tout historicisme, même dans sa noble forme, hégélienne. Heidegger part aussi de cette imprévisibilité pour se détacher d’une vision du destin scandée par des époques historiques, au profit d’une vision destinale méta-historique impliquant l’intuition du lieu invisible quoique hyper-réel où se nouent le Libre et la liberté humaine. « Phénoménologie de l’inapparent » qualifiera ce tournant de sa pensée, enrichi de l’image du Carrefour – « das Geviert ». Migrer, voyager, s’installer, notions hölderliniennes, se révèlent d’authentiques repères moraux à l’époque du réseau technologique mondial, le « Gestell ».
Si la morale régulatrice, du « nomos », a glissé dans l’éco-nomique, qui est tout sauf moral, l’ethos de la liberté se trouve en phase avec une éco-logie dont le logos retrouve sa fonction de rassembleur. Le regret d’avoir négligé l’espace en faveur d’une préséance universelle du temps, exprimé par Heidegger en 1962 dans Temps et Être, est le résultat d’une longue ambivalence qui a commencé dès la rédaction d’Être et Temps. Car Heidegger y fait précéder l’exercice de la liberté (la résolution) par une ouverture sans laquelle la résolution ne pourrait faire sauter les verrous (entschließen) du comportement inauthentique ! Or l’Existenz se définissant par l’authenticité du « là », il faut bien convenir que le lien entre le rapport à l’espace et le choix de vie tracasse Heidegger depuis le départ.
Reste à savoir si ce problème de la place de l’existant provient de la lecture de Schelling. N’est-il pas la marque de Husserl, qui reprend le couple kantien espace-temps pour viser les essences ? La notion de « sens », qui implique le va-et-vient entre lieu et langage, entre orientation spatiale et signification exprimable, a aidé Heidegger à lier Logos à Ethos : à ménager, à côté du référentiel temporel historique, les repères d’une phénoménologie de la spatialité. Ainsi, dans les cours de 1927 à 1929, très husserliens, le laisser place et le partage de l’espace commun font écho à la dénonciation de la fausse sollicitude, qui prend la place d’autrui. L’espace y prend place à côté du mode le plus authentique du temps, l’avenir. Quant à l’importance du Lieu dans les commentaires de Hölderlin, qui montre le balancement des mortels entre installation dans le lieu familier et migration en terre étrangère, il est suscité par la pure écoute de la Parole du poète, lecture qui projette sa lumière sur la rédaction des Contributions à la Philosophie. Dans ce traité, l’auteur exprime en effet le souci de penser l’Espace à nouveaux frais, dans le cadre de la Résolution, à la mesure du Dasein (daseinsmäßig). L’influence du pressentiment poétique, le rôle de l’imagination dans le Projet d’un être-là authentique, la réhabilitation, à côté du couple ontologique du Même et de l’Autre, du couple sacré homme semblable / dieu dissemblable – aurait pu être mentionnés.
L’auteure aurait pu aussi développer l’idée que Heidegger avait appris chez Schelling une philosophie de la Personne, issue de son intérêt pour l’identité, non seulement « die Identität », mais l’haeccéité, l’individualité, dans ses rapports complexes avec le Tout, où elle puise et s’épuise. L’ethos étant par définition axé sur la personne – « je t’ai appelé par ton nom », « Person sucht Person » (p. 318) – il y a là un courant conceptuel très fort où les thèmes du Soi et de l’espace (intériorité et extériorité) se relient non au sujet, mais à un espace originaire qui est la liberté même, la liberté qui appelle chacun à être libre au sein du Libre.
Sylvaine Gourdain dessine donc un ethos à la fois personnaliste et spatial : le Même où Heidegger et Schelling déploient leurs différences, l’un en parlant de Dieu, l’autre en parlant de l’Être, se précise. Ce n’est pas l’imprépensable en général, négativement défini par ce qui se soustrait à nos calculs de probabilité, mais positivement : l’Autre Présence qui s’impose à nous et se définit donc par rapport à l’être et non à la pensée. « Imprépensable » dit donc plus qu’« imprévisible », car il ne se confond pas avec « impensable » (undenkbar) ni avec « impensé » (ungedacht), mais met l’accent sur l’avant de l’avant, le « vordem ». Avant que tu ne fusses, j’étais. Le lieu où se tient l’Autre est l’Origine encore étrangère à toute pensée, mais qui la requiert. Cela est vrai de l’être, du prochain, et de Dieu lui-même – « être » pur qui requiert de son propre Esprit qu’il le pense comme Origine.
Heidegger n’en attend pas moins de la pensée, qui devient une tâche sacrée du fait de l’héritage schellingien, biblique, de son appel. Dans la protestation de Heidegger – l’être ne s’inféode pas à la pensée ! – on entend la voix d’un migrant exilé des terres métaphysiques dont la « vérité » englobe tout, ôte toute réalité au mal. Ce marcheur marche vers une terra incognita indiquée par Schelling, la terre originaire où la considération du réel real, non de l’effectif wirklich, inspire un comportement tout aussi « réel » que celui dont il entend les exigences, hors des autoroutes du transcendantal que l’homme croit conduire de main de maître, comme si le paradigme de l’hôte séjournant sur la terre était le savant qui mène une expérience de laboratoire. Non, l’espace originaire, « Urraum », Région (Gegnet) est l’Urphänomen, l’Urereignis) éthique, le là accordant à chacun d’être celui qu’il est.
Ce terme tardif de Gegnet (cf. 49) indique ce qui échappe à la philosophie transcendantale : le carrefour où se croisent terre et ciel, mortels et êtres divins, où l’on marche et navigue, comme dans les poèmes de Hölderlin (les fleuves sont tels) ou de Trakl (la table de l’auberge est ainsi rassemblante). Ainsi peut se réinterpréter la phénoménologie heideggérienne de la perception, étendant l’espace et le temps, de l’intuition au vécu, et du vécu à l’être. Elle ne réduit plus le donné spatio-temporel à la conscience, mais à l’être dans sa différence d’avec l’étant, région inaccessible à la pensée, non parce qu’elle est liée à la sensibilité, mais parce qu’elle précède absolument. Un peu plus loin, Sylvaine Gourdain rappelle le nom que Schelling donnait à ce que Heidegger appellera « la Différence » : l’Absolu. Que le bouleversement de la révélation de l’Être au beau milieu de l’étant porte immédiatement à s’engager en faveur de cette justice qu’Anaximandre définit par le laisser-place, prouve ainsi que ce qui est en jeu dans l’Eclaircie, c’est indifféremment la vérité des phénomènes et la liberté de l’action. Le mérite de Sylvaine Gourdain est de faire une lecture transversale, nomade et associative, des œuvres des auteurs où elle trouve des propositions d’éthique, en revenant au concept d’Origine, longtemps délaissé par les commentateurs au profit de celui d’Ereignis. « Ursprung » appartient à l’époque du Tournant et de la lecture de Schelling, pour qui ce concept primordial s’oppose à l’historicisme. Nous sommes dans un monde parallèle à celui de Hegel, qui met l’Histoire à la clef de toute interprétation ; nous sommes devant une présence constante, un Principe. L’auteur écrit, p. 52 :
L’origine doit être comprise comme le déploiement même, « l’essence » de la phénoménalité. […] L’origine est imprépensable non parce qu’elle se situe au commencement d’une chaîne d’actions ou d’événements, mais parce qu’elle est imprévisible, parce qu’elle nous surprend toujours, et parce qu’elle ouvre un nouveau contexte de sens.
Déjà, dans Être et Temps, l’arrivée inopinée de la voix de la conscience faisait que, quoique rien ne fût changé dans les phénomènes, tout fut changé dans leur sens : revisiter ainsi la révélation de la Différence Ontologique comme Manifestation de l’Origine ne permet pas seulement de penser le monde, mais de voir en un seul coup d’œil (qui est projeté tant hors de la pensée que du fait d’être soi) le lien entre être et penser. Tel le site platonicien du Bien, au-delà de l’être, tel le site tant schellingien que heideggérien de « Cela » qui se donne, l’imprévisible, au-delà non seulement de l’étant mais de l’être lui-même, en une sorte d’hyper-différence ontologique. L’auteur interprète ainsi l’adoption, par Heidegger, de l’orthographe schellingienne de l’être : « das Seyn », qui rappelle son sens schellingien d’imprévisibilité. Heidegger, dans le poème que cite notre auteure, en GA 81, p. 200, se réfère à Héraclite, qui, au fragment 18 donne, à l’inaccessible et introuvable Chaos, le nom d’Inespéré. L’éthos est ainsi ancré dans l’Origine, et celle-ci pensée comme la Singularité par excellence, le Même Un, l’identité mystérieuse de qu’on ne peut penser à l’avance (Eigenes unvordenklich). Notre auteure note à juste titre l’ambivalence de Heidegger : si le Principe est avant la pensée, on a une métaphysique d’adéquation (de l’intellect à la chose) ; mais si penser et être sont la même chose (ce que ne veut pas dire Parménide, Heidegger nous prévient) alors l’être est sous la coupe de la vérité, corrélat idéaliste du réalisme et tout aussi métaphysique que lui. Il suffit pourtant de ne pas penser la pensée comme représentation, pour entendre, dans la pensée, l’Imprévisible nous enjoindre. Nous lisons p. 55 :
Ainsi, dans les deux cas, aussi bien chez Schelling que chez Heidegger, l’imprépensable acquiert une dimension d’obligation : il ne s’agit pas là d’une contrainte, mais plutôt de la manière dont l’homme est exhorté à l’ethos. Dans la philosophie tardive de Schelling, […] l’homme est appelé à imiter son créateur en se comportant face à cet être depuis la plus haute mais aussi la plus difficile des libertés, la « liberté d’être ou de ne pas être », la liberté de renoncer à son être propre pour celui d’autrui. […] Chez Heidegger, … l’imprépensable est le nom de la Lichtung. […] La pensée s’enracine dans le « libre », ce qui veut dire qu’elle participe elle aussi de cette liberté. […] C’est à ce titre que l’homme est obligé à la pensée, parce qu’il est, originairement, un être pensant et donc un être libre.
L’Origine n’a par conséquent aucun caractère de présence de substance ; sa phénoménalité n’est pas comparable à d’autres. L’Histoire, pour Schelling, est le site d’une médiation qui appelle à la position éthique parce qu’elle se retire et laisse la place à l’homme. En ce site mouvant, l’historicité de la révélation (Geschichtlichkeit, terme promu par Schelling) est l’odyssée (p. 58) de la liberté humaine. Pour Heidegger aussi, chaque métamorphose de l’Envoi de l’être requiert l’homme pour une tâche herméneutique. Les dieux de Hölderlin, comme ceux que narre Schelling, renvoient à des images qui étaient vraies pour les hommes d’autrefois, et par conséquent ont fasciné leur réalité concrète. A l’allégorique il faut préférer celui le « tautégorique » (p. 61), à la parole qui renvoie à autre chose, celle qui renvoie au Même. L’histoire positive de l’homme se meut, à chaque époque, dans un Même plein de constellations d’images qui obligent l’homme à lire les signes d’un ethos universel. Tel est le sens de la religion, pour Schelling, du sacré pour Heidegger. N’oublions pas que Heidegger avait pu déjà concevoir une haute opinion de Schelling en lisant La philosophie des formes symboliques, de Cassirer.
L’être donne ainsi l’espace de déploiement de la liberté de l’être humain (p. 68). Cette méthode de positionnement – qui lie l’éthique à un principe de séparation spatial – fait comprendre l’essence même de l’instant décisif : c’est dans un espace que le temps est le curseur, le départ entre le passé dont l’homme se libère et l’avenir auquel il s’ouvre avec confiance, en recevant, dans le présent, les dons de l’imprévisible (cf. p. 62-63). Bien qu’historial, le « es gibt », le « ça donne » ne se met qu’au présent, ici, dans une Séparation créatrice entre réserve inapparente et apparition donatrice, tant pour Schelling que pour Heidegger. La nostalgie du « Dieu réel » (der wirkliche Gott) devient recueil d’un événement qui fait appel à notre liberté, et ressort de ce que Schelling appelait la philosophie positive, laquelle pose l’être lui-même, non ses cadres logiques. Heidegger l’appela facticité à l’époque analytique, puis envoi, Geschick. Nous pouvons ainsi, p. 66, imaginer le pont qui relie Schelling à Heidegger :
La positivité de cette philosophie vient donc de son attachement à la facticité des événements et à ce qui ne se laisse pas concevoir de façon logique par la raison. L’historialité ne se laisse que recevoir et non construire a priori. Ainsi, c’est non seulement la facticité des événements qui est imprépensable, mais aussi la manière dont le sens apparaît, c’est-à-dire, si l’on veut reprendre le vocabulaire heideggérien, l’histoire en tant qu’histoire de l’être, dans une perspective herméneutique.
Mais l’innovation heideggérienne est de promettre une Origine sans volonté. Sa philosophie reste négative au sens schellingien, logique : l’être se détecte dans les métamorphoses d’un Même, en une tension entre être et néant. Le Destin (Geschick) indique une dévolution humaine qui ne confère aucune volonté ou intention. Heidegger ne rejette le fatalisme que parce qu’il y voit une des figures de la Volonté. Mieux : une intention transcendante supprimerait tout ethos pour une libre humanité. L’ancrage dans une autre logique, construite autour de l’être et du néant, du même et de l’autre, donne raison à Derrida d’en tirer sa propre notion d’im-possible pour qualifier un Ereignis qui n’advient qu’à partir du « non » du retrait propre à l’imprévisible (p. 72). Laisser disposer n’est pas proposer, tant s’en faut, et l’être qui, ouvrant l’espace libre, se retire, est à mille lieux du Dieu caché du Psaume 88 ou 150, ou d’Isaïe 45, auxquels se réfère le chrétien qu’est Schelling. Comment transformer sans blasphème l’apophatique Singulier propre à l’Er-eign-is, qui n’est pas intentionnellement imprévisible – en cette parole positive, cette injonction de l’Imprépensable personnel qui dit : « Ecoute, Dieu est Un ». L’analogie logique entre Gottes Offenbarung / göttliche Verstellung, d’une part, et Ereignis / Enteignis est-elle une laïcisation d’un Principe qui est sa propre médiation ? Estre ou Dieu, « Cela » se révèle en s’abritant dans l’inapparent. Qui parviendra à dire la différence entre un Dieu caché et une Origine sans intention ? Faut-il que Dieu ait un vouloir pour le prier et le louer ? Peut-on répondre philosophiquement à cela ?
Sylvaine Gourdain p. 72, a raison pourtant de négliger ces différences, et de conclure que pour les deux penseurs, la liberté humaine, milieu ontologique de l’éthique, a affaire à l’événement non parce qu’il se produit dans le temps – aucun événement ne pose par lui-même d’obligation – mais parce qu’il incarne une proposition se présentant dans l’histoire. L’homme entre dans l’étendue (Reichweite) en saisissant la main tendue (das Reichen) de l’être dans la concentration des trois extases du temps au sein de la Présence (Anwesenheit). Que cette Présence (que Derrida écrit « Présance ») soit fond abyssal (Abgrund), non fondement (Grund), rapproche Heidegger du dépassement schellingien de l’Ungrund par la destinée singulière de l’Existant. C’est ainsi que Heidegger dépasse, lui aussi, la philosophie négative, en passant de l’apophatique « parce que c’est ainsi » à l’injonction de s’adapter à la facticité, non pour s’y soumettre, mais pour changer le séjour en pensant la Présance. Tel est le sens du Jeu. Sylvaine Gourdain voit que, dans le « Zeit-Spiel-Raum », seule la conscience éthique peut entendre 1°) le vrai sens du mot « jeu » : le jeu cosmique d’Héraclite est celui de la liberté humaine, qui donne sens à l’énigme du monde en s’y engageant ; 2°) la place de l’accent : non sur « Zeit », mais sur « Raum », l’espace : l’éthique est l’espace où la liberté se donne du jeu, se donne le temps, laisse la place. C’est en un « ici » que la liberté éprouve le fait qu’il y a du jeu dans les trois extases du temps. Loin d’être métaphorique, cet espace éthique est celui, fort concret, de notre séjour sur Terre, le « là » qui conjoint l’espace du monde et la place singulière de chacun. Être et Temps est le tremplin du saut vers une pensée de la liberté inspirée de Schelling, un salto, l’« Ur-sprung » dont parlent les Contributions à la Philosophie, écrites clandestinement dix ans plus tard, quand le vent de la liberté ne soufflait plus qu’entre les pages des livres.
Mais le corrélat du caractère éthique de l’espace est qu’il recèle l’imprévisible. La philosophie positive de Schelling concernant l’Existence en tant que telle, à savoir l’a posteriori qui anticipe toute anticipation, elle attire dans sa sphère la pensée du Positif Pur, à savoir Dieu. Mais ce constat exclut un Dieu calculateur, il restaure les droits d’un Cosmos sive Chaos jouant sur l’échiquier du Temps. Notre auteure montre que Heidegger a changé le sens du « Dum Deus calculat, fit mundus » en substituant à calculare (qui implique le prédictible) le spielen « qui permet de figurer l’idée de l’imprépensabilité et de la facticité herméneutique de l’être » (p. 78) en abolissant tout biais cognitif causal (le jeu est sans pourquoi, il se produit parce qu’il se produit).
Mais ce que Schelling appelle le pur Possible n’est autre que l’idée de l’être, qui ne peut que penser l’effectivité de l’être sans l’être. Schelling se gardait bien d’assimiler la pensée du réel au réel, et il stigmatisait chez Hegel une philosophie négative qui se prenait pour une philosophie positive : n’est-ce pas là le « méchant danger » du philosopher (p. 90) ? On note que Schelling se sert, comme tous les penseurs depuis Kant, de la réfutation de l’idéalisme (la pensée produit l’idée de l’effectif, non l’effectivité même, cf. p. 95). Heidegger lie l’éthique à la « contrée », à la spatialité du séjour humain, à la « danse » du temps dans le libre espace. En réhabilitant la certitude absolue de l’existence, Kant invoquait l’expérience de l’espace. C’était en effet par un même mouvement que Berkeley doutait de l’existence de l’espace et du monde. La restauration de l’expérience positive de l’existence passe donc par celle de l’espace, non comme « chose » mais comme forme de l’expérience. Ainsi, comme l’éthique repose elle-même sur l’essence imprévisible, a posteriori, de l’existence dont on ne sait qu’une chose : qu’elle est parce qu’elle est (daß es ist, dadurch, daß es ist), l’indubitabilité de l’espace est du ressort de la morale.
Mais il n’y a pas que la spatialité. A côté d’elle, la logique schellingienne trouve une raison qui est puissance infinie du connaître, comportant en elle la puissance infinie de l’être lui-même (p. 82) sans pouvoir l’atteindre effectivement, mais seulement comme Possible. C’est pourquoi la philosophie positive de Schelling articulait une théorie des puissances sur trois moments historico-théologiques : mythologie, monothéisme, incarnation. Ce discours sur Dieu suppose une logique du « pouvoir-être » que la raison trouve immédiatement en elle, et qui n’est ni étant ni non-étant – et par conséquent fait signe vers l’être en tant qu’Existence.
Ce nouveau couplage de la spatialité et de l’historicité nous font remonter de l’éthique à l’ontologie. Il faut dire adieu à « une représentation du monde sûre d’elle-même et certaine de pouvoir organiser le monde à sa guise ». Le nouveau Commencement de la pensée (Anfängnis) s’annonce ainsi, p. 88-90 :
Heidegger et Schelling partagent donc la même idée essentielle : il faut maintenant trouver une autre pensée qui soit capable de rendre compte de l’imprépensable (et donc d’abord du « positif » selon Schelling, c’est-à-dire de l’existence) tout en acceptant son incapacité à le comprendre (begreifen) et à le conceptualiser. Par conséquent, cette autre pensée doit s’élever à partir de la reconnaissance d’une impuissance fondamentale, elle doit se déployer sur la base d’une humilité vis-à-vis de ce qui nous dépasse mais que nous avons à penser… Cette pensée que recherche Heidegger … doit subir « la douleur de l’adieu »…, deux des caractéristiques principales de ce que Heidegger nomme l’Anfängnis… Par conséquent, il va de pair avec un « détachement de tout » … qui rappelle, là encore, le vocabulaire de Maître Eckhart…. En effet, le commencement comme Anfängnis, … ne peut pas être décrit ni exprimé par des mots, puisqu’il précède la pensée, qui seule peut dire.
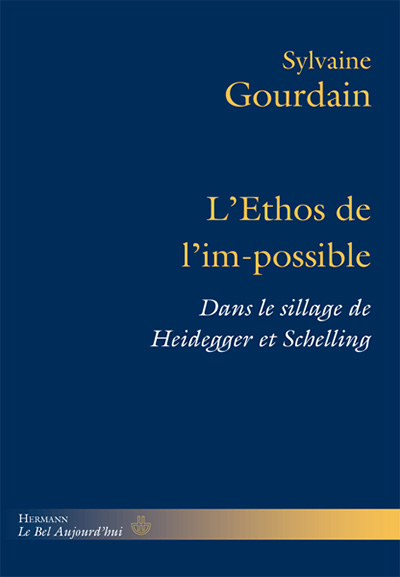
Heidegger accompagne Schelling dans son dépassement de l’auto-position du Sujet et de l’illusion de « saisir » Dieu et d’arriver à l’existence par concept. Cet abandon est donc en un accomplissement (conformément à la logique schellingienne, qui procède par principe d’identité subtil, où le parfait « est » l’imparfait parce qu’il sait l’assumer). La piété ne demande pas, elle questionne, elle prie pour méditer et louer : celui qui demande sait ce qu’il demande et s’attend à le reconnaître s’il est accordé. Schelling parle d’acte libre de l’esprit, Heidegger va plus loin, et refuse l’idée d’échange : tout perdre pour tout gagner. Il parle de promesse, non de pronostic, même risqué. Attitude qui reprend la position de Luther face aux actes, dont la valeur morale vient d’être inspirés par la Grâce. La liberté du chrétien (die Freiheit des Christen) est analogue à la liberté du sabbat : effacer de ses œuvres tout trait de travail servile, d’esprit d’échange. Œuvrer et penser ne se distinguent plus ; le salut est la pensée de Dieu. Luther intégrait les œuvres à une expérience de pensée où travaillait l’Autre en nous, parlant au cœur humain pour le changer. Il y avait là matière à réflexion, semble-t-il.
Nous retournerions donc, en ce qui concerne Heidegger, la phrase suivante, p. 92 :
« S’il faut tout laisser derrière soi, ce n’est pas pour demeurer dans le désespoir le plus profond, mais pour permettre à l’imprépensable de se manifester, pour créer l’espace qui peut l’accueillir. » en suggérant cette formulation inversée : « Si l’imprépensable se manifeste, si l’espace qui peut l’accueillir se révèle, alors il faut tout laisser derrière soi. » L’interdiction de s’autolégitimer est fidèle à l’esprit de la Réforme : ne pas partir de la causalité par libre-arbitre, mais de la grâce, du don (gratia ne signifie pas autre chose). Nous lisons, p. 93 :
La pensée … se retire de cet enchaînement d’actions par liens de causes à effets, mais cela ne veut absolument pas dire qu’elle se réfugierait dans l’inaction et dans la passivité, mais bien plutôt qu’elle refuse de s’immiscer au sein du système régnant en se soumettrant purement et simplement à son mode de fonctionnement. Or, c’est justement par là qu’elle va pouvoir acquérir la distance nécessaire pour pouvoir réellement méditer sur ce monde et de la sorte agir. Loin de se fonder par elle-même et de s’autolégitimer, cette pensée se donne une « tâche » (Aufgabe) à accomplir, une tâche seulement préparatrice et non fondatrice, celle de contribuer à « l’éveil d’une disponibilité de l’homme » pour une autre possibilité du séjour au monde, pour une autre attitude, autrement dit pour un autre ethos.
Le mot Aufgabe comprend celui de Gabe (don) : le devoir, la tâche, sont des manifestations immédiates de grâce (Huld, Gnad) que Heidegger célèbre dans ses multiples gloses du « es gibt » (il y a ceci et cela de donné). Sylvaine Gourdain a ainsi parfaitement raison de rattacher la voie précoce de l’herméneutique de la facticité (qui souffla à Heidegger sa réflexion sur le péché chez Luther) à l’Abandonnement (Gelassenheit), qui délaisse le vouloir et accepte les leçons de la passion (Leid) et de la compassion (Mitleid).
Cet ethos ne part pas de la lex romaine (cf. p. 94) mais de la fides abrahamique ; elle n’oriente donc le devoir sur aucun contenu préétabli au destin de l’homme singulier concerné par l’injonction, mais sur l’à propos d’un moment révélé, qui montre ce qu’il faut faire : la lecture de la Bible fournit des signes. Le souci est douloureux : il ne peut prévoir le contenu de l’injonction morale, du « heißen ».
Le lien entre identité (Selbstheit) et éthique se heurtait pourtant à l’analyse schellingienne, sans complaisance, du penchant inévitable de l’individu à l’égoïté pathologique, puisqu’il puise dans l’Origine de la vie de quoi nourrir sa spécificité et que l’Origine étant chaotique et sans limites, cet emprunt dégénère toujours en injustice, chacun se repliant sur ses acquisitions, l’individualisme n’étant autre chose qu’une « Verstellung », une contrefaçon du macrocosme, du Tout, dans un individu se prenant pour un monde. Heidegger résout la difficulté en sortant définitivement de toute pensée de la subjectivité, y compris de l’intersubjectivité. Si en effet Ce qui focalise tout Sens, c’est le Même Imprévisible, les êtres humains ne sont pas distincts par leurs différences (qui ne sont que les modes de ce Même, donc constituent des éléments à associer harmonieusement, non à opposer entre eux), mais par la structure même de toute relation : l’altérité (Andersein). C’est elle qui donne son sens à toute injonction : l’Autre n’est pas un au-delà, dont l’existence ne serait que possible, et par conséquent hors du champ moral. L’autre est la pure existence, dont il n’est pas possible de se demander si elle est possible, d’où le rappel du terme derridien : im-possible (p. 94). Autrui incarne la loi de l’être, cet imprévu, impensable. L’éthique jetée dans l’espace du monde l’est donc au carrefour des existences singulières, ce Carrefour où appelle la Sagesse. Voici, p. 95, la matrice schellingienne morale de la future Existenzphilosophie de Heidegger, où « positif » donne le « la » et le « là » au futur « existential » :
Le positif est précisément ce qui ne se laisse « savoir » qu’a posteriori, et qui ne peut jamais être connu d’avance. Il s’oppose au négatif, qui, lui, est construit a priori, dans un système qui s’appuie sur les modalités de la possibilité, l’effectivité et la nécessité. […] L’effectivité, pour être pensée comme telle, implique de partir de l’existence, qui, elle-même, ne tolère aucune possibilité au préalable. L’existence est en effet un principe de liberté et tout à la fois la manifestation d’une liberté absolue et, comme telle, elle ne peut pas remplir un programme de possibilités qui lui préexisteraient. L’existence doit toujours être imprévisible, imprépensable, et stupéfiante.
Notre auteure montre que la reprise heideggérienne de la préséance husserlienne du possible sur le réel est, malgré les apparences, paradoxalement compatible avec l’affirmation de Schelling, que l’effectivité précède la possibilité (p. 99). Car il s’agit de possibilités incrustées dans l’être, que l’existant se doit d’assumer – adaptation plutôt qu’appropriation à ce que Schelling appelait les puissances de l’être : les manifestations historiales de l’Existence. L’identité (das Eigene) grandit en adoptant ces possibilités de l’Ereignis, cet Ami qui vient dans la Maison de l’homme. Cette alter-ontologie (comme on parle d’alter-mondialisme) passe par l’Amour pour relier les existences humaines entre elles grâce à un Lien à la fois existant et absolu : c’est ce message explicite chez Schelling dont notre auteur lit l’écho chez Heidegger. Cela suppose un « empirisme supérieur » (p. 95), ce que le jeune Heidegger, féru de Rilke, appelait une « philosophie de la vie ». L’expérience de la pensée (die Erfahrung des Denkens) concerne la diaphanité de l’être au sein de l’étant : le « daß » (le fait que) éclaire le « das » (ce qui est). La « merveille des merveilles » n’est point tel ou tel étant visible, mais la présence de l’Invisible ici même, inapparente. Schelling voit que la critique de la raison est ambivalente : héraut d’un triomphe politique plus que témoin d’une crise religieuse, elle n’éclaircit pas le statut de l’être en tant qu’être ; sa morale est bancale, prompte à glisser dans la législation d’un Etat dominant. Kant enseignait à sauter dans la raison hors de l’expérience aveugle ; Schelling apprend à retrouver l’expérience du pur existant, ce « Seigneur de l’être » qui « pose » la liberté de l’être sans dépendre d’aucune idée (cf. p. 100), quoique donné à penser par la raison humaine à titre de bien interne.
La raison sort ainsi d’elle-même pour trouver l’être en elle. Cette pure substantialité essentielle (p. 102) de la raison est en même temps pure Relatio. Malgré les différences – Schelling va vers la volonté, Heidegger vers l’abandon de la volonté – on sent l’analogie entre une nouvelle définition de la liberté, chez Schelling : la liberté de l’être ouvre la liberté de la raison à l’infini – et le thème heideggérien de la liberté comme Espace Ouvert (die Freie, das Freie). « Die eigentlich freie Philosophie » de Schelling est parente de la pensée heideggérienne de la liberté comme « das eigentlich Freie », l’authentiquement Libre (p. 102). L’interprétation de l’identité (das Eigene) chez Hölderlin, comme aller-retour entre le même et l’autre, le familier et l’étranger, l’installation et la migration, illustre le partage, par nos deux penseurs, d’une autre conception de la dialectique, proche de l’itus et redditus de Pascal, et, en amont, de la tension héraclitéenne. Nous lisons, p. 102-103 :
La liberté n’est donc plus liée à une auto-affirmation ni même à l’autonomie, mais elle s’éprouve dans la confrontation à ce qui ne vient pas d’elle et elle se montre dans l’ouverture à ce positif. C’est en se dessaisissant d’elle-même que la philosophie devient libre, libre d’elle-même, et libre pour l’existence, […] doublement libératrice : d’une part, elle libère l’existence en l’émancipant de l’emprise du concept, et d’autre part, elle libère le sujet philosophant en l’incitant à une décision qui lui permettra de recevoir la plus haute des libertés, la liberté sur soi-même. […] D’une certaine façon, la raison, dans la philosophie positive, accepte de n’être plus vraiment elle-même, puisqu’elle se reçoit de son autre radical et imprépensable, celui-là même qu’elle ne peut pas penser comme tel. La raison … ne se réveille de sa torpeur que si elle prend la décision de se déposséder d’elle-même jusqu’au bout, afin d’acquérir sa liberté dans le renoncement à elle-même et dans l’accueil de l’existence en son surgissement par essence infondé. La raison qui triomphe est en réalité celle qui accepte de se plier au réel.
II. MYSTERE ET PERIL DU MAL (p. 105-176)
Pourtant, c’est autour de l’ambiguïté du concept de volonté que se noue la critique, par Heidegger, de ce maître d’abord vénéré, en 1936. En 1941, Heidegger assimile Schelling, à cause de sa détermination de l’être comme volonté à une philosophie de la Subjectivité au sens de Fichte, une pensée du Substrat à deux faces, l’une comme Fond(s), l’autre comme Entendement (p. 106-107), identité repliée sur soi dans le rapport à soi, retrouvée par Nietzsche sous forme du se vouloir-plus-puissant, volonté de puissance. Ce qui déçoit Heidegger est donc le repli d’une identité qui semblait, en passant du négatif au positif, s’ouvrir à l’altérité de l’existence comme telle. Heidegger se méfie de ce concept d’être qui, de son premier site, im-possible – l’être est, un point c’est tout – ek-siste dans l’étantité et, y in-sistant, suscite la dualité entre émergence de la potentialité et besoin de réalisation. Aucune promesse de rectitude dans ce glissement de sens du possible, qui de la libre possibilité qui s’énonçait dans la philosophie négative, retourne à la massive dualité de l’être, aristotélicienne, où Dieu pur in potentia, devient Dieu créateur, in actu, initiant le Mal, puis décidant, devant la catastrophe, de se faire naître pour tracer un Salut… Si le non-vouloir premier se dissout dès que le vouloir apparaît, cela change le Don de l’être en cadeau empoisonné. Les spéculations théologiques sur le devenir de Dieu présentent un être qui se fait étant : l’im-pré-pensable n’est plus accessible qu’à la pensée, et ravale le saint non-vouloir originel à l’instinct (p. 117).
Notre auteure se fait l’avocate de Schelling : elle montre que l’engendrement divin d’une figure qui reconcilie le non-vouloir indifférent et la volonté de différenciation – la deuxième personne de la Trinité, le Christ – pose une volonté d’existence dépassant définitivement la première forme de l’Amour, le non-vouloir, mais que c’est une volonté d’existence de l’autre en faveur de l’autre. La volonté pure, qui est aussi bien non-vouloir, car elle ne veut rien, est certes l’abyssal imprépensable, mais elle ne se connaît pas. La volonté d’existence introduirait le mal par crispation sur l’étant. La volonté d’existence de l’autre est donc la seule qui bénit le vouloir-l’être (p. 113). L’extase pure est déficiente, l’extase tendue est perverse, l’extase médiatisée est salutaire.
Et si y ajoute une anthropologie théologique, l’homme est le site premier du drame divin, de l’opposition entre la volonté ouverte, universelle, et la volonté crispée sur telle ou telle étantité. Or, lieu-tenant de Dieu par dévolution, il n’exerce cette fonction qu’illégitimement, car il se met volontairement à la place de Dieu. D’où le Mal, par l’homme, donc, non par Dieu. Seul un Dieu fait homme corrige cette confusion. Le Christ est le Dieu qui, mis à l’envers par l’homme, s’inverse et se dresse : grâce à lui, Dieu sauve Dieu. Dit en termes philosophiques : le vouloir sauve le vouloir. Le salut de la Volonté est son Shabbat, après six jours de tribulations. Mais Heidegger rejette de plus en plus toute sorte d’apologie de la volonté. Ce que constate notre auteure, p. 119-120, :
Le mouvement propre à la volonté est paradoxal : si la volonté est mise au service de l’altérité, alors elle permet par là même de préserver l’ipséité et de sauvegarder une harmonie des différentes singularités. Si, en revanche, elle se dresse contre l’altérité en voulant s’imposer elle seule, alors elle provoque la destruction du tout, ce qui se retourne finalement contre elle-même. […] Heidegger se rend de plus en plus compte du péril que représente la volonté pour l’homme moderne, car elle le plonge dans l’illusion qu’une maîtrise totale du monde est possible, ce qui ne concourt en réalité qu’à sa perte. […] Il lui importe à présent d’exhiber l’évolution qui a eu lieu dans sa pensée, à savoir le renoncement net à toute structure volontative.
Mais Heidegger est un fin commentateur. Il étudie, dans les Recherches sur la liberté humaine, la connexion entre le fondement abyssal et le Mal, en montrant que Schelling, plongeant dans l’essence pré-identitaire de Dieu (p. 122), y découvre en fait le Mal. Heidegger savait gré à Schelling d’être un des rares théologiens qui n’assimilât pas Dieu à la toute-puissance, confusion contre laquelle il s’est maintes fois élevé. Schelling, dans le contexte leibnizien d’énergie potentielle Potenz, oppose le « fond » à « l’existant » qui en est, à chaque fois, l’individuation, pour élever les droits de la personne humaine contre la figure d’une transcendance divine qui, prise en tant que telle, n’est que la réserve chaotique de la fécondité d’être, a-morale. Si on se souvient que Schelling, tout comme Hegel, pointe les moments ontologiques de l’histoire des religions, il est bon de rappeler que le premier stade de la divinité n’est même pas unique, car non unifié : le non-dieu précède le dieu, comme le montre la symétrie des lettres hébraïques du mot « dieu » (אל signifie « dieu », לא signifie « non »). Schelling refuse donc tout attribut éthique à cette forme première, chaotique, de Dieu. P. 124, Sylvaine Gourdain décrit la forme que prend, chez Schelling, cette pensée :
La figure du Grund représente un contre-modèle au fondement métaphysique classique, car il ne vient pas rendre raison de ce qui existe ni le justifier (begründen) mais il résiste et se rétracte en soi, il est le sol fuyant de l’existence qui s’effondre dès que celle-ci surgit. Avec le fond, Schelling pointe en réalité une forme d’impuissance originaire affectant l’être divin, que celui-ci a pourtant toujours déjà surmontée en la conservant en lui (aufheben) selon une forme inverse à la dialectique hégélienne, puisqu’ici, c’est la négation qui précède l’affirmation, le non-moi qui devance le moi. Le fond désigne ce que Dieu trouve en lui toujours avant lui, cet être nécessaire avec lequel il doit composer, ne pouvant d’abord le poser, et qu’il doit porter et donc assumer en lui pour exister lui-même. … Le Grund en Dieu est l’impuissance (Ohnmacht) qui jamais n’existe comme telle, mais qui dans sa non-existence constitue le sol depuis lequel s’érige la puissance (Macht) […] Il constitue l’obscurité originaire en Dieu qui n’a cependant pas eu le temps de demeurer dans son obscurité, puisque Dieu l’a toujours déjà uni à lui dans la lumière de son existence. En cela, il incarne en Dieu « une source de tristesse (ein Quell der Traurigkeit) qui cependant ne parvient jamais à l’effectivité (nie zur Wirklichkeit kommt), mais ne sert qu’à l’éternelle joie du surmontement (zur ewigen Freude der Ueberwindung dient). » […] Le fond ne peut pas non plus n’être qu’un moment obscur que l’existant pourrait définitivement écarter de lui. […] Le fond est la marque des ténèbres qui se situent au fond de Dieu et qui ne sont certes pas Dieu, mais contre lesquelles Dieu ne peut rien.
Quiconque connaît un peu la Kabbale aura reconnu là une dialectique bien plus ancienne que l’hégéliano-platonicienne, quoiqu’on en perçoive l’écho dans la Sainte Inquiétude de Hegel. Schelling apprit de là à effacer le concept romain d’une toute-puissance absolue et accablante (p. 125), qui n’est pas celle de Spinoza ! L’étude de détail du cours de 1936, nous montre que la position, tant de Schelling que de Heidegger, vis-à-vis de Spinoza, est subtile. Il constate que sans le panthéisme, jamais Schelling ne se serait libéré de l’ontothéologie et de l’exégétique dogmatique. L’amor intellectus Dei lui inspira l’idée d’intuition intellectuelle, puis lui révéla un conatus propre à la vie éternelle qui n’est autre que l’épanchement tout maternel inclinant vers autrui le don de l’existence. La simple force d’être (Können) devient aptitude, puissance prête à agir (Vermögen), qui recèle une inclination (ein Mögen) envers la créature. Heidegger scrutera ces thèmes.
L’individuation posant les limites, elle contredit le fond d’où elle vient. C’est donc à l’intérieur du monde créé que Dieu s’oppose à lui-même, en ses deux volontés, l’une de Fond, l’autre d’Amour. Pour se sortir du danger d’imputer le Mal à Dieu, Schelling n’hésite pas à invoquer l’imagination divine, la création d’une image de soi comme figurant ce qu’il n’est pas – car Dieu, avant d’être un soi, n’était que vie indifférenciée, matière où l’entendement puisait les formes (Ein-bildung, p. 129). Schelling ne refuse pas l’essence de la matière à la nature divine, comme on le voit. L’unité dissimulée au sein de la matière, la singularité émergeante, éprouve un désir bipolaire : ouvrir sa forme propre et contenir la matière dans une permanence qui épuise le fond d’où sort la forme. Ces pages du livre de Sylvaine Gourdain sont essentielles pour son propos, à savoir dégager un ethos original. Car la lutte entre le bien et le mal, qui est la Saga éthique, se noue autour de « la présence refoulée mais jamais entièrement disparue du chaos premier et sans ordre » (p. 131), d’où l’effort de l’entendement pour retenir la pulsion d’aspiration de la vie. Subsiste malgré tout une latence du Fond, rétive à l’intellectus comme à l’amor, chez l’individu comme dans les âges de l’humanité.
L’auteur élabore, en ces pages, un parallèle constant entre les Recherches sur la liberté humaine et le commentaire, par Heidegger, du livre Théta de la Métaphysique d’Aristote, ce qui colore l’étude de la dynamique de la Force, chez celui-ci, d’une tonalité morale étrangère au propos aristotélicien, chez qui l’alogique n’est pas le mal au sens biblique, mais une possibilité pour l’homme de mener une vie ou de tête brûlée ou de héros ménageant ses entraînements. Toutefois, définissant le Fond – la Matière de l’être, l’Hylé première – comme « le pouvoir de l’impossible qui, lorsqu’il s’actualise, dans sa folie destructrice, se retourne finalement contre soi-même » (p. 136), notre auteure accorde les violons du kabbaliste qu’est Schelling à la lyre de l’amoureux de tragédie grecque qu’est Heidegger : avant le « commencement », à savoir l’individuation des étants au sein de la division entre lumière et ténèbres, la Nécessité se ménageait le champ agonistique entre monstres et dieux aux belles formes ; sur le Tohu-va-Bohu, Vide informe, planait l’Esprit qui n’avait pas encore « eingebildet », imaginé, formé. Encore un mérite de ce livre : détruire le préjugé d’une opposition entre civilisations, entre Athènes et Jérusalem, entre Occident et Orient, entre morale païenne et morale biblique, d’où son allusion à Plotin, p. 132 (dont la conception de l’Hylè rend bien compte des spéculations schellingiennes sur le Mal) – le néoplatonisme fut l’antique truchement de la tolérance. Les variations de pouvoir entre la force singulière aliénable au mal sauvage du Fond, Janus de pouvoir et de magie, et l’aptitude au bien et au mal, qui responsabilise la liberté, sont le propre de toute réflexion éthique. La Séparation, concept essentiel de l’Individuation, fait apparaître le mal comme mal, trait fondamental de l’être qui touche la terre toute entière. Loin de définir le mal par la privation, comme le fait le Schelling plus tardif, Heidegger suit ses premières intuitions. On lit p. 142 :
Le mal est ce qui fait éclater le transcendantal dès son émergence, puisque tout ce qui est est traversé par une obscurité irréductible et insaisissable. Mais il faut aussi abandonner toute moralisation du mal, qui revient à un amoindrissement considérable et dangereux de la force même du mal, et qui est en soi la marque de l’hybris de l’homme se croyant capable d’éviter le mal en le cantonnant à un domaine de valeur. Une telle moralisation du mal révèle déjà la puissance insidieuse du mal en nous, qui se donne les apparences du bien pour mieux agir.
L’auteur signale ainsi le déplacement de l’objet du souci éthique : il s’agit, avec l’homme, de la terre, que dévaste le mal qui aliène l’esprit : l’éthos détecte dans le dieu Progrès la marche sinistre d’une domination du monde humain sur la terre naturelle, si bien que l’humain devient l’inhumain. Ordre, sécurité, certitude, ces « valeurs » morales, se révèlent n’être que ce qu’elles sont : des valeurs d’échange d’un marché guidé par un projet de planification. Ce n’est donc pas la catastrophe qui provoque l’appauvrissement du sens du monde en figeant sa compréhension (p. 146), c’est l’inverse : le monde dominant la terre perd son sens en coupant sa relation avec son autre, la Nature ; la compréhension de la vie – de l’imprépensable – se bloque, encapsulée qu’elle est dans des notions de classe, de genre, terreau idéologique des catastrophes. La suspension du pouvoir de penser, du fait du règne des chiffres et de l’informatique – la machine à parler – répand un mal qui se détecte à ce qu’il se présente comme une amélioration de la condition humaine. Mais il n’y a là aucune faute de l’homme, aux yeux de Heidegger : c’est l’être qui nous a abandonnés (Seinsverlassenheit, événement qu’il ne faut pas confondre avec l’abandonnement à l’être, Gelassenheit). C’est cet abandon qui laisse la place au no man’s land géré par une science qui ne pense pas.
En ce sens, nous ne sommes plus du tout dans l’atmosphère schellingienne, ce que montrent les textes tardifs – que notre auteure étudie avec précision, comme ce dialogue imaginaire entre deux prisonniers de camp en Russie, écrit en 1944-1945, alors que Jörg et Hermann, les deux fils du couple Heidegger, sont effectivement captifs là-bas (figure poignante de l’im-possible !). La question de l’essence du mal est au centre de l’entretien : étant là par décret d’autrui, les détenus sont à même de percer dans la volonté l’origine du mal. Il ne s’agit plus, comme Schelling le faisait, de montrer que la volonté qui se veut elle-même est « l’enfer de l’homme », mais que tout vouloir est impulsion à dominer (Herrseinwollen) (cf. p. 150). Cette stigmatisation rejoint la dénonciation des Recherches sur la liberté : autorité, commandement (der Befehl), vont de pair avec l’aliénation du lieu dans le plan et l’embrigadement des singularités dans des genres et des nombres (Heidegger, depuis sa thèse de 1916, lie toujours les deux, en leur opposant l’intégrité de l’haeccéité).
Heidegger en déduit un chiasme entre l’oubli de ce qui précède tout possible, oubli qui recouvre tout être de calculs de possibles – et « l’actualisation forcée, un passage obligatoire du possible à l’effectif, plus exactement, une élimination du possible par le passage à l’effectif » (p. 151) Tandis qu’une même liberté gît dans le réel (real), qu’il soit l’imprépensable excluant le possible ou l’éclosion du possible au sein de l’existant individué et désormais pensable, l’aliénation naît d’un effectif (wirklich) qui réduit tout à sa seule effectuation, biffant la différence entre impossible et possible. Le Gestell est ce mouvement de la volonté qui donne l’impossible pour but (p. 159). Une course vers l’impossible entraîne donc tout le réel, tant l’im-possible que le possible, au nom de l’effectif par faisabilité (Machenbarkeit p. 154). Cela révèle l’accord entre l’imprépensable d’avant le possible et le possible déployé par l’existence abritée dans la pensée. Nous lisons, p. 160 :
La disparition du possible et de l’impossible, tous deux ingérés dans l’effectif, marque le caractère funeste de cette époque moderne. Les « possibilités sans fin » de la technique signifient tout à la fois la négation de l’impossible.[…] En effet, l’impossible semble faire affront à l’apparente et orgueilleuse toute-puissance technologique de l’homme, si bien que l’on met tout en œuvre pour le maîtriser et le vaincre. L’idée même d’impossible contrarie la démesure de l’être humain dans ce contexte de Machenschaft.
La comparaison entre le Fond schellingien et la Terre heideggérienne (cf. p. 158) montre certes une différence : Schelling pense en termes de procession génétique, Heidegger pense en termes de dualité. Mais le Fond, présenté dans son penchant à l’existence, est analogue à la Terre engagée avec le Monde dans une mutualité spatiale essentielle. C’est pourquoi jamais la Terre n’est, pour Heidegger, le site du Mal, et que, malgré son statut dans le Quadrat, elle se distingue par essence de l’être comme Ereignis, dont elle n’est qu’un des acteurs.
Heidegger dénonce alors aussi, chez Nietzsche, l’autisme de la volonté devenue principe de l’être, volonté de volonté, éternel retour du semblable – et non du Même ! Elle va en effet de pair avec l’unidimensionnalité créée par un Monde qui nie la Terre, ainsi qu’avec le clivage de l’identité nationale quand elle se ferme à l’étranger, thèmes heideggérien centraux des commentaires poétiques de Hölderlin, de Trakl et de Hebel. Nous restons dans la promotion de la « dualité » (la « Undheit », dit parfois Heidegger) sans laquelle l’éthique ne reçoit aucun appui ontologique, et que détruit « une tendance généralisée à l’uniformisation » (p. 153). La folie de la puissance (Macht) issue du faire (machen) est cette magie noire que Heidegger nomme « menées » (Machenschaft) : on aura reconnu là les causes souterraines de ce qui s’est présenté dans l’histoire comme le « machinisme » de la grande industrie déployé par l’ordre bourgeois (p. 154). Mais, comme chez Marx, il ne faut chercher dans ce malheur nulle intention, nulle faute de l’homme : c’est l’être, son déploiement historico-géographique, qui est le péril (die Gefahr, p. 162). En l’être est l’origine de la structure duelle de tout événement, manifestation et dissimulation. Le problème du mal est donc que le péril se cache dans le bien, et qu’on ne perçoit pas quand le monde éclipse la terre qui lui est pourtant ontologiquement appariée (p. 165). Le mal n’arrive donc pas du fait d’actions humaines : (niemals ein menschliches Gemächte, p. 165). Faisant écho à Pascal, dûment célébré dans Qu’appelle-t-on penser ?, Heidegger proclame que tout notre devoir consiste en la pensée, à savoir à la considération de l’essence de la manifestation et de la dissimulation, chacune dans son ambiguïté. Penser l’effacement de l’imprépensable par le Gestell restitue l’expérience de sa présence. Nous lisons, p. 166 :
Dans cette perspective, le Gestell est donc considéré comme une « époque de l’être », … c’est-à-dire une mise à l’abri et une retenue. […] Autrement dit, le Gestell lui-même est la forme moderne de déploiement de la Lichtung, il est donc une figure que prend l’imprépensable, et en cela même, il constitue l’espace à partir duquel l’homme peut acquérir sa liberté propre. […] La liberté de l’homme consiste à … prendre gare à ce qui advient, à ouvrir les yeux afin de se savoir toujours déjà pris dans le déploiement du Gestell, et, à partir de là, à recevoir sa liberté propre.
Méditer l’être précédant toute pensée, c’est comprendre que le mode de dévoilement actuel de l’être est un mode de dévoilement dissimulant sa propre dissimulation (p. 167) : c’est se saisir du mode actuel de la Liberté. Car l’être est toujours Liberté – voilà une leçon de Schelling que Heidegger n’a jamais reniée. Penser la liberté, c’est se rappeler son origine involontaire : c’est là une rupture avec l’intentionnalité scolastique et le transcendantal kantien, qui réduisent la morale à un sujet « tendu ». Merci à Sylvaine Gourdain (p. 167-169) d’avoir à la fois :
1° rapproché l’attribution schellingienne de la liberté à l’être même, et non plus à la subjectivité humaine – avec le deuxième tournant heideggérien, qui outrepasse la positivité du premier, celui de l’Ereignis, pour penser l’Enteignis invitant carrément au non-vouloir ;
2° cherché dans des textes d’avant le tournant, encore pleins d’herméneutique existentiale orientée sur la volonté d’écouter la voix de la conscience morale (Gewissenhabenwollen) les germes de cet Eräugnis que je traduis par le vieux mot français « advision » : la vision sensée d’un éthos, celui de l’abandonnement. Il s’agit d’un texte rédigé en 1930, De l’Essence de la Vérité, rarement exploité, qui contient un schibboleth moral essentiel, entre l’ex-sistance qui re-specte et l’in-sistance qui, si j’ose dire, fait du rentre-dedans ;
3° rapporté ce pointage de l’obstination humaine à violer tout mystère aux textes plus tardifs concernant le Gestell, pour montrer qu’il n’y a dans l’erreur humaine nulle faute, mais une conséquence du mode moderne, historial, par lequel nous est dévolue notre relation à l’être. S’accuser du viol de l’étant est donc un des effets de ce viol même : le libre-arbitre n’est qu’un des avatars de la volonté de puissance. Cette auto-accusation de l’humanité n’est qu’une illusion découlant de la dissimulation même du fait que l’être se dissimule à nous !
Nous lisons ainsi, p. 168 :
C’est du mystère intrinsèque au déploiement de la Lichtung que vient le péril, et c’est en lui que s’enracinent également l’« insistance » et « l’errance ». […] L’homme se tient livré à l’étant dans son être. […] Mais, en raison du mystère du déploiement, … l’homme a toujours tendance à se méprendre au sujet de la dissimulation et à négliger le mystère lui-même. Il se comporte par rapport aux étants en oubliant qu’ils proviennent d’une Lichtung originaire, en laquelle lui aussi se tient. Si l’on rapporte cette considération à l’époque du Gestell, on peut dire que l’homme est plongé dans une préoccupation agitée, dans une course effrénée à la performance, dans une action toujours plus fébrile et précipitée, dans un faire et un vouloir toujours plus avides et affamés, sans voir que cette préoccupation, cette course, cette action, ce faire et ce vouloir ne sont que des formes différentes de la « destination » de l’être comme Gestell et qu’à une autre époque de l’être, un tout autre type de rapport à l’étant serait possible.
L’espace, c’est l’entre-deux entre terre et monde – entre fond et existence – et c’est lui qui est le sol de la morale, lui pour lequel le regard doit se libérer. Il est clair qu’ici, la référence de l’éthos au Lieu est intimement connectée avec le Temps historique : la géopolitique ne pourra avoir de suite bénéfique que comme réflexion (Besinnung) géo-historique.
Notre auteur n’a donc pas tort de remplacer le concept de culpabilité par celui de responsabilité, dans un sens nouveau, libre de libre-arbitre, si l’on peut dire. Savoir quel est notre pouvoir (Vermögen), ce n’est pas nous accuser ou nous tester, mais sentir la double orientation possible de l’être, vers l’épanouissement ou le désastre ; c’est être à l’écoute (hören) de la situation. Sylvaine Gourdain (cf. p. 174-175) rappelle que « Vermögen », comme « Möglichkeit », se rapporte à un tout autre auxiliaire de mode que « können » (avoir la puissance) et ignore le « dürfen » (avoir le droit de son côté) : il se rapporte à « mögen » : bien vouloir, bien aimer, incliner vers (« ich mag dich » veut dire : « ich liebe dich »). Notre auteur retrouve là, dans sa lecture de la Lettre sur l’Humanisme, la tonalité schellingienne qui étend à l’être l’amour infini. Mais Heidegger montre la contradiction de Schelling : dire l’être « aimant » abolit toute domination, et l’homme n’a point reçu cette seigneurie sur l’étant qui copierait celle de Dieu sur l’être, il n’est que berger de l’être. Le premier acte de l’éthos est donc d’entendre ce qui, avant toute pensée, se présente à la pensée, écouter ce qu’il en est. L’amour, c’est la pensée qui adopte l’étant. Le verbe « annehmen » signifie accepter, adopter, embrasser une cause, une foi, se charger de quelqu’un, en prendre soin. Il renvoie au concept éthique central d’Être et Temps, le Souci. Mais ce n’est pas l’homme qui se soucie de l’être, c’est d’abord l’être qui se soucie de l’être pensant, l’homme, et le lui prouve lorsque l’homme aime penser.
Ainsi, être renvoyé à soi, pour l’étant, c’est se penser en rapport à l’être, non se vouloir. Sylvaine Gourdain a raison de corriger la traduction de Roger Munier, en substituant « aimer » à « désirer », terme qui dit la tension d’un vouloir. La pensée est un effet de l’amour que l’être porte à l’étant : elle ne veut rien. Mais elle n’est pas sans agir : penser, c’est faire. La pensée fait être ce qu’elle laisse être, et laisse être ce qu’elle fait être (seinlassen). Non seulement l’essence, mais l’existence de la pensée provient d’un amour venu d’ailleurs, de la Différence appelée, depuis le Tournant, Ereignis, à savoir : l’offre, faite par l’être, d’une Réception du déploiement des choses. User de sa capacité à penser est donc jouir d’un don fait par amour, par lequel l’être ne s’impose plus comme réalité brute, imprépensable, mais, parce qu’il s’efface en donnant, comme réalité portant sa propre possibilité (Möglichkeit). L’avalanche de verbes actifs – l’être aime, donne, offre, permet, fait et laisse être, etc. – révèle une Force (eine Kraft) qui nous maintient dans l’élément où nous pouvons être nous-mêmes, à savoir : humains ; mais ladite force est paisible (still). L’élément de l’action humaine est donc la pensée, l’aptitude à saisir le sens de ce qui est, de ce qui n’est pas, de ce qui naît, de ce qui périt. L’homme est élu, l’homme est doué. Mais jamais d’éthos sans variété : l’eau où les poissons évoluent doit être riche en données, sinon ce n’est plus un élément, mais une arme d’extermination. Il ne suffit donc pas de penser, encore faut-il penser à plusieurs voix : car si vraiment penser, c’est penser le Même, ce n’est jamais penser pareil. Pas de Ge-wissen (conscience morale) sans Ge-spräch (dialogue).
III. L’ETHOS OU DE LA RESPONSABILITE DE L’ÊTRE HUMAIN (p. 177-273)
Sylvaine Gourdain souligne qu’on n’a guère approfondi ce que signifie, pour Heidegger, la quête du sens de l’être. Ce n’est donc pas un hasard si notre auteur commence (p. 178) à énumérer les différentes orthographes du concept d’être chez Heidegger. Mais si l’on s’éloigne non seulement du sujet, mais de la substance, alors le « substantif » qui désigne l’être se transforme en notation d’un processus relatif, comme en physique où il n’y a que des phénomènes relativistes : le mot « être » (quelle que soit son orthographe) échappe à l’espace fermé des substantifs, et doit rester un verbe qui dit l’action entre l’homme et l’être (p. 179). Nous sautons alors dans cet imprépensable dont nous savons qu’on peut aussi bien l’appeler le factuel que le possible : sauf que cet imprépensable n’est pas une « chose », mais quelque chose qui se passe entre deux référents : une relation.
Le thème de l’immanence court donc à la fois dans les textes de Schelling et de Heidegger, le « sens » de l’être ne pouvant être une direction extérieure, un but, etc. à l’homme, mais toujours un chemin intérieur à l’humanité. Mais la langue ordinaire, jugulée par le préjugé d’un être substantiel, peine à dire ce qu’il en est vraiment d’une relation, puisqu’elle semble maintenir les deux éléments en rapport chacun pour soi même au sein de la relation (cf. p.180). L’éthique part de l’Autre (das Andere) en tant que « cela » (Jenes) qui nous regarde et auquel nous devons répondre – l’Autre ouvre nos yeux sur la place d’autrui. Notre auteure déplore, p. 354, que Heidegger, qui était parti du pour-autrui, n’ait plus bien distingué, dans sa pensée tardive, l’altérité en général de l’altérité de l’autre homme. Peut-être cela vient-il, précisément, de la précession du souci du séjour commun sur le concept d’existence, celle-ci ne pouvant trouver sa place que si la communauté a fait une place à un accord pacifique entre monde et terre, entre nature et habitat. C’est là le sens de « Ereignis », appropriation humaine de la terre sur un mode autre que la domination. L’inclusion de la dimension éthique dans cette définition tardive de l’Ereignis est d’ailleurs signalée p. 181 : à nous de jouer, de contribuer à la relation, quoique cela advienne spontanément en nous, avant toute décision, au mitan de l’être où se croisent notre rapport au ciel et à la terre, et notre distinction du profane et du sacré. On ne peut partir tout bonnement d’autrui : avant d’accueillir quelqu’un, il faut lui faire de la place. L’amour doit être offrant, et nous devons d’abord nous rendre disponibles. Sylvaine Gourdain remarque d’ailleurs que Heidegger rechigne de moins en moins à employer le verbe vouloir, lorsqu’il intègrera à ses concepts celui d’amour (Mögen, Minne et même, explicitement, Liebe). Il reprend l’idée de Schelling, que le vouloir est l’Être primitif : Wollen ist Urseyn, p. 183). Pour que le mal survienne, il faut un autre vouloir : la volonté singulière de l’homme, qui se fige sur une ipséité indépendante. Sylvaine Gourdain remarque, p. 185, que pour Schelling, l’effort éthique visait déjà l’au-delà de l’être, et de son être propre, et du fond de l’être :
Puisque la vérité inscrite en Dieu requiert de l’homme qu’il imite son créateur au lieu de tenter de prendre sa place, il doit lui aussi se détacher du principe réal en lui, de son Grund, de son être. […] L’exigence éthique est donc étroitement liée, centrale chez Schelling, d’une scission… nécessaire non seulement au commencement, mais aussi au progrès de la vie, au processus de « surmontement de soi-même » [Selbstüberwindung]. […] C’est par cette scission que l’homme reçoit sa liberté la plus propre, celle de l’existant qui n’est pas tenu de s’accrocher à son être, qui est débarrassé du souci de son propre être.
Heidegger aussi fait reposer ce « surmontement » de la cruauté sur la réciprocité d’un pour-autrui qu’il décrit comme un Toi-Toi, processus qui commence par la relation. Il s’agit, on l’a vu, d’un mouvement vers le dehors (ex-sister), vers l’étranger, d’un exil même, d’une désappropriation, comme le creux féminin du vase taoïste, pour accueillir, non pour conquérir une liberté qui est là dès le premier moment de la relation. L’auteure propose donc une notion de responsabilité spéculaire.
Elle montrait en effet, au chapitre précédent, p. 175, que Heidegger détectait, dans les métamorphoses du destin, un effet de miroir, de réciprocité : en fonction du comportement de l’homme, de l’orientation de son pouvoir « aimant » (sein Vermögen), l’être advient comme fond abyssal producteur de rythmes féconds ou au contraire comme fosse sinistre du rien, « Ungrund », de même que selon l’intention du voyageur, le chemin se fait ou exil instructif, ou errance dans le no man’s land. Mais le choix ne produit une telle interaction avec l’être que s’il est fait sans calcul, engagement ne se regardant pas, considérant seulement le déploiement de ce qui lui apparaît. Le lien est donc fait non entre liberté et volonté (comme c’est le cas depuis Kant), mais entre liberté et identité : c’est le fameux « avoir à être » de l’époque existentiale, nourri de la tension vers le « propre » intégrant l’étranger, que Heidegger a appris de Hölderlin. C’est en ce sens que notre auteur cite Schelling : « Tout être doit être ce qu’il est avec liberté » (Jedes soll, was es ist, mit Freiheit sein). Identité toutefois biface, oscillation entre des contraires – chose en laquelle les deux penseurs conviennent, Sylvaine Gourdain laisse même entendre que le fameux conflit entre la Terre et le Monde, que l’art met à jour, est parent de la pensée héraclitéenne de Schelling, (cf. p. 187), L’ethos s’explicite donc en déplaçant 1° la différence être / étant vers l’opposition Appropriation / Désappropriation et 2° la décision (Entscheidung) vers l’adieu à la domination Abschied en faveur de la sérénité, comme on le voit dans le commentaire de Trakl, par exemple (cf. p. 188). Ressurgit la centralité de l’espace dans l’attitude éthique, la manière dont le « berger » de l’être paît l’étant. En fait, c’est un savoir, plus qu’un pouvoir, une sagesse avisée (Eräugnis), un amour de la sagesse, distinguant l’étant vu avec l’être de l’étant vu sans l’être, et la préservation du ravage.
Malgré la différence théologique qui marque nos deux penseurs, il y a donc une sorte de trauma ontologique, qu’il s’appelle faute d’Adam (acte intelligible, vouloir savoir le mal comme le bien), ou catastrophe d’un commencement habité par l’Esprit de la Technique. Dans les deux cas, on a l’épuisement du fond de l’être plutôt que la retenue. La déraison de la raison, pour Schelling, est un acte par lequel elle se décide librement d’entrer dans l’existence (cf. p. 191). Heidegger, par son écoute fidèle du vieux maître de sagesse et de vie, Maître Eckhart, entend la profondeur schellingienne qui sonde en nous les dilemmes de la vie divine. Car dire que Dieu se détache de son être imprépensable, refusant de s’identifier à ce Fond obscur dont parle l’Ecclésiaste, afin de ménager un face-à-face avec l’homme, comme le raconte le livre de Job – rompt avec l’ontothéologie, complice la métaphysique. Il n’y a pas de fossé entre l’attitude de Heidegger, qui lâche prise à la manière taoïste et celle de Schelling, qui prône « la liberté vis-à-vis de son propre être, le fait de pouvoir ne pas être ce que l’on peut être » (p. 193). Cette réforme de la Relation nous fait randonner de la base au sommet de l’être, de l’abri au pic découvert, sans cesser d’appartenir au Même dans sa duplicité d’attributs contradictoires, ce dont témoigne aussi la tripartition des personnes de la Trinité : car dans cette histoire-là, le concept essentiel est justement celui de la « personne », à laquelle l’ontologie doit faire de la place. Le respect, la sollicitude, le soin de l’équilibre entre le monde et la terre – ne dépendent ni de la foi ni de la théologie, mais d’un Même à quoi celles-ci se rapportent, et que notre auteur nomme l’Imprépensable. Un imprépensable qu’on ne peut penser – mais qu’on peut questionner…
Qu’en est-il, dès lors, du refus du réalisme, commun aux deux penseurs ? L’auteure l’interprète, chez Heidegger, comme la remise de l’avènement de l’être à l’être humain, dans le contexte de l’interaction entre l’homme et son environnement (p. 195). Heidegger l’identifie même au nominalisme atomique, qui détruit notre lien avec l’arbre en fleur et l’homme qui vient de loin. Être phénoménologue, c’est écouter l’être exhorter l’homme à penser (p. 197) – à penser précisément l’inséparabilité de l’être et de l’être-là. Pourquoi l’être est-il mouvant (p. 198), entraînant par ses métamorphoses l’homme qui le pense, sinon parce qu’il est le Vide au milieu du Quadrat, le lieu où se diluent les fixations ? Oui, Heidegger, antisubstantialiste, ne s’intéresse « qu’à ce qui se laisse penser sur la base de la corrélation » (p. 198-199), c’est dans de « co » (mit, mitzusammen) qu’il accueille l’imprépensable. Rechercher à quoi pourrait ressembler un séjour juste de l’homme sur terre, déployer la phénoménologie non comme épistémologie mais comme conseil, ce « Rat » dont il parle dans Beiträge, n’exclut pas mais inclut explicitement la considération du « Reste » qui, de manière abyssale, interpelle la pensée. Ce Reste, notre auteur le nomme avec Schelling la Nature. C’est la raison profonde du choix conjoint, par Heidegger, de Hölderlin et de Schelling, non seulement contre Fichte mais contre Hegel et sa Dialectique (que Heidegger compare à des rails de chemin de fer, p. 183). La notation de Sylvaine Gourdain, p. 200, – Fichte, dit Schelling, donne un coup mortel à la Nature – dit le point névralgique de l’éthos : le destin de la Nature ravagée par l’homme, péril maximal de notre époque. D’où l’entrain avec lequel Heidegger connecte le concept de liberté à l’immanence du Dieu schellingien à la Nature : car un maître dans le ciel justifie tous les maîtres terrestres. Schelling libère de la très cartésienne volonté infinie, dont la cible est explicite : la Nature. Idéaliste, antimarxiste, Heidegger inverse grâce à lui l’ordre des structures : l’esprit donne le coup d’envoi à la course du monde, et, s’incarnant en réseau technologique, se déploie sur la Terre.
Notre auteure a donc très bien vu que Heidegger a hérité de Schelling l’interpénétration (Wechseldurchdringung) d’un réalisme dû à la considération ontologique de la Nature et d’un idéalisme résultant d’une coappartenance de l’être et de l’être-là, que révèle la parole, pensante ou poétique. Car ce « Real » qu’il s’agit de considérer, ne porte-t-il pas aussi, du point de vue de l’éthique de notre temps, le nom de « Nature » ? Que Heidegger ait développé cette inclination pour la Nature dans les commentaires de Hölderlin n’est pas un hasard : ce qu’il appelle aussi « la Terre » (synonyme prochain de « Nature ») ressortit à la pensée du sacré, lequel se révèle dans un éthos spécial, l’état poétique, parallèle à la piété de la pensée, la question. Cette attitude se trouve dans la Philosophie der Mythologie de Schelling, p. 202, citation qui aurait pu l’être de Heidegger, dans une même métamorphose du réalisme en réalisme du Sacré. La voici, avec quelques modifications de traduction :
« La question qui se pose ici n’est pas de savoir quelle vue conforme à une philosophie il faut prendre du phénomène pour pouvoir l’expliquer aisément, mais, inversement, quelle philosophie est requise pour être à la hauteur de son objet, à un niveau qui lui soit identique. Non pas : comment le phénomène doit être tourné, retourné, tiré dans tel sens plutôt qu’un autre, ou rabougri, pour pouvoir être encore tout au plus explicable à partir de principes que nous nous sommes naguère proposé de n’enfreindre pas, mais : jusqu’où faut-il élargir nos pensées pour nous tenir en relation avec le phénomène. »
Sylvaine Gourdain rappelle, p. 204, que la phénoménologie doit à Schelling, plus qu’à Hegel, son fameux retour aux choses mêmes – qu’elles soient ce à quoi la pensée est redevable (Dinge) ou l’affaire pour laquelle les questeurs de vérité en viennent au conflit (Sache). La surimpression entre Schelling et Heidegger est remarquée par notre auteur (p. 205) – laisser tomber le concept, mettre le « daß » avant le « was », le constat de l’impuissance de la pensée à précéder l’être pur. Le fameux « retrait » obscur, qui cohabite avec le non moins fameux dévoilement lumineux, concerne la Nature, et interpelle ce que Heidegger, dès le début, a pointé comme « être au monde », lequel, par conséquent, se trouve toujours dans un « crépuscule », une diaphanité constitutive nommée « Ereignis », lever et coucher à la fois d’une appropriation de la Terre et du Monde. Cela, notre auteur le résume très bien p. 208 :
Penser ne veut pas dire réfléchir consciemment à « l’état du monde », mais assumer notre mode d’être par lequel nous montrons l’Ereignis du retrait. Autrement dit, penser implique de reconnaître que nous existons depuis un espace imprépensable et par là-même ne jamais absolutiser nos propres fondements mais toujours les remettre en question, puisqu’eux-mêmes viennent de la Lichtung sur laquelle nous n’avons pas de prise. En cela, la pensée n’est pas uniquement liée à la philosophie et pas même essentiellement. La pensée désigne plutôt une forme de Verhalten, une façon d’être au monde indépendante de tout savoir et de toute connaissance.
Cette indistinction entre penser et habiter la terre, est, nous dit notre auteure, l’éthos heideggérien. Ce même éthos invite à regarder la cruche de Cézanne, les champs de Van Gogh, en levant la censure de l’opposition entre actif et passif : ces choses, recueillies dans le regard, pensées, se révèlent elles-mêmes pensantes, car donnant à penser. N’était-il pas éthique, le conseil du Christ, de regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel ? Ce n’était pas, à coup sûr, une simple métaphore ! Mais le Christ aurait-il dit, comme Schelling, que l’homme fut créé dans le centre de la divinité, et que la chute consista en ceci qu’il se crut le centre de tout – au centre de la terre qui lui fut donnée pour en prendre soin ? Schelling en conclut cela. Et ainsi pense aussi Heidegger, comme le remarque Sylvaine Gourdain, p. 215 :
La philosophie doit incarner le rapport éthique de l’homme au milieu de l’étant, c’est-à-dire le séjour de l’homme dans la vérité de l’être, qui constitue l’« éthique originaire » (die ursprüngliche Ethik)
Cette éthique considère le Tout, la nature, elle est sagesse de l’intériorité, l’« Inständigkeit » proche de la simplicité évangélique. Tandis que Heidegger dit que les familiers de l’Abîme assument le feu dévorant de cette centralité pour sauver la terre, Schelling, en philosophe, prône la mort à l’être propre, l’extinction volontaire de l’identité clivée. L’homme est celui qui doit rester celui que, poète, il est : entendant l’appel de l’être et lui répondant par la voix du sacré. L’identité, « das Eigene », qui va et vient du familier à l’étranger, invoquée par Hölderlin, est le don précieux qui répond à celui de l’es gibt. Lorsque Heidegger en vient au côté sombre de l’éthos, au sacrifice – il aborde ce thème dans ses commentaires sur Trakl – la séparation n’est salvatrice que si le renoncement à soi est don de soi, en un destin accepté. L’auteur fait bien de souligner (p. 212), qu’à l’époque des Beiträge, qui est aussi celle de sa lecture de Nietzsche, se vouloir en allant hors de soi, se gagner soi-même dans la métamorphose, constitue un renoncement qui n’en est pas un, car il est volontaire. Elle a encore plus raison de mentionner un deuxième tournant, au début des années 1940, qui troque le vouloir contre le laisser. Mais ce souci de la Nature se conjoint une conception de la tâche dévolue (Aufgabe) dont l’essence n’est autre que la grâce, excluant toute origine humaine, volontaire, et tout mérite. Est-ce Schelling qui a soufflé à Heidegger ce refus luthérien du paradigme de valeur d’échange, de bipolarité commerciale, qui grève la morale occidentale, qui rabat le salut sur l’utilité (p. 216) ? Sylvaine Gourdain, p. 213, note leur convergence :
Dans la pensée tardive de Heidegger et de Schelling, la responsabilité de l’homme vis-à-vis du tout est plutôt décrite comme un don (Gabe) et une tâche (Aufgabe), que l’homme doit recevoir sans pouvoir se l’approprier ni y prétendre de par un quelconque droit. La difficulté est double, car d’une part, l’homme occupe de par son existence une position instable, et d’autre part, il se trouve par là même investi d’une mission cruciale à laquelle il est appelé à répondre mais dont il ne peut retirer aucun mérite.
Les débats, vifs à l’époque de la Réforme, sur le salut par la grâce ou par les actes, ressurgissent chez Heidegger : la pensée se déploie sans servir d’utilité, sous peine de ne plus être de la pensée (p. 216). Notre auteure voit bien que cette conjonction de la nature et de la grâce libère la pensée : comme chez Schelling, c’est non seulement au-delà de l’étant, mais de l’être – donc de la différence ontologique – que s’ouvre l’espace du bon séjour, la Bienvenue dans la liberté (p. 218). Cette Grâce prend le nom de Même (das Selbe), « le mot de l’énigme » (das Rätselwort). L’angoisse, en Être et Temps, annonçait ce passage difficile entre le non-sens métaphysique et l’accueil dans la Région du sens, où le Même, et non l’être de l’étant, devient « l’Ami de la Maison ». Mais si nature et grâce jouent à deux voix la fugue du Même, c’est dans l’immanence de la Parole (p. 218). A vrai dire, la Parole est donnée avant la Pensée, elle est la prédonation (Vorgabe) correspondant à l’imprépensable : il y a langage parce que l’être montre l’étant, et le langage se sublime en poésie quand l’être lui-même se montre dans son déploiement, non comme éternel retour du pareil, mais comme Présence qui rassemble à la fois la variété ontique et la différence ontologique.
Cette dynamique autoréférente de la parole, qui, se montrant elle-même, recueille la mêmeté de l’être, est abritée dans l’éloquence du silence. Sylvaine Gourdain insiste, p. 219 :
En réalité, c’est l’être lui-même qui est dire, car il nomme toujours l’étant d’une certaine façon. […] mais par là, lui-même demeure dissimulé et voilé derrière cette nomination. Dans la mesure où il est la phénoménalité du phénomène, l’être se retire dans le même geste où il montre l’étant. L’être est donc « la redite la plus fréquente en tout dire, parce que hors de l’être rien n’est dicible », et en même temps, il est le tu, le non-dit, ce qui « dans le dire garde le silence sur son déploiement ».
Le silence est le suspense du sens (cf. p. 220) : c’est lui qui fournit l’expérience de l’im-possible, paix qui se pose avant toute imposition de monde. D’où la référence à la sagesse bouddhiste, dans l’entretien avec le maître japonais. Mais il y a plus : le lien entre la grâce de parler et la (re)tenue morale est depuis longtemps rassemblé dans le prophétisme, c’est-à-dire l’attention adressée aux signes, propre à tout message (p. 223). Le lecteur de la Bible qu’est Schelling sait que le prophétisme n’est pas une magie, ni même une forme de connaissance, mais une ouverture au sens de « ce qui se passe » afin que l’homme voie clair dans l’espace où il a à faire. D’où une louable passivité, qui laisse se juxtaposer, dans l’imagination du lecteur, la rose d’Angelus Silesius et la fleur de lotus du Professeur Tezuka. La Parole, originée, pour la Bible, en Dieu lui-même (Elle est le Réal même, le « Davar ») est, ici aussi, le pouvoir de l’être (p. 223), non en tant qu’être de l’étant, mais en tant que Rassemblement, Recueil, Versammlung. La Parole est le Logos, le Vendangeur de l’être, le Signe qui fait signe qu’il y a des signes, l’Autoréférence par excellence, l’Enfant porté par l’être. Le prophète vit les souffrances de l’accouchement des temps annoncés par les signes desquels il est lui-même signe. La notion heideggérienne de responsabilité se définit ainsi comme « responsa », attitude qui fait face (ent, ant, anti). Nous lisons ainsi, p. 229 :
La responsabilité de l’être humain consiste d’abord en ceci qu’il a à écouter ce qui se dit à lui dans le paisible de la réserve et à y répondre en y cor-responsant à son tour dans le silence. Par conséquent, l’ethos implique en premier lieu de lui qu’il demeure là où il se trouve, qu’il y séjourne sans toutefois rester dans une passivité stérile mais en se faisant le message de ce qu’ainsi il entend.
Nous retrouvons, dans ce thème de la passivité, l’étoile de la conscience morale, autrui, ce que Être et Temps appelait le pour-autrui et la sollicitude appropriée, non intrusive. La pensée est féconde passivité : « Ereignis » signifie non pas appropriation au sens d’une acquisition (ce serait « Ereignung »), mais conduite adaptée à l’autre comme existence et à l’existence comme autre. C’est un grand mérite de notre auteur d’avoir souligné le sens éthique de ce maître-mot de la philosophie heideggérienne, « Ereignis » en le reliant à la spatialité non métaphorique, mais herméneutique, de la « Maison » des frères humains. Nous lisons, p. 230 :
Heidegger conçoit donc l’ethos à partir de la façon dont l’homme séjourne au monde, dont il habite le monde. Nous pensons que ce Wohnen s’envisage comme l’un des paradigmes principaux venant succéder à la transcendantalité et également à l’intentionnalité de la pensée, car le rapport à l’étant est désormais compris non comme une relation unilatérale (intentionnalité) accordant une prévalence au pôle sujet (transcendantalité), mais comme une spatialité plane, où les différentes composantes peuvent être conçues sur un même niveau.
Refus de la hiérarchie, accueil, mutualité, absence d’unilatéralité dans la relation, mise à disposition d’un espace de rencontre : voilà des éléments d’une liste de vertus qui concilient sagesse antique et biblique. Schelling ouvrit l’Esprit à l’alter ipse, la Nature ; Heidegger ouvre le nunc de l’Histoire à son hic. « Befindlichkeit », situation, indique le fait de se trouver quelque part, de s’y retrouver ou non, de pouvoir y être trouvé (p. 232) : impuissance et ouverture, exposition et maintien d’un cap. L’homme, être jeté dans le monde, n’y est pas jeté pour rien ni pour personne ; l’impuissance même est le signe d’une dévolution.
L’éthos dit la tenue (Verhalten) qui freine toute entrée violente, tout rentre-dedans : le Séjour est retenue (Auf-ent-halt). Notre auteure dit, p. 234 : « L’éthos, pour Heidegger, signifie d’abord accepter cette part d’altérité en nous, qui se manifeste à nous par les tonalités, et les laisser s’éveiller en nous. » Réhabilite-t-il une morale du sentiment, par la centralité du concept de Stimmung pour la définition du comportement humain ? Ce serait tomber dans le clivage idéologique entre cognitif et affectif : mais jamais l’un ne va sans l’autre. Le sentiment peut être passager, mais peut aussi régir d’un bout à l’autre tout un comportement, être un principe. La stupeur (cf. p. 240-241) devant l’être pur est ainsi le saut schellingien de la philosophie négative à la positive, comme l’étonnement (p. 234) exprimait le passage aristotélicien de la sensation à la science. L’humeur témoigne de la présence de ce qui n’est pas nous et nous concerne, il est preuve vivante de la force de l’extériorité. Or l’homme ne peut développer sa propre force que confronté à une force qui lui résiste – car il vit dans la correspondance des signes lancés par tout ce qui l’entoure. L’auteure rend compte du traité des passions qui se trouve dans Beiträge en notant l’hésitation de Heidegger entre deux ethos possibles : le vouloir avoir conscience et le laisser-être (cf. p. 238). Mais il les concilie dans le spectre émotionnel qui va de la stupeur coupant le souffle à l’extase qui restitue la liberté quand le vouloir renonce à savoir ce qui ne sera jamais qu’être – expérience de la dépossession de soi consécutive à la confrontation à un contexte étrange(r) de sens (p.244). On y détecte la dépotentialisation à travers la confrontation à l’altérité (p. 245). Ainsi, p. 244 :
Chez les deux auteurs, la tonalité [Stimmung] apparaît comme un moment seuil, entre la crise et le possible tournant, entre traumatisme et saut dans l’existence, entre non-savoir et savoir, entre oubli du secret de l’être et sauvetage à partir du péril. Le passage d’un moment à l’autre ne peut être ni voulu, ni provoqué, mais il advient seulement par le laisser-être de la tonalité. Ce laisser-être constitue la liberté propre à ce nouvel ethos de la pensée, une liberté qui présuppose l’acceptation de sa propre impuissance et qui s’oppose en cela à toute idée d’autodétermination et d’autonomie. C’est ce moment « pathique », manifesté par l’étonnement et la stupeur, qui représente chez Schelling le véritable commencement de la philosophie.
Le flottement entre la stupeur devant l’Imprévisible et l’extase qui s’en console en lâchant prise, donne le coup d’envoi à l’ethos de la liberté, qui est et reste une libertas animi. Schelling dessine une réforme de la vie intérieure qui répare la chute adamique. Il nous semble qu’il faudrait faire ici une remarque. Chez Heidegger, le lâcher-prise, tonalité fondamentale de la maturité (p. 250) n’est pas rabattu sur le non-agir. Car « garder et tenir un lieu » (p. 249) impliquent des actes précis : conception de l’habitat, relations de voisinage, rencontres, etc. Nous perdons la moitié de la vérité en traduisant inlassablement « lassen » par « laisser ». Le verbe allemand introduit un factitif ; « seinlassen » signifie aussi « faire être ». Or il est possible de faire être sans exercer de volonté : faire l’amour, mettre au monde, rêver. Quant à dire, c’est le faire le plus puissant ; c’est montrer (sagen, zeigen), consoler (zusprechen), enjoindre quelqu’un en l’appelant par son nom (heißen), empêcher de couper l’arbre de la prairie ou le chêne où Goethe écrivit son poème, laisser l’enfant nous enchanter de parataxe, ne pas vouer les fleurs et les fruits au forçage industriel : tous ces exemples se trouvent, presque naïvement, dans l’œuvre de Heidegger. La mère qui fait reposer l’enfant dans ses bras – « gelassen » – agit, peut quelque chose.
Réciproquement, il ne s’agit jamais de condamner le « können » en soi. D’ailleurs que signifierait un pouvoir en soi, pour un penseur de la singularité ? Dès l’époque existentiale, Heidegger est clair : pouvoir authentiquement, au sens propre (eigentlich), c’est pouvoir-pour, c’est la sollicitude (Fürsorge). L’opposition entre « laisser » et « faire », entre passivité et activité, est ce contre quoi Heidegger a systématiquement combattu, de même que l’opposition entre parole et silence, ouverture et secret, etc. Même le verbe « sein » est actif et transitif et signifie déployer sa singularité, anwesen, se poser là, aller à la rencontre en ami. Notre auteur le voit bien, en différenciant, p. 253-254 condamnation du pouvoir en général chez Schelling et sa modulation chez Heidegger :
Rappelons-nous que le « pouvoir », pour Schelling, … est la non-liberté la plus totale, dans la mesure où elle est un passage nécessaire et donc non libre à l’être. Le « pouvoir-être », chez Schelling, est bien une forme de fatalité, et par conséquent, être libre consiste d’abord à préserver le pouvoir comme pouvoir, sans l’actualiser. […] Sous les traits du pouvoir-être, cette tentation du mal exerce sur l’homme une puissance toute-particulière si bien que celui-ci est presque nécessairement conduit à y succomber, … car le Können s’épuise dans l’être : « Il est maintenant ce qui ne peut plus ne pas être. » La liberté ne consiste donc pas en un pouvoir qui s’actualise et passe à l’être, mais au contraire en un pouvoir ne pas pouvoir, un pouvoir ne pas être. […] Mais revenons à la Gelassenheit heideggerienne. On peut montrer que, en tant que la liberté exigée par l’ethos, elle est préfigurée par la conception du … laisser-être de l’étant comme liberté et il explique que le laisser dont il est question ici n’a pas « le sens négatif de ‘se détourner de’.., de ‘renoncer à’, de l’indifférence ou même de l’omission. […] » Laisser-être signifie ‘s’adonner à l’étant’ ».
« Sich einlassen » (cf. p. 256) signifie ainsi « s’engager », s’y mettre – et non pas suivre, se laisser aller en intégrant le courant. L’entre-deux n’est séjour que si chacun y « met du sien », inter-vient ; la bilatéralité conditionne une action qui ne soit pas domination. D’où la prédilection pour le dialogue (cf. p. 256), l’entre-tien, où les inter-locuteurs se tiennent les uns les autres grâce au vide premier, à l’Entre-Deux qui invite à donner. L’auteur le dit nettement, p. 257 : « Ce laisser n’indique donc pas une passivité ni une absence de mouvement au sens de l’immobilité, mais plutôt le repos en lequel peuvent s’installer les différentes composantes qui interviennent au sein de ce laisser ». S’il n’y a plus de dialectique du maître et de l’esclave, le travail n’est plus maudit ; il inclut la paix qui avise de loin la présence invisible du cœur du monde, de l’âme de la terre et du vrai pouvoir de l’homme. C’est cela, la Contrée (Gegnet) : le retour des choses à elles-mêmes grâce à une prise en mains qui ne machine rien (p. 260), un faire dans l’expectative, attendant (wartend). Nous lisons ainsi, p. 261 :
Le lâcher-prise, en tant qu’attente, désigne ce rapport à la Gegnet, c’est-à-dire à l’origine imprépensable de tout phénomène, au sein duquel cette dimension qui nous échappe peut se montrer en cela même qu’elle nous échappe, de sorte que l’affaire de la pensée devient plus proche et qu’une autre phénoménalité peut alors advenir. Autrement dit, le retrait de la Gegnet est préservé, mis à l’abri, dans la Gelassenheit.
Ce qui signifie que le lâcher-prise est un « lâcher » au sens où l’on dit un lâcher de ballons, par exemple, un envoi, le lancer d’une action qui répond aux exigences émanant de l’espace avisé par l’attente. « L’attente s’engage dans l’ouvert lui-même » : cette citation de Heidegger invite à rendre justice à l’origine des choses par une pensée définie tout autrement que selon une tradition qui l’oppose à l’action. Car un acte de préservation, par exemple, peut être aussi appelé « pensée », pour Heidegger ; et de même une offre, un don, l’expression de notre reconnaissance envers quelqu’un, élever un enfant, voyager pour aller à la rencontre de l’étranger. Les célèbres analyses qui rapprochent « denken » de « danken », « think », « thing », « Ding » font résonner une parole qui est aussi événement, et des actions qui sont éloquentes. La centralité de la Parole (elle-même autoréférente, car la parole parle d’elle-même en même temps qu’elle parle d’autre chose) explique le pouvoir des mots, ce qui interdit d’opposer la théorie à la pratique. Ainsi, pas plus que la théorie luthérienne de la grâce, dont le jeune Heidegger était parti, n’est un obstacle à l’action, pas plus l’abandonnement, la sérénité, ne figent l’amélioration du séjour des mortels entre terre et ciel. L’inutilité est la chose la plus utile à l’existence inéchangeable – et la sérénité ne dépend pas du vouloir de l’homme, mais d’une grâce venue de cette « région » qui dispense l’image de sa profondeur. Non un autre monde, mais ce monde même, vu dans la lumière de l’être. Cela, l’homme le sait en agissant avec reconnaissance. L’acte éthique est un remerciement localisé. Le concept qui réunit le repos de la pensée et le mouvement de l’acte n’est autre que le jeu, activité de l’enfant, qui ignore encore tout genre, toute hiérarchie, tout couteau d’abstraction.
Chez Schelling, il y a cette aspiration, qui a soufflé le terme de « Gelassenheit » à Heidegger, supprimant toute différence entre sujet et objet (p. 264) Notre auteur souligne donc une mutation du vocabulaire éthique. En Être et Temps, nous trouvions encore la sémantique classique : conscience morale, culpabilité, résolution de se reprendre, choix des possibilités appropriées au fait d’être là, dans le monde avec l’autre. La lecture de Schelling inverse la position et de la pose éthiques, qui allaient de l’ouverture à la décision : l’ex-statique, l’ouverture die Erschlossenheit, prévalent désormais sur le projet résolu (Entschlossenheit). La grâce ouverte par ce que Schelling invoque sous le nom de « révélation » (Offenbarung) ne reçoit aucun ordre du « leisten », du « perform ». Schelling rappelle à Heidegger le halo plus ancien d’une donation qui se donne en pro-posant (sans intention) « la dimension essentielle ». Il s’agit, dans l’éthique, d’élever le monde lui-même à sa lumière de séjour, non d’y faire briller une lumière hors du monde, qui devient vite im-monde. Le questionnement ne supprime pas, mais relaie le retour repentant, la « reprise », dont Heidegger empruntait le concept à Kierkegaard et non à Hegel. La question ouverte sur l’avenir du séjour tient (le) lieu de (la) prière. Le temps accueille désormais l’espace, si négligé dans la tradition qui va de Saint Augustin à Heidegger lui-même, lequel l’avoue dans Temps et Être, ce qui avait fait l’objet d’une analyse de notre auteur p. 69 à 71.
Il en résulte une conduite conforme à l’expérience de l’intériorité (Er-fahrung), et les nouvelles habitudes y afférentes, qui retrouvent le couple biblique : « souviens-toi et garde », cette injonction de l’amitié humaine. Cette sécularisation de thèmes qui, chez Schelling, sont ouvertement exégétiques (il connaît son hébreu autant que la mythologie), deviendra chez Heidegger une habitude – un ethos qui hypostase tout Texte d’origine. Antigone accompagne, mieux que le Dionysos de Nietzsche, le paradigme suprême, le sacrifice pour la liberté. Sylvaine Gourdain indique cette constellation spirituelle dans les dernières pages de son troisième chapitre. On lit p. 270 à 273 :
C’est donc engagé dans son eksistence que l’homme doit correspondre à la Gegnet … […] ce qui confirme notre rapprochement entre la Gelassenheit heideggérienne et la structure de l’ekstase chez Schelling. […] Mémoire et souvenir, la pensée est aussi « méditation » (Besinnung). La méditation est la forme de la pensée par laquelle l’homme ne se fait pas fondateur, mais assume son ek-sistence en laissant, dans son rapport aux choses et à tout étant, être l’imprépensable, c’est-à-dire en reconnaissant qu’une dimension essentielle ne peut pas être saisie par lui et qu’elle doit pourtant s’installer et se déployer en son ek-sistence. […] C’est cette méditation qui nous permet de ne pas nous perdre aveuglément dans le contexte de sens en lequel nous sommes toujours déjà jetés. […] Si donc la pensée doit d’abord apprendre à discerner l’espace imprépensable en lequel elle habite, … c’est pour pouvoir (vermögen) mettre en question, remettre en mouvement ce qui nous apparaît tel qu’il nous apparaît. […] Il ne faut certainement pas interpréter cette « piété » comme l’expression d’une adhésion naïve et sans conditions à ce qui est, mais plutôt comme l’écoute du destin de l’être, ce qui constitue la première « action » de la pensée. […]
La merveille des merveilles n’est donc, ni pour Schelling ni pour Heidegger, l’existence au sens brut, mais le don de pouvoir changer les choses, don paradoxal car aussi imprévisible que l’imprévisible qui précède toute volonté. Il n’y aurait pas d’ethos sans ce dégagement de puissance concrète offert à quiconque s’engage dans un questionnement désintéressé, de même qu’il n’y aurait pas d’art si les images – visibles, sonores – ne donnaient à penser. Que le pouvoir de faire se dégage du renoncement à la domination, que le mouvement prenne son énergie de l’arrêt, sont un trait de cette dialectique que Heidegger a prise à Schelling, retournant le mal en bien. Il y a là quelque chose de « divin », bien que le terme de « dieu » soit, pour notre auteure, métaphorique chez Heidegger alors que chez Schelling, il est par lui seul une invocation. Mais si l’on considère l’inadéquation de la nomination de ce qu’on vise en disant « Dieu », (Heidegger acquiesce au doute d’Héraclite sur le nom de Zeus et le problème se pose également pour nommer l’Imprépensable, p. 281), il est permis de glisser sans blasphème du vocable « Dieu » à celui de « possible ». Notre auteure écrit, p. 272 :
On peut en ce sens parler d’une forme de religiosité de la pensée… La pensée se relie à ce dont elle provient, son origine propre qui la précède mais se manifeste aussi en elle. Nous avons déjà noté la présence du vocabulaire du divin chez Heidegger, et le renvoi constant à Hölderlin participe de cette attitude de pensée. Toutefois, ces références au divin ou à une forme de piété de la pensée ne constituent pas une théologie. […] Nous pensons que « le dernier dieu » dans les Beiträge désigne l’oscillation des possibles, c’est-à-dire le tremblement du sens originaire et n’est pas, au sens littéral, le nom d’une figure divine. Nous le comprenons bien plutôt comme une métaphore pour la vérité de l’être comme ouverture radicale au possible. […] La prière, au sens religieux, ne peut être prière que parce que l’homme en tant qu’homme est appelé à cette attitude de recueillement vis-à-vis de son origine.
IV. L’ETHOS DE L’IM-POSSIBLE (276-345)
Sylvaine Gourdain approfondit ici l’origine de la mystérieuse attribution, à l’homme, du pouvoir-faire, sans lequel l’éthique ne serait que souhait. Ce pouvoir accordé s’exprime de manière différenciée (p. 280), car la même Liberté s’identifie à l’identité de chacun. Notre auteur rattache le sens donateur d’individuation, également prisé par Schelling et par Heidegger, à une commune doctrine de l’Amour. Nous lisons, p. 275 :
L’origine imprépensable de la phénoménalité ne peut pas être fondée en retour, et on peut en cela la comprendre comme l’expression d’une liberté originaire. Or, pour autant que cette liberté accorde à tout étant son être propre, elle est aussi décrite comme une figure aimante, comme l’amour même.
L’être abyssal est accessible par une figure, une image, qui sert non une pensée analogique, du semblable, mais du Même. Les innombrables différences de l’étant renvoient au Même qui les origine, chatoiement phénoménal qui fait signe vers ce qui n’apparaît pas. La tautologie – l’être est l’être, la rose est la rose – empêche la pensée de détruire l’accès à cet halo unique qui s’épanche en tout (cf. p. 276-277). La phénoménologie persistante de Heidegger questionne l’attitude humaine en proposant une vue dans ce qui est. Car ce paradoxe : faire apparaître ce qui n’apparaît pas, nous révèle l’origine de tous nos pouvoirs de faire (Vermögen). L’être autoréférent, dont il convient de dire une seule chose : qu’il est, révèle l’intériorité de sa médiation, car « être » est un verbe, un acte qui ne disparaît pas en accordant à l’étant son pouvoir de déploiement dans le « milieu » de son engagement (p. 277). Alors que la médiation schellingienne était l’Incarnation, elle concerne ici l’Origine se donnant « comme » (als) ceci ou cela. La foi de Job était que le salut de Dieu est en Dieu même ; la sagesse de Parménide, que l’essence de « être » est en « être », dans son repli englobant-diffusant. Notre auteur ajoute que toute sagesse s’ancre en une topologie de l’être, localité (Ortschaft) liée au vagabondage (Wanderschaft). Heidegger emprunte cette dualité à Hölderlin, qui joint l’image du sol imprépensable au mouvement replié du Chaos (p. 280). D’où une phénoménologie de l’inapparent, (p. 278-279) :
Tout ce qui est, tout étant, est médiatisé, parce qu’il ne reçoit son être que depuis l’ouvert, la Lichtung ou la Gegnet. Non seulement les étants ne se tiennent en rapport les uns avec les autres que depuis l’ouvert, mais ils ne sont, ils n’apparaissent comme ce qu’ils sont, que dans la mesure où ils s’enracinent en l’ouvert. […] L’être est lui-même la médiation de l’étant, … et l’effectivité n’est elle-même qu’une forme de médiation parmi d’autres qui seraient possibles. […] Vermittlung (médiation) désignerait l’être et Mittelbarkeit (médiateté) l’epace de l’ouvert depuis lequel toute Vermittlung peut avoir lieu. Lorsque Heidegger écrit que la médiateté doit être « présente en tout », il faut comprendre cette indication au sens de la présence-absence de l’imprépensable : la médiateté, elle-même imprépensable, perce à travers tout ce qui est et qui, sans elle, ne pourrait pas apparaître. Comme telle, la médiateté est l’inapparent dont nous parlions plus haut, « l’immédiat [das Unmittelbare] », parce qu’elle n’est pas de nouveau médiatisée par un fondement qui se situerait en deçà d’elle.
Nous retrouvons ici le concept de fond indifférencié, Chaos, réserve d’être pour le différencié qui y persiste, asile de vie malgré tous les ordres imposés. C’est à la réciprocité (Zu- und Miteinander) non ordonnée par avance que s’ouvre l’espace où se révèle l’essentiel (p. 278). L’esprit de liberté des Recherches sur la liberté humaine, qui souffle de ne recevoir d’ordre de personne, du ciel ou de la terre, qui se présente comme transcendant à l’existence commune, s’est communiqué à Heidegger : peut-être aurait-il fallu insister sur le lien entre l’ontologie à la fois heideggérienne et schellingienne, de la médiation immédiate – et le refus de tout principe autoritaire transcendant, féru d’ordre. L’intuition d’un ethos humain garde Schelling et Heidegger de la manie de l’ordre et de toutes ses justifications. C’est précisément contre cet ordre, qui se prétend fondateur, que se développe, chez Schelling explicitement, chez Heidegger de manière plus clandestin, l’ontologie de l’amour annoncée dès les premières lignes de ce chapitre. Il doit en effet y avoir le même rapport entre l’être manifesté et son origine, qu’entre l’amour présent et le fond obscur d’où il naît, entre le chaos et la foudre, pour parler comme Héraclite. Il ne faudrait plus définir l’être humain comme pensant et comme libre, mais réunir pensée et liberté dans cette force singulière qui se manifeste comme amour parce qu’au fond – au sens de Schelling – « il y a » est amour. Ne faire qu’un, aspiration de l’amour, témoigne de l’Indifférencié. Or l’amour ne se déclare, comme le feu, qu’à partir d’un « champ libre » (Freie), car ce qui est aliéné, ordonné, fondé, ne donne pas, mais prend. Le premier don de ce qui se manifestera ensuite comme amour est donc le don de la place (p. 282). Le premier faire est le faire-de-la-place.
Il revenait à Schelling de rapporter cette origine inconditionnée de tout le donné à l’Amour, autrement dit d’entendre dans le « ταὐτόν » de la tautologie – l’être est l’être – l’Inhérence universelle. Schelling hésite entre l’attribution à l’homme de la transformation de la Liberté originaire en amour (p. 282), le premier devoir étant d’aimer ce Fond imprépensable que les peuples appellent « Dieu » – et la qualification de l’Origine elle-même comme Amour, au sens johannique (p. 283), qui met la contemplation avant l’éthique proprement dite. Certes, d’un point de vue métaphysique, il faut bien mettre en premier la Liberté d’être ou de ne pas être ; mais cette liberté absolue n’est pas libre, au sens où elle ne peut se poser elle-même, car elle est d’emblée Acte pur, pouvoir vis-à-vis de l’être, et être vis-à-vis du possible (cf. p. 285). Elle se libèrera en existant. L’étonnant est que ni l’Imprépensable ne s’épuise pas du fait de cette entrée dans l’étantité, ni que tout ce qui a de l’être ne perde la puissance de l’être inconditionné qui l’origine. De même que Dieu reste Dieu en suspendant son être en acte pour poser l’altérité – cette autre possibilité devant lui – de même le pouvoir-être que l’étant reçoit demeure potentialisation, car la nécessité de la contingence « n’est que la forme de l’être imprépensable, mais que cet être soit nécessairement contingent, voilà qui dépend, à l’origine, d’une liberté … qui peut elle-même faire, défaire et même inverser les lois de la nécessité et de la contingence » (p. 288). Or ce pouvoir correspond exactement à la liberté éthique, qui est législative, normative, c’est-à-dire qui pose (setzt) de quoi déverrouiller (ent-schließen) ce que l’ordre des choses ne cesse d’aliéner (cf. p. 297-298).
Par cette médiation, l’être imprépensable, loin de confirmer l’ordre du fait, ouvre et possibilise l’acte de droit. Le mystère se dédouble, puisque l’être imprépensable, inaccessible au concept, contient en lui-même quelque chose qui précède même le fait de l’être, et que Schelling nomme tantôt liberté, tantôt amour. Car, ne l’oublions pas, Schelling se situe dans une perspective panthéiste, où créer est, pour Dieu, passer librement à l’être en demeurant celui qu’il était, est et sera. Dieu crée par amour ce qu’il rend extérieur à lui sans se retirer dans une transcendance monopolisant le pouvoir ; l’amour se remarque en effet à ce qu’il se rapporte à ce dont il n’a pas besoin pour être ce qu’il est. Enfanter répugne à toute notion de but, qui ne convient qu’à la production, laquelle découle d’un vouloir quelque chose et avoue précisément par là sa dépendance envers un chose (p. 292). Et une volonté qui se donne n’est plus une volonté, c’est un amour, comme dit l’ancien anglais « will ».
Heidegger a compris cela, et accepte, dans ses écrits tardifs, de réemployer le verbe vouloir. Y a-t-il aussi à ses yeux un degré d’être se situant encore en deçà de l’en deçà, et qui donne son sens à l’Indifférencié originaire ? Sylvaine Gourdain montre que, pour lui aussi, c’est l’Amour : la dévolution d’une place singulière résonne d’une Inhérence première (Innigkeit). Ainsi, l’être « est » seulement dans le contexte d’apparition de « modes » d’être, chaque « mode » étant et n’étant que celui d’une l’existence singulière connectée à celle des autres (p. 291). Aussi Sylvaine Gourdain, qui parle, dans la citation suivante, p. 292, de Schelling, aurait-elle pu aussi bien parler de Heidegger :
Or, cette volonté qui se vide de soi-même pour s’emplir de l’autre, qui se donne à l’autre sans pourtant se perdre n’est autre que l’amour même. La « liberté d’être et de ne pas être » désigne donc aussi la possibilité de sortir ekstatiquement de soi, d’abandonner son être propre pour s’ouvrir à l’autre. Elle n’a de sens que parce qu’elle peut donner l’être qu’elle suspend, c’est-à-dire parce qu’elle s’accomplit fondamentalement comme don, et non comme négation, de soi.
La culture de Heidegger n’allait pas jusqu’à celle de Schelling qui, versé dans la Kabbale du fait de sa théosophie (p. 320), invoquait les concepts de Vide obtenu par restriction et retrait (צימצום, que Schelling traduit par « Beschränkung » et « Zurückziehen ») et de Sans-Fin (אין־סוף, terme traduit par Ungrund dès Jakob Boehme). Ce vocabulaire rendait compte de la dualité d’extériorité (libre) et d’appartenance (aimante) entre le Grand Abîme (תהום) et l’homme. Sylvaine Gourdain mentionne avec raison cette source : Schelling connaissait le Sefet-Yetsira et réciproquement, les kabbalistes appréciaient son œuvre. Schelling est celui qui, en son temps, se sert le plus du concept de « contraction » de l’espace divin pour rendre compte du fait que, bien que Dieu ait créé le monde « en » lui-même, il y ait séparation entre l’identité du monde et l’identité de Dieu – et pour expliquer comment l’éternité s’est articulée sur les trois modes du temps, en accueillant l’unité divine. Le pouvoir de bien faire ne peut s’originer dans les seules forces de l’entendement, il implique un rapport global à ce qui est, qui ne nous est accessible que par une idée directrice, sans conceptualisation possible. L’aptitude à bien faire est un Vermögen qui suppose un mögen ne dépendant pas de l’homme seul, mais d’un pouvoir-aimer (ver-mögen) dont la voix de la conscience n’est que le témoin (p. 294). Cette attitude, développée par Heidegger, l’est dans le sillon de Schelling. Si l’on veut trouver trace de théologie chez Heidegger, il faut entendre cette façon de parler de l’être d’une façon si personnelle (Cela qui nous aime, le pouvoir aimant du possible, le déploiement de l’être repose dans l’aimer, etc.), (cf. p. 295-296). Plus besoin de substantialiser le Verbe, c’est le Verbe qui vient en personne et qui parle.
Le pouvoir de bien faire vient du pouvoir des mots, parce qu’ils ne portent pas seulement un message, mais la force de s’acquitter de cette charge (p. 298). Dans un texte tardif, Heidegger va jusqu’à appeler ce « milieu » où est conféré le pouvoir d’agir en conséquence, « l’élément de l’amour » (Element der Liebe) (p. 299). Cette grâce module son vocabulaire selon les termes de Gunst, Gönnen, Gewähren. Cette grâce n’est pas une propriété privée, elle est un don à partager : être là signifie que chacun est pour l’autre (das füreinander Dasein, p. 300). Le nom d’antan de l’ethos, la Philia, a pour programme, si on ose encore ce mot : s’appartenir l’un à l’autre dans le Même (Zusammengehören im Selben). Voilà comment le laisser implique l’agir de l’homme (p. 301).
Cette ontologie du Diaphane vise un ethos relationnel jouxtant la liberté et l’amour : de l’amour de deux êtres naît la liberté la plus intime de chacun (p. 308-309). Et cela, réciproquement, permet de jeter un coup d’œil dans le mystère de l’être : pour Schelling comme pour Heidegger, il n’est pas Substance, mais Relation, Lien (p. 313). Sylvaine Gourdain rassemble ainsi 1°) la conception schellingienne de l’essence, qui se déploie entre Fond indifférencié et existence singulière (l’essence créatrice de toute chose se déploie comme amour en tant qu’elle est différenciation) – et l’être pensé par Heidegger comme Relation, Contrepoint, « Fuge ». Ainsi, p. 302 -303:
Pour être, l’amour doit se révéler, il n’y a pas d’amour qui demeurerait entièrement dans le retrait, dans l’ombre, intégralement voilé. Et pourtant, il n’y a pas non plus d’amour qui s’épuiserait dans sa manifestation, le véritable amour doit aussi savoir se contenir et se retenir en soi. C’est pourquoi la Fügung est « l’inapparente (die Unscheinbare) », non pas parce qu’elle serait entièrement invisible, mais parce que, dans tout apparaître, elle se retire, précisément pour laisser être ce qui apparaît. […] Cette médiateté immédiate – l’élément de l’amour – est aussi pensée comme le se reposer en soi. […] L’événement de l’aimer … advient comme la co-appartenance entre l’élément de l’aimer originaire et le séjour de l’homme au sein de cet élément. […] Un tel aimer se suffit à soi-même parce qu’il n’est précisément pas lié à soi-même mais toujours ouvert à l’autre.
Ainsi, l’être reçoit le nom d’« Inapparente », laquelle soutient noblement l’apparaître en le laissant briller. Il revient à la pensée – qui est amour, amour du Sage, de ce Même qui sait laisser et faire être – de faire briller l’Inapparente à partir d’elle-même pour montrer qu’elle ne se met jamais en avant, bien qu’elle soit au-dessus de tout (p. 303). Penser est ainsi la forme d’amour qui cor-respond, qui témoigne qu’« être » s’abandonne, qu’il laisse, ne prend pas, quoique actif (lieben, mögen), car il prépare un royaume. Dans les actes sereins gît un repos qui ne rajoute rien, mais transmet à autrui le don d’origine. Sylvaine Gourdain, dans ces pages (304 à 310) produit des textes tardifs essentiels qui prouvent le lien entre amour et abandon serein. Les rattacher au thème de l’amitié, central dans les commentaires de Hebel, aurait renforcé encore sa thèse que l’ethos, chez Heidegger, ne va jamais sans cet affect qui est en fait une position ontologique, car l’amour contient en lui le libre espace du « mögen », du « may be », du « mag sein », et sans ce « peut-être » rien de nous ne peut être. Par l’amour, être devient faire, et c’est pourquoi « lassen » signifie à la fois ne rien faire (laisser faire) et faire en sorte qu’être passe à l’acte, faire faire par le faire propre à l’être. Ainsi, l’action ne glisse jamais dans l’activisme, ni le laisser dans la lâcheté. Si la morale se teste d’emblée dans le rapport à autrui – l’aliène-t-on ou l’aime-t-on ? – c’est qu’elle suppose non seulement un pouvoir de respecter la liberté d’autrui, non par décret, mais par la nature même des choses, mais un modèle, si l’on peut dire : l’aimer est d’abord et toujours le déploiement du Même, qui observe le Premier le « comportement » (Verhalten) éthique par excellence, surgi du fait qu’il est Relation (Verhältnis) (cf. p. 321).
Sylvaine Gourdain en revient donc aux leçons de Kabbale reçues comme clandestinement de Schelling par Heidegger, et qui renforcent la centralité du concept d’espace en morale. Retrouvant le « da » du Da-seyn, nous lisons p. 320 :
En tant que tel, le mouvement propre à la sérénité correspond bien au double mouvement de l’amour, c’est-à-dire à la fois une retenue, un retrait de soi en soi, et une dynamique inverse qui est tournée vers l’autre en cela même qu’elle suspend toute intentionnalité, pour laisser à l’autre la place de se déployer en propre, de façon similaire à la figure du tsimtsoum. Autrement dit, la volonté que l’autre soit ne consiste pas à créer l’autre ni à vouloir le constituer, mais seulement à lui faire de la place, lui donner de l’espace, lui libérer son lieu propre. Voilà le sens de l’amour en tant que das liebende Vermögen, « le pouvoir qui aime » ou « le pouvoir aimant » au sens fort. Aimer, cela veut dire a-ménager de l’espace pour l’autre, faire du vide et l’entretenir pour qu’il puisse s’y installer.
Or « unterhalten » ne signifie pas seulement entretenir, veiller sur la vie d’autrui, mais « sich unterhalten » signifie s’entretenir, dialoguer : la parole médiatise en un lieu la pensée et le faire. Cet aménagement commun prend une couleur fort actuelle. Un regard dans les conditions lamentables de l’habitat humain à l’heure du réseau technologique mondial fait prendre la mesure de cet ethos heideggérien défini comme exigence de ménager un habitat humain aux humains (p. 322). Il s’agit moins d’habiter que de laisser habiter, laisser autrui déployer son être dans « être », incarner la Relation qui définit « être ». La religiosité avec laquelle Heidegger parle de l’Habitat à ménager, fait écho à la piété de la question : car c’est sur l’Habitat que porte la Question.
La pensée s’élève ainsi jusqu’au Sacré, que Heidegger distingue comme deux frères. Habiter, c’est être ensemble sur terre sous le Ciel, en face des immortels. Le « templum » n’est sacré que parce qu’il est éthique : le sanctuaire n’est sanctuaire qu’au sein d’un habitat partagé, qui accueille l’hôte qui nous vient de loin. Notre auteur scrute ainsi le Quadrat dans la lumière de ses conclusions sur l’éthos du laisser-habiter et de l’amour : l’amour consiste à s’engager à ce qu’autrui puisse parcourir librement la terre, et, non moins librement, s’y installer. Ainsi, permettre d’habiter, c’est, dans une tonalité appartenant à la Terre, permettre d’être : c’est médiatiser l’amour maternel (p. 326). Mais si le dernier dieu des Beiträge – où se trouve d’ailleurs une première esquisse du Quadrat – était une figure, ce n’est pas le cas des dieux du Quadrat. La tension entre dieux et mortels – et non, c’est vrai, la dualité terre / ciel – reprend le conflit entre terre et monde, qu’on croie ou non à ces dieux : l’essentiel est la sainte présence qu’apportent leurs figures, leurs légendes, leurs sanctuaires. Voici la fonction du divin dans l’éthique : le dieu est un modèle de vie vraie, non la projection d’une divinisation de l’homme. Prendre le divin pour mesure est mesurer la distance avec l’infini et, dans le fini, s’ouvrir à l’im-possible (cf. p. 345). Le sacré est le domaine où l’impossible laisse sa trace (p. 325). Le saint espace est le « templum » dont seul peut parler le poète, cet autre du penseur, qui dit la sainteté (« das Heilige ») du rapport entre mort et immortalité.
Nous ne sommes plus dans la fugue, mais dans une forme sonate, « où chaque variation est la reprise d’un même thème et doit s’appuyer sur la variation précédente tout en demeurant indépendante d’elle » (p. 327). L’écriture harmonique des quatuors de Mozart, ce luth de Dieu, éclipse l’écriture contrapunctique des Beiträge, où chantaient les différentes voix de l’Ereignis. Depuis Trakl, l’homme meurt, le dieu joue. Le Quadrat est Miroir de ce jeu (p. 327). Pourtant, c’est seulement alors qu’apparaît le terme d’infini (cf. p. 327), si rare chez Heidegger, comme si l’Ein Sof de la Kabbale, l’Ungrund de Schelling, faisaient une résurgence là où on ne l’attendait pas, pour générer un halo d’utopie. Car si on rapporte le Quadrat à l’ethos, et plus précisément à celui que notre auteure a défini comme reliant la liberté, l’amour et l’habitat, il est alors la figure même de l’harmonie, comme l’était le grand hymne de Hölderlin, la Fête de la Paix. Bannissant la violence explicite de la guerre et l’inhumanité implicite du calcul, la communauté figurée par le Quadrat est une image du monde, une agora nouvelle, « qui unifie à partir d’elle-même les voix du destin » (p. 328), non dans le cadre fixe d’un Etat ou l’ordre tyrannique de l’opinion, mais dans l’éther de l’infini – situation non finie, non achevée, toujours changeante. La « société ouverte » de Bergson – cet auteur qui avait enthousiasmé le jeune Heidegger – se retrouve ici (p. 328) :
Le Geviert nous présente donc une image du monde en tant qu’ouverture radicale, où chaque « composante », chaque voix, est par elle-même déjà ouverte, si bien que les quatre ne sont pas des entités substantielles, mais seulement des dimensions liées les unes aux autres. Le Geviert est ainsi une configuration où règne l’« intimité » [Innigkeit], une intimité qui cependant n’est « pas une fusion ni une disparition des distinctions [kein Verschmelzen und Verlöschen der Unterscheidungen] ».
L’espace est plus que jamais le concept central de l’éthique – il est l’image du Lieu qui « n’existe pas », au sens où l’ami de Heidegger, le poète René Char, écrivait : « Obéissez à vos porcs qui existent, je me soumets à mes Dieux qui n’existent pas ». A-topique, u-topique, le topos est plus que jamais moralement pertinent, tableau où se dessinent des « relations » conformes à LA Relation, au Verhältnis que constitue « être ». Chacun est a approprié à l’autre, et c’est cela qui fait qu’il demeure lui-même dans son identité : voilà ce que permet et figure l’alliance, l’harmonie constituée des mortels et des forces immortelles de la nature, ainsi que de la terre et du ciel, témoins du Commencement. On aura reconnu ici la polémique contre l’individualisme et l’unidimensionnalité, contre la subjectivité qui, partant du Moi, ne parvient jamais à la Relation, mais à la représentation d’autrui, la lutte contre le clivage entre familier et étranger, tri aveugle à leur coappartenance, enfin l’avertissement contre une morale de l’effacement total de soi menant à l’aliénation à tous les sens du terme.
Or, en cette utopie, non seulement la Parole a une place essentielle – elle dit la sainteté du Lien – mais l’art, dont les artéfacts meublent l’habitat, comme la cruche qui offre à boire aux hôtes et figure l’épanchement d’être, et les beaux-arts qui donnent à penser en son sein. Pour Heidegger, le rapport à ces « choses » (Dinge) devient pensant et poétique grâce à la médiation de l’artiste, qui suscite, au sein du visible, l’invisible même. A la spatialité qui se dégage de la beauté préservée (das Geschonte) par le vide libérateur rassemblant chaque chose en révélant son identité, succède un Vide qui se transporte du monde biblique au monde oriental. Heidegger est chez lui dans cet Espace où les Caractères dessinent une Voie si lointaine et si proche, où tout s’adapte à tout, à condition de ne pas fermer, de ne pas remplir, de ne pas forcer. L’auteur rapproche le dernier Heidegger des néoplatoniciens et de la théologie apophatique, et souligne à quel point cette tradition dessine une figure immédiate de l’Inaccessible qui stimule l’exploration du champ des possibles (p. 336-337). Ce qui rend précisément possible l’effort d’instaurer un amour qui fasse être l’essentiel (p. 337).
Certes, l’auteur remarque que le rêve d’or de Heidegger – lucide advision de ce qui vient avant tout possible, vue de l’à-venir de ce qui ad-vient – n’est pas de l’utopie (p. 339) au sens courant du terme, politique et idéologique. Mais, comme nous l’avons vu plus haut, « l’ethos de l’im-possible renvoie à un autre possible, un possible qui se déborde et s’excède soi-même et qui ne se laisse pas penser dans le cadre de la philosophie métaphysique ni de la « vision du monde » dominante à l’époque du Gestell » (p. 341), Heidegger est fils légitime d’un Schelling qui, ayant élargi le champ du pensable, dessina, à partir de l’Inaccessible, une éthique accessible, une figure de l’amour et du lien.
CONCLUSION
La modestie et la prudence sont de mises en éthique, c’est bien connu. Sylvaine Gourdain insiste surtout sur celle de Heidegger, qui prétendait n’en avoir élaboré aucune. Nous lisons, p. 348 :
Mais dans tous les cas, l’apparaître qui se déploie depuis l’imprépensable n’est toujours qu’un clair-obscur, où ce qui est éclairé contraste avec ce qui est plongé dans l’ombre, et c’est lorsque tout nous apparaît sous un jour parfaitement limpide et translucide, lorsque nous ne percevons plus aucune occultation, aucune dissimulation, que nous nous révélons en réalité les victimes aveuglées du sens prédominant.
Voilà donc la leçon éthique de Schelling, qui change le concept plein, substantiel, de Dieu, en intuition d’un Être caractérisé par sa passion, sa contraction interne ; une Identité qui, par amour pour ce qu’Elle n’est pas, fait le vide en elle jusqu’à disparaître des radars de la phénoménalité qui l’exprime. On en conclut que l’espace, que Newton appelait « Sensorium Dei », est sensorium libertitatis. La liberté, abyssale, est Origine infondée (p. 349). Elle crée les oscillations infinies des différents réseaux de sens, qui se mènent une lutte effrénée et que l’être, malgré toute sa Présence, ne peut arbitrer car la condition de l’existence des êtres est que l’Origine s’en détache et se dissimule en un non-lieu dont seule la pensée peut faire un lieu. Schelling comme Heidegger ne reculent pas devant ce problème du mal et l’y poursuivent jusque dans les abysses de la vie contrastée de l’être (p. 350). Tout est une question de pouvoir : est-il cette force déchaînée (Können) qui s’autorise du fond imprépensable pour y puiser les moyens d’une action sans limites ? Ou est-il la possibilisation (Vermögen) d’engendrement du vide interne de l’être, qui fait la place à tous et à chacun, cette Auberge d’une récollection où tous, se retrouvant, se trouvent eux-mêmes ? Dans les deux cas, il y a liberté – liberté pour le bien comme pour le mal. Mais la liberté de l’amour est le second type de pouvoir, pouvoir-pour, qui repose en ses limites et s’épanche dans l’extériorité. Au renoncement à l’illusion de la transparence, s’ajoute donc l’abandon de la prétention à l’autofondation (p. 351).
L’ethos est un questionnement sur le sens qui, trouvant des réponses, en laisse d’autres ouvertes, équilibre entre écoute et dire : les pensées aussi doivent s’aimer les unes les autres. Le véritable commencement d’une pensée qui ne s’aliènerait pas à la domination du monde, serait donc une confiance dans l’affect herméneutique, cette « Stimmung », cette humeur, qui nous rend aptes à saisir les signes pour aller à l’essentiel et sortir du réseau de nos opinions. Toutefois, un tel ethos étant dédié à l’étant singulier, aucun ordre politique, aucune loi, aucune norme ne peut déterminer à l’avance ce qu’il faudra faire dans telle situation, quoiqu’il doive faire le départ entre un pouvoir clivé et un pouvoir authentique dévolu à la mutualité. L’im-possible oblige à une invention comportementale orientée sur autrui, dont la présence vient du plus profond de l’inexplicable. Sans la considération de l’inapparaître, sans cette vision de l’Invisible au sein du Visible, sans une oreille affûtée pour les voix du silence, la pensée de l’altérité perd l’individu, le désespère, le jette dans le non-sens en l’enfermant sur lui-même au lieu de lui donner un séjour sur terre. L’éthique a au contraire le pouvoir de faire d’autrui « le centre même, celui en vue duquel l’espace est aménagé et entretenu, celui qui reçoit ainsi son lieu propre et la place qui lui convient » (p. 353).
Notre auteure exploite la phénoménologie de l’inapparent, qui caractérise les recherches tardives de Heidegger, pour la mettre en phase avec Schelling, phénoménologue avant l’heure (p. 354), prophète d’un Ancestral Imprévisble qui ne se montre que médiatement, et qui dissimule son Abîme, fait de liberté autant que d’amour. Les deux philosophes, abandonnant la subjectivité en faveur d’un rapport de sens originaire, où objet et sujet deviennent des concepts caducs, ne conçoivent plus le Principe comme Substance, encore moins comme Sujet, mais comme Relation, Lien. A la temporalité, axée sur la conscience morale et la responsabilité de l’individu dans l’orientation vers l’avenir de l’unité des trois extases, Heidegger substitue, sous l’influence de Schelling, l’advision d’un Espace où le séjour sur terre se révèle être le vrai souci. Les choses, intégrées à l’habitat ; le monde, à nouveau conscient de la Nature ; les hommes, renouvelant le sens du sacré sans la contrainte religieuse ; tout cela forme une constellation d’obligations dont la tonalité d’ensemble est de laisser être autrui à la place où il peut dégager son pouvoir d’être lui-même. L’amour est la ferme volonté de faire qu’autrui puisse être lui-même, dit Heidegger. Derrida (p. 355), dont les concepts généreux permettent d’interpréter les interférences des grands penseurs, apprend à préférer, à l’historique de ce que l’on appelle des événements, l’essence « emphatique » du véritable avènement, ici même, de l’éthos secret, discret, qui constitue l’Humain : le don, le pardon, l’hospitalité, l’inventivité architecturale, l’écoute psychanalytique, la pédagogie, la préservation des arbres, des fleuves, et, au premier chef, l’Habitation. L’ethos se manifeste à ceux qui ne se demandent pas si la chose est possible, mais qui avisent qu’elle s’impose comme impossibilité d’une simple possibilité – sans pour autant glisser dans la nécessité logique ni la contingence abrupte qui nous ôtent tout pouvoir de bien faire. La confiance que témoignent Schelling et Heidegger à ce pouvoir pour autrui, est nourrie d’un respect infini pour ce qui ne veut pas se montrer. Nous lisons ainsi, p. 355-356 :
L’amour comme retrait en soi pour faire émerger l’espace de l’autre, l’élément de l’amour comme le laisser-être de tout phénomène respectant sa dissimulation propre, soulignent que l’homme n’atteint ce qui fait la spécificité de son humanité que sur le fond d’un certain écart vis-à-dis de soi. Le rapport de l’homme au monde repose sur la libération à l’égard de ses propres exigences compulsives et sur l’ouverture à l’autre. L’« entre » qui émerge de ces deux mouvements et se déploie comme la liberté vis-à-vis de soi pour l’autre ouvre un espace libre au sein duquel l’homme peut ek-sister. […] Cet espace du possible est un espace de l’im-possible, parce que l’homme endosse par son être même, par son inapparaître, la correspondance à l’espace originaire qui se réserve en soi pour laisser-être ce qu’il accueille en lui. Dans cette distance à soi, l’homme peut rencontrer l’autre sans le saisir et se retrouver soi-même sans imposer son être.








