Cet entretien a été réalisé le 26 janvier 2015, alors qu’avait paru deux ans auparavant Dynamique de la Manifestation et que se préparait à travers les séminaires la matière des deux livres à venir, Métaphysique du sentiment et le Désir et le Monde. Alors que la revue Actu-Philosophia avait consacré une recension à chacun de ces deux ouvrages, recensions consultables à cette adresse, et à celle-ci, et qu’un entretien en deux parties avait été publié à la faveur de la sortie de Le Désir et le Monde, nous avons jugé utile, compte-tenu de l’importance de l’œuvre de Renaud Barbaras, de proposer un nouvel éclairage sur l’élaboration des deux livres de 2016 à partir du séminaire de 2015, à travers un entretien mené par Aurélien Deudon et Thomas Maurice.
A : Approche de l’œuvre et rôle de la corrélation
Actu-Philosophia : Serait-il faux de dire que Dynamique de la manifestation arrive comme un moment de récapitulation et de percée. Dans le sens où ce que nous avons cru déceler comme structure de votre travail pour l’instant ce sont les 3 moments que vous reprenez justement dans Dynamique de la manifestationet qui sont : « Phénoménologie », « Cosmologie » et « Métaphysique ». En effet, avec le Désir et la distance on assiste à l’essor de votre phénoménologie et à la découverte du désir comme opérateur de la phénoménalisation. Ensuite, quelques ouvrages de recherches et de commentaires mènent au second grand ouvrage, Introduction à une phénoménologie de la vie, qui, lui, porte principalement sur la cosmologie, avec déjà le premier tâtonnement pour donner votre propre définition du monde. Suite à de nouveaux livres de recherches et de commentaires, vous aboutissez à cet ouvrage qui est Dynamique de la manifestation. Bien qu’il reprenne les acquis des ouvrages précédents, il arrive pour déployer l’acquisition du champ métaphysique : précisément, votre percée métaphysique consiste à thématiser la notion d’« archi-événement » à la fois totalement contingent et totalement nécessaire. Cette présentation serait-elle juste ?

Renaud Barbaras : Je vous remercie, oui, c’est une excellente présentation et une récapitulation de mon parcours. Le seul élément que je pourrais ajouter c’est que, dans Introduction à une phénoménologie de la vie, le moment cosmologique a évidemment un rôle important, mais il y a aussi une dimension phénoménologique très présente, surtout dans la première partie, première partie où je discute avec certains philosophes de la tradition pour engager d’abord une position phénoménologique du problème de la corrélation et c’est seulement ensuite que cela débouche sur une cosmologie. Cosmologie qui, à mes yeux, en tout cas a posteriori, est encore inchoative et schématique. Pour ce qui est du dernier ouvrage, Dynamique de la manifestation, ce que vous dites est absolument juste : la percée tient au 3ème moment qui relève de ce que j’appelle « Métaphysique » et qui thématise ce que j’ai nommé « archi-événement ». Mais le versant cosmologique, qui constitue la 2nd partie du livre, est à mes yeux aussi un approfondissement, une avancée par rapport à Introduction à une phénoménologie de la vie dans la mesure où je développe ce qui n’y était qu’esquissé et, surtout, où je situe les choses au plan d’une philosophie et d’une pensée du mouvement, d’une cosmologie dynamique et donc d’une dynamique phénoménologique qui, par différence avec la phénoménologie dynamique, affirme que tout mouvement est phénoménalisant. Cette dynamique phénoménologique, qui fait l’objet propre de la cosmologie, n’était pas vraiment conquise ou acquise dans les ouvrages antérieurs. La percée est donc incontestablement métaphysique, mais il me semble qu’il y a également une avancée cosmologique dans la vision que j’ai, a posteriori, de mon parcours. Pour le reste, pour l’essentiel, ce que vous dites est absolument juste.
AP : Et est-ce qu’on pourrait dire justement que tous vos ouvrages, tout ce que vous décrivez passe devant le tribunal de la corrélation, et peut-être même qu’à chaque fois vous êtes plus husserlien que Husserl en respectant le triple commandement de « droit aux choses mêmes », du « principe des principes » au § 24 des Ideen 1 et évidemment de la découverte de l’a priori corrélationnel de l’étant transcendant dans la Krisis. En somme que votre seule loi, votre seule méthode de description c’est d’être fidèle à ces trois principes husserliens qui ne font qu’un.
RB : Alors oui. Si je reprends les trois points : « aux choses mêmes », c’est compliqué parce que les choses chez Husserl ce ne sont pas des choses évidemment, mais des vécus, des actes, et donc des phénomènes. Le retour aux « choses mêmes » a un sens très large, introductif, et non pas le sens technique que ce précepte possède chez Husserl. Cela exprime simplement un souci de description et encore je quitte le plan de la description assez vite. Pour ce qui est du §24, oui, mais là aussi avec une nuance fondamentale car je formule une critique de l’intuition alors que le §24 est évidemment une affirmation fondamentale de l’intuitionnisme, de l’intuition comme étant la seule garantie…
AP : D’ailleurs, vous revendiquez ce § 24 comme droit pour la perception plus que pour l’intuition.
RB : Bien sûr, ma perspective en un sens part d’une phénoménologie de la perception mais elle débouche sur une conception non-intuitionniste de la perception. Et peut-être même (je suis en train de travailler là-dessus), sur une critique de la perception comme telle. Parce que, est-ce qu’il s’agit encore de perception ? Je veux dire que si on entend par perception la donation de quelque chose (« Percevoir, c’est percevoir quelque chose », dit Pradines), d’un objet, alors mon travail se situe très au-delà d’une phénoménologie de la perception. Maintenant, pour revenir à la question que vous me posiez, le plus important c’est le troisième point qui est évidemment l’a priori corrélationnel. Naturellement, je le répète souvent, c’est un point de départ, mais qui est fondamental, au point que Husserl dit que c’est la tâche de toute sa vie d’élaborer cet a priori. Mais, surtout, il me semble que c’est, disons, la charte minimale pour qui fait de la phénoménologie car la question de savoir tout simplement ce qu’est la phénoménologie, ce qui circonscrit le champ de la phénoménologie, est une question très difficile, très ouverte. Il me semble que la seule manière de circonscrire cet espace c’est de s’en tenir à cet a priori. Et cela a presque plus une fonction négative, permettant de déterminer le champ que je qualifie de phénoménologique, que proprement positive. Même si, bien entendu, j’élabore et approfondis ensuite cet a priori, c’est d’abord une manière de refuser toutes les formes de dualisme naïf : l’étant n’a pas de réalité hors de son apparition ; le sujet n’a pas d’existence hors de son être-porté sur l’étant, c’est-à-dire de l’intentionnalité. Donc, de ce point de vue-là, il faut d’abord retenir l’anti-dualisme. Néanmoins, dans la mesure où tout apparaître est « apparaître à », il y a une forme de dualité interne à la phénoménalité qui interdit tous les monismes, qu’ils soient de type ruyerien ou bergsonien. L’espace de la phénoménologie, tel que je l’entends, est d’abord défini par exclusion du dualisme naïf, qui vaut pour l’empirisme, pour Locke, mais aussi pour Kant. Le dualisme naïf c’est celui qui pose une réalité de l’étant qui est indépendante de sa manifestation. Et puis, bien entendu, exclusion aussi du monisme, naïf ou non, notamment du monisme neutre (Bergson, Ruyer), qui repose sur l’idée d’engendrer la différence entre l’être et l’apparition à partir d’un plan premier qui est neutre par rapport à cette distinction.
B : Approche phénoménologique du sensible
AP : On peut commencer à poser quelques questions sur le moment phénoménologique. Tout d’abord, sur la théorie du sensible, vous avez dispensé cette idée que tout sensible nous ouvre à ses propres qualités sensibles et aussi aux autres étants sensibles et donc constitue des rayons de monde. Vous parlez quelques fois de grammaire sensible du monde. Une objection semble pouvoir se poser à ce genre de théorie, c’est celle, peut-être un peu naïve, du simulacre et de la surprise : le pain de plastique. Ces moments de surprise perceptive où le sens qu’on cible n’est pas le bon. Du coup, le rayon de monde qu’on avait inféré, pressenti s’effondre. Sont-ce des moments limites, des cas limites qui, pour vous, montrent, indiquent la structure permanente du sensible ; ou bien sont-ce des cas qu’il faut prendre à bras-le-corps ?
RB : Il ne me semble pas du tout que ce soit une objection ; il me semble au contraire que l’expérience de la désillusion que vous évoquez s’inscrit totalement dans cette perspective. Qui dit rayons de monde dit anticipations. Le schéma husserlien reste ici fondamental. La théorie des rayons de monde revient à dire que l’être sensible du sensible c’est sa dimension d’ostension d’un monde. Le sensible est une sorte de fenêtre sur le monde, mais de fenêtre qui préserve la transcendance du monde et dont la transparence est en même temps pure opacité. Le sensible est à la fois absolument évident – le rouge n’est rien d’autre que le rouge qu’il est -, et en même temps absolument opaque en tant qu’il est comme la partie émergée de l’iceberg, c’est-à-dire l’ostension d’un monde. Et s’il est l’ostension d’un monde, il communique avec tous les autres sensibles en droit. D’où la grammaire dont vous parlez, avec des degrés de proximité, de distance, des modes d’articulation, etc… Ici, l’objet est hors-jeu, l’objet relève d’une autre couche. A ce niveau-là, il n’y a pas d’objet : il y a le monde et les sensibles qui en sont l’ostension et qui communiquent entre eux. Je vous dis tout cela parce que ça implique évidemment que, sur la base de la réalité sensible d’un objet – puisqu’on a finalement affaire à des objets – et bien il y a des anticipations qui se produisent, c’est-à-dire des manières de glisser sur les rayons du monde, comme dit Merleau-Ponty. Mais ce n’est pas pour autant que le rayon de monde et le mode de communication sont les bons. Il y a des illusions possibles. Comme dit Merleau-Ponty, on voit un objet noir et brillant au loin, on pense que c’est une pierre parce qu’un type de rayon semble s’exhiber sur la base de cette apparition sensible et puis on s’approche et, finalement, on s’aperçoit qu’il s’agissait d’un morceau de bois échoué sur le sable. Donc je ne vois pas en quoi cette expérience démentit radicalement la grammaire sensible.
AP : C’est-à-dire que quand on parle de grammaire j’ai l’impression qu’on parle aussi de rayons définis. Par exemple, le jaune du citron va apporter avec lui l’acidité. C’est une expérience qu’on fait effectivement mais qu’est-ce qui nous assure de son essentialité ? C’est la question de l’harmonie préétablie.
RB : Je suis prêt à retirer le mot « grammaire » si l’objection s’appuie sur ce mot.
AP : Mais par exemple si un étant est en lien avec tous les autres, est-ce que tout rayon est valide ? Est-ce que n’importe quel sensible peut nous suggérer un autre étant que personne n’a vu auparavant ?
RB : En droit oui bien sûr. Si tout sensible est ostension du monde et est donc traversé par une transcendance interne – c’est ce qui lui donne son poids de réalité en quelque sorte et c’est aussi ce à quoi répond la passivité du sujet, du sentant – alors il communique en droit avec tous les autres sensibles. Au fond, tout le travail de la poésie c’est d’exhiber ce dont il est question. Il vous est arrivé, à vous comme à moi, à la faveur de la lecture d’un poème, de rejoindre tout à coup un écho, une résonance que nous n’avions pas du tout aperçue.
AP : Mais il y a des métaphores beaucoup moins puissantes que d’autres justement, certaines glissent sur un rayon superficiel.
RB : Je suis tout à fait d’accord avec vous, mais cela signifie simplement que dans cette grammaire, si on veut conserver le terme, il y a des degrés de proximité, de distance, que c’est articulé, bref, qu’il s’agit d’un monde. Ce n’est pas une harmonie préétablie mais une donnée phénoménologique : celle de l’ajointement, de la Fügung. C’est du multiple mais un multiple qui n’est pas du pur disparate, un multiple traversé par une unité totale qui est celle du monde et donc par des sous-unités.
AP : Si on faisait l’hypothèse du § 49 des Ideen 1, d’un monde disloqué, est-ce qu’on serait dans une pure disparité ? Est-ce que ça serait encore un monde pour vous ? L’absolue contingence des esquisses est-ce encore un monde avec cette structure de grammaire du sensible ?
RB : Bien sûr que non. Dans l’hypothèse de Husserl, il ne s’agit pas seulement d’une anticipation sur la base d’esquisses qui tout à coup, se trouve démentie, comme dans l’exemple que je donnais du rocher, mais de l’hypothèse de l’impossibilité d’anticiper puisque tout esquisse est infirmée par la suivante et cela est, pour Husserl, un non-monde.
AP : Patočka ne dit-il pourtant pas qu’il s’agit d’un monde chaotique, mais que c’est encore un monde ?
RB : Oui mais c’est autre chose. Ce qui est en jeu avec Patočka c’est la question de la transcendance. Ce que vise Patočka dans cette affaire ce n’est pas tellement la question de la structure du monde, mais c’est le pas franchi par Husserl consistant à dire que, dans ce jeu d’esquisses, on n’aurait plus de monde mais seulement des vécus. Patočka affirme que, même dans ce cas, on aurait affaire à un monde parce que l’on aurait affaire à de la transcendance. Sa question n’est donc pas celle de savoir ce que c’est qu’une structure de monde, mais de montrer que le chaos dont Husserl a fait l’hypothèse demeure un chaos transcendant et donc, en ce sens, un monde.
AP : Oui effectivement, il s’agissait de déstabiliser cette notion de grammaire, d’articulation entre les étants. Pour aller encore un peu en ce sens, il y a le cas du rêve où les moments de contingence peuvent être forts et on se demande si cette structure des rayons de monde est possible.
RB : Pour en revenir à votre question, ou y répondre d’une autre façon, on peut dire qu’il y a des champs. Par exemple, le visible n’est pas du tactile ; ça ne veut pas dire que ça ne communique pas, mais il faut bien admettre qu’à côté de la totalité monde il y a aussi des sous-totalités, des champs. Pour ce qui concerne le rêve, il faut dire, à la suite de Patočka, que si toute épreuve sensible est ostension d’une transcendance alors le rêve l’est aussi. Bien entendu, cela signifie que la frontière entre le rêve et la réalité, l’imaginaire et le réel, comme l’a très bien montré Annabelle Dufourcq dans ses deux livres, est une frontière labile. D’une certaine façon, il faut verser l’imaginaire au compte du réel, voire penser un soubassement imaginaire du réel et le rêve ne fait pas exception ; celui-ci n’est pas l’épreuve d’une sorte de sphère privée.
AP : Il y aurait tous les posthumes de Husserl sur les phantasia à réélaborer avec votre théorie. Ça serait vraiment intéressant.
RB : Vous avez raison, ce que je dis là ça reste vraiment programmatique et il y a tout un travail à faire. En toute rigueur, si on défend l’idée que le sensible, la matière sensible, loin de relever de l’immanence est au contraire ce qui nous ouvre à la transcendance, alors toute expérience sensible est donation d’un monde, y compris par conséquent ce qu’on appelle l’imaginaire. Cependant, cela n’empêche pas que des anticipations soient infirmées, qu’on puisse se tromper, qu’on puisse errer dans cette grammaire du monde. Les expériences auxquelles vous faites référence sont des témoignages de ce que j’appelle l’errance. Et ce que montre la désillusion perceptive, c’est que, dans tous les cas, je pensais avoir affaire à du monde, même si ce n’était pas ce à quoi je croyais avoir affaire. Mais ce qui compte, c’est que je croyais avoir affaire à du monde.
C : La question du désir
AP : Je voulais aborder une contradiction interne que j’ai relevée sur la question du désir. C’est à la fois ce désir qui ne doit pas chuter au rang de besoin ontologique et, en même temps, il doit quand même être désir de réconciliation. Je voulais vous citer deux petits passages de Dynamique de la manifestation pour que vous voyiez exactement. Page 145 vous écrivez :
« En effet, si ce qui aimantait le désir était une véritable réconciliation, l’immobilité d’une pure coïncidence ontologique, la visée commandant l’essence du désir serait la fin du désir et le fait qu’une telle réconciliation demeure impossible ne changerait rien à ceci qu’un désir ainsi conçu serait commandé par l’horizon de cette annulation. Un tel désir, traversé par une visée de plénitude correspondant à une forme de réconciliation ontologique, ne serait pas tant un désir qu’une sorte de besoin ontologique supérieur puisque, au moins en droit, un « objet » serait susceptible de l’éteindre au lieu de l’exacerber »
et page 305-306 :
« Le mouvement subjectif est donc plutôt un mouvement de subjectivation, mouvement infini pour autant que l’appropriation du sujet et donc l’accomplissement du mouvement exigerait une pleine réconciliation, aussi impossible que nécessaire, avec le monde et donc quelque chose comme une assomption du monde. Dans ce mouvement, le sujet demeure indéfiniment à l’horizon de lui-même sous la figure du monde, comme lieu où repose sa puissance et où il se régénérerait absolument au lieu de finir par s’éteindre. »
En somme, c’est de deux choses l’une : soit on donne au désir un objet, aussi indéterminé soit-il, mais il chute alors au rang de besoin ontologique ; soit effectivement on dit que le monde est quand même dans une sorte de réconciliation impossible, mais on ne comprend pas alors dans ce cas-là ce que c’est qu’une réconciliation impossible.
RB : Je vais vous répondre simplement, et je crois que je m’en explique ailleurs dans le livre. Ce qu’il faut comprendre c’est que le monde ici est un procès caractérisé par un inachèvement fondamental – ce que j’ai explicité à travers le concept de puissance et de reconstitution de la réserve de puissance par son actualisation même. Ce que je veux dire, c’est qu’à la fois il y a bien une visée de réconciliation, au sens où le désir est toujours désir de soi et où le lieu du soi c’est le monde ; mais cette réconciliation est impossible parce que ce qui est visé par le désir n’est autre qu’un désir éminent. C’est-à-dire que l’accomplissement du désir ce n’est pas la fin du désir, son extinction dans je ne sais quel objet. L’accomplissement du désir c’est la coïncidence avec ou l’accès à un désir qui serait désir absolu, pur désir. Et ce pur désir c’est exactement la figure du monde, du procès mondain. Autrement dit, il y a le désir au sens propre, qui est le désir du sujet et, en toute rigueur, c’est la seule modalité possible d’usage du concept de désir ; et puis il y a le mouvement du monde qui est ce que notre désir vise, parce qu’il est comme la forme éminente de celui-ci : cela que nous ne pouvons que viser car nous en sommes nécessairement séparés. Je ne sais pas si je suis clair. Toute la question est d’identifier ce qui est visé dans le désir : le désir de soi est désir de désir.
AP: Le cas du besoin ontologique c’est le cas d’un désir qui voudrait juste s’abolir en tant que désir ?
RB : Exactement.
AP : D’accord, mais alors est-ce que la figure du suicidaire pourrait être une dégradation du désir en besoin, désir exténué ?
RB : Cette question nous renvoie plutôt aux deuxième et troisième parties de mon livre. La figure du suicidaire est celle de celui qui voudrait rejoindre l’archi-vie par cette voie courte. Donc en un sens oui, vous avez raison. Mais la figure du suicidaire n’échappe pas à cette économie du désir. Si vous voulez, ce qui est en jeu c’est ce qu’on entend par monde. Dans l’idée de besoin ontologique, il y a l’idée d’objet puisque le besoin suppose un objet qui permet d’éteindre ce besoin, de sorte que penser le sujet comme besoin ontologique c’est penser le mode d’être du monde sur le mode objectal. Ce qui est en jeu n’est donc pas tant le désir que le statut du monde. En vérité, la »contradiction » dont vous faites état, et qui n’est pas une contradiction à mes yeux, renvoie au développement de mon travail, qui a connu deux étapes. Dans un premier temps, j’ai cru penser que le désir pouvait être désir de sa propre extinction, c’est-à-dire réconciliation absolue dans l’immobilité, mais j’ai fini par comprendre que si le désir est désir de soi il ne peut être que désir de désir, désir d’un désir sous une forme supérieure. D’où la distinction entre un désir que je n’appelle pas désir, qui est la puissance mondifiante, « désir » éminent au sens où, contrairement à notre désir, elle produit ce qu’elle vise, et, d’autre part, le désir proprement dit. Notre désir est désir du monde au sens où il désire un désir qui n’éprouverait jamais la frustration. Donc je pense qu’il n’y a pas de contradiction si on insiste sur la nature du visé. Le désir n’est désir de rien de positif, d’aucun objet ; il est désir de cette négation concrète qu’est le procès mondain.
AP : C’est donc un mouvement qui tend vers un autre mouvement ? Un mouvement qui ne peut être satisfait que par un autre mouvement ?
RB : Exactement. Et donc qui par là même demeure nécessairement insatisfait. En tout cas, le désir ne peut pas conduire à une extinction, à une immobilisation, à un type de plénitude. On ne sort pas du dynamisme.
AP : Vous me servez sur un pont d’or la prochaine question !
RB : Sur un plateau en tout cas.
AP : Il y aurait deux modes de recherche de la satisfaction. Soit je disparais dans le monde, ce que vous avez dit avec l’extinction du désir par la voie courte dont vous parliez dans votre séminaire. Soit, et vous en aviez également parlé, ça serait l’en-soi-pour-soi sartrien. La question que je me pose, c’est quelle différence il y a entre le Dieu sartrien – puisque pour Sartre c’est se faire Dieu le but du désir -, le Dieu dialectique de Sartre qui est toute immobilité justement, olympien et un Dieu dynamique. Vous aviez dit que le désir désire revenir à l’Archi-vie mais sans désindividuation. Quelle est donc la figure là-dessous de « divinisation » dans l’économie de votre philosophie ?
RB : L’alternative que vous me proposez n’en est pas vraiment une parce que, d’un côté, le suicide et, de l’autre, l’en-soi-pour-soi renvoient à deux niveaux très différents. Le désir dont je parle, je le qualifierais de transcendantal, par différence avec le désir psychologique. Ensuite, que l’on puisse et doive faire – ce à quoi je travaille en ce moment – une genèse du désir psychologique à partir du désir transcendantal c’est autre chose. Mais le désir dont je parle ne se réduit pas à ce que nous éprouvons : c’est plutôt l’existential fondamental. Dès lors, on peut travailler sur le suicide mais on ne peut pas travailler sur le désir dont je parle en tablant exclusivement sur le désir empirique, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il n’y a pas de rapport. D’autre part, il n’y a pas de Dieu dans mon affaire. Le Dieu sartrien ce n’est pas un Dieu puisque l’en-soi-pour-soi est impossible. Je vois l’homologie que vous mettez en évidence quand j’ai pu dire que ce que le sujet visait c’était coïncider avec l’Archi-vie sans se désindividuer. Et en disant cela je dis presque trop puisque cela signifie que le sujet veut rester soi tout en coïncidant avec l’en-soi, de sorte que l’on est très près d’un en-soi-pour-soi. Mais, en vérité, on se trouve dans une conceptualité radicalement différente de celle de Sartre puisqu’il ne s’agit ni d’en-soi, ni de pour-soi. En fait, il s’agit d’une chose qui n’a rien à voir avec l’en-soi, qui est l’Archi-vie, à savoir un procès, une dynamique phénoménologique, qui renvoie à l’idée que tout mouvement est fondamentalement phénoménalisant – il n’y a donc tout simplement pas d’en-soi. Il n’y a pas non plus de pour-soi, ni de genèse du pour-soi. Je comprends l’homologie que vous faites, mais en même temps je m’en sens très loin. S’il y a une proximité, c’est seulement au sens où, comme chez Sartre, il y a une place centrale qui est faite au désir. J’ai montré dans plusieurs articles, dont un a été publié aux PUF dans un volume que j’avais dirigé sur Sartre, comment Sartre manque le désir à la fois par excès et par défaut. Au fond le désir sartrien c’est du besoin, quelque chose comme un besoin ontologique. Sartre manque la vérité du désir au sens où il passe à côté de cette sorte d’insatisfaction fondamentale, constitutive et donc du type d »’objet » qui lui correspond. Pour Sartre, le désir est désir de l’en-soi-pour-soi, c’est-à-dire de quelque chose mais de quelque chose qui est impossible. Dès lors, d’un côté, il manque le désir par défaut en le rabattant sur le besoin, puisqu’il a bien un objet. Et d’un autre côté, il le manque par excès puisque cet objet est logiquement impossible : en effet, un désir de l’impossible est un désir impossible. Sartre est donc loin de ce que je comprends phénoménologiquement par désir : il en donne, au mieux, la maquette abstraite, comme disait Merleau-Ponty.
AP : Au niveau de la cosmologie, Thomas voulait une précision sur l’Archi-vie, il lui semble qu’elle est entendue comme surpuissance du monde, phusis ou comme tension entre l’archi-mouvement et l’archi-événement.
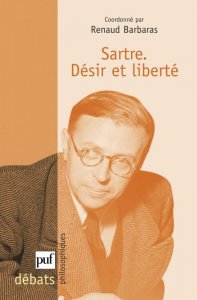
AP : Vous nous aviez dit dans votre séminaire, et je crois dans Dynamique de la manifestation, que l’Archi-vie correspondait au proto-mouvement, à l’archi-mouvement du monde, à la puissance mondifiante. Mais vous aviez dit aussi que l’Archi-vie, si on pousse jusqu’au bout ce concept, c’est la tension entre cette blessure de l’archi-événement et l’archi-mouvement qui va essayer de la guérir, de sorte qu’il n’y a pas d’archi-événement sans archi-mouvement.
RB : Vous avez raison. Ce livre je l’ai écrit il y a deux ans, il est sorti il y a un an [l’entretien date de 2015]. Bien entendu, j’avance et donc ce que je dis en ce moment dans le cours peut être un peu décalé par rapport à ce que j’ai écrit dans Dynamique de la manifestation. Je me souviens très précisément de ce dont vous parlez. Dans mon livre, l’archi-vie renvoie, comme vous le rappeliez, à l’archi-mouvement mondifiant par différence avec les vivants individués à la faveur de l’archi-événement. Maintenant, ce que j’ai pu dire en cours – et peut-être faudrait-il trouver un autre mot que celui de « vie » – c’est que, en raison de cette tension fondamentale entre archi-événement et archi-vie et de cette emprise permanente et renouvelée de l’archi-vie sur l’archi-événement (c’est cela la blessure qui est constamment guérie), j’en étais venu à l’idée que cette dualité était peut-être encore abstraite, que, par conséquent, plus radicalement que cette dualité, il y avait la tension elle-même Plus profond que la distinction entre vie et vivants, il y aurait cette tension, ce jeu : en quelque sorte la vie de la vie, l’archi-archi-vie. C’est cela que j’ai voulu esquisser et vers quoi je m’achemine. Je ne sais pas si le mot »vie » conviendrait puisque ce serait la source commune de l’archi-vie et des vivants. Comment nommer ça ? J’essaie de m’écarter au maximum de la dimension duelle inhérente à la manifestation ; en cela, je suis profondément moniste tout en étant profondément phénoménologue. Au fond, mon problème est celui-ci : comment être radicalement moniste et radicalement phénoménologue ? C’est ce qui me conduit à l’idée d’une source commune qui est la tension même. Il y a néanmoins une sorte de dissymétrie parce qu’autant l’archi-vie est de l’ordre d’une sorte de nécessité – au fond, c’est l’autre nom de l’Etre, autant les vivants individués procèdent d’un l’archi-événement qui est métaphysiquement et logiquement contingent, même s’il est phénoménologiquement nécessaire puisque nous sommes là pour en parler.
D : L’archi-mouvement
AP : On voulait revenir sur cet archi-mouvement. Comment comprendre cet archi-mouvement comme surpuissance ne pouvant être à l’origine de sa propre négation – vous dites que l’essence ne peut être l’essence de sa propre négation – alors qu’il est bien en même temps un procès engendrant ses propres négations de soi, les étants phusiques étant les négations du procès ? A la fois il semble qu’on ait affaire à un mouvement qui est toujours négation de soi et à la fois il ne peut être à l’origine de sa propre négation.
RB : C’est qu’il y a deux négations comme il y a deux individuations. C’est là que réside sans doute la vraie dualité. On pourrait dire qu’il y a une négation-limitation et une négation-séparation ou encore négation-expulsion, et ce n’est pas du tout la même chose. Si elle est vraiment surpuissance, la surpuissance du monde ne peut se réaliser qu’en se limitant. En d’autres termes, pour que sa surpuissance soit préservée comme surpuissance, ses réalisations, ses productions ne peuvent que demeurer en-deçà d’elle-même. Il s’agit d’une limitation en un sens très précis, qui n’est pas tant une négation de la surpuissance que la conséquence même de l’affirmation de cette surpuissance. Il n’y a donc pas de vraie limitation : dire que la surpuissance se limite, c’est dire qu’elle est toujours au-delà de ses réalisations. Telle serait sans doute la meilleure manière de le dire : quelle que soit la nature de ses productions, en tant que surpuissance, elle est toujours au-delà d’elles et c’est pourquoi ses productions sont nécessairement des limitations. C’est parce que la surpuissance est toujours plus qu’elle-même que ses œuvres sont nécessairement moins qu’elle-même : leur négativité n’est que l’envers de sa surpositivité. C’est donc une limitation, une négation en un sens très particulier, qui tient à l’idée d’excès, de surpuissance : face à une réserve infinie toute réalisation est limitation, finitisation. A l’inverse, cette seconde négation qu’est l’archi-événement n’est pas une simple finitisation. C’est vraiment autre chose, comme une chute, une perte de puissance. C’est donc une négation dont la puissance ne peut pas être la source puisqu’elle consiste dans la négation même de son être. Ce que j’ai essayé de montrer dans mon cours et que je n’ai pas exposé aussi clairement dans mon livre, c’est comment cette négation ne peut donner lieu qu’à une séparation, à une scission : si la surpuissance est surpuissance, cette faiblesse interne, cette chute de puissance ne peut donner lieu qu’à une séparation, à la naissance d’un autre. En tant que surpuissance, elle ne peut pas demeurer elle-même en faiblissant, en se perdant au sein d’elle-même ; elle ne peut que se détacher d’elle-même. On a bien affaire ici à une genèse des vivants par séparation et c’est en cela que consiste la vraie négation.
AP : Oui. Je dois dire qu’un moment m’a marqué dans votre livre quand vous parlez de la mobilité de la mobilité. On comprend qu’un véritable mouvement pour ne pas être substantiel doit être un mouvement à la seconde puissance, de sorte que, mobile lui-même, ce mouvement doit se modaliser en différents mouvements. On pourrait penser que ce mouvement serait amené à se modaliser en mouvements phusiques, en génération d’étants, et en mouvements des vivants.
RB : Vous touchez un point important. C’est en effet un problème auquel j’ai été confronté dans ce livre puisqu’il fallait concilier cette mobilité de la mobilité avec le fait que l’archi-événement n’est pas l’œuvre du mouvement. La réponse est très simple : c’est qu’un événement ce n’est pas un mouvement. L’archi-mouvement peut se modaliser dans des mouvements ontiques, mais il ne peut pas se modaliser sous la forme de sa propre séparation, d’un événement qui est au-delà du mouvement. Par métaphore, on peut évidemment dire que l’événement est un mouvement dans le mouvement, mais en réalité ce n’est pas un mouvement, c’est au-delà du mouvement : l’événement c’est ce qui vient interrompre le mouvement.
AD : Du coup, la phusis ne se substantialise-t-elle pas en un seul type de mouvement même s’il y a des modalités ontiques ?
RB : Non, parce qu’au fond la seule réalité de l’archi-mouvement du monde c’est l’infinité des mouvements mondains. C’est ce qui se fait en chacun de ses mouvements. Autrement dit, il n’y a pas de réalité possible d’un mouvement qui ne serait que mouvement indépendamment de ses modalités ontiques. L’archi-mouvement, c’est ce qui se fait dans tous les mouvements mondains, c’est le mouvement de ces mouvements. Donc il ne faut pas imaginer une sorte de phusis autonome et puissante qui, après coup, se modaliserait : elle n’est autre que ses propres modalisations. C’est ce qui se fait, c’est le fait que ça ne cesse pas de se défaire, de se refaire, de permuter : ce mouvement c’est la phusis même. Il ne faut donc pas l’imaginer sur un mode trop grec, trop pré-socratique.
La suite de l’entretien est consultable à cette adresse.







