Jean Vioulac vient de publier, en janvier 2018 aux Presses Universitaires de France, son cinquième livre : Approche de la criticité, sous-titré Philosophie, capitalisme, technologie. Il s’inscrit dans la lignée des quatre précédents, L’époque de la technique aux PUF en 2009, La logique totalitaire, dans la même maison d’édition, en 2013, Apocalypse de la Vérité chez Ad Solem en 2014 et enfin Science et révolution aux PUF en 2015, pour lesquels il reçut, en 2016, le Grand Prix de Philosophie de l’Académie Française récompensant l’ensemble de son œuvre. Cet entretien est l’occasion de revenir sur sa pensée en général, et les apports spécifiques d’Approche de la criticité en particulier. Qu’il soit ici vivement remercié de sa disponibilité.
Baptiste Rappin : Cher Jean Vioulac, je fais partie de vos lecteurs réguliers et fidèles, depuis 2009 et la sortie de L’époque de la technique jusqu’à aujourd’hui. Et s’il y a une chose qui me frappe en premier lieu, c’est que votre pensée me semble être un effort constant pour saisir l’époque contemporaine comme le lieu d’une crise, peut-être même de la crise. D’ailleurs, le mot apparaît dans le sous-titre de La logique totalitaire : Essai sur la crise de l’Occident (2013), avant d’intégrer le titre de votre dernière parution : Approche de la criticité (2018). Mais on le percevait dès le livre de 2009 dans lequel vous décriviez, dès l’entame, « l’ampleur du basculement d’une ère à une autre » (p. 15). Comment doit-on alors comprendre ce concept de « crise » ? Et de quelle « crise » parlez-vous ?
Jean Vioulac : La réponse à votre question exige d’emblée de rappeler un principe méthodologique incontournable, celui qui impose, à toute pensée qui se veut lucide aujourd’hui, de prendre en compte l’ensemble des données procurées par les sciences contemporaines. Seules ces sciences nous permettent de penser le réel, seules elles procurent la matière de la connaissance, et non les évidences intellectuelles ni les données perceptives de qui que ce soit, encore moins les traités philosophiques d’époques révolues. Or que ce soit du point de vue de la démographie, de l’écologie, de l’économie, du savoir, de la technique, de l’urbanisme, de l’art, des mœurs, des religions…, les XIXe et XXe siècles sont caractérisés par des bouleversements sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Il y a plus de différence entre la vie quotidienne d’un homme d’aujourd’hui, vie urbaine et connectée, et celle d’un homme du XVIIIe siècle, vie rurale et locale, qu’entre la vie de celui-ci et celle d’un Romain de la République ; de même pour le monde, aujourd’hui intégralement urbanisé, exploité et pollué. La première chose à faire est donc de prendre acte de ces bouleversements. Mais ceux-ci sont difficiles à concevoir, d’abord parce qu’ils portent sur des domaines très différents qui ne semblent pas avoir de rapports les uns avec les autres, ensuite parce que la masse de données à traiter sature quiconque tente de s’y confronter. D’où le second principe de la méthode, issu du constat que nous ne nous en sortirons pas tout seul, et que pour avoir une vue d’ensemble sur l’événement en cours, nous qui sommes des nains, il va nous falloir grimper sur les épaules de géants. Or notre époque est aussi celle de bouleversements dans l’ordre de la pensée, bouleversements tels qu’il ne s’en était pas produit depuis les Grecs, et il y a des géants qui ont su être à la hauteur de l’évènement : Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger sont les Titans de notre temps, et c’est à partir d’eux qu’il devient possible d’embrasser la masse énorme de données sur notre époque et de tenter de lui donner sens. Le concept de crise s’impose avec La Crise des sciences européennes de Husserl, qui conçoit notre époque comme achèvement du destin de la rationalité grecque : celle-ci s’était inaugurée sur un oubli initial, celui de la vie subjective charnelle, et l’hégémonie contemporaine de la rationalité objective et abstraite est alors un danger qui porte directement sur l’essence de l’homme, mais elle est aussi la révélation de cette origine oubliée de la rationalité elle-même, et offre donc la possibilité de sa refondation. Cette même structure de l’événement critique se retrouve chez Marx dans son analyse de la domination du capital, chez Nietzsche dans son diagnostic sur l’ère du nihilisme, chez Heidegger dans sa pensée du dispositif. Il faut alors insister sur l’ambiguïté de la crise, qui est à la fois un danger de dévastation et une promesse de renouveau. Le diagnostic de crise ne consiste donc en rien à condamner notre époque en bloc : il s’agit de reconnaître que, dans le processus évolutif qui la caractérise depuis sa rupture avec son passé animal, l’humanité a aujourd’hui atteint un seuil critique, qui lui procure tout à la fois la possibilité de s’accomplir, et celle de se détruire, et que nous sommes donc à la croisée des chemins.
BR : Je reviendrai plus tard sur la possibilité de cet accomplissement et également, bien sûr, sur les grandes figures de la philosophie que vous venez d’évoquer. Mais je me permets d’insister sur la dimension méthodologique de votre pensée ; en effet, ainsi que vous le dites dans votre première réponse, vous faites des acquis de la science contemporaine votre point de départ, affirmation qui fait écho à votre constat d’un monde aujourd’hui entièrement artificialisé : « Mais l’univers qui est le nôtre n’est plus naturel, il est artificiel – scientifique, industriel, urbain, technologique, et pollué –, cette infrastructure planétaire n’est pas création, elle est production, résultat d’un dispositif dont l’hégémonie et la puissance imposent leur vérité à tous les peuples de la Terre […] », écrivez-vous ainsi dans Approche de la criticité (page 23). Comment articulez-vous par conséquent ce constat initial à une ambition phénoménologique et ontologique, alors que Husserl et Heidegger pensaient encore l’être sous le prisme de la physis, de la « croissance naturelle » ?
JV : Il faut alors revenir sur le statut contemporain de l’ontologie et de la phénoménologie, pour évoquer un autre géant de la pensée qui est Kant. La Critique de la raison pure est une « révolution » (selon le mot de Kant lui-même), qui disqualifie toute pensée de l’être comme entité substantielle transcendante et met en évidence comment tout objet est résultat d’activités immanentes à la subjectivité. Il ouvre donc la voie à une ontologie transcendantale, qui considère tout donné comme un phénomène dont l’être est un ensemble d’activités subjectives de constitution. La réduction de tout donné à ses conditions de possibilité fonde la critique au sens philosophique : le moment kantien est donc crucial, puisque la pensée de la crise exige une pensée critique. C’est cette démarche que radicalisent la phénoménologie de Husserl et celle du premier Heidegger, en concrétisant la subjectivité transcendantale, en cessant de la définir au seul niveau théorique pour la considérer comme un « corps vivant » ou un « existant » aux prises, non plus simplement avec l’objectivité, mais avec le monde. Il s’agit de considérer le niveau théorique comme une simple superstructure, une couche superficielle, pour creuser en direction de la strate primordiale où a lieu le rapport primitif de l’homme avec le réel. Le trajet que fait le premier Heidegger dans les années 1920 est révolutionnaire, qui le conduit à définir les données non plus comme objets de connaissance, mais comme choses utiles, comme outils, et donc à faire de la technique (au sens ancien, artisanal) la condition de possibilité première du rapport au monde, et à définir la strate primordiale comme « monde du travail du travailleur manuel » ; sa généalogie des concepts de l’ontologie grecque dans Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie dégage même « l’activité de production de l’existant » comme attitude primaire de l’homme dans le monde. C’est le même trajet qu’accomplit Husserl dans les années 1930, pour définir la strate primordiale par le terrain de la pratique, découvrir les techniques grecques à l’origine de la géométrie, reconnaître ainsi que les idéalités sont reçues par héritage, ce qui impose d’assumer une historicité ontologique fondamentale. L’ontologie transcendantale réduit donc tout phénomène à des activités subjectives concrètes, quotidiennes, en rapport avec la matière du monde et dans le cadre d’une communauté historique : elles ne sont plus activités de constitution mais activités de production. Les œuvres de Husserl et du premier Heidegger sont touffues, complexes, pleines de tensions, mais si l’on y suit les avancées les plus révolutionnaires, on parvient à une ontologie de la production (même le second Heidegger met au cœur de sa pensée la production de la clairière de l’être, qu’il n’envisage certes que comme la poïèsis du poète). Là donc où la métaphysique pensait les étants comme des donnés et l’être comme donation (à partir de la passivité contemplative de la théôria ou de l’aïsthèsis), la phénoménologie pense les étants comme des produits et l’être comme production. Au bout de l’itinéraire de Husserl, on se retrouve au début de celui de Marx, et de même pour celui du premier Heidegger (c’est d’ailleurs sans doute parce qu’il n’a pas pu ou pas voulu l’assumer qu’il a mal tourné, mais c’est une autre histoire). Quand Husserl pense la crise des sciences européennes, il n’aborde donc qu’un niveau de la crise, celui de la superstructure idéelle, de la couche objectivo-logique : cette crise théorique doit être elle-même fondée sur une crise pratique, c’est-à-dire une crise de la production ; non plus une crise des sciences européennes mais une crise de l’économie européenne. Il devient alors possible et nécessaire de lire Le Capital, comme un traité d’ontologie phénoménologique : ontologie de la production, phénoménologie des formes-valeurs. Et c’est cela qui permet de penser notre univers artificiel, intégralement produit par un dispositif de production.
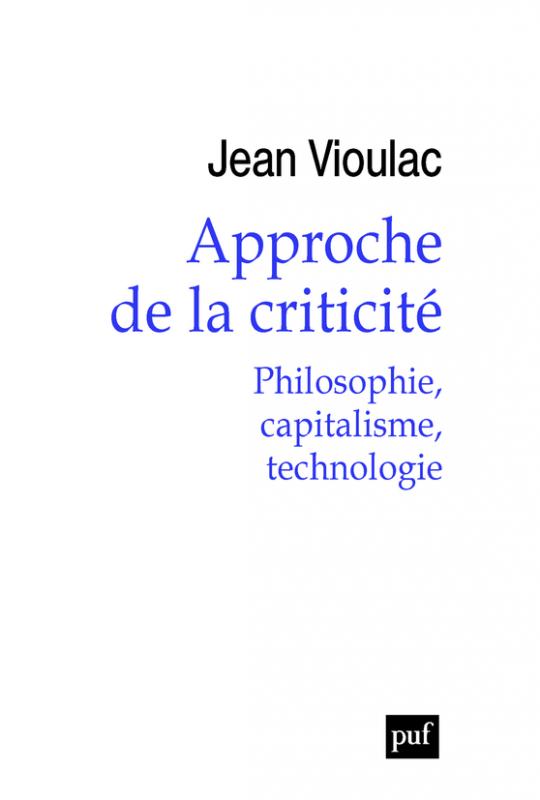
BR : Le lecteur comprend à présent pourquoi le sous-titre de votre premier ouvrage, L’époque de la technique, est le suivant : Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique. En effet, alors que la physique se hisse au rang de science première au sein d’un cosmos naturel, l’économie lui dame le pion dans un univers intégralement artificialisé. De telle sorte que technique et économie, révolution industrielle et révolution capitaliste deviennent indissociables. Mais alors, arrêtons-nous justement sur la façon dont vous articulez l’œuvre de Marx et la pensée de Heidegger. Certains voire beaucoup trouveront cet alliage étrange, et même…artificiel, et pourtant cette rencontre semble « logique » quand on vous lit. Qu’allez-vous chercher chez Marx que Heidegger ne vous offre ? Et que retenez-vous de Marx que Heidegger ne vous donne ?
JV : La philosophie ne se préoccupe pas des philosophes, mais uniquement de ce dont les philosophes se préoccupent. Il ne s’agit donc pas de chercher des points de convergence dans les corpus de Marx et de Heidegger, mais de saisir la connexion entre capitalisme et machinisme, et de saisir le sens de l’avènement du dispositif techno-capitaliste dans l’histoire. Le premier Heidegger a radicalisé la révolution kantienne par une analytique de la finitude qui permet de montrer le statut fondatif du monde du travail et d’articuler phénoménologie de l’ustensilité et ontologie de la production : il procure en cela un outillage conceptuel puissant pour aborder Marx. Le second Heidegger a eu sur l’histoire un regard d’une hauteur vertigineuse, qui permet de saisir notre époque sur le long cours, et permet donc de penser la crise. L’autre grand livre de Heidegger, après Être et temps en 1927, est selon moi Le Principe de raison en 1957, qui reprend la question de Husserl dans La Crise des sciences européennes, pour voir l’accomplissement de la rationalité grecque, non pas dans la science, mais dans la technique. Technique qui n’a plus aucun rapport avec le maniement de l’outil qu’il analysait dans les années 1920, puisqu’elle n’est plus déploiement de la puissance manuelle de l’existant dans le monde du travail, elle est déploiement d’une puissance machinale, gigantesque, qui n’a d’autre but que son propre accroissement : la technique n’est plus manœuvre, elle est machination, termes qui désignent ici les modalités fondamentales de constitution du monde. Les années 1950, où Heidegger prononce son cours sur le principe de raison, sont en effet caractérisées par l’avènement de l’informatique, et l’informatique, c’est précisément le moment où une logique abstraite, purement formelle, définie par l’automatisation des procédures de calcul, vient directement commander des processus matériels. L’invention de l’ordinateur par John Von Neumann (un mathématicien) en 1946 est un événement métaphysique : celui en lequel la raison pure vient immédiatement régler le monde de l’expérience, celui par lequel le monde des idées pénètre le monde sensible, elle est une révolution qui a instauré un platonisme réellement existant (comme on parlait à une époque de « socialisme réellement existant »). En tant qu’elle permet la domination totale de la rationalité objectivo-logique, la question de l’informatique doit néanmoins être reprise à partir d’une question que vous connaissez bien puisque vous lui avez consacrée un livre important, la cybernétique. Le concept de cybernétique permet en effet de concevoir le dispositif technique planétaire dans ses effets sociaux, comme pouvoir de commandement de la logique sur les vivants. Une question demeure pourtant ouverte chez Heidegger : comment comprendre cette domination de l’idée sur les corps, de la raison sur la vie ou, pour le dire dans son vocabulaire, des étants sur les existants ? C’est là où le second Heidegger me semble en recul par rapport au premier, puisqu’il restaure la théologie et sa providence en expliquant l’histoire par le « destin de l’être » ; le premier Heidegger imposerait pourtant d’expliquer la soumission des existants à l’idéalité sur les bases du « monde du travail » et du « comportement de production » de l’existant. Il s’agit donc d’expliquer l’aliénation du travail : ce à quoi Marx s’est consacré, pour redéfinir la domination de l’idéalité pure par le mode capitaliste de production. L’originalité du capitalisme n’est pas l’exploitation du travail (qui a toujours existé), c’est son aliénation, et celle-ci est rendue possible par le salariat : le salariat est fondé d’abord sur la distinction entre la puissance et l’acte du travail, ensuite sur la réduction de la puissance à une quantité abstraite, enfin sur l’usage de cette puissance par un dispositif destiné à produire la quantité abstraite de la valeur, quantité numérisée qui aujourd’hui n’a même plus besoin du support matériel des pièces de monnaie. Le dispositif capitaliste est un dispositif cybernétique, qui procure toute puissance à l’idéalité pure de la valeur, et c’est d’ailleurs ainsi que Friedrich Von Hayek a conçu le marché. Toute pensée de la technique aujourd’hui qui n’envisage pas sa connexion structurelle avec le capitalisme est nulle et non avenue : les outils et machines sont d’abord et avant tout des moyens de production, les systèmes de transport et de communication sont d’abord et avant tout des moyens de circulation, et le dispositif capitaliste est l’unité de la production et de la circulation.
BR : Puis-je ici me permettre d’émettre une réserve, ou plutôt de vous demander une précision ? Lénine fut l’un des premiers admirateurs de Taylor et du management scientifique, Himmler importa les techniques des relations humaines (l’importance du « facteur humain » dans la productivité ouvrière), et des expériences cybernétiques significatives se déroulèrent au Chili et en URSS. De même, des administrations ou des associations, c’est-à-dire des organisations non marchandes, s’équipent de systèmes d’information et conçoivent leurs processus internes en termes de Lean Management. Est-ce donc à dire que cette diversité de situations organisationnelles, politiques et historiques se trouvent toutes absorbées dans la catégorie du capitalisme ? Et, de plus façon plus générale, peut-on établir un strict isomorphisme entre capitalisme et révolution industrielle de telle sorte que les structures des deux ensembles se recoupent parfaitement ?
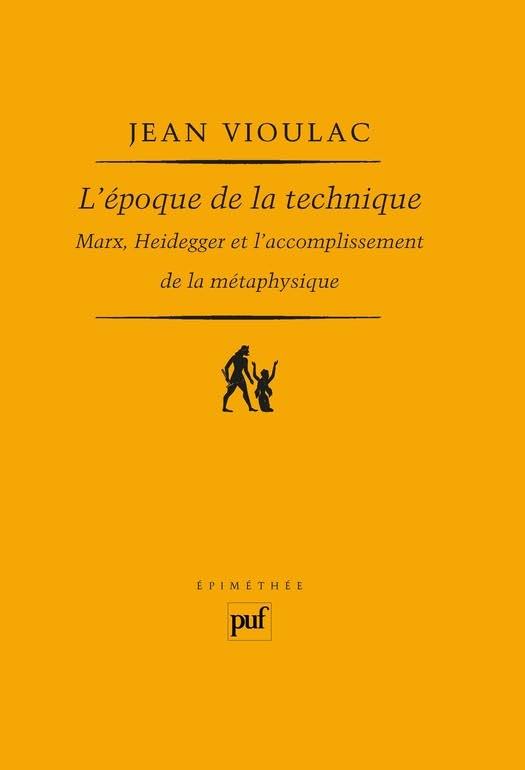
JV : Vous parlez de « révolution industrielle », et c’est le concept qui s’impose en effet après des analyses qui mettent le monde du travail au fondement et se déploient donc à partir d’une ontologie de la production. La situation de crise qui définit les XIXe et XXe siècle et ce début de XXIe siècle n’est autre que l’ensemble des répliques d’un séisme fondamental, la révolution industrielle. Ce qui permet de situer notre époque dans l’histoire : elle est la seconde révolution totale après la révolution néolithique qui, il y a une centaine de siècles, a fait passer l’humanité de la préhistoire à l’histoire. Encore ce processus fut-il très lent, à partir d’une aire géographique très limitée, et ceux qui l’ont vécu ne se sont rendu compte de rien. La révolution industrielle a bouleversé l’existence des hommes, le monde lui-même et les conditions de la vie sur terre, en moins de deux siècles, et pour tous les peuples de la planète ; ces bouleversements sont tellement rapides qu’ils sont visibles à l’échelle d’une vie d’homme. Ce qui permet d’introduire un autre concept, celui de révolution : penser la crise, c’est tout autant penser la révolution ; dire que nous sommes dans une situation critique, c’est dire que nous sommes dans une situation révolutionnaire. Marx a donc analysé une révolution qui avait déjà eu lieu, sans que personne ne l’ait décidé, et il l’a définie par l’avènement du capitalisme, compris comme « révolution économique totale », il montre ainsi que quand on parle de révolution industrielle, on parle en vérité de la révolution capitaliste. Révolution authentique parce qu’elle est l’inversion pure et simple du producteur et de son produit : le travail est soumis à l’objectivité de la valeur, qui n’a pourtant d’autre source que le travail. Le sujet est ainsi soumis à son propre objet, et Marx définit fréquemment le capitalisme par « l’inversion du sujet et de l’objet ». Dans le processus d’avènement du capitalisme, la révolution industrielle proprement dite est le moment de la « subsomption réelle » du processus de production, moment où le capitalisme met en place l’infrastructure technique qui lui est nécessaire. C’est-à-dire le machinisme, qui se définit par la même inversion : alors que l’outil est au service du travailleur, le travailleur est au service de la machine. La question que vous posez est absolument fondamentale : il s’agit de savoir si le rapport entre machinisme et capitalisme est structurel ou conjoncturel. Il me semble que dans son analyse du capitalisme, Marx tend à montrer qu’il est structurel, mais que quand il envisage la révolution communiste, il fait le pari qu’il y a un autre usage possible de ce système machinique. Je ne suis pas sûr qu’il puisse y avoir de réponse théorique à cette question. Jusqu’ici, l’histoire tend à indiquer que le rapport entre machinisme et capitalisme est structurel. Il ne faut pas être dupe en effet de la propagande soviétique qui prétendait proposer une alternative au capitalisme, puisque le bolchevisme n’a rien fait d’autre que déchaîner la révolution industrielle en Russie sous la forme d’un capitalisme industriel d’État fondé sur l’expropriation des paysans, leur prolétarisation et leur exploitation et, comme vous le soulignez, qu’il a massivement taylorisé la production : il est même possible de voir dans le stakhanovisme un triomphe du management. C’est d’ailleurs en URSS que la cybernétisation de l’économie est expérimentée, où Victor Glouchkov met en place un « Système National Automatisé d’Administration de l’Économie » (l’OGAS) au début des années 1960 : mais le néolibéralisme ne fait rien d’autre que promouvoir une autorégulation cybernétique du marché mondial, et c’est au début des années 1970, au moment même où l’échec de l’OGAS en URSS est acté, que la bourse de New-York commence l’informatisation de la finance (avec le NASDAQ, qui n’a rien à envier à l’OGAS). Dans un cas la régulation cybernétique se fait par l’État, dans l’autre par le Marché, mais il n’y a là que deux modes différents de la domination des sociétés par une entité abstraite. Ce qui permet de comprendre que la question du Capital dépasse de très loin le seul champ économique. Le capitalisme, c’est « l’inversion du sujet et de l’objet », « l’autovalorisation de la valeur », c’est-à-dire le moment où l’idéalité pure est devenue « sujet automate » du processus de sa reproduction : le capitalisme est une chose trop grave pour être confiée aux économistes.
BR : Votre interprétation de Marx, qui s’axe principalement, et même principiellement, autour du procès d’abstraction du travail, me paraît s’accorder avec celle que Michel Henry développe dans son Marx, mais également avec les analyses du courant de la Wertkritik (« critique de la valeur ») auquel on associe les noms de Moishe Postone, Anselm Jappe ou encore Robert Kurz, autant d’auteurs qui prolongent la pensée d’Alfred Sohn-Rethel auquel vous consacrez un développement non négligeable (un peu moins d’une vingtaine de pages) dans La logique totalitaire. Sont-ce là des sources d’influence de votre pensée ? Quel rôle ont-elles joué dans la genèse de votre réflexion ? En outre, ces questions appellent la suivante : si je peux me permettre de vous paraphraser, dans quelle mesure estimez-vous que le « marxisme » est une chose trop importante pour être confiée aux « marxistes » ?
JV : Il est vrai que dans ma propre approche de Marx, Michel Henry a été important, parce qu’il a mis en évidence la portée phénoménologique de ses analyses économiques. Mais le Marx de Michel Henry n’est pas un livre sur Marx : c’est un livre de Michel Henry, qu’il me semble impossible de suivre jusqu’au bout. La thèse henryenne d’une « subjectivité inobjective » est en effet intenable pour interpréter Marx, qui définit tout au contraire la subjectivité par l’activité d’objectivation, et par le rapport qu’elle entretient avec ses objets : quand Marx parle d’une « subjectivité sans objet », il désigne le point extrême d’aliénation du travailleur, « réduit à cette position nihiliste » selon une expression du Capital. La conception henryenne de la vie purement subjective reste spéculative et métaphysique : la définition la plus sommaire du concept de vie impose d’y intégrer une interaction constante avec un milieu, donc une hétéronomie radicale et une ouverture vitale avec la transcendance d’un monde, Michel Henry ne parle pas de la vie, il parle de l’âme, au sens cartésien. La subjectivité, pour Marx, c’est « l’homme réel, en chair et en os, campé sur la terre solide et bien ronde, l’homme qui aspire et expire toutes les forces de la nature » comme il l’écrit magnifiquement dans les manuscrits de 1844, elle se définit donc par un processus constant (et dialectique) d’échanges et d’interactions avec l’objectivité. Par ailleurs, la thèse d’une immanence radicale de la vie à elle-même me paraît tout aussi intenable : il n’y a de vie proprement humaine que par l’espace de jeu du deuil, c’est-à-dire par l’intériorisation de la mort et l’espace cryptique qui se creuse en chacun où la mémoire des morts est sauvegardée. Il n’y a pas d’humanité sans cette déchirure, cette faille et cette défaillance intimes. Parmi les auteurs que vous citez, c’est Alfred Sohn-Rethel qui a été pour moi décisif. Sohn-Rethel a en effet développé de façon systématique le thème marxien de « l’abstraction réelle », qui résoud le problème de la genèse des idéalités. À partir du moment où l’origine des idéalités ne peut plus être expliquée ni par un ciel des idées, ni par un don de Dieu, ni par leur innéité, il faut leur trouver une origine pratique et historique. La plus archaïque, c’est à mon sens le deuil, comme intériorisation idéalisante de l’objet perdu. Mais la question est de déterminer comment peut apparaître la rationalité scientifique : la question de la généalogie de la raison est l’axe central du travail de Husserl dans les années 1930, et dans son essai sur L’Origine de la géométrie, il en arrive à fonder les concepts géométriques sur les techniques de mesure, d’arpentage, de triangulation ou de calcul de l’impôt qui apparaissent avec la révolution néolithique. Mais ça ne suffit pas : il faut en outre se demander comment peut se faire le saut entre ces différentes techniques empiriques d’une part, et leur essence formelle d’autre part, c’est-à-dire comment peut s’opérer la réduction des choses particulières concrètes à leur essence universelle et abstraite. Or si la Grèce ancienne est le moment où apparaît la raison pure, elle est aussi le moment où apparaît la monnaie frappée et où les Cités s’organisent autour du marché (l’agora). Ce que comprend Sohn-Rethel, c’est que la monétarisation des échanges, sur le terrain fondatif du monde du travail, opère concrètement, pratiquement, quotidiennement la réduction des qualités particulières concrètes des multiples choses (les valeurs d’usage) à une quantité universelle et abstraite (la valeur d’échange), et fait de cet Universel-Abstrait un objet autonome et accumulable (la monnaie). Il y a d’ailleurs un passage absolument remarquable de Husserl, dans un texte écrit moins d’un an avant sa mort, où il note que « ce sont les mêmes choses qui ont pour les étrangers un sens religieux et qui, pour les Grecs, au marché, ont un prix. C’est à partir de là que s’accomplit la première découverte de la différence entre une existence en soi identique et ses multiples modes d’apparition ou d’appréhension subjectifs » : à la toute fin de sa vie, Husserl découvre lui aussi la monnaie comme puissance primordiale d’idéation (ce qui confirme que tout son itinéraire mène à Marx). La monnaie, c’est donc tout à la fois l’opérateur de la réduction du multiple à l’un, du particulier à l’universel, du concret à l’abstrait, et de l’autonomisation de cet Universel-Abstrait par rapport aux hommes réels en chair et en os. Le capitalisme, système de production où l’argent fait de l’argent, c’est alors le moment où cette idéalité pure, cet Universel-Abstrait conquiert l’hégémonie mondiale, et où se met en œuvre l’abstraction du réel, sa numérisation, sa virtualisation, sa réduction au spectacle total. D’où les limites du marxisme (courant propre au XXe siècle, qui a son intérêt, mais qu’il faut rigoureusement distinguer de la pensée de Marx), qui a été borné par son matérialisme et son positivisme et s’est ainsi interdit, par principe, de penser le capital. Marx insiste pourtant sur le fait que « le capital, étant valeur, est de nature purement idéelle », et que « le capital est quelque chose d’immatériel, d’indifférent à sa subsistance matérielle » : il y a capital justement quand l’idéalité pure de la valeur, par la circulation, n’adhère à aucune chose et ne s’incarne dans aucune marchandise particulière. Il est impossible de penser le capital dans le cadre d’un matérialisme qui refuserait tout être à l’abstraction parce que le capitalisme est un idéalisme, où la « forme idéelle » de la valeur devient « sujet automate » et « sujet dominant », selon les expressions de Marx. La marchandise, le capital lui-même, est une « chose sensible-suprasensible, dit Marx, c’est-à-dire une entité physique-métaphysique, et on ne comprend pas le capitalisme si on ne prend pas en compte cette puissance de l’idéalité (et on ne comprend pas davantage l’informatique, la cybernétique, la physique quantique ou le spectacle, c’est-à-dire notre époque). En quoi le capitalisme est accomplissement de la métaphysique : mais l’élaboration même de la métaphysique en Grèce ancienne était en connexion secrète avec la monnaie.
BR : À cette genèse de la métaphysique par le pouvoir irréalisant et unifiant de la monnaie fait écho le règne de l’image aujourd’hui : en effet, les écrans des télévisions, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones dits intelligents, des différentes bornes de commande (restauration rapide, gares, administrations, etc.), peuplent notre quotidien. Ce n’est donc pas innocemment que vous avez prononcé le mot de « spectacle » : Guy Debord, lui aussi, considérait le spectacle comme l’ultime phase du capitalisme, comme un concentré de marchandise dont il explique l’hégémonie par la séduction qu’exerce sur l’Occident, dès son aurore grecque, le sens de la vue. Ainsi écrivez-vous, dans L’époque de la technique (page 154), que « l’importance capitale de la télévision vient de ce qu’elle donne à voir ». Quel rapport au monde instaure donc cette société de l’écran ?
JV : La Société du spectacle est en effet un texte fulgurant qui, dès 1967, pressent la mise en place de l’univers médiatique contemporain dans son essence totalitaire, et y voit la phase ultime du capitalisme. Le capitalisme, c’est la réduction de toute chose à sa valeur d’échange, forme abstraite devenue indifférente à tout contenu matériel, qui peut ainsi circuler indéfiniment dans l’espace-temps du marché : le spectacle parachève ce processus en réduisant toute chose à sa représentation, et en instituant ainsi un milieu universel et abstrait où circulent indéfiniment des images détachées de la vie réelle. L’univers spectaculaire est ainsi l’espace public produit par le dispositif capitaliste de production (qui pulvérise donc l’espace politique de la res publica). Cet univers médiatique est entièrement technique : il est fondé sur une infrastructure cybernétique et un réseau planétaire, où les écrans servent d’interface entre les hommes réels en chair et en os, et ce milieu numérique et virtuel. Or un écran de télévision, d’ordinateur, de tablette ou de smartphone, c’est une machine phénoménologique (phénoménotechnique, plutôt) qui produit des apparitions phénoménales. D’où l’importance de la Critique de la raison pure pour analyser le dispositif contemporain, puisque l’on se retrouve là avec des phénomènes, des représentations ou des objets, qui ne sont plus résultats d’activités de constitutions immanentes à la subjectivité : ce sont des phénomènes intégralement objectifs, où les fonctions de la sensibilité, de l’imagination productive et de la synthèse catégoriale sont prises en charge par la machine, des phénomènes donnés à un sujet passif et réceptif qui retrouve ainsi la position contemplative du philosophe idéaliste. La vie connectée se situe ainsi dans la différence entre l’univers numérique et le monde charnel, elle impose à tout un chacun la subjectivité schizophrénique du métaphysicien. Le cyberespace, qui s’est mis en place avec une rapidité sidérante, est le topos noètos de la métaphysique platonicienne, le lieu intelligible, en dehors du monde sensible, purement numérique, qui recèle en lui les archétypes qui peuvent alors se manifester de multiples façons dans le monde sensible. L’imprimante 3D est une machine tout à fait étonnante à cet égard, on peut y voir la revanche de Platon sur Aristote : Aristote opposait à Platon que les formes sont immanentes à la matière et que l’on ne peut pas les considérer comme des réalités en soi, mais l’invention de l’informatique, c’est précisément celle de la réduction des formes (de l’information) à une quantité numérique qui acquiert un mode d’existence totalement indépendant de tout substrat matériel (c’est toute la différence entre le code et le signal). Avec une imprimante 3D, vous avez donc la possibilité de matérialiser à volonté dans le monde sensible des archétypes purement numériques, qui existent dans le cyberespace, c’est-à-dire partout et nulle part : machine qui remplit ainsi la fonction du démiurge.
BR : Je crois qu’il nous reste deux philosophes à aborder pour clore cette phénoménologie déjà bien avancée de la planétarisation. Vous leur consacrez à chacun un chapitre dans La logique totalitaire je veux parler de Hegel, dans l’œuvre duquel vous décelez le procès de totalisation caractéristique de l’histoire européenne, et de Tocqueville, en qui vous voyez l’analyste de la massification, en d’autres termes de la démocratie entendue comme forme de la souveraineté moderne. Pourriez-vous revenir sur ces deux mouvements, la totalisation et la massification ?
JV : Hegel est sans aucun doute le philosophe fondamental de notre temps, la Phénoménologie de l’esprit peut-être le plus grand livre de l’histoire de la philosophie, et il n’est à mon sens pas possible de penser aujourd’hui sans Hegel. Hegel est le premier à comprendre, au début du XIXe siècle, que l’humanité est en train de basculer d’une ère à une autre, que nous sommes en train de sortir de l’histoire, et qu’il est vain de tenter de maintenir tout ce qui est en train de s’effondrer. Ce qui s’achève sous les yeux de Hegel, c’est le processus de réalisation de la raison et de rationalisation de la réalité : et en effet, nous ne vivons plus dans un environnement naturel, mais dans un univers intégralement articifiel et numérique, au sein de ce que Hegel nomme une « seconde nature », qui s’est substituée à la première. Hegel lui-même y voit l’accomplissement du platonisme, l’achèvement de la métaphysique, et c’est ce qu’il oppose à Kant : la Critique de la raison pure veut montrer que la métaphysique est impossible parce que les idées de la raison ne peuvent pas trouver de vérification expérimentale dans les structures de la subjectivité finie, et tout particulièrement dans les formes de l’espace et du temps ; Hegel lui objecte que ce n’est précisément pas par les sujets finis que se fait cette vérification, mais par le biais du travail millénaire de peuples qui se sont succédés pour opérer cette rationalisation intégrale du réel, et ce dans le temps de l’histoire et dans l’espace du monde. Hegel conçoit ainsi notre époque comme synthèse de toutes les contradictions, comme identité achevée de l’idéal et du réel, adéquation parfaite du réel et du rationnel : de son point de vue, la Sagesse que recherchaient les philosophes est enfin atteinte, nous sommes entrés dans l’ère du Vrai et du Bien, et il conçoit même l’avènement de cette totalité rationnelle comme marche de Dieu sur terre. Hegel est ainsi fondamentalement le penseur de la réconciliation : c’est pourquoi il n’est pas un penseur de la crise. Il demeure en effet idéaliste et reste pris dans les structures de la métaphysique, en ce qu’il identifie la réalité à l’idéalité, le réel et le rationnel. À partir du moment où, avec Marx, on reconnaît que les idées, la rationalité, l’esprit sont productions des hommes réels en chair et en os, alors la domination totale de l’idée absolue sur les hommes réels se révèle comme soumission des producteurs à leur propre produit. Marx ne voit donc pas en notre époque celle de la réconciliation absolue, mais celle de l’aliénation absolue, celle de la crise et du conflit, et le processus que décrit Hegel doit alors être reconnu comme danger : non pas comme achèvement, mais comme phase critique qu’il faut tenter de surmonter. Tocqueville comprend lui aussi que notre époque est celle du passage d’une ère à une autre, et il analyse ce passage du point de vue de l’avènement des masses (sociétés de masse connues sous le nom de « démocratie »), en lequel il voit à la fois une lame de fond irrésistible et une catastrophe historique : la démocratie n’est pas un régime politique, c’est une réalité sociale, elle n’est pas caractérisée par la liberté des individus, mais tout au contraire par leur soumission totale à la masse, leur formatage et leur conformisme, leur adaptation constante aux normes et leur normalisation, dans des modes de vie où la liberté disparaît tout simplement parce qu’elle est devenue sans usage. Mais Tocqueville reste lui-même pris dans une conception théologique de l’histoire, et voit dans ce processus un effet de la providence divine (en précisant que ce qui lui paraît catastrophique à lui est sans doute très bien aux yeux de Dieu). Il note pourtant le lien entre la démocratisation et développement de l’industrie : c’est évidemment dans son rapport à la révolution industrielle qu’il faut l’analyser, pour mettre en relation la production de masses humaines avec les impératifs du dispositif capitaliste, fondé tout à la fois sur la massification de la puissance de travail, la production en masse et la consommation de masse.
La suite de l’entretien est consultable ici.








