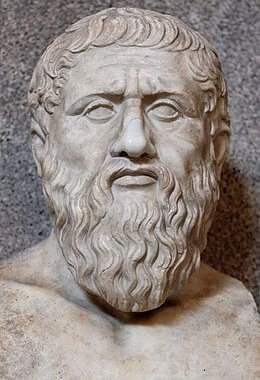La première partie de l’article se trouve à cette adresse.
C : Une physique mathématique ?
AP : De ces analyses découle une réévaluation de la place de la mathématique au sein de la physique platonicienne ; vous évoquez très rapidement dans l’ouvrage la présence d’une « authentique physique mathématique »1 et allez jusqu’à écrire que « la première étape scientifique de la mathématisation de la physique est l’acoustique pythagoricienne. »2 Ne pourrait-on pas cependant objecter que la présence de cette « mathématisation » au sein d’un mythe en atténue la portée ?
JJD : D’abord, que l’acoustique du Timée soit une « authentique physique mathématique » est rigoureusement exact, ce qui semble avoir malencontreusement échappé aux interprètes. La version officielle est que Platon a eu un projet de physique mathématique qui commence avec les cinq solides inscriptibles dans une sphère, et qui, donc, était forcément arbitraire et étranger à la science. On salue l’intention, tout en insistant sur le fait qu’on est bien loin de la science. La réalité textuelle est très différente : l’interface choisie par Platon entre mathématiques et physique n’est pas la géométrie, mais l’acoustique, avec la construction de l’Âme du monde (qui en est la structure vivante), et cette acoustique était la seule branche de la physique mathématique qui existait à l’époque. Les calculs de longueur de corde à partir des rapports de quinte et d’octave relèvent en effet d’une acoustique très élémentaire, certes, mais parfaitement scientifique, du niveau de celle qu’on enseignait autrefois en seconde (c’est ce qui m’a permis de retrouver les calculs). Il est donc tout à fait incontestable que « la première étape scientifique de la mathématisation de la physique est l’acoustique pythagoricienne ». Ici, le mythos est un modèle mathématique, parce qu’il s’agit d’une réalité mathématique, celle de la structure vivante du cosmos. La philosophie est la recherche de la connaissance, le premier objet de la connaissance est la totalité du réel que constitue le monde, et le postulat de Platon est que le monde est mathématique (parce qu’il est une œuvre d’art divine), donc le modèle doit être mathématique. Le terme de mythos ne doit pas nous tromper ; mutatis mutandis, Platon est dans la même situation épistémique que nous, même si c’est pour des raisons très différentes : il sait qu’il n’a aucune garantie que son analyse soit absolument juste, et il sait qu’il ne peut pas en avoir parce que l’objet dépasse les limites de la connaissance humaine, de sorte qu’il se rabat sur une conjecture qu’il essaye de rendre le plus en accord possible avec la réalité, ce que nous appelons un modèle.
AP : Vous écrivez par ailleurs que l’originalité pythagoricienne n’est pas de découvrir des rapports mais de construire une échelle entièrement mathématisée, qui servira d’échelle pour le monde occidental. Pythagore comprend ainsi que les nombres entiers peuvent avoir une expression physique, acoustique. Dès lors, si l’harmonie qui résulte de l’architecture est ressentie par celui qui la contemple, l’harmonie acoustique est quant à elle une réalité physique et est « un effet réel indépendant du goût »3 Je m’interroge néanmoins sur le problème du nombre chez Pythagore : peut-on associer nombre et mathématique chez Pythagore ? Le nombre n’est-il pas le chiffre d’une réalité supérieure chez ce dernier, ce qui interdirait d’en faire l’indication d’une quantité et, partant, ce qui rendrait plus que délicate l’idée de « mathématisation de la physique » ?
JJD : Je crois que les choses sont plus simples, je me place toujours du point de vue de l’expérience, et non du concept. Les Pythagoriciens, qui s’intéressaient aux nombres, ont évidemment saisi l’occasion qu’offrait la mesure des cordes vibrantes. On ne sait pas à partir de quand se font les expérimentations sur le monocorde, mais la mesure des cordes vibrantes est une opération très simple. Le point central de l’expérience est qu’on entend très clairement le résultat : les consonances de quinte et d’octave se perçoivent immédiatement, elles se signalent par la pureté de l’accord, beau par là même, tandis que les décalages rendent vite le son désagréable. Il s’agit là d’une expérience naturelle universelle. Les Pythagoriciens ont mesuré et construit leur échelle sonore au moyen de ces mesures, c’est-à-dire essentiellement la quinte (3/2) et l’octave (2). A. Bélis a fait une remarquable reconstitution de papyrus exposant une gamme pythagoricienne. Quelle qu’ait pu être leur conception du nombre, les Pythagoriciens ont expérimenté très concrètement, et scientifiquement comme nous l’avons vu, la mesure des cordes vibrantes. L’expérimentation acoustique pythagoricienne se situe à l’interface des mathématiques, de la physique et de l’esthétique.
AP : De la même manière, je me demande si la science moderne n’est pas caractérisée par l’introduction de la mesure comme critère de scientificité, et si dans ces conditions l’approche pythagoricienne du nombre ne rend pas incommensurables celle-ci et celle-là, rendant discutable une affirmation comme celle-ci :
« La conception platonicienne de la science est donc très moderne, en ce qu’elle postule qu’une réalité mathématique la plus simple possible sous-tend le réel, mais paradoxalement, le seul domaine où elle peut s’appliquer de façon valide est la construction d’une gamme qui n’est ni celle des Grecs, ni la nôtre (…). »4
JJD : Galilée, à la suite des médiévaux comme Grosseteste, Oresme ou Buridan, procède à la mesure, en l’occurrence celle du mouvement, ce que n’avaient pas fait les Grecs, mais, comme on vient de le voir, l’acoustique avait introduit la mesure dans la science dès le pythagorisme. Pour savoir quels sont les rapports d’octave, de quinte et de quarte, il faut les avoir mesurés, et l’expérience de la correspondance parfaite entre la mesure exacte et la consonance a dû être une révélation : on expérimentait le fait que la simplicité mathématique correspondait à l’harmonie et à la beauté, la nature coïncidait avec les mathématiques et avec le beau. Et le phénomène pouvait se ramener à du calcul. Une telle expérience a dû être bouleversante. Ce qui est tout à fait moderne est donc le fait de ramener un phénomène physique à une formule mathématique, mais ce qui, pour nous, s’étend à toute la physique, n’était pour les Grecs pertinent que pour l’acoustique élémentaire. Pourtant Platon n’a pas hésité à extrapoler et à faire la bonne conjecture, en quoi il est très moderne, contrairement à Aristote.
D : « le cycle éléatique »
AP : Venons-en maintenant au troisième aspect de votre ouvrage, à savoir une reconstruction de l’ordre logique des dialogues platoniciens. Avant d’en dire plus, il me semble important de dire que, pour un professeur de philosophie, au-delà même de la question de la datation, il est fréquent d’être confronté à de pénibles moments, à savoir ceux où se trouve abordé le contenu précis des Idées : exposer ce dont il est question dans l’Idée du Juste, voire du Bien ou du Beau, est toujours un moment inconfortable qui ne peut laisser que sceptique l’auditoire. Or, en disant d’une part qu’il n’y a pas de doctrine des Idées et en affirmant d’autre part que l’auto-réfutation du Parménide n’est pas un terminus ad quem mais un terminus a quo, vous décomplexez si je puis dire le professeur peinant à expliquer ce qu’est cette supposée doctrine des Idées en montrant qu’elle n’existe pas. A cet égard, en tant que professeur, je ne peux être que très séduit par la thèse que vous exposez en ces termes : « seule l’intégration de la scénarisation platonicienne du Parménide comme dialogue initial et initiatique de la recherche de l’eidos, permet d’en donner une lecture cohérente. »5
Vous proposez de ce fait un ordre logique des dialogues :
1) le point de départ est le dialogue imaginaire du Parménide.
2) Arrive la République où Socrate ne tombe plus dans le piège du troisième homme. La République pose l’équivalence structurelle de l’âme humaine et de la cité.
3) Avec le Timée, Platon ajoute le monde, ordre divin, qui va à son tour servir de modèle harmonique. Seule la psychè du cosmos permet d’en assurer l’automotricité et la régulation. Le monde est un, vivant et divisible.
4) Cette logique impose de revoir l’éléatisme et repenser cela. C’est le rôle du Théétète, du Sophiste.
Pour parvenir à un tel résultat, vous commencez par une longue analyse de l’eidos et distinguez l’Idée de la Forme ; pourriez-vous expliciter ces points ?
JJD : Il y a toujours deux dates des dialogues, la date dramatique et la date d’écriture. L’ordre dramatique est essentiel au cycle éléatique, qui oppose le jeune Socrate du Parménide au vieux maître de la trilogie qui a lieu au moment du procès. Chronologiquement le Socrate de la République est évidemment entre les deux, et on peut tout naturellement opposer l’inexpérience du premier à la maîtrise que manifeste la République. Dans l’ordre de l’écriture, toutefois, je suis d’accord avec l’ensemble des interprètes pour considérer que la République est antérieure au Timée et au cycle éléatique. La République est un peu la somme du socratisme, qui précède la mise en place du véritable platonisme, dont le moment clef est le Timée, qui, à mon sens, en est aussi le moment initial. Il me semble que l’exposé du Timée fait prendre conscience à Platon qu’il est passé sur un autre plan et qu’il doit opérer une révision générale. Le passage de l’harmonie de la cité à l’harmonie cosmique lui fait comprendre qu’il vient de forger l’outil qui peut permettre de débloquer les paradoxes éléatiques et de penser à la fois l’unité et la pluralité du monde. C’est ce qui l’amène à se trouver une nouvelle généalogie, en faisant de Socrate un élève de Parménide, et, sous le masque de l’Éléate parricide, de reprendre le flambeau de Socrate dans le Sophiste. Cette nouvelle perspective est en rupture avec la République, mais Platon tient toujours à lisser les transitions et à les présenter non comme des ruptures mais comme des accomplissements. Et là, dans le Timée, il se met sous le patronage de Socrate au moment même où il le dépasse. D’une autre manière, dans le Philèbe, il fera dépasser par Socrate lui-même, que j’ai appelé Socrate 2, le dualisme socratique du Phédon.
L’eidos est un concept flou, qui n’est jamais défini, et qu’il ne faut pas chercher à définir, pour lui laisser toute sa souplesse. Il est ce qu’on recherche, mais quoi ? La vérité de la chose, qui peut être forme, structure ou idée selon l’angle choisi.
AP : Vous suggérez néanmoins de rendre eidos par notion ; ne craignez-vous pas que cela fasse basculer Platon vers une pensée moderne du sujet, où l’analyse de la connaissance se substituerait à celle de l’Être ?
JJD : Cette suggestion n’est qu’une hypothèse imaginaire, dont tout l’intérêt tient à ce qu’elle invaliderait automatiquement toutes les difficultés initiales du Parménide. J’ai voulu montrer que si on adoptait une version moderne du problème, en rendant eidos par notion, ce que, d’ailleurs, le Liddell Scott n’exclut pas, les objections éléatiques deviennent absurdes. Les difficultés soulevées par les deux Éléates tiennent à une conception matérialiste de la signification, qui identifie le concept à la chose, comme s’il devait y avoir un peu de la chose dans le concept, ce que le dialogue appelle la participation. Ce sont les Stoïciens qui mettront au clair la question de la signification en distinguant le signifié, incorporel, de la chose signifiée. Ce qui, au passage, montre qu’il y a des progrès en philosophie. Platon n’aurait pas pu écrire le Parménide après les Stoïciens. Socrate flaire quand même un peu le faux problème, et suggère timidement la bonne solution, mais, dramatiquement, il ne peut insister et renverser ces deux grands aînés.

AP : La jeunesse de Socrate dans le Parménide a été maintes fois interrogée. De votre côté, vous y voyez la mise en scène rétrospective des apories initialement rencontrées par la doctrine des Idées :
« Le plus probable est donc que Platon construit la fiction d’un jeune Socrate mis sur la piste des eidè par les objections mêmes des Éléates, qui, stimulé par des réfutations auxquelles il n’est pas encore en mesure de répondre, entrevoit néanmoins déjà la piste sur laquelle il ouvrira lui-même la voie à Platon. En tout cas, que Platon ait choisi de représenter un Socrate de vingt ans, plus avancé philosophiquement que celui de la République, n’aurait pu relever que d’une incompréhensible maladresse. »6
JJD : Absolument. Le traitement classique des dialogues par les spécialistes, qui les considèrent comme des touts qu’on peut étudier séparément, se heurte à de lourdes inconséquences dans le cas du Parménide. À quoi s’ajoutent les erreurs de lecture de ceux qui, à force de partir de la littérature secondaire, en oublient le texte. On fait dire au dialogue que Socrate serait un tenant de la théorie des Idées, ce qui est textuellement faux, puisque Socrate, qui n’est pas du tout un partisan de la théorie des Idées, est conduit par le forçage des Éléates, qui procèdent à une assimilation indue, à se trouver du côté de cette hypothèse, qu’il n’avait absolument pas présentée spontanément, et qui le prend même de court. En fait, les Éléates se livrent ici à une démonstration par l’absurde. Quoi qu’il en soit, le fait de faire défendre, même si c’est malgré lui, la théorie des Idées par un Socrate de vingt ans, serait d’une incroyable maladresse si la logique du dialogue n’était pas ailleurs. Et cet ailleurs est d’inscrire Socrate dans la quête éléatique de l’unité, qu’il ne conduira pas lui-même à son terme, mais dont il sera l’accoucheur puisque c’est son élève Platon qui découvrira la réponse à l’aporie. Socrate devient ainsi l’intermédiaire entre Parménide et Platon, médiateur nécessaire, dont la patiente maïeutique permettra à son disciple et successeur de mener à bien la quête ouverte dans le Parménide. En même temps la liquidation de la théorie des Idées présente un bénéfice réel, qui sera rappelé dans le Sophiste, puisque toute théorie de ce type, qui ferait des Idées un double de la pluralité infinie des réalités physiques, rendrait impossible l’unité du cosmos (ce qui est la logique profonde des objection éléatiques). En réalité, comme le montrera le Timée dans le cas de l’eidos du feu, l’eidos, type de la chose, en est la structure fondatrice inapparente, en l’occurrence une structure mathématique, le tétraèdre pour le feu.
AP : Toujours dans cette optique, vous réévaluez le rôle du Théétète qui n’est plus qu’un dialogue aporétique ; quel est le rôle que vous lui conférez au sein de la logique de découverte platonicienne ?
JJD : Le Théétète ne peut se comprendre que dans le cycle éléatique, et le simple fait, tout à fait exceptionnel, qu’il se termine par une prise de rendez-vous pour le lendemain montre bien qu’il ne doit pas être pensé seul, mais qu’il prépare autre chose. En tout cas c’est un dialogue capital. C’est un peu le testament de Socrate, qui y fait sa dernière apparition de maître du jeu, fonction qu’il transmettra à l’Éléate du Sophiste, et c’est l’occasion pour lui d’exposer sa fonction d’enseignant, en présentant la maïeutique. On n’a pas assez remarqué combien ce Socrate du Théétète était atypique. D’abord parce que Théétète est présenté comme son clone alors qu’il est, et ne sera que, mathématicien. Ensuite parce qu’il est venu justement avec Théétète et aussi avec son maître Théodore. Enfin parce qu’il fait une allusion discrète à la spirale de Théodore, qui représente les racines des entiers jusqu’à 17. Socrate apparaît donc ici quasiment comme un mathématicien. Ce Socrate mathématicien est évidemment à mettre en relation avec le rôle de professeur de mathématiques que lui donne le Ménon, mais aussi avec Les Nuées d’Aristophane, qui montrent un Socrate mathématicien, bien avant son entrée dans la vie de Platon. Recentrer Socrate sur les mathématiques, auxquelles il s’est sans doute beaucoup intéressé, permettait aussi à Platon de le remettre dans le jeu de sa propre philosophie, dont on a vu l’inspiration mathématique. Notons au passage que mon interprétation permet de faire le lien avec le glissement historique de l’école vers les mathématiques, sous la direction de Speusippe et Xénocrate.
Et le Théétète sert à déblayer le terrain avant la reconstruction qui s’opère dans le Sophiste. Il faut montrer que les explications purement physiques de la nature, sur le mode héraclitéen, l’Éphésien étant la référence la plus aboutie de l’approche des physiologues ioniens, ne mènent à rien. Le Théétète doit dire ce que la science n’est pas, pour que le Sophiste puisse dire ce qu’elle est, à savoir la dialectique, qui consiste à diviser le réel selon ses vraies articulations. Il fallait mettre au jour l’inanité des autres voies pour ouvrir celle de la philosophie véritable, qui est la dialectique.
AP : Vous proposez de ce fait une longue analyse du Sophiste au sein de laquelle ressurgit le problème de la théorie des Idées ; à son sujet, vous concluez que la réalité véritable est de l’ordre du noûs et non du logos, et qu’elle renvoie à une pensée vivante. Pourriez-vous préciser le sens de cette distinction et indiquer quel gain elle apporte à votre interprétation ?
JJD : La distinction bien connue entre noûs et dianoia, thématisée au sixième livre de la République, précède et prépare la sortie de la Caverne du livre suivant, sortie qui débouche sur la vision de la réalité véritable. Le thème de l’époptie, vision mystérique, est central chez Platon, on le retrouve, d’ailleurs, dans le Théétète, lorsque Socrate évoque l’expérience de l’ascension de l’âme. Dans cette époptie, Platon rejoint sans doute la vision parménidienne qu’évoque le prologue du poème de l’Éléate. Le plus simple serait peut-être d’imaginer que c’est une vision de connaissance totale qui est à l’origine de la conception parménidienne de l’Un, qui serait ainsi sous-tendue par une expérience singulière. Si le réel est un, seule une vision globale peut le saisir, et une telle vision ne se réalise jamais dans un état normal. Il faut un état modifié de conscience, de type très exceptionnel, pour atteindre, très brièvement, d’ailleurs, de telles visions, qui sont attestées, qu’elles soient illusoires ou non. Le noûs est cette faculté qui nous donne accès à un degré plus réel de la réalité, tandis que le logos n’est que le raisonnement, qui, lui, ne peut saisir le réel que sur un mode séquentiel, mot après mot, idée après idée, ne formulant qu’une chose à la fois, alors que le réel n’est véritablement réel que dans sa globalité. Comme on l’a dit plus haut, on peut voir un tout en tant que tout, tout à la fois, on ne peut pas dire tout à la fois. Seule une vision peut accéder à la globalité indicible du réel véritable (étant évidemment entendu qu’il ne peut s’agir que d’un accès partiel). La supériorité ontologique de la vision est incontestable, mais elle a un prix : elle perd tout dès qu’elle se dit, puisque, par nature, elle n’est pas linéaire.
AP : Un autre moment passionnant de votre ouvrage réside dans la célèbre analyse du lit de la République : vous pointez une anomalie à laquelle, là encore, tout professeur s’est heurté durant son enseignement, à savoir qu’il n’y a pas de lit à l’état naturel. Pourtant Platon dit que le premier lit est dans la nature et que Dieu l’a conçu. Avant de vous lire, j’avais toujours pensé que Platon indiquait par là que le lit n’était pas tant une chose qu’une fonction, à savoir ce sur quoi le sommeil est possible ; mais le coût d’une telle lecture était lourd, car cela supposait de banaliser la métaphysique platonicienne en la rabaissant à un quasi-nominalisme, les choses n’étant ce qu’elles sont que lorsqu’elles fonctionnent comme telles. Là-contre, vous proposez de voir dans cette illustration l’indice d’une anomalie volontaire, comme s’il y avait un art d’écrire métaphysique platonicien :
« Le caractère insensé de cette menuiserie divine, qui fait de ces trois lits une histoire à dormir debout, implique qu’elle ne peut pas être prise au pied de la lettre. Il ne saurait s’agir que d’une analogie (…). »7
De cette anomalie ou de cette histoire insensée, que faut-il alors en conclure ? Et pourquoi insistez-vous sur le fait que Platon ne parle jamais de l’essence d’un lit ?
JJD : Platon ne peut pas parler de l’essence d’un lit, du simple fait qu’il n’y a pas d’essence en grec. Le concept d’essence a été formalisé par les Médiévaux, comme le montre la forme latine du terme, essentia. Les Grecs disent à la fois la même chose et tout autre chose : ti esti, ce que c’est, ou qu’est-ce que c’est (la même forme pour l’interrogation directe et l’interrogation indirecte). Certes « ce que c’est » renvoie bien à ce que nous appelons « l’essence », mais avec une différence capitale : le terme essence substantialise son objet, tandis que le « ce que c’est » grec ne renvoie en lui-même à aucune espèce de réalité substantielle qui fonderait la chose de l’intérieur, il dit l’identité sans l’hypostasier à un niveau différent. Dans tout ce passage, Platon joue avec l’expression « ce que c’est » en articulant le raisonnement sur « ce qu’est un lit », et non en renvoyant à une essence qui ontologiserait ce qu’elle nomme, en faisant apparaître le spectre de l’Idée. En tout cas, l’Idée de lit n’est pas un lit.
AP : Faut-il alors totalement refuser le lien entre la notion d’ousia et celle d’essence ? Ousia dérivant de einai, le lien avec esse et essentia peut paraître tentant et ainsi permettre de trouver une racine grecque aux spéculations scolastiques.
JJD : Vous soulevez là une question lourde qui a suscité toute une polémique. Dans Le problème de l’être chez Aristote, P. Aubenque avait choisi de rendre ousia par essence, il a, d’ailleurs, été suivi par F. Ildefonse et J. Lallot dans leur édition bilingue des Catégories (Point Seuil, 2002). Pourtant, Aubenque était revenu sur cette traduction, pour se ranger derrière la version classique, substance. La parenté entre ousia et einai est évidente pour nous, comme elle l’était pour les Grecs, mais il faut remettre l’étymologie à sa place. Comme nous l’a appris Saussure, ce n’est pas la diachronie qui distribue le sens, mais la synchronie, parce que le langage est un système qui organise le sens des mots relativement les uns aux autres, autrement dit dans l’usage présent et non dans l’histoire de la langue. Que signifie donc ousia en grec classique ? Les biens, les avoirs ! Et on retrouve le croisement grec de l’être et de l’avoir : avoir signifie être lorsqu’il est accompagné d’un adverbe, et être désigne l’avoir dans l’expression c’est à… D’ailleurs la formule aphanès ousia (l’ousia invisible) désigne l’argent noir, celui que les financiers plaçaient à la banque sous contrat secret pour ne pas1 être mis à contribution par les finances publiques. L’ousia c’est le capital, et les Athéniens avaient aussi inventé les paradis fiscaux. Nous sommes donc aux antipodes de l’abstraction à laquelle renvoie le terme d’essence : l’ousia désigne la réalité concrète des choses, ce qu’on possède. La notion de l’essence apparaît en pointillé avec Aristote, non pas dans le terme ousia, mais dans la substantialisation du ti esti par l’article neutre : to ti esti, le ce que c’est, fragile substantialisation puisqu’elle ne repose que sur l’article, qui ne pilote pas un substantif mais une question. Fragilité qui conduira Aristote à la redoubler dans le fameux et intraduisible to ti èn einai, l’être de l’être, ce qui fait qu’un être est ce qu’il est, qui n’est toujours pas substantialisé par un substantif, et ne fait que redoubler la question sur elle-même. Abstraction sans substance. Une substantialisation conduirait à l’Idée, que rejette Aristote. Pour le traducteur, c’est évidemment insoluble : nous ne pouvons pas renoncer à la commodité de rendre ti esti par essence, tellement plus simple et plus naturel pour nous, puisque nous avons le terme, mais qui nous fait tomber dans les pièges du langage. En tout cas, chez Platon, on n’en était pas là, et le ti esti est seulement un ce que c’est.
Notons que les Stoïciens iront encore plus loin, puisque pour eux ousia désigne la matière première, tandis que l’être désigne un corps, ce qui fait basculer l’être et l’ousia dans la réalité physique. On aura, d’ailleurs, les mêmes équivoques avec hypostasis, dont la transposition par hypostase fait faux sens, ce qui est quand même un comble, comme je l’ai montré dans « Du Dieu d’Aristote à celui de Plotin », in L’archaïque, le réel et la littérature, quelques chemins en hommage à Gilbert Romeyer Dherbey8. L’hypostasis finira aussi par désigner le capital.
AP : Dans ce cas, qu’est-ce qu’un lit chez Platon ?
JJD : La remontée des trois lits me semble être un passage capital, par sa maladresse même. Les contorsions sémantiques des traducteurs, qui veulent à tout prix éliminer la notion de nature, pourtant omniprésente, parce que l’Idée ne saurait être dans la nature, sont accablantes, et malheureusement significatives des a priori qui grèvent trop souvent les traductions de Platon.
Techniquement, j’avais voulu mettre au clair ce passage parce que c’était le socle des partisans d’une théorie platonicienne des Idées, et je me suis aperçu qu’il était capital, d’une maladresse extrêmement révélatrice, et qu’il ne présentait en rien une théorie des Idées.
La notion de physis sature toute cette page, ce que les traducteurs se font un devoir d’effacer parce qu’un texte à qui on veut faire affirmer la théorie des Idées ne saurait renvoyer à la nature. Et cette ascension, puisqu’il y a ascension, même si elle mène à l’Idée qui est dans la nature, conduit à celui qui en est l’auteur, le phytourgos, mot-à-mot celui qui fait la nature, ou, plus exactement, le végétal (phyton) (à mettre évidemment en rapport avec le démiourgos Timée, Dieu comme ourgos). Certains interprètes ont un peu hâtivement pris ce travailleur du végétal pour un jardinier, se méprenant sur le sens du terme, qui, à l’époque classique, désigne le père, fondateur de l’arbre généalogique (qui, contrairement aux nôtres, pousse naturellement par la racine). Le dictionnaire de référence, le Liddell Scott, ne laisse aucun doute sur ce point : il s’agit d’un père, et non d’un jardinier. Le terme est donc un étonnant jeu de mots métaphysique : le créateur de la nature en est le père, et comme toute production est une reproduction, la création initiale est celle du père, qui se reproduit – en quoi il est père –, sans pouvoir évidemment se reproduire à l’identique puisqu’il est unique, ce qui le conduit à se reproduire sur le mode de l’iconicité, qui apparaîtra, sous-jacent, dans le Timée. En remontant de la physis au phytourgos, on découvre un Dieu père. C’est la théologie socratique, sur laquelle le Timée apportera toute la construction qui s’opère grâce à la modélisation découverte à l’occasion de la gamme.
AP : Vous venez d’évoquer « le créateur de la nature » et, dans votre ouvrage, vous évoquez très fréquemment la notion de création divine, qui semble se substituer chez vous à la doctrine des Idées ; Dieu crée à son image, mais il n’a pas d’image si bien que sa « création » est son image en tant que dérivation métaphorique de sa perfection. Plus explicitement encore, vous écrivez que « ce ne sont pas les Idées, qui intéressent Platon, mais le postulat de la création divine, qu’il essaie de rendre crédible par une projection analogique à partir de la relation du meuble avec un tableau qui le représente, argument qui s’articule sur le fait que la technè reproduit toujours quelque chose, que toute production est une reproduction. »9 Ne craignez-vous pas, en insistant autant sur ce concept si ambigu de création, de déshelléniser Platon et de le penser selon une conceptualité judéo-chrétienne, dont on pourrait dire qu’elle est étrangère aux Grecs ?
JJD : C’est une objection qui s’appuie sur la conception classique qui oppose Athènes et Jérusalem. Or ce schéma ne tient pas, comme je viens de le montrer dans mon dernier livre, L’affaire Jésus, un quiproquo ?10, qui développe un point que j’avais déjà ébauché dans mon Épictète11 et dans un article des travaux du Centre Léon Robin12.
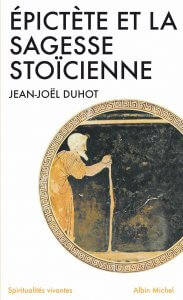
Dans un premier temps, j’avais montré comment le judaïsme hellénistique s’était imprégné de philosophie grecque, et j’ai ensuite découvert que la théologie des Pharisiens, et, par là, celle de Jésus, s’articulaient sur des concepts grecs, à commencer par le Logos divin qu’on retrouve dans le quatrième évangile, et sans oublier le Pneuma, concept stoïcien métamorphosé en Saint Esprit. Tout cela s’appuie évidemment sur une étude serrée des textes. Nous ne connaissons à peu près rien de ce qu’était le judaïsme à l’époque de Platon (c’est un trou noir de l’histoire juive), mais il est absolument certain que le catholicisme est beaucoup plus proche du Platon du Gorgias que du judaïsme du quatrième siècle. Saint Justin, philosophe et martyr du deuxième siècle, constatant une troublante correspondance entre le christianisme et le platonisme, supposait que Socrate et Platon avaient bénéficié d’une Révélation naturelle, tandis que Moïse, censé être l’auteur du Pentateuque, avait, lui, reçu la version littérale. La vérité est plus banale : le judaïsme s’était hellénisé, et le christianisme, ou plus précisément l’helléno-christianisme paulinien, s’est développé sur la base théologique du judaïsme philonien, dont toute l’armature philosophique vient de Platon et du Portique. L’acculturation hellénistique de la Palestine a duré trois siècles, et celle de la diaspora alexandrine a été complète puisqu’elle a perdu l’usage de l’araméen et qu’elle lisait la Bible dans sa version grecque. Le judaïsme était donc largement marqué par une philosophie grecque, qui a tout naturellement pris une place encore plus importante dans le christianisme. Quand Philon écrit un traité sur la Création (De opificio mundi), il démarque le Timée, ce qui signifie qu’un juif mystique et érudit, né une quinzaine d’années avant Jésus, comprenait la Genèse dans une conceptualisation platonicienne. Philon a besoin de Platon et des Stoïciens pour penser la Bible. Si les plus savants des théologiens juifs contemporains de Jésus analysaient la Création à travers le Timée, il est clair que non seulement l’opposition radicale entre hellénisme et judaïsme ne tient pas, mais surtout que l’héritage platonicien du christianisme est incontestable. Ce n’est pas mon Platon qui est juif, c’est le judaïsme hellénisé qui est platonicien.

Conclusion : questions de méthode
AP : Pour finir, deux questions de méthode m’ont hanté en lisant votre ouvrage ; vous ne citez quasiment jamais, en dépit d’une succincte bibliographie à la fin de l’ouvrage, de commentateurs. Même l’étude classique de Luc Brisson, Le même et l’autre dans la structure ontologique du Timée13 ne fait guère l’objet de discussions. Pour quelle raison avez-vous choisi de ne jamais discuter la littérature secondaire ?
JJD : J’étais formidablement bien avec Platon, et, pour le dire familièrement, je ne voulais pas être dérangé. Ce livre est la trace laissée par une longue aventure, plus de vingt ans de dialogue avec Platon. Je suis parti de la découverte dont j’ai parlé, mais j’avais déjà commencé à soupçonner des lignes de force attendant d’être dégagées. Et quand je me suis lancé dans l’exploitation de ma découverte, je ne savais pas du tout où elle allait me mener. Pendant des années je n’ai à aucun moment imaginé qu’elle me conduirait à une réinterprétation globale de l’œuvre de Platon. Je n’étais pas du tout dans la logique d’une thèse, où on part d’une idée qu’on essaye ensuite de démontrer. Je n’ai rien voulu démontrer, je me suis contenté d’explorer. J’étais, d’ailleurs, en accord avec Brisson, résolument hostile à l’école de Tübingen et à l’enseignement secret de Platon, que j’allais finir par retrouver crypté dans les dialogues. Je n’ai jamais cherché à établir quoi que ce fût, j’ai trouvé des clefs, des portes se sont présentées et je les ai ouvertes sans savoir ce qui allait apparaître derrière, et, de porte en porte, j’ai fait le tour du platonisme. Paradoxalement, je me suis retrouvé avec une interprétation globale qui s’est imposée au fil des textes et des années, sans avoir été attendue. Et surtout je me suis aperçu que, sans avoir besoin d’aucune hypothèse ad hoc, j’intégrais tous les paramètres qui jusque là étaient restés erratiques et inexpliqués, relevant simplement de la fantaisie de Platon ou de l’habillage littéraire de l’œuvre. Tout entrait en correspondance, et je découvrais une dimension insoupçonnée du génie de Platon, l’adéquation parfaite de la scénarisation des dialogues, du choix des personnages, du style, et d’une pensée qui allait être le vecteur de notre civilisation.
Je peux certes avoir l’air de faire preuve d’une prétention insupportable en bouleversant ce qu’on croyait savoir de Platon, mais comment le décryptage d’une énigme codée au cœur du platonisme, dans la structure de l’Âme du monde, n’aurait-il pas d’incidence sur toute notre compréhension de la pensée de Platon ?
C’est une aventure que j’ai menée, durant des années, avec mes étudiants, affinant mes recherches dans mes cours et dialoguant avec eux. Je n’ai jamais séparé la recherche de l’enseignement, et je crois que si je n’avais pas enseigné, je ne serais pas allé aussi loin avec Platon ; mais je n’ai pas dialogué avec les exégètes. J’étais sur un paradigme totalement nouveau qui me donnait l’impression d’aborder un texte vierge, qui appelait une toute nouvelle lecture. Méthodologiquement, j’ai travaillé dans une logique de modélisation, et toute modélisation est forcément globale, elle doit se suffire à elle-même. Une explication globale n’est ni un bricolage ni une accumulation de références. C’est d’elle-même que doivent venir les réponses.
Concrètement, le livre fait presque 400 pages, si j’avais dû discuter tout ce qui a été écrit, il aurait été beaucoup trop long, et parfaitement illisible. Ma démarche était totalement singulière, puisque je partais d’un cryptage que personne n’avait deviné. J’avais mis au jour un système de lecture grâce auquel je pouvais comprendre véritablement ce qui avait échappé à deux millénaires de commentaires érudits, deviner le sens profond de ces textes, qui, d’un seul coup, prenaient vie. C’était une sensation extraordinaire, qui a culminé avec ma lecture du Théétète : la maïeutique ne pouvait prendre sens que s’il y avait une vérité issue de l’enseignement socratique. Or pour l’ensemble des spécialistes il n’y en avait pas, ce qui reléguait la maïeutique au rang de fantaisie socratico-platonicienne. Comment Platon pouvait-il avoir commis une telle bévue ? Pourquoi parler de la maïeutique si elle n’avait rien donné ? Le dialogue se retournait contre lui-même. Il devait bien y avoir une vérité quelque part si on prenait le Théétète au sérieux, sinon ce n’était qu’un texte, paradoxal, mais au fond sans importance.
En découvrant la vérité platonicienne, je sauvais le Théétète, comme s’il m’avait attendu pour être validé. C’était une émotion énorme, je donnais à l’œuvre de Platon tout son sens caché jusqu’ici. J’ai terminé ce livre avec un bonheur plus grand encore que celui que m’avait donné sa découverte initiale, avec entre les deux les inévitables passages de doute, les moments où on se dit que c’est trop beau, que les choses s’arrangent trop bien, que ça ne peut pas être aussi compact et lumineux, mais quand j’ai confronté ma lecture avec celle d’Aristote, qui est à la base de l’interprétation de Tübingen, j’ai constaté qu’elle collait parfaitement avec ce que j’avais dégagé, ce qui me permettait de résoudre le problème lancinant de l’enseignement secret de Platon. Là, les concordances étaient trop fortes, ce ne pouvait plus être le hasard, la validation aristotélicienne cautionnait objectivement mon travail.
Évidemment il y a un prix à payer. Je contrevenais à tous les usages, mes chers collègues n’allaient pas me rater. Depuis Aristote, la règle est de ne présenter son point de vue qu’après avoir exposé ceux des autres, c’est la politesse académique de base, ce qui rendait ma transgression insupportable. Il n’y a rien de plus conformiste que le conformisme académique, mais je comprends aussi qu’il ne soit pas très agréable de voir quelqu’un d’autre trouver quelque chose de nouveau dans des textes qu’on avait lus, labourés, commentés, sans rien soupçonner. Oser présenter une interprétation toute nouvelle de textes lus et relus depuis plus de deux millénaires, est évidemment une transgression majeure, surtout quand on résout les problèmes classiques d’interprétation. Les chercheurs n’aiment pas ceux qui trouvent.
AP : Oui, il est fort possible que le monde académique cherche moins à trouver qu’à poser des codes de reconnaissance mutuelle. Cela étant dit, la reconstruction de l’ordre logique des dialogues que vous proposez est passionnante, mais, loin de s’appuyer sur une étude philologique, elle repose tout entière sur la présupposition d’une parfaite cohérence du platonisme au cours du temps ; postuler cette cohérence ne risque-t-il pas d’évacuer les aléas et les imperfections de toute doctrine philosophique ?
JJD : Comme je le disais plus haut, je n’ai jamais été guidé par la moindre présupposition dans toute cette recherche, et j’ai trouvé des choses que non seulement je ne cherchais pas, mais surtout qui étaient contraires à ce que je présupposais. C’est seulement très tard dans mon travail que j’ai compris que j’avais tout simplement redécouvert l’enseignement secret auquel je ne croyais pas. Je pense même que si, au départ, j’avais imaginé que j’étais sur le point de réinterpréter tout Platon, je n’aurais pas eu le courage de l’entreprendre. J’ai été embarqué dans une affaire qui me dépassait.
Il ne me semble pas qu’on puisse me reprocher de ne pas m’appuyer sur une étude philologique. D’abord parce que, globalement, je suis d’accord avec l’ensemble des platonisants sur l’ordre d’écriture des dialogues. Il peut y avoir débat sur la place du Timée, que certains jugent plus tardif que moi, mais cela ne change pas grand-chose. Globalement, j’ai suivi le texte, souvent ligne à ligne, proposant même quelques conjectures qui me paraissent un peu l’améliorer, et donc plus près que beaucoup d’autres platonisants. Ma lecture de ce que j’ai appelé le cycle éléatique a le mérite de donner une cohérence parfaite à toutes les anomalies relevées par les spécialistes mais restées sans explication, comme le choix des personnages, les dates des dialogues et leur tuilage par le lien de personnages muets, qui, sinon, font une figuration absurde. J’ai été le premier étonné de constater la cohérence et la puissance de ma grille de lecture.
J’ai toujours considéré que l’historien de la philosophie devait chercher la logique profonde du philosophe qu’il étudie, même si elle va au-delà de ce dont il pouvait être conscient. La cohérence du modèle platonicien qui s’est découvert à moi m’a convaincu parce qu’elle expliquait tout et effaçait toutes les difficultés. Je comprends qu’on puisse quand même se poser la question de savoir quelle conscience en avait Platon. Il est possible que certains points soient restés plus ou moins implicites pour lui, mais j’en doute. La maîtrise de la pensée et du style est totale chez Platon, et il est extrêmement dommage qu’aucune traduction n’en donne une idée juste.
Quant aux aléas et aux imperfections, ils ne sont pas du tout absents de l’œuvre de Platon. Le premier Platon, auteur des dialogues socratiques, n’est visiblement pas encore maître de sa pensée ; l’auteur de la République ne dispose pas encore du formidable outil qu’il va mettre en œuvre dans le Timée, et le dernier Platon doit revenir sur le dualisme du Phédon, et réhabiliter le corps, dans le Philèbe. Le jeune auteur du Phédon et des petits dialogues socratiques du début est bien loin du dernier Platon, mais celui-ci, une fois maître de sa pensée, la déroule d’une manière formidablement organisée, et découvre quel en est le pouvoir. Pour le dire plus simplement, je suis parti du principe que Platon devait être cohérent, et j’ai constaté qu’il l’était, en voyant que cette lecture expliquait ce qui n’avait pas été expliqué jusque là, mais cette cohérence n’est que celle du dernier Platon, qui s’est longtemps cherché.
Cela dit, je suis heureux que vous parliez de cohérence, ce qui montre que vous m’avez lu et compris. Cette cohérence, qui s’est imposée à moi à mesure que j’appliquais ma grille de lecture, est là, incontestable, et elle seule, jusqu’à présent, peut faire disparaître les apparentes maladresses des dialogues et de la pensée qu’on croit y trouver. Il faut aussi savoir aborder une œuvre pour elle-même, sans se poser la question des intentions de l’auteur, comme font les littéraires. Il m’est souvent arrivé d’imaginer Platon venant me taper sur l’épaule pour me dire : « Enfin quelqu’un qui m’a compris ! », à moins que ce ne soit : « Merci, j’ai enfin compris ! », mais j’ai trop habité ces dialogues pour douter un instant du génie de l’auteur. Ce génie se déploie dans une parfaite correspondance entre l’écriture, l’art du dialogue, la mise en scène et la pensée : ce n’est pas seulement un génie philosophique, c’est un génie total, et Platon lui-même a pu ne pas avoir toujours une pleine conscience des processus de son génie.
Il y avait une clef cachée dans le texte de Platon, elle ouvrait toutes les portes. Ma position doit forcément déranger : comment prétendre avoir compris Platon mieux que tout le monde ? D’autant plus que je ne suis pas le meilleur : bien d’autres, à commencer par Brisson, ont une érudition platonicienne que je suis loin d’avoir, mais le détail décisif était hors de leur champ de vision. Il ne suffit pas de chercher, il faut porter son regard au bon endroit, et ce sont les hasards de ma vie, la rencontre de mes deux existences professionnelles, qui m’ont fait percevoir ce qui ne pouvait qu’échapper à un simple érudit platonisant, si omniscient fût-il. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui voient le détail décisif, mais ceux qui se sont trouvés dans le bon angle de vision, parfois tout simplement parce qu’ils venaient d’ailleurs et qu’ils pouvaient transposer d’autres expériences.
Platon accorde un statut éminemment privilégié à la gamme pythagoricienne, puisqu’il en fait la structure de l’Âme du monde. Je n’ai eu qu’à analyser le fonctionnement de cette échelle sonore, avec un minimum d’acoustique et de mathématiques, et à constater qu’elle correspondait parfaitement à toute la construction de la métaphysique platonicienne et qu’elle faisait apparaître la logique profonde des dialogues. Une telle cohérence ne pouvait être aléatoire. L’analyse mathématique de la gamme a sans doute été un moment crucial de l’expérience intellectuelle de Platon : c’était le modèle qui permettait de résoudre les problèmes de l’un et du multiple, de dépasser Parménide sans l’abolir. L’homologie structurelle était très féconde. Et il est finalement assez logique que ce soit un musicien qui l’ait mise au jour.
- L’énigme platonicienne, op. cit., p. 15
- Ibid., p. 28
- Ibid., p. 33
- Ibid., p. 47
- Ibid., p. 241
- Ibid., p. 239
- Ibid., p. 341
- L’archaïque, le réel et la littérature, quelques chemins en hommage à Gilbert Romeyer Dherbey, Jacques André éditeur, Lyon, 2013
- Ibid., p. 348
- Jean-Joël Duhot, L’affaire Jésus, un quiproquo ?, Paris, Kimé, 2018
- Jean-Joël Duhot, Epictète, Paris, Bayard, Paris, 1996 ; rééd. Albin Michel, coll. Spiritualités Vivantes, Paris, 2003
- cf. Jean-Joël Duhot, « Métamorphoses du Logos, du stoïcisme au Nouveau Testament », in Les Stoïciens, Paris, Vrin, 2005
- cf. Luc Brisson, Le même et l’autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, Paris, Vrin, 2016