La première partie de l’entretien se trouve à cette adresse.
C : Arendt et Heidegger
Actu-Philosophia : Votre livre est extrêmement instructif, et même si l’on ne partage pas toutes ses thèses, on ne peut qu’apprécier la rigueur de ses remarques et la volonté de citer un maximum de sources. Quatre points me semblent absolument convaincants dans votre ouvrage. D’abord l’aspect incontournable de l’adhésion convaincue et non seulement « opportuniste » de Heidegger au nazisme, et, plus fondamentalement son antisémitisme profond. A la rigueur, la citation d’une lettre de Heidegger de 1916 suffirait à convaincre de l’antisémitisme profond de Heidegger, lettre citée p. 184 :
« L’enjuivement (Verjudung) de notre culture et de nos universités est en effet effrayant et je pense que la race allemande devrait trouver suffisamment de force intérieure pour parvenir au sommet. »
Sa réduction des chambres à gaz et des camps à de simples dispositifs techniques, la diffusion dans ses cours d’une conception des Juifs « sans monde » et « sans mort », donc inhumains, ainsi que son utilisation à deux reprises du terme spécifiquement nazi de « déracification » ne peuvent que forcer le lecteur à admettre l’importance et la profondeur de la compromission de Heidegger avec le nazisme. On ne voit pas quels motifs pourraient être invoqués pour disculper Heidegger de telles pièces à conviction.
Emmanuel Faye : Merci de votre approbation de ces quatre points. J’apprécie particulièrement que vous sembliez lire les Cahiers noirs, dans lesquels effectivement Heidegger déplore la « déracification » (Entrassung) de la germanité et de la russité – un terme clé de la doctrine raciale nazie –, non comme une réfutation mais comme la confirmation de la thèse d’une introduction heideggérienne du national-socialisme dans le champ philosophique. Pour qui a lu attentivement les volumes parus des Cahiers noirs ainsi que les chapitres 6 et 7 d’Arendt et Heidegger qui leur sont consacrés, cela devrait aller de soi1.
Cependant, vous ne mentionnez pas le thème central du livre en ce qui concerne Heidegger, à savoir, depuis le cours non traduit du semestre d’hiver 1933-1934 sur L’essence de la vérité, jusqu’aux Cahiers noirs des années 1941-1942, en passant par le cours de mai-juin 1940 sur Nietzsche, le nihilisme européen, on observe la présence récurrente des thèmes positivement assumés de la Vernichtung : anéantissement ou extermination et de la Selbstvernichtung : auto-anéantissement ou auto-extermination. Heidegger appelle en 1934 ses étudiants à préparer sur le long terme l’attaque en vue de l’« anéantissement total » de l’ennemi et il prononce en 1941 l’éloge de la politique qui entend contraindre l’adversaire à procéder à son propre auto-anéantissement. C’est cette métapolitique de l’extermination, ainsi légitimée par Heidegger dans son Œuvre intégrale, qui demande aujourd’hui à être prise en compte dans l’appréciation que nous pouvons porter sur la signification et les effets de sa pensée, à court et à plus long terme.
AP : Remarquable aussi est la restitution de la tentative, consciente ou non, d’Arendt pour disculper Heidegger de son engagement nazi. Vous montrez en particulier sa tentative de repenser l’origine de l’antisémitisme nazi dans les origines du totalitarisme, en insistant sur l’Affaire Dreyfus et en disculpant le romantisme politique qu’elle avait étudié et discerné comme origine de cet antisémitisme dans un texte antérieur, mal connu et intitulé « Antisemitismus ». Pourriez-vous indiquer l’enjeu de ce texte séminal ?
EF : Effectivement, la période de la fin des années 1930 m’apparaît comme la plus intéressante et la plus clairvoyante dans la trajectoire d’Arendt. C’est celle où elle rédige les deux derniers chapitres de Rahel Varnhagen et entreprend la rédaction en allemand de son essai inachevé, Antisemitismus. Arendt y analyse la responsabilité d’une partie de la culture allemande dans la montée en puissance de l’antisémitisme contemporain. Elle décrit l’Allemagne comme « le pays classique de l’antisémitisme » et affirme qu’« aucun pays au monde n’a infligé autant de malheurs aux Juifs que l’Allemagne. Ni les pogroms d’Ukraine ni ceux de Pologne ne nous ont autant dévastés que la fondation théorique d’une vision du monde antisémite (einer antisemitischen Weltanschauung) et la victoire du national-socialisme » 2. Arendt rappelle notamment le rôle déterminant du libelle antisémite publié par Wilhelm Marr en 1879 et du mot de Heinrich Gotthardt von Treitschke, « Les Juifs sont notre malheur », qui sera repris par Julius Streicher comme mot d’ordre du journal nazi antisémite Der Stürmer. Elle soutient que « la guerre moderne visant à détruire les Juifs s’annonçait […] sous l’égide spirituelle de l’Allemagne » 3. Or, plus rien de ces analyses et de cette thèse n’apparaît dans le premier volume, sur L’Antisémitisme, des Origines du totalitarisme. Les noms de Marr et de Treischke ne sont même plus cités. Dans l’ouvrage de 1951, la « vision du monde antisémite », telle qu’elle s’est cristallisée en Allemagne de Marr à Rosenberg, est ainsi à peu près entièrement passée sous silence. Entretemps, Arendt s’est rapprochée de la thèse historiquement démentie de Hermann Rauschning, lequel propose, dans La Révolution du nihilisme, une vision purement instrumentale de l’antisémitisme nazi, réduit à n’être qu’un moyen politique de capter et d’aiguiser au profit du pouvoir en place le mécontentement des masses. C’est ainsi qu’Arendt a finalement barré pour longtemps la voie d’une étude des fondements théoriques de la vision du monde antisémite qui s’est constituée pour une grande part en Allemagne, de la seconde moitié du XIXe siècle aux premières décennies du XXe, une voie qu’elle avait pourtant contribué à frayer dans son essai inédit de 1949. Bien entendu, les antisémites français et autres ont également joué leur rôle, et il y a certes eu des allers et retours entre l’Allemagne et la France, mais l’on ne saurait tout expliquer par l’Affaire Dreyfus et la pensée raciale de Disraeli, comme Arendt s’évertue à le faire dans Les Origines du totalitarisme.
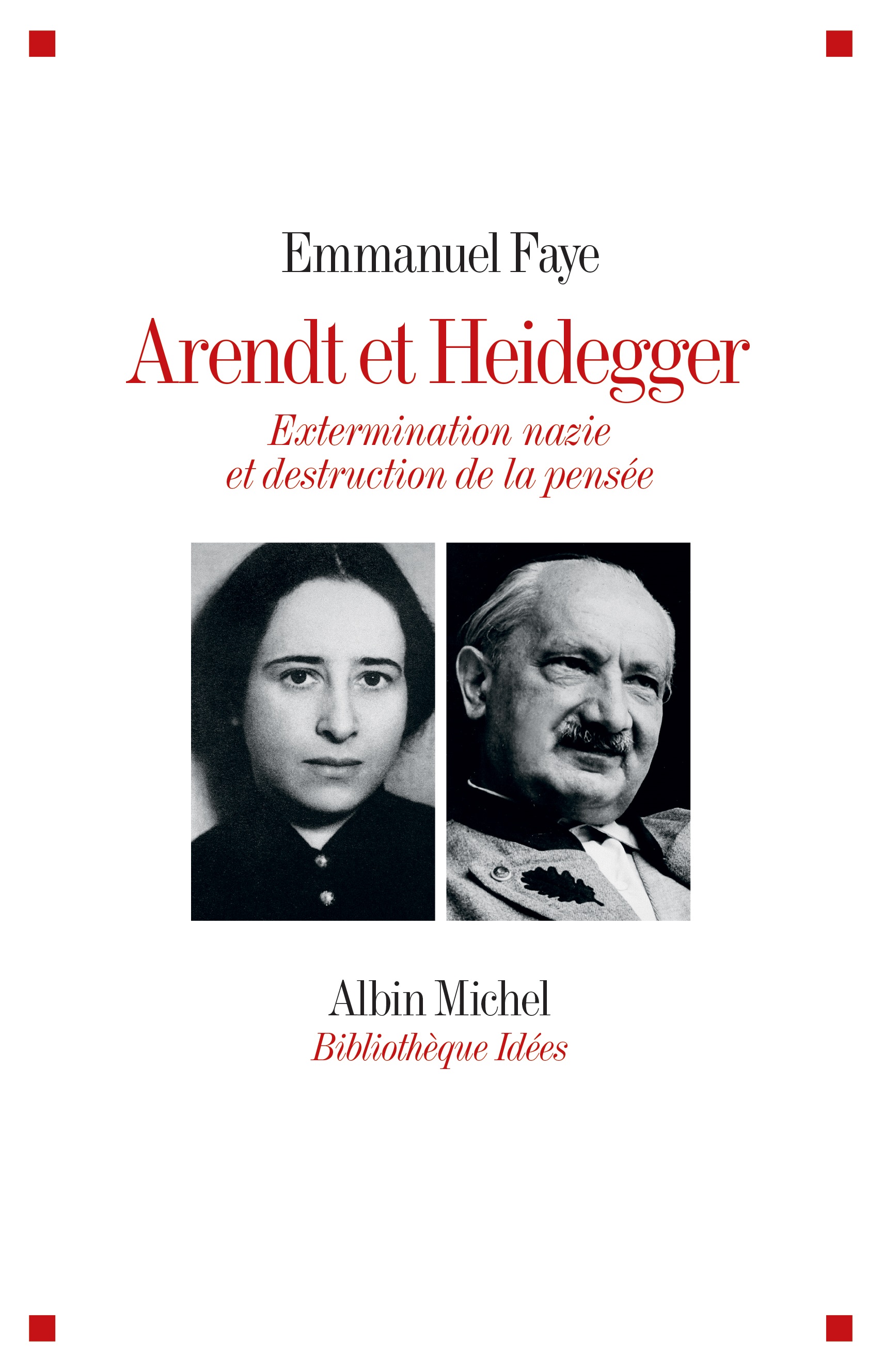
AP : Vous examinez également comment la conception du nazisme d’Arendt, perçu comme lié à la masse et non aux intellectuels, dédouane les intellectuels qui s’y sont engagés de toute responsabilité active dans ce que fit advenir le régime hitlérien. Vous remarquez également que ne pas attribuer à Hitler de conception de la nation, puisqu’il ne se serait intéressé qu’à la race, exempterait Heidegger d’une profonde convergence intellectuelle, puisque ce dernier se serait intéressé à la nation. C’est ainsi tout le discours de disculpation de la compromission heideggérienne qui se trouve déconstruit de manière convaincante tout au long de l’ouvrage.
Mais surtout, vous analysez l’influence absolument déterminante d’Heidegger – en particulier de certains textes d’après-guerre – sur la pensée d’Arendt. De la lettre dans laquelle Arendt écrit à Heidegger à propos de la condition de l’homme moderne : « il te doit tout à tous égards » (p. 361), au fait que de nombreux termes de ce livre qu’on n’attribue pas traditionnellement à un héritage heideggérien se disent, en version allemande, dans la langue de Heidegger (« Mitwelt » pour ce qu’on traduit en français par « monde commun », « Dasein » pour « condition humaine », etc. ) et à une parenté de pensée sur la logique totalitarisante, l’« aliénation moderne au monde » et l’absence de pensée de la science. L’influence semble donc agir tant sur le fond que sur la forme.
EF : En effet ! Il est en outre possible de montrer que les notions arendtiennes de natalité et de pluralité ne sont nullement opposées à Heidegger.
AP : Vous proposez enfin la nécessité d’un regard plus critique sur la méthode et les sources arendtiennes. Si l’on peut constater que ce qu’elle écrivit fut critiqué par certains, il établit qu’on peut ne pas être d’accord avec elle, à l’instar de Raymond Aron sur sa conception de la « masse », de R. Hilberg trouvant son livre sur les origines du totalitarisme idéologiquement surdéterminé, de I. Kershaw pensant son explication du nazisme comme transformation d’une société de classe en société de masse erronée, etc.
Mais vous sondez la probité même du texte arendtien et changez si l’on peut dire de registre. D’une part, il arrive à Arendt de tronquer des citations. Par exemple, elle fait dire à Marlow dans Au cœur des ténèbres de Conrad l’inverse de ce qu’il dit en ne notant dans les Origines du totalitarisme, que l’horreur du personnage de Conrad à l’égard des populations africaines et donc leur apparence quasi inhumaine, et en taisant la suite de sa réaction qui le conduit à ré-humaniser ceux qu’il avait d’abord perçus comme inhumains. D’autre part, les sources qu’elle utilise sont parfois sujettes à caution, et à ce titre se révèlent marquées d’une idéologie dont il conviendrait de se méfier davantage : elle utilise ainsi Walter Frank et d’autres historiens nazis pour ses travaux, A. Gehlen en anthropologie, F. Schachermeyr pour sa conception de la polis antique. Diriez-vous que les ambiguïtés idéologiques ont ainsi pu rejaillir sur la probité des références et des emprunts ?
EF : Contrairement à ce qu’ont longtemps cru nombre d’interprètes, la pensée d’Arendt ne vient pas de la gauche et du marxisme. On ne peut pas comprendre sa vision intellectuelle et politique si l’on ne prend pas en compte les cours dispensés par Heidegger qu’elle a suivis, à commencer par celui de l’hiver 1924-1925 sur Le Sophiste, puis la formation à Heidelberg sous Jaspers et Gundolf et le long compagnonnage avec Benno von Wiese und Kaiserwaldau. Ainsi s’expliquent son choix de travailler sur le romantisme politique allemand – Adam Müller et Friedrich von Gentz –, et sa lecture attentive des principaux auteurs de la révolution conservatrice comme Oswald Spengler et Arthur Moeller van den Bruck. La part considérable qu’elle accorde sans guère de distance, dans l’établissement de ses sources, à des auteurs nationaux-socialistes comme Carl Schmitt, Walter Franck, Friedrich Schachermeyer, Richard Harder, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky et d’autres encore, n’est pas l’aspect le moins troublant de cette pensée. À part le rapport à Heidegger que j’ai voulu étudier de façon approfondie, je n’ai fait qu’effleurer dans mon livre cette dernière question, déjà soulevée pour les sources historiques par Bernard Wasserstein. Je ne voudrais donc pas formuler des conclusions prématurées à ce propos. D’autres études critiques restent à réaliser sur les sources d’Arendt et les thèses qu’elle tire de ses lectures.
D : Discussion critique
AP : Cet ouvrage, en plus d’éclairer le travail d’Arendt à la lumière de travaux récents portant sur des points particuliers de son analyse, des périodes ou des personnes sur lesquelles elle a travaillé, questionne notre rapport au statut d’icône que semble recevoir assez unanimement son œuvre. Mais d’autres points me semblent en revanche devoir être discutés. A propos d’Heidegger, d’abord, la démonstration étant faite de son adhésion non seulement en surface, mais également en profondeur au parti nazi, qu’en tirer pour l’examen du statut et de la valeur de sa pensée ? Quelque chose peut surprendre : il semble que Heidegger n’ose pas dire publiquement son antisémitisme (manifesté en privé dès 1916), en le camouflant derrière un langage et des concepts apparemment philosophiques. Mais dans les années 1930, dès que l’occasion se présente, il explicite sa pensée profondément nazie. Soit, mais cela veut-il dire que tous les concepts heideggériens de toutes les époques sont nazis ? Et que les réutiliser en se les réappropriant serait non pas philosopher en nazi, puisque nazisme et philosophie sont, nous sommes d’accord avec l’auteur, exclusifs l’un de l’autre, mais transmettre ou accepter quelque chose du nazisme ? Et si oui, la parenté textuelle vaut-elle argument ?
EF : Il faut en effet s’entendre sur ce que signifie le national-socialisme de Martin Heidegger. Vous admettez son adhésion en profondeur au parti nazi, mais la question va bien au-delà. Dès 1929 à Davos, Heidegger oppose à Cassirer le fait qu’une vision du monde (Weltanschauung) se trouve au fondement de toute philosophie. Dans un cours de 1933, il prononce l’éloge de la façon dont Hitler éduque le peuple allemand à la « vision du monde nationale-socialiste ». Plus tard, il s’agacera des lieux communs du discours idéologique du nazisme, notamment chez un auteur avec lequel il est en conflit comme Ernst Krieck, et il ne retiendra plus guère le terme de vision du monde. Il y a d’autre part chez lui, à partir du début des années 1930, une volonté récurrente de récuser la philosophie et la métaphysique pour leur opposer un autre terme : ce sera, dans les premiers Cahiers noirs, le terme clef de « métapolitique » ; et après 1945, dans La lettre sur l’humanisme, la « pensée » qu’il opposera définitivement à la philosophie.
En ce qui concerne le statut des « concepts heideggériens », je reconnais bien entendu que la vision heideggérienne s’inscrit, pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu, dans le « champ philosophique » 4. Heidegger est un universitaire, professeur de philosophie, qui dispense des cours et séminaires sur Aristote, Leibniz, Hegel, etc. La distinction entre catégories et existentiaux est reprise par exemple à Leibniz et j’ai montré dans une étude récente comment, loin de tirer de l’oubli la différence de l’être et de l’étant, Heidegger avait fait sienne au début d’Être et temps, comme je l’ai mentionné dans le premier moment de l’entretien, une différence en réalité thématisée par Ernst Cassirer quatre ans plus tôt, dans les premières phrases de La philosophie des formes symboliques. Il faut donc être précis dans ce que l’on entend par « se réapproprier les concepts de Heidegger ». Si on le fait à partir du même fond de pensée que lui et dans une intention similaire, comme par exemple Alexander Douguine, lorsqu’il fait sienne la proposition résumant selon lui toute la « philosophie » de Heidegger : das Dasein existiert völkisch, alors, certes, on participe à la diffusion d’un fond de pensée national-socialiste5. Mais si on repense, dans un tout autre esprit, des concepts et des distinctions philosophiques, y compris la différence de l’être et de l’étant ou la distinction des catégories et des existentiaux que celui-ci s’approprie pour légitimer un fond de pensée identitaire et völkisch, on ne s’expose pas forcément, bien évidemment, à pareil reproche.
AP : A propos d’Arendt, lire sa biographie par Rahel Varnhagen comme un autoportrait (« largement autobiographique », lit-on p. 65) dans lequel on retrouve une forme de haine de soi et du juif que l’on est parce que ce dernier serait irrémédiablement étranger à l’Allemagne, n’est-ce pas méthodologiquement un peu trop affirmatif ? Qu’on propose une telle hypothèse, pourquoi pas, mais de là à insinuer que, puisqu’Arendt peint Rahel comme ne s’aimant pas parce que juive, donc ontologiquement étrangère au peuple allemand, admirative de Goethe le vieux penseur, il faut considérer qu’Arendt ne s’aime pas, se sent irrémédiablement étrangère à l’Allemagne et admire Heidegger, n’est-ce pas construire un argument sur une série de glissements ? N’est-ce pas fonder un raisonnement hasardeux sur une hypothèse heuristiquement intéressante mais dont rien ne garantit la véracité ?
EF : Je laisse les insinuations que vous évoquez et qui n’ont pas de place dans mon livre. Le fait de considérer la biographie de Rahel Varnhagen comme ayant une dimension autobiographique n’est pas une hypothèse que j’aurais inventée, mais, comme je l’indique, l’interprétation que Benno von Wiese, qui a connu intimement Hannah Arendt, et d’autres auteurs encore, donnent de l’ouvrage. Benno von Wiese apparaît comme un personnage clé pour comprendre Arendt. Il fut à Heidelberg, durant près de deux années, l’ami de cœur et le condisciple intellectuel d’Arendt. Les deux étudiants furent proches au point d’envisager de se marier. Von Wiese versera par la suite dans un national-socialisme radical qu’il parviendra à faire oublier après la guerre. Avec les conseils et l’appui d’Arendt, bien documentés par toute une correspondance encore inédite, il sera bien reçu dans les universités américaines et deviendra le mentor de la germanistique de l’après-guerre.
L’hypothèse que je formule pour ma part, c’est que l’étude publiée par Arendt sur l’ami le plus proche de Rahel, Friedrich von Gentz, personnage central du romantisme politique et introducteur de Burke en Allemagne, contient, elle aussi une dimension autobiographique. La dualité de Gentz sur laquelle Arendt met l’accent, libéral dans son existence personnelle et conservateur dans sa pensée, au sens fort que ce mot prend dans le contexte allemand de l’époque, ainsi que sa tournure d’esprit caustique et railleuse, nous éclairent à mon sens sur la psychologie complexe d’Arendt.
AP : Vous dites qu’Arendt défend l’aristocratie, ou prône une nouvelle aristocratie. Mais que faut-il entendre par aristocratie ? Est-ce une aristocratie grecque, nietzschéenne, renaissante ? Quel rapport y a-t-il entre cette aristocratie qu’elle espérerait et le nazisme de Heidegger ? Le nazisme vous apparaît-il comme un aristocratisme en un sens comparable à celui que défend Arendt ?
EF : Hannah Arendt n’a cessé de s’en prendre dans son œuvre à nos modernes démocraties égalitaires et, dans son prologue à Condition de l’homme moderne, elle exprime sa nostalgie à l’égard du fait que les conditions de la formation d’une nouvelle « aristocratie politique et spirituelle » ne soient plus réunies. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dimension explicitement aristocratique de la pensée politique d’Arendt est trop rarement prise en compte. L’image qui est véhiculée ordinairement, c’est celle, tout à fait inexacte, d’une penseuse soucieuse de refonder le « vivre ensemble » démocratique.
L’aristocratisme arendtien procède de la distinction venue de Heidegger, sans fondement philologique dans la langue grecque, entre la vie purement biologique et animale, qu’elle rapporte au terme grec zôê et qui caractérise l’animal laborans, et l’existence authentiquement humaine, réservée au petit nombre de ceux qui sont parvenus à accéder, en vertu d’une « seconde naissance », au bios politikos. Il ne s’agit pas seulement d’une hiérarchisation mais d’une véritable ligne de fracture qui détruit l’unité du genos humain.
Par ailleurs, contrairement à ce que des esprits polémiques ont prétendu, je ne cherche nullement à faire de Hannah Arendt une nazie. Si j’ai rappelé l’interrogation du Nouvel Observateur en 1965 : « Hannah Arendt est-elle nazie ? », je ne l’ai pas reprise à mon compte. Ce qui sépare radicalement Arendt de Heidegger à cet égard, c’est que, contrairement à lui, jamais elle n’a appelé à l’anéantissement total d’un ennemi intérieur qui désignait avant tout, dans l’esprit de ce dernier, les Juifs assimilés dans le peuple allemand. Il n’y a évidemment pas d’antisémitisme exterminateur chez Arendt comme il en existe un chez Heidegger.
Votre question me permet donc de clarifier une fois pour toutes, du moins je l’espère, la thèse critique qui procède des analyses de mon livre. L’aristocratisme d’Arendt la conduit plus d’une fois dans les parages d’une hiérarchisation des appartenances ethniques. C’est le cas de ses prises de position sur les droits civiques des afro-américains, sur ce qu’elle nomme the Negro question, ou de sa différenciation ethnique des appartenances juives, au sommet de laquelle elle place les Juifs allemands et au plus bas la « populace orientale ». Pour autant, je n’ai jamais entrepris de montrer qu’Arendt partagerait intégralement le nazisme heideggérien, ce qui constituerait à l’évidence une exagération. Ma thèse, c’est que l’on ne peut pas se laisser fasciner et imprégner en profondeur par une vision aussi foncièrement destructrice et génocidaire que celle de Heidegger sans propager quelque chose de cette destruction dans la pensée même.
Arendt, quant à elle, a fait sienne l’opposition heideggérienne entre « pensée » et philosophie, sans discerner à quel point cette opposition est destructrice pour la pensée humaine elle-même. La « pensée » qu’elle promeut à la suite de Heidegger, pensée sans catégories, explicitement opposée à la logique et au principe de contradiction d’un côté, au libre-arbitre et à la liberté de pensée de l’autre, détruit la capacité de résistance critique de l’esprit humain. On se retrouve ainsi face à des heideggériens qui ont fait de leur maître une idole et à des arendtiens qui considèrent celle-ci comme une intouchable icône, au point que toute analyse critique de leurs écrits est reçue comme un sacrilège. Je me suis en 2005 opposé frontalement aux heideggériens les plus fanatiques et les plus manifestement de mauvaise foi, car il fallait bien que quelqu’un marque un point d’arrêt. La question du corpus arendtien est plus mouvante et plus complexe et je trouverais stérile d’entreprendre une nouvelle guerre de tranchées. Je laisse donc parler celles et ceux qui m’attaquent le plus violemment à ce propos sans me convier à débattre6 et tente de dialoguer avec celles et ceux qui n’ont pas perdu tout sens critique et cherchent sincèrement à démêler les problèmes que posent les écrits d’Arendt.
AP : Un des points forts de l’ouvrage consiste à reprocher à Arendt de ne pas apercevoir de différence entre les victimes et les bourreaux dans les camps, et d’accuser les juifs d’être responsables de la Shoah. Mais peut-être peut-on au moins admettre la déshumanisation à titre d’objet de questionnement. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés, suite à l’expérience concentrationnaire et exterminatrice des nazis, sur le statut d’humain des victimes et des bourreaux, se demandant quelles étaient les limites de l’humanité, sans partager le point de vue des nationaux-socialistes. Les titres mêmes de Si c’est un homme de Primo Levi, ou l’Espèce humaine d’Antelme questionnent les limites de l’humanité sans reprendre l’idéologie nazie.
EF : L’humanité est fragile et il est plus facile de la détruire que de la défendre. Ceux comme Primo Levi qui s’interrogent sur les limites de notre humanité pour mieux la défendre ne doivent pas être confondus avec ceux comme Heidegger qui ont testé ces limites pour mieux la détruire. Or, les écrits d’Arendt brouillent ces distinctions nécessaires. On la voit d’un côté affirmer dans Les origines du totalitarisme que les « intellectuels » du national-socialisme comme Carl Schmitt ou Walter Frank ne portent aucune responsabilité et de l’autre, notamment dans son Eichmann à Jérusalem, accabler les victimes juives comme si elles étaient plus responsables de leur extermination que leurs bourreaux.
AP : Il en va de même pour la question du « monstrueux ». Qualifier de « monstrueux » le comportement des bourreaux comme des victimes peut signifier, plutôt que l’indiscernabilité des comportements que vous attribuez à Arendt, leur commune démesure. C’est un des sens de monstrueux que donne le Larousse : « qui est d’une intensité extraordinaire ; excessif, gigantesque ». Arendt, plutôt que d’accepter l’équivalence des culpabilités entre bourreaux et victimes indique l’équivalence de l’horreur, mais en étant consciente que celle-ci est subie par les victimes et commises par les bourreaux.
De même, il me semble que dire que le propos d’Arendt, dans « The Image of Hell » « tend à l’indistinction complète entre tortionnaires et victimes, et même à leur interchangeabilité » (p. 31) est aussi manifestement excessif, ne serait-ce que parce qu’elle écrit ceci :
« Et il y eut bien des cas où ceux qui infligeaient les souffrances un jour, devenaient le lendemain à leur tour des victimes »
Je souligne et je souhaiterais attirer l’attention sur la non universalité de ce que dit Arendt, capable de discerner des cas, ce qui devrait conduire à analyser sa pensée en faisant plus grand cas des distinctions ou à ne pas la réduire à des affirmations aussi tranchées que celles que l’on trouve parfois dans l’ouvrage étudié. Aussi me semble-t-il que ce texte suggère une allusion au rôle des kapos, des détenus devenus chefs, « privilégiés » diraient Primo Levi, dans Les naufragés et les révoltés, Primo Levi qui par son expression de « zone grise » entend dépasser une vision manichéenne des camps, dans lequel tous auraient des victimes entièrement innocentes tandis que les bourreaux furent tous autant atroces et coupables. Évidemment Primo Levi affirme que les victimes furent les victimes et les bourreaux des bourreaux, mais que certaines victimes, de par leur comportement dans les camps, furent aussi des bourreaux, et que des bourreaux furent aussi parfois en un certain sens des victimes. Il nous semble que c’est ici ce à quoi pense Arendt. D’ailleurs votre ouvrage montre page. 149 qu’Arendt trouve cette idée d’une forme de convergence entre le bourreau et la victime dans le livre Rousset qu’elle a pris partiellement en notes.
EF : J’ai répondu à une question similaire de Thibaut Gress dans le premier entretien en rappelant la citation que vous commentez. Il faudrait ajouter une autre citation, tirée de la conclusion de l’édition de 1951 des Origines du totalitarisme, où elle écrit, de façon plus catégorique encore, car non atténuée par l’incise évoquant « bien des cas », que dans les camps d’extermination, « les oppresseurs d’aujourd’hui allaient devenir les victimes de demain7 ». Le rôle souvent problématique des kapos dans les camps de concentration est bien documenté mais dans le passage que vous citez partiellement, Hannah Arendt commence par évoquer les chambres à gaz. On ne peut donc pas soutenir que ses développements ne concerneraient que les camps de concentration. En réalité, elle ne distingue pas camps de concentration et d’extermination alors même que cette distinction est explicite dans le Livre noir dont elle prétend effectuer la recension. Et dans les « usines de mort », selon l’expression de Grossmann à propos de Treblinka que reprend Arendt, on n’a jamais vu les bourreaux : SS et supplétifs ukrainiens, périr dans les chambres à gaz. Tout le propos d’Arendt tend vers une dilution, voire même un effacement, des vraies responsabilités. Il y a une continuité sur ce point de la préface à Jaspers de son livre trop peu connu Sechs Essays, publié en langue allemande en 1948, au livre sur Eichmann de 1963. J’ai approfondi ce point dans une étude récente8.
AP : Quand Arendt évoque la figure de l’animal laborans dans son analyse sur le travail, vous la lisez comme une déconsidération et une déshumanisation du travailleur. N’est-ce pas plutôt une dénonciation de l’exploitation ? Annoncer qu’elle va critiquer Marx, affirmant que l’homme s’humanise par le travail, veut-il vraiment dire qu’elle va en prendre le contrepied, et soutenir que le travail déshumanise l’homme ou n’est pas digne de lui, conformément aux valeurs qu’elle attribue aux Grecs ? Il me semble excessif d’affirmer que pour Arendt l’esclavage « ne constitue pas un problème pour elle » (p. 121) Il semble qu’on peut essayer d’expliquer l’argumentation d’Aristote à propos de l’esclavage sans être esclavagiste.
EF : Arendt ne dit pas que le travail déshumanise l’homme. C’est là un des contresens les plus répandus sur sa pensée. Selon la distinction reprise à Heidegger entre zôê et bios, l’animal laborans, décalque de l’arbeitende Tier selon Heidegger, n’est pas encore pour elle à proprement parler un être humain. L’animal laborans dans la vision d’Arendt apparaît donc plus infra-humain que déshumanisé. La distinction entre l’homme et l’animal « recoupe, écrit-elle, le genre humain lui-même » 9. La vie proprement humaine ne commence qu’avec la bios, seul mode de vie « authentiquement humain » 10. C’est la vie selon l’agir politique, réservée au petit nombre : « la plupart […] n’y vivent pas ». Tels sont par exemple, « l’étranger, l’esclave, le barbare », « l’ouvrier », ou encore, de nos jours, « l’employé » 11.
Ce n’est pas le lieu de discuter la pensée même d’Aristote, mais d’observer ce que Hannah Arendt tire de sa lecture et ce qu’elle affirme pour sa part : « la maîtrise de la nécessité », écrit-elle, « ne peut être réalisée qu’en commandant et en faisant violence aux autres qui, comme esclaves, dispensent les hommes libres d’être eux-mêmes contraints par la nécessité. L’homme libre […] doit posséder des esclaves et les commander » 12. Dans l’essai De la révolution, Arendt magnifie la Révolution américaine qui a maintenu l’esclavage et s’en prend à la Révolution française qui l’a aboli. Elle soutient qu’il n’y a jamais eu de révolte d’esclaves réussie mais elle passe sous silence la Révolution haïtienne qui a institué une République indépendante. Bref, on ne trouve pas dans la vision politique d’Arendt une pensée de l’émancipation pour tous de la servitude. Dans sa vision, « l’égalité elle-même n’est nullement un principe universellement valable » 13.
AP : La question de l’éducation est également un point délicat. Peut-être faut-il plutôt penser que le droit à l’éducation n’est pas pour elle un droit politique, thèse qui n’est pas en-soi indéfendable ; dans ce cas, on pourrait penser que, pour que l’éducation s’accomplisse sans trop d’idéologie, ce soit à la famille d’éduquer. En tout cas, je ne vois pas comment on peut analytiquement déduire de la position aristocratique d’Arendt sur l’éduction quelque soupçon de racisme que ce soit.
EF : Il ne s’agit pas de déduction analytique, mais d’un constat de fait. Katryn T. Gines, en effet, a précisément montré, dans Hannah Arendt and the Negro Question, que sur les droits civiques et la question du droit à l’éducation des afro-américains dans les mêmes conditions et les mêmes écoles que les « Blancs », Arendt défend les mêmes positions que les suprémacistes blancs14. Quand un éditeur français aura-t-il le courage de publier cet ouvrage indispensable ? Les arendtiens français ne semblent pas prêts à affronter les questions que pose une lecture critique attentive des écrits d’Arendt telle qu’on la trouve chez Gines ou chez Steinberg15, pour ne pas parler de mon livre.
AP : Pour finir, peut-être un sujet plus léger. Vous dites ne pas vous en prendre à la personne d’Arendt. Mais, dans ce cas, critiquer la « moquerie arendtienne » (p. 302) et son « esprit railleur » (p. 48), n’est-ce pas une façon de la critiquer elle en tant que personne ? N’est-ce pas contradictoire avec vos principes méthodologiques ? Plus gravement, n’est-ce pas implicitement proposer un modèle normatif de philosopher ou de penser ? Je m’explique : affirmer que par son ton même et sa méthode, « cette ironie disculpatrice qui tourne en dérision les choses les plus graves plutôt que de les affronter dans un esprit de précision et de vérité », n’est-ce pas invalider l’ironie de Montesquieu dénonçant l’esclavage et Voltaire la superstition ? Cela ne reviendrait-il pas à demander à Nietzsche de cesser ses aphorismes provocateurs ?
EF : L’ironie de Pascal dans les Provinciales, qui se rit des accommodements des théologiens et des casuistes, celle de Montesquieu ou Voltaire à propos de l’esclavage et de la superstition, cherchent à éveiller l’esprit critique. La moquerie manifeste dans les écrits d’Arendt au contraire, à propos du procès de Jérusalem, tourne en dérision l’approche critique indispensable sur une question aussi tragique. L’auteur d’Eichman à Jerusalem invite à ne pas prendre au sérieux le personnage d’Eichmann et barre l’accès au fond du problème. Critiquer cet aspect de ses écrits apparaît donc légitime16. Beaucoup plus éclairante apparaît par contraste l’étude de l’historien anglais David Cesarani, qui a su reconstituer la formation d’un génocidaire17. Les recherches critiques sur les écrits d’Arendt n’en sont qu’à leurs débuts.
- Dans sa recension plutôt laudative de l’ouvrage fort révisionniste de Francisco Alfieri et F. W. von Herrmann sur les Cahiers noirs, publié dans Actu Philosophia, Étienne Pinat soutient par exemple que la publication des Cahiers noirs donnerait « nettement raison » à « ceux qui affirment que l’adhésion au nazisme n’a été qu’une erreur provisoire et rapidement dépassée après la démission du rectorat » contre « ceux qui affirment que Heidegger était nazi jusqu’à sa mort et a voulu en réaliser ‘l’introduction dans la philosophie’ ». Il ne mentionne guère cependant dans son compte-rendu que les interprétations des Cahiers noirs favorables à Heidegger et passe sous silence tous les travaux critiques, comme par exemple les dossiers parus dans les revues Critique, Cités, ainsi que la Revue d’Histoire de la Shoah, le collectif allemand publié par Marion Heinz et Sidonie Kellerer chez Suhrkamp, mon étude de « La métapolitique de l’extermination » publiée en 2016 dans Arendt et Heidegger. Cette manière de procéder ne favorise pas le débat. Par ailleurs, il y a une question de fond tout à fait décisive que n’aborde pas Pinat : s’il était vrai que son adhésion au national-socialisme n’aurait été que provisoire, comment comprendre que Heidegger ait programmé la publication de ses écrits les plus radicalement hitlériens, antisémites et génocidaires dans son Œuvre intégrale en 102 volumes, sans un mot d’auto-critique ou de repentir, de sorte que nous voyons aujourd’hui les plus radicaux des heideggériens russes ou américains comme par exemple Alexandre Douguine ou Greg Johson, reprendre ouvertement ses positions völkisch ?
- The Hannh Arendt Papers at the Library of Congress, Speeches and Writing file 1923-1975, « Antisemitismus », p.41 ; Hannah Arendt, « L’antisémitisme », Écrits juifs, trad. de l’allemand par Sylvie Courtine-Denamy, Paris Fayard, p. 188-189 (trad. modifiée).
- Ibid., p. 190-191.
- Cependant, contrairement à Bourdieu, je distingue entre philosophie et « champ philosophique ».
- Voir Judith Goetz, Joseph Maria Sedlacek, Alexander Winkler, Untergangster des Abendlandes. Ideologie und Rezeption der rechtsextremen‚ Identitären‘, Hambourg, Marta Press, 2018, p. 173.
- Voir par exemple le propos liminaire de Martine Leibovici à un colloque sur Arendt conçu à l’origine comme une réponse à Arendt et Heidegger : http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Arendt.html L’auteure durcit le trait dans son évocation de mon livre – je ne parle pas comme elle le fait de « configuration völkisch » à propos d’Arendt – et elle argue du fait que ne voulant pas me prendre pour « unique interlocuteur », les organisateurs du colloque m’ont tout simplement refusé la parole. Pourquoi ne pas avoir envisagé un colloque ouvert, dans lequel les arendtiens se seraient confrontés à différents interprètes critiques, venant des horizons intellectuels et politiques les plus variés comme par exemple Richard Wolin, Martin Jay, Pierre Manent, Ian Kershaw, Bernard Wasserstein, Jules Steinberg, Kathryn T. Gines ou Édith Fuchs ? Car je ne suis pas le seul critique de la pensée d’Arendt, loin s’en faut. On relèvera également que l’un des participants, Facundo Vega, cite en la traduisant une phrase d’Arendt et Heidegger, pour la présenter comme une « theoretical maneuver riddled with unfair implications », laquelle manifesterait « the lack of real effort to draw analytical distinctions » (http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Arendt/pdf/vega.pdf). Voici la phrase : « Arendt took the intellectual responsibility for elevating Heidegger’s writings, which she knows contain lively praise of the National Socialist movement, to the rank of a paradigm of thinking. » (traduit de Arendt et Heidegger, p.520). En réalité, loin de toute « manœuvre théorétique », ma remarque ne fait que reprendre et souligner l’affirmation d’Arendt citée juste auparavant : « L’œuvre et la vie [de Heidegger] nous ont appris », écrit-elle, « ce qu’est PENSER, et que les écrits demeureront à cet égard paradigmatiques ; paradigmatiques aussi du courage qu’il y a à se risquer dans la contrée énorme de l’inexploré, à s’exposer entièrement à l’impensé ». Cet éloge figure dans le Livre d’or publié par Klostermann en septembre 1969, pour les quatre-vingts ans de Heidegger. Quant à l’éloge heideggérien de la « vérité interne et grandeur » du mouvement national-socialiste, on sait qu’elle y fait allusion pour s’efforcer de le désamorcer dans son discours du même mois, « Heidegger a quatrevingts-ans », traduit à la fin du recueil intitulé Vies politiques.
- Cité dans Arendt et Heidegger, op. cit., p. 31.
- Voir E. Faye, « Arendt, Heidegger et le ‘déluge’ d’Auschwitz », Des philosophes face à la Shoah, Revue d’Histoire de la Shoah, n°207, octobre 2017, p.97-114.
- Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, 1983, p.55.
- Ibid., p.48.
- Ibid., p.258.
- Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p.155.
- Hannah Arendt, De la révolution, Paris, Gallimard, 2013, p.421.
- Kathryn T. Gines, Hannah Arendt and the Negro Question, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 2014.
- Jules Steinberg, Hannah Arendt on the Holocaust. A Study of the Suppression of Truth, Lampeter, Th e Edwin Mellen Press, 2000.
- De fait, je ne prétends pas dresser un portrait critique de la personnalité d’Arendt, comme le fait par exemple son ami William Barrett, qui met l’accent sur ce qu’il nomme son « arrogance » (W. Barrett, The Truants. Adventures Among the Intellectuals, Garden City, New York, Anchor Press/Doubleday, 1982, p.101-105).
- David Cesarani, Adolf Eichmann, trad. de l’anglais par Olivier Ruchet, Paris,Tallandier, 2010.








