Qu’est-ce qu’une mauvaise monographie ? Est-il possible de dresser une liste de critères qui, pour l’histoire de la philosophie, détermineraient l’échec d’une entreprise ? La question de la fidélité à l’œuvre étudiée doit-elle servir de critère suprême d’évaluation ? Le contresens est-il l’échec fondamental de la monographie, fût-il fécond ? Si chacun s’accorde aujourd’hui par exemple sur le fait que Deleuze ait produit une série de contresens sur la philosophie nietzschéenne, peu iraient jusqu’à dire que son Nietzsche et la philosophie soit un mauvais livre, comme si l’originalité ou la fécondité qui en découlaient sauvaient l’entreprise de ses contresens. Mais faut-il alors faire de la surprise et de la fécondité d’une monographie le lieu de sa réussite, indépendamment de sa pertinence au regard de l’auteur abordé ? Ce serait sans doute trop accorder à l’originalité et trop peu à la probité. Mais réévaluer l’importance de la probité ne va pas non plus sans dangers, au moins du point de vue pratique : le meilleur moyen de ne pas produire de contresens et de rester fidèle au texte est en effet de verser dans la paraphrase, donc de reproduire en une langue à peine modifiée ce que le texte d’origine dit déjà. Ne pas y succomber suppose soit de parvenir à expliquer un raisonnement tant du point de vue de la logique interne d’une pensée que du point de vue de sa représentation générale, soit de penser la particularité d’un texte à partir d’une interprétation générale. Là encore, de nombreux risques guettent le commentateur : soit il parvient à expliquer la logique interne d’une pensée, sans pour autant être en mesure de donner à se représenter ce dont il s’agit, soit il subsume tel ou tel texte sous une interprétation générale mais il prend le risque d’être prévisible, tout passage ne pouvant être unilatéralement pensé qu’à partir de l’angle choisi, lequel tue tout suspens et donc toute surprise du résultat.
Ainsi se dessinent plusieurs écueils qui, mis bout à bout, permettraient de penser une détermination de la mauvaise monographie en tant qu’elle cumulerait les défauts suivants : 1) l’absence, délibérée ou non, de fidélité à l’œuvre commentée, c’est-à-dire la série de contresens plus ou moins volontaires ; 2) l’incapacité à expliquer un passage au profit d’une paraphrase constante, en général dissimulée par un usage verbeux et / ou obscur de la langue ; 3) la prévisibilité du résultat, dicté par l’interprétation utilisée comme idéologie ; 4) la présence d’un faux problème utilisé comme fil directeur, déduit de l’idéologie retenue et non de l’œuvre étudiée. Si ces quatre critères cumulés définissent la mauvaise monographie dans le cadre de l’histoire de la philosophie, alors il nous semble clair que le dernier ouvrage de Dan Arbib, Descartes, la métaphysique et l’infini1 relève de cette catégorie et satisfait pleinement chacun des critères exposés.
A : La « métaphysique » peut-elle être un problème du point de vue cartésien ?
Y a-t-il, du point de vue cartésien, une réflexion sur le statut de la métaphysique ou sur sa dimension problématique ? Descartes en fait-il un objet explicite de thématisation ?
La métaphysique ne fait pas chez Descartes l’objet de longs développements, ni et encore moins celui d’une thématisation singulière, ce qui n’exclut pas la possibilité de la définir. En un premier sens, la métaphysique est chez Descartes l’étude de ce qui est immatériel donc de ce que l’esprit humain conçoit comme inétendu. Cette équivalence se trouve rappelée à de nombreuses reprises, notamment dans la fameuse Lettre-Préface des Principes, où l’auteur évoque les principes dont il se sert « touchant les choses immatérielles ou métaphysiques » (Lettre préface des Principes, AT IX-II, 10), « métaphysique » apparaissant comme un synonyme d’immatériel. C’est la raison pour laquelle les Méditations de 1641, qui traitent de l’ego comme d’une entité immatérielle, mais aussi de Dieu, peuvent être reliées à la métaphysique, lien que Descartes opère d’ailleurs explicitement en précisant que sa « métaphysique » se trouve tout entière dans ses Méditations2. Plus explicite encore, il évoque « les Méditations de ma métaphysique » (Principes I, § 62), achevant ainsi d’établir l’équivalence entre métaphysique et étude de l’immatériel compte-tenu des réalités immatérielles dont traitent les Méditations.
En ce premier sens, la Métaphysique ne présente aucun mystère et s’occupe des réalités échappant à la matière, Descartes utilisant un tel sens comme une évidence ne nécessitant aucun développement supplémentaire. On ne saurait à cet égard mieux dire que Laurence Devillairs, rappelant que « la méditation est la forme que prend toute connaissance lorsqu’elle est métaphysique, c’est-à-dire lorsqu’elle porte sur des objets « purement intelligibles ». »3 Bien enracinée dans la tradition des commentateurs, cette première définition de la métaphysique était notamment celle que retenait Alquié pour fonder la fameuse « découverte métaphysique » de l’homme, appuyée sur une entente immatérielle et non mondaine des objets métaphysiques, eux-mêmes explicitement apparus avec la création des vérités éternelles ; celle-ci, nous dit Alquié, « exprime une évidence s’imposant à Descartes, elle traduit la déréalisation du monde qu’opère en lui l’apparition de la dimension métaphysique. »4 Il y a donc métaphysique lorsqu’il y apparition de réalités immatérielles à côté desquelles semble se déréaliser l’ensemble des objets mondains et matériels.
Si la Métaphysique se définit donc prioritairement par son objet – l’immatériel –, elle peut également être pensée du point de vue noétique comme connaissance des éléments premiers, ce qui revient à dire que toute connaissance d’éléments étendus s’enracine sur la connaissance de principes premiers qui, eux, sont immatériels. Tel est le sens de la célèbre image de la Lettre-Préface des Principes : « Ainsi toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences (…). » (AT IX-II, 14). Du point de vue noétique, la métaphysique se présente comme la première des sciences, en tant que toute connaissance positive ne peut être fondée que sur ses premiers principes, si bien que la compréhension de la matière ne saurait être acquise en-dehors de la compréhension de l’ego comme entité pensante et de l’existence de Dieu. Ainsi, cette vraie philosophie, « dont la première partie est la métaphysique, qui contient les principes de la connaissance, entre lesquels est l’explication des principaux attributs de Dieu, de l’immatérialité de nos âmes, et de toutes les notions claires et simples qui sont en nous » (Ibid.), se distribue-t-elle selon deux ordres, celui défini par son objet – l’immatériel – et celui défini par son ordre procédural dans l’ordre noétique, faisant de la science de l’immatériel le fondement de toutes les autres sciences. C’est la raison pour laquelle Descartes explique à Mersenne que « le peu de métaphysique qu’ [il] [lui] envoie contient tous les principes de [sa] physique. »5.
C’est ce second sens que privilégie par exemple Jean-Marie Beyssade lorsqu’il ramène la métaphysique à sa dimension noétique, ou, plus exactement, aux premiers principes fondant un dire rationnel et certain. « Établir avec les premières vérités la possibilité de dire la vérité, la possibilité de la vraie et certaine science : voilà ce que Descartes appelle métaphysique, ou philosophie première. »6 De cette définition proposée en avant-propos, et qui se suffit à elle-même, Beyssade fait un point de départ pour l’introduction de son ouvrage : « La métaphysique est, pour Descartes, une science dont toutes les propositions relèvent de la norme du vrai et dont chacune doit pouvoir être justifiée. »7
Si donc la métaphysique en son sens cartésien fait signe autant vers un type d’objets que vers le fondement d’une noétique dans l’ordre épistémique, et si aucune obscurité ne semble grever cette double approche complémentaire, comment serait-il possible de justifier le fait d’en faire un thème spécifique d’étude, non pas tant pour en étudier le contenu que pour en comprendre la nature ? Du point de vue strictement cartésien, il nous semble que s’il est évidemment pertinent de chercher à comprendre ce que sont les objets métaphysiques, et comment ils peuvent être connus, il est en revanche inutile, vain, voire absurde de chercher à épiloguer sur la nature métaphysique d’un discours au détriment de la connaissance des objets de ce discours ; ce serait en effet abandonner la recherche de la vérité du discours au profit d’une investigation de sa nature, ce qui est éminemment anti-cartésien et contraire à toute l’ambition du cartésianisme. Mais alors, pourquoi adopter un tel parti-pris si éloigné de la logique même du cartésianisme ?
Il faut ici évoquer le nom de Heidegger et l’inflexion que celui-ci fit subir à l’histoire de la philosophie, en abandonnant toute évaluation de l’argumentation des pensées antérieures et, partant, en évacuant leur rapport à la vérité, au profit d’une détermination de leur situation au sein d’une prétendue « histoire de la métaphysique » réduisant chaque pensée à des symptômes du déploiement de ladite métaphysique. Cela revient à produire une double altération de l’histoire de la philosophie car, non seulement, cela revient à biffer l’exigence première des philosophies classiques qui ambitionnaient de faire de la connaissance de la vérité leur objet primordial, mais en plus cela revient à imposer à ces philosophies un sens de la Métaphysique qui leur est totalement étranger. Ainsi, si la Métaphysique ne constitue aucunement un problème pour Descartes ni même un thème, elle peut le devenir si l’on prend la Métaphysique en un sens non cartésien – pour ne pas dire anti-cartésien –, de sorte que la pensée cartésienne ne soit plus l’objet réel du commentaire mais devienne le symptôme du déploiement d’une histoire et l’illustration supposée d’une pensée qui lui est tout à fait étrangère.
De surcroît, la convocation par Dan Arbib de Levinas à la fin de l’ouvrage aggravera cette manière de faire ; en évaluant la « sortie de la Métaphysique » opérée par Descartes – sans d’ailleurs jamais justifier que les sens heideggérien et levinassien de la Métaphysique se rejoignent –, le rapport du cartésianisme à la vérité et à l’argumentation sera définitivement brisé ; seule importera sa situation au regard d’une supposée histoire de la Métaphysique, situation jugée « paradoxale » puisqu’à la fois fondatrice et extérieure à cette histoire.
B : Lecture heideggérienne de l’histoire de la métaphysique : du contresens à l’idéologie
Que découle-t-il de nos remarques antérieures ? La première conséquence est liée au fait de traiter Descartes comme le symptôme d’une histoire générale et non comme un philosophe cherchant à penser les conditions de l’obtention de la vérité. Il s’agit, dans une telle optique, non pas d’évaluer la pertinence ni l’intelligence d’un propos, mais d’y repérer des mots-clés qui seraient autant d’indices de la nature de son discours ; les raisonnements cartésiens se trouvent ainsi totalement oubliés et effacés au profit d’une espèce d’enquête lexicale abstraite. En d’autres termes, Dan Arbib traite Descartes comme s’il était essentiellement l’utilisateur d’un lexique n’ayant au fond d’intérêt que selon une dimension indicielle, et jamais comme un philosophe capable de raisonnements et d’enchaînements cohérents au sein d’une pensée systématique. Il semblerait alors que ce que déplorait déjà Alquié à l’égard des usages hégéliano-marxistes de Descartes, traitant ce dernier comme un simple moment d’un déploiement historique aveugle à la démarche singulière du philosophe, puisse se transposer mot pour mot à l’entreprise heideggérienne de Dan Arbib :
« Ces prétendus historiens ne témoignent guère que de leur incompréhension de ce qu’est la philosophie. Ils négligent cette sorte de dimension verticale par laquelle l’homme entre en contact avec la vérité, oublient que le projet du philosophe est de se dégager de l’histoire, et de la juger au lieu de la subir ; ils ne peuvent donc parler d’un philosophe qu’en refusant, d’abord, de l’entendre. »8
Partant, le Descartes que restitue D. Arbib se révèle étranger à toute forme patiente de méditation – laquelle suppose un enchaînement continu de pensées – mais aussi étranger à toute forme de méthode rigoureuse ; à l’encontre de la compréhension rationnelle et argumentée des textes, l’auteur propose une sorte de lexicologie aveugle aux enjeux argumentatifs des textes étudiés, le sens de ces derniers étant en outre brisé par l’espèce de sautillement permanent que leur impose D. Arbib en convoquant des bribes de paragraphes isolés, sans se soucier des différences de date, d’enjeux, ni même d’ordre, certains textes tardifs étant convoqués pour « expliquer » des textes antérieurs, et ce à l’encontre de toute logique élémentaire. Bref, toute l’oeuvre de Descartes apparaît comme une sorte de buffet dans lequel Arbib vient picorer çà et là une ou deux phrases, au gré de ses envies, sans aucun souci de probité ni de cohérence. Une telle conséquence est hélas inévitable dès lors que l’on réduit la philosophie à de simples opinions exprimées lexicalement et dénuées d’arguments, et que l’on réduit ensuite ces opinions à un simple moment, fût-il décisif, d’une histoire globale. Le texte n’est plus l’exposition d’une démonstration philosophique mais n’a plus de valeur qu’indicielle au regard d’une histoire globale que le surplomb que l’on s’auto-attribue permet de contempler.
Par ailleurs, et telle est la seconde conséquence préfigurée par la première, la visée de l’ouvrage n’est pas tant celle de comprendre ce que dit Descartes pour lui-même que de le situer au sein d’une histoire supposée de la métaphysique, dogmatiquement pensée à partir d’une histoire de la philosophie intégralement dictée par les canons herméneutiques heideggériens ; de ce fait, et contrairement à ce que pourrait laisser abusivement croire le titre, il ne s’agit pas tant d’un livre sur Descartes que d’une énième variation sur l’histoire de la philosophie perçue inconditionnellement depuis une perspective heideggérienne, dont la totalité des résultats est éminemment prévisible puisque présupposée par le type de questions soulevées. Lorsque Dan Arbib introduit par exemple son propos en notant que les ambiguïtés cartésiennes pourraient révéler les ambiguïtés de l’infinité dans l’histoire de la métaphysique, il se désintéresse en fait de Descartes en tant que Descartes, ce que confirme le propos suivant :
« L’examen des rapports entre infinité et métaphysique impose au surplus un double regard sur l’histoire de la métaphysique. D’abord, l’assignation de la situation exacte de l’infinité cartésienne dans l’histoire de la métaphysique rend nécessaire la détermination précise des positions des prédécesseurs ou des adversaires de Descartes, la radicalité de ses décisions apparaissant d’autant mieux qu’est fidèlement indiqué le status quaestionis où elles s’insèrent. »9
Là encore faudrait-il mesurer la violence que suppose cette approche, et que résume parfaitement Alquié par anticipation :
« rien n’est moins naturel que d’être philosophe, et sans doute nul métaphysicien n’eut-il jamais l’impression de se situer en une histoire de la pensée, de succéder à d’autres comme, en quelque entreprise, un fils peut remplacer son père. Les philosophes ne naissent point de philosophes. »10
La troisième conséquence tient à l’absence totale de surprise de l’ouvrage, tant dans le type de questions qu’il propose que dans les solutions qu’il apporte. En effet, sans même lire l’ouvrage, on devine qu’il sera question de la place de la pensée cartésienne dans l’histoire de la métaphysique perçue en son acception heideggérienne, donc du concept de l’ens et, plus précisément encore de l’ens infinitum ; mais en même temps, parce que le titre indique l’importance de l’infini, on sait par avance qu’il s’agira de montrer une fois encore que la métaphysique est « débordée », « éclatée », « percée », « trouée », etc. par l’infini, ce dernier étant toutefois toujours déjà récupéré à la fois par le logos de la supposée constitution onto-théo-logique de la métaphysique et en même temps « excédé » par ses propres résultats, Levinas étant en embuscade. On sait par avance qu’il y aura un « paradoxe », celui d’un infini éclatant le cadre métaphysique (Levinas) et en même temps pensé à l’intérieur des bornes du logos ; on le sait a priori parce que c’est toujours la même idée qui est charriée depuis Heidegger, reprise par Jean-Luc Marion, et recyclée par Dan Arbib sous la forme du sacro-saint paradoxe ainsi exprimé :
« l’idée d’infini est à la fois idée du fondement qui outrepasse la rationalité, et l’idée qui s’intègre à la rationalité pour conquérir ce fondement. Surgit ainsi, au cœur de l’infinité divine, une tension d’autant plus puissante et insoutenable que Descartes l’a étrangement tue ; sa métaphysique tout entière en acquiert une sorte de dualité interne dont elle paraît inconsciente et à laquelle, comme interprète, nous n’avons pas voulu rester aveugle. Descartes a ainsi associé en un même nom une détermination métaphysique et une détermination non métaphysique de Dieu. »11
On est ici au cœur de ce que Raymond Boudon appelait « l’idéologie », c’est-à-dire un type de discours dogmatique excluant toute surprise et tout imprévu ; autrement dit, il y a idéologie quand le discours, une fois reconnu comme idéologique, ne peut plus produire le moindre étonnement, ne peut pas aboutir à autre chose que ce que nous avons prévu. C’est très exactement cela qui se joue dans le livre de Dan Arbib, à savoir le déploiement d’un logiciel dont ni le point de départ problématique, ni l’angle thématique retenu, ni la formulation de la réponse ne sauraient apporter le moindre embryon de surprise. Manière de dire que l’on connaît donc par avance l’ensemble de ce qu’y sera exposé. Heidegger et Levinas. Univocité et Sortie de la Métaphysique. Fondement et excès.
Quatrième conséquence, la manière surdéterminée – idéologique – de questionner les textes en-dehors de leurs intentions première et de leur logique propre, s’accompagne d’une négation systématique et paradoxale de l’histoire réelle, tant la Renaissance se trouve interdite d’accès dans l’intelligibilité du devenir de la métaphysique ; de la scolastique à Descartes, il semble n’y avoir rien ; le néoplatonisme, la question de la causa sui depuis Plotin, ou encore le rôle de l’infini dans ce même néoplatonisme sont catégoriquement ignorés, les travaux de Garin, Robinet, Gontier, Faye, Toussaint, pour ne rien dire des nôtres, toujours passés sous silence. Au nom de l’histoire se trouve dès lors menée une vaste entreprise de dissolution de cette dernière, tandis qu’un jeu permanent de faux semblant envahit rapidement l’ouvrage : plus la rigueur et la précision y sont explicitement affirmées, moins elles y sont réellement présentes, D. Arbib reprenant par exemple l’usage très marionien de l’adverbe « précisément » dans les endroits les moins bien argumentés de son livre. Nous renvoyons le lecteur à notre recension de Certitudes négatives où nous avions analysé la manière dont les flottements logiques des ouvrages de Jean-Luc Marion étaient dissimulés par une inflation d’adverbes simulant la précision et la rigueur.
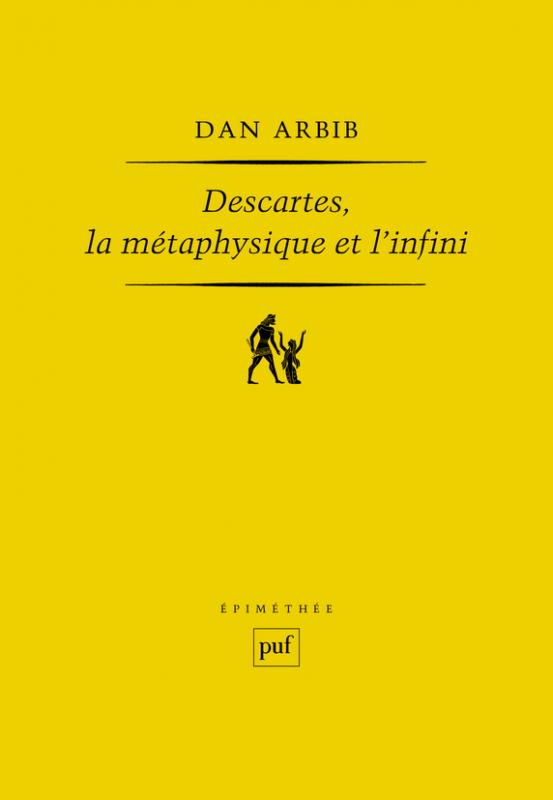
Le lecteur assiste ainsi bien souvent à des passages sidérants de dogmatisme, où la convocation de l’autorité heideggérienne semble autoriser la dispense de toute argumentation ; ainsi en va-t-il de la si délicate question de la causa sui pour laquelle D. Arbib assène qu’il nous faut inconditionnellement adhérer aux thèses de Heidegger en la matière, ajoutant qu’ « il ne semble pas qu’il y ait lieu d’y revenir »12 Les remarquables analyses de Thierry Gontier développées dans Descartes et la causa sui13 ne sont pas même évoquées en notes, alors qu’elles établissent de manière serrée les nombreuses erreurs et impasses heideggériennes sur ce sujet.
De la même manière, alors que Jean-Baptiste Jeangène Vilmer avait consacré de substantiels articles aux questions soulevées par l’infini chez Descartes, dont un remarquable intitulé « Le paradoxe de l’infini cartésien »14, Dan Arbib se contente de n’en mentionner que deux, en bas de page (pages 174 et 177), sans même les discuter alors qu’ils constituent de puissantes et probes tentatives d’interprétation immanente à côté desquelles le dogmatisme d’Arbib paraît particulièrement déroutant.
C : Au cœur des présupposés de l’ouvrage
Une fois posées ces réflexions préliminaires rendant compte de notre scepticisme à l’endroit de la démarche générale de Dan Arbib, il devient possible d’examiner dans le détail le procédé retenu. Le cadre revendiqué impose d’emblée un certain vocabulaire qui quadrille lui-même un certain type de questions portant toutes sur la nature du discours philosophique, et jamais sur sa véracité ni sur sa cohérence. La pensée cartésienne ne peut dès lors être interrogée qu’à l’intérieur d’un système de coordonnées qui ressemble à une permanente pétition de principe dans la mesure où, jamais, le sens ici retenu de la Métaphysique ne se trouve véritablement justifié alors même que c’est lui qui gouverne l’ensemble des résultats. Pour suivre la démarche de l’ouvrage, il va falloir admettre une série de thèses très lourdes, systématiquement présentées comme de quasi-évidences, dont la validité n’est jamais discutée, et dont, par ailleurs, la compatibilité entre ses ententes heideggérienne et levinassienne ne se trouve aucunement établie.
1°) Admettre une entente de la Métaphysique comme constitution onto-théo-logique
Nous entendrons « métaphysique », expose ainsi Arbib, « comme onto-théo-logie, c’est-à-dire comme la structure ou l’articulation interne de la métaphysique constituée comme science à partir de Duns Scot. »15 Le propos n’est pas des plus clairs, dans la mesure où il définit la métaphysique par « l’articulation interne de la métaphysique », mais il a le mérite de situer explicitement l’idéologie dont procède l’ouvrage, à savoir une lecture heideggérienne de l’histoire de la philosophie, faisant de Duns Scot le moment fondamental, par l’univocité, de la constitution de la métaphysique dont Descartes serait quelque chose comme un des symptômes les plus aboutis.
Dan Arbib pose dès le départ le cadre de son questionnement : il sera question de « la structure onto-théologique, remarquable description de la métaphysique en sa détermination historique, c’est-à-dire scolaire et donc scotiste. »16 De même, le questionnement lui-même sera explicitement heideggérien puisque c’est avec Heidegger qu’il faut se demander quel logos peut présider à la constitution d’une onto-théo-logie si l’étant suprême échappe à l’étantité commune et au logos comme transcendant. « Quel logos, se demande Arbib, peut bien déployer une onto-théo-logie dont l’étant suprême se donne comme irreprésentable ? »17 De là la réflexion sur le nom d’infini qui signifie à la fois la sécession de la transcendance devant la métaphysique et l’intégration métaphysique de Dieu. Autrement dit, comment passer de Heidegger à Levinas à partir d’une même réflexion sur l’infini.
La discussion de la légitimité de cette approche excéderait de beaucoup le cadre de cette recension et cela nous accule à faire comme si ce choix était valide ; admettons donc que cela ait un sens de penser la métaphysique comme « articulation interne de la métaphysique », de penser que la métaphysique ne devient « scientifique » qu’avec Duns Scot ; constatons que Dan Arbib repose les mêmes questions que celles soulevées par Jean-Luc Marion dont Le prisme métaphysique de Descartes ambitionnait de « fixer la figure cartésienne de l’onto-théo-logie »18 et demandons-nous plutôt ce que cela signifie, au moins du point de vue de l’école heideggérienne.
2°) Admettre que la Métaphysique ne devient pleinement elle-même qu’avec Duns Scot
Une fois admis le premier présupposé, il nous faut comprendre pourquoi Duns Scot jouerait un rôle privilégié qui, premièrement, donnerait son extension plénière à la Métaphysique et, deuxièmement, engagerait un mouvement conférant un gain d’intelligibilité à l’étude des œuvres cartésiennes, sachant que Descartes ne se réfère jamais à Duns Scot.
Nous devons à cet égard nous référer aux études historiques d’Olivier Boulnois qui avait établi de quelle manière Duns Scot avait considéré nécessaire d’en finir avec l’analogie de l’être pour fonder enfin une science solide à partir de l’univocité et de l’infini. Loin d’en revenir à l’imperfection de l’analogie, la positivité du concept d’étant devait être conquise afin de qualifier Dieu, le concept d’ens infinitum étant alors la meilleure réponse dans le cadre d’une saisie conceptuelle de Dieu. Cette analyse avait été entre autres magistralement exposée dans l’introduction à la traduction à la première partie de l’Ordinatio de Duns Scot, et ainsi formulée :
« […] le discours théologique suppose l’application à Dieu des concepts de notre expérience finie. S’il n’y avait pas d’univocité entre le lieu de notre expérience, l’étant fini, et celui de notre discours sur Dieu, l’étant infini, et si nos concepts avaient deux raisons analogues ici-bas et en Dieu, « il n’y aurait absolument aucune évidence » dans notre théologie.
L’exercice de la théologie présuppose une unité fondamentale entre notre expérience et l’objet de cette science, elle repose donc sur l’unité de la métaphysique garantie par le concept univoque d’étant. »19
Et Boulnois de noter que l’univocité est « la sauvegarde des deux sciences maîtresses : la philosophie et la théologie. Elle le peut dans la mesure où elle est la condition de leur rencontre dans une métaphysique. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que la destruction de l’analogie a permis de dégager les assises de la métaphysique comme science, puis de la refonder nouvellement sur l’univocité, et, par-là même, de la sauvegarder, en l’articulant d’une autre manière à la théologie. »20
Et en combinant l’univocité avec l’infini, Boulnois montrait quelle était l’argumentation de Duns Scot menant ce dernier à concevoir Dieu comme ens infinitum :
« Nous comprenons maintenant pourquoi le nom d’étant infini est le premier nom de Dieu. Le concept d’étant est premier dans l’ordre de transcendance par rapport à toutes les autres passions convertibles, qui s’y rapportent par une teneur additive. Le concept d’infini est premier dans l’ordre de perfection par rapport à tous les autres modes : c’est la seule propriété disjonctive qui excède l’ordre formel pour atteindre la racine de l’essence divine, l’identité réelle d’où fluent toutes les autres perfections. Le recoupement de ces deux primautés fonde la priorité du nom d’étant infini sur tous les autres attributs divins. »21
L’univocité est ici jugée décisive en ce qu’elle permet à l’intellect de saisir Dieu sous sa raison d’immensité, de le saisir distinctement et proprement ; tout cela contribue, explique O. Boulnois, à faire de Duns Scot le fondateur d’une métaphysique scientifique, définissant son objet unique et commun, l’ens, et accédant à une clarté conceptuelle à son endroit. Quant à l’infini, il vient déterminer l’ens selon une spécification différenciante, Dieu étant pensé comme l’étant dont la différence d’avec les autres étants est d’être justement infini, la différence se jouant donc à l’intérieur de l’étantité, donc à l’intérieur d’une conceptualité commune obtenue par l’intellect. Là encore, il nous faut admettre cette lecture, stimulante s’il en est, et ne pouvant faire l’objet d’une discussion critique dans la présente recension22.
3°) Admettre la requalification des résultats de l’école heideggérienne sous le vocable du « paradoxe »
S’il s’agissait de répéter la question de Jean-Luc Marion quant à la place de Descartes au sein de l’onto-théo-logie et de recopier les analyses d’Olivier Boulnois concernant Duns Scot, l’ouvrage paraîtrait insensé ; afin de lui apporter une valeur ajoutée, l’auteur décide donc de qualifier le moment scotiste de la conceptualisation de Dieu comme ens infinitum selon la forme du paradoxe et l’on peut raisonnablement considérer que c’est là l’innovation principale du livre, gouvernant la préfiguration de la cinquième partie avec la convocation de Levinas. En voici la formulation centrale :
« Cette hypothèse [celle de conceptualiser Dieu comme ens infinitum], un paradoxe inouï la suggère : c’est sous le nom d’infini que Dieu est entré en métaphysique avec Duns Scot ; si surprenant qu’il paraisse, ens infinitum n’est pas le nom d’un Dieu outrepassant la métaphysique, c’est le nom du Dieu de la métaphysique. »23
Non seulement il nous faudrait admettre qu’il y aurait là un paradoxe, mais de surcroît nous devrions le percevoir comme « inouï », ce qui n’est pas une mince affaire. Mais où réside-t-il ce paradoxe, aussi « inouï » que discret ? En deux points. Le premier est circonstanciel et vise à dramatiser une discussion très locale, celle menée avec Jean-Luc Marion pour qui l’idée d’infini, rappelons-le, « ne relève pas de la constitution cartésienne de la métaphysique. »24 Ici s’accuse donc un micro-écart entre Dan Arbib et Jean-Luc Marion que l’auteur dramatise avec gourmandise pour lui conférer l’intérêt qu’il n’a sans doute pas. Le second, découlant du cadre très restreint de cette discussion, vise à établir que le logos aurait défini Dieu par un nom qui porte en lui-même l’excès à l’égard de ses propres capacités de représentation. En d’autres termes, il est constitutif de la métaphysique de nommer l’étant suprême dans le registre de l’excès à l’égard du logos bien que ce soit par le logos que se constitue la métaphysique. Dès lors, puisque le logos pilote la métaphysique, alors l’infini excède à son tour cette dernière qui accueille et perd du même geste Dieu comme infini, la sortie de la métaphysique étant contenue dans la détermination du nom métaphysique de Dieu. Pour le dire encore autrement, le « paradoxe » ici décrit serait que Dieu n’aurait pas pu avoir d’autre nom que celui de l’infini dans la métaphysique d’inspiration scotiste, mais qu’en recevant un tel nom il excède cela même par quoi il peut y avoir métaphysique, à savoir le Logos. Descartes porterait le paradoxe de ce moment séminal à son incandescence, dessinant deux déterminations porteuses d’une tension permanente.
D : Métaphysique heideggérienne et Métaphysique cartésienne
On admettra sans peine, une fois les présupposés établis, qu’apparaissent de multiples difficultés logiques que la simple confrontation entre les sens heideggérien et cartésien de la Métaphysique permet de constater – pour ne rien dire de la compatibilité entre les ententes heideggérienne et levinassienne de la Métaphysique. Si la Métaphysique cartésienne se laisse appréhender selon son objet comme l’étude de l’immatériel et selon sa dimension noétique comme la position des premiers principes de la connaissance, force est de constater que l’on se situe avec Descartes aux antipodes de l’approche heideggérano-marionienne retenue par Dan Arbib. Mais on pourrait rétorquer qu’il n’est pas illégitime de chercher à mettre à l’épreuve la logique heideggérienne au sein des textes cartésiens, le but étant alors de penser Descartes selon les canons dogmatiques de l’école heideggérienne, quitte à faire violence à Descartes ; soit, ce serait alors un livre sur les lectures heideggérianisantes davantage que sur Descartes mais l’entreprise serait recevable. En revanche, devient incompréhensible ce que Dan Arbib présente comme le relevé des occurrences du terme « métaphysique » dans les œuvres de Descartes puisque le sens cartésien de la Métaphysique ne constitue en aucun cas un fil directeur de l’ouvrage ; le relevé des occurrences apparaît même comme insensé compte-tenu des ambitions et de l’idéologie affichées.
L’invraisemblance de ce relevé se redouble lorsque l’on mesure à quel point il est incomplet et désarticulé. Négligeant totalement les nombreuses occurrences des Principes, il se concentre sur quelques occurrences de la correspondance, toujours moins certaine que les œuvres publiées, et ne convoque jamais ni les Principes ni la fameuse déclaration de 1637 dans la quatrième partie du Discours de la Méthode. Pourquoi procéder ainsi ? La raison nous semble stratégiquement assez claire : un relevé exhaustif des occurrences aurait immédiatement révélé que la Métaphysique en son sens cartésien désigne un type d’objet, l’immatériel, et secondairement une primauté épistémique. Or le sens premier est totalement inintégrable dans une réflexion heideggérienne, laquelle n’est pas en mesure de rendre compte de la question de l’immatérialité en tant que thème ; de ce fait, il devient impératif de faire violence aux textes cartésiens et de ne retenir que le sens second, celui des premiers principes de la connaissance en tant qu’ils peuvent être reliés à la sacro-sainte problématique de la représentation. De là cette formulation si rassurante de l’approche cartésienne de la Métaphysique : « La métaphysique se définira donc comme un tel retour en arrière, depuis les choses à connaître jusqu’aux éléments requis pour la connaissance. C’est pourquoi elle ira de propositions ou de notions conditionnées à des propositions ou notions qui en sont les conditions. »25
Comprenons bien la situation impossible dans laquelle s’est retrouvé l’auteur ; parce qu’il n’y a pas de coïncidence réelle entre le sens cartésien de la Métaphysique et celui thématisé par l’école heideggérienne, deux solutions et deux seulement s’offraient à lui : soit ne procéder à aucun relevé des occurrences cartésiennes du terme et assumer pleinement que seule importait la définition de son école heideggérienne, mais c’eût été prendre le risque de rendre absurde le fait de présenter l’ouvrage comme un commentaire de la pensée cartésienne, soit relever certaines occurrences mais éliminer toutes celles qui, en aucune manière, ne pouvaient être rattachées à la problématique de la connaissance et de la représentation. C’est le second choix qu’a retenu Arbib, dissimulant d’ailleurs le dilemme tragique où il était tombé par une opposition tout à fait factice entre les lettres de 1630 et la démarche de 1641 dont Arbib ne semble pas comprendre qu’avec onze ans d’écart, ce sont les enjeux qui ont changé et non les thèses fondamentales.
E : L’infini peut-il être un concept ? Erreur lexicale et contresens sémantique
L’opposition évoquée précédemment, de peu d’intérêt en-soi, se révèle riche d’enseignement pour une autre raison, à savoir qu’elle contient le germe des contresens qui feront de la lecture de l’ouvrage une entreprise souvent pénible. Nous devons citer à cet égard un long passage à nos yeux particulièrement significatif :
« Bref, alors que la métaphysique de 1630 a pour premier objet Dieu en vertu d’une supériorité ontique, la philosophia prima de 1641 a pour premier objet l’ego en vertu d’une primauté épistémique. Tout se passe comme si la philosophia prima devait remonter le sens de la création des vérités pour atteindre au fondement ontique de la rationalité (Dieu), rationalité à laquelle pourtant en tant que philosophia prima elle obéit toujours déjà : l’ego procède par ordre et n’exerce sa primauté épistémologique que pour tâcher de s’en défaire en accédant à sa propre fondation (ontique) par Dieu.
Cette tension, Descartes l’aurait-il entrevue ? Sans doute, et très tôt, puisque dès 1630 son discours en traduit l’embarras : (a) En tant que fondement ontique des vérités éternelles, Dieu devrait s’excepter de la rationalité et partant de la métaphysique elle-même : mais alors, si c’était le cas, comment la doctrine de la création des vérités éternelles pourrait-elle seulement être formulée et prise en vue ? Descartes suggère son embarras en une formulation étrange : « Pour votre question de Théologie, encore qu’elle passe la capacité de mon esprit, elle ne me semble pas toutefois hors de ma profession, pource qu’elle ne touche point à ce qui dépend de la révélation, ce que je nomme proprement Théologie ; mais elle est plutôt métaphysique et se doit examiner par la raison humaine. » »26
Il serait aisé de montrer que la prétendue « tension » ici « analysée » n’est jamais que l’expression d’un changement de problématique, Descartes n’ambitionnant aucunement de résoudre les mêmes problèmes dans les Méditations que dans les lettres de 1630, mais passons ; l’essentiel réside bien plutôt dans ce qu’Arbib appelle l’ « embarras » de Descartes face au statut de Dieu et au type de discours qui pourrait s’en emparer ; cet « embarras » manifesterait l’hésitation de Descartes quant à la possibilité de traiter rationnellement de Dieu, c’est-à-dire d’en traiter philosophiquement. Commençons par remarquer que la fin de la citation de la lettre n’est nullement embarrassée, Descartes affirmant que la question en jeu « se doit examiner par la raison humaine » ; nulle hésitation dans cette réponse ferme et résolue ; plus généralement, aucun embarras ne vient alourdir le propos cartésien : celui-ci pose simplement qu’un même objet peut être traité par la Théologie pour les aspects qui ne peuvent être abordés par la raison et en même temps par la Métaphysique lorsque la raison peut en dire quelque chose. Dieu est à cet égard l’exemple le plus caractéristique en ceci que la Théologie développe tout ce que la foi dans la révélation peut en dire tandis que la Métaphysique, sans aucune contradiction, se propose d’en démontrer l’existence et de le nommer par l’infini.
Or, le contresens ici commis par l’auteur à l’endroit de la lettre de Descartes nous paraît significatif en ceci qu’il exprime le contresens général sur lequel reposent de nombreuses lectures heideggérianisantes en général et sur lequel repose l’ouvrage en particulier : chez Descartes, la théologie ne désigne pas un domaine d’objets mais une manière spécifique de parler d’objets dont la Métaphysique peut fort bien parler également. En croyant que la théologie est un domaine précis et spécifique d’objets et non une manière de s’en emparer, les lectures heideggérianisantes commettent un contresens sur les textes cartésiens dont les répercussions sont immenses : elles amènent à voir un « embarras » lorsque Descartes distingue le discours sur Dieu du point de vue de la raison de celui du point de vue de la révélation là où il n’y a que clarté et distinction. Parce que la Théologie et la Métaphysique ne désignent pas des domaines d’objets mais des manières de penser les mêmes objets, il est nécessaire pour Descartes que la Métaphysique parle de Dieu selon la raison mais ne puisse en parler selon la révélation ; et inversement.
Par ailleurs, D. Arbib ne semble pas comprendre que le discours métaphysique cartésien ne prétend jamais épuiser ce dont il parle, c’est-à-dire que la raison ne prétend jamais rendre compte de l’essence de ce dont elle s’empare. Ainsi, lorsque la raison s’empare de Dieu, elle ne le perçoit que selon la perspective où elle peut le percevoir, tout comme la raison ne parvient à définir l’ego que comme res cogitans, tout en sachant pertinemment que l’essence de Dieu et de l’ego échappe infiniment à ce que la raison peut en dire. En d’autres termes, la raison sait que ce qu’elle dit de Dieu et de l’ego n’est jamais que le point de vue limité par lequel s’exprime la pensée humaine en son stade suprême, ce qui revient à dire que jamais Descartes ne considérerait que la représentation rationnelle soit en mesure d’épuiser l’Être, quoiqu’elle soit parfois capable de coïncider avec Lui, notamment lorsqu’elle parvient à démontrer l’existence absolue de l’ego et de Dieu. En somme, la Métaphysique ne prétend aucunement épuiser le sens de l’Être, elle prétend épuiser le sens du pensable, et cela change tout.
Mais ce n’est pas tout : à la suite de Jean-Luc Marion, Dan Arbib présente l’infini cartésien comme un concept ou comme le produit d’une « conceptualisation », et ce afin de satisfaire le critère heideggérien du primat conceptuel au sein de la métaphysique. Or, outre que cela revient à confondre représentation et concept, c’est une fois encore faire preuve d’une violence inouïe à l’encontre de la logique même du texte et de l’argument cartésiens, puisque l’infini, loin d’être un concept, est au contraire ce que Dieu a mis en moi comme une trace me permettant de le retrouver : l’idée de Dieu, rappelons-le, « avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie » (Méditations Métaphysiques III, AT IX, 36) ; du point de vue cartésien, donc, l’infini ne peut être un concept puisque ce n’est pas moi qui lui ai donné naissance, raison pour laquelle nous devrions dire que « nous avons une idée » davantage que nous ne la concevons. C’est inversement une idée dont je ne suis pas l’auteur, que je n’ai donc pas conçue, et on ne saurait imaginer plus grave contresens du point de vue cartésien que de présenter l’infini comme un concept. A cet égard, des déclarations comme celles voulant que le concept d’infini soit « maximalement un concept »27 sont littéralement dénuées de sens du point de vue cartésien, ce qui pourrait à la rigueur être admis du point de vue heideggérien à la condition de thématiser ce hiatus, c’est-à-dire d’expliquer en quoi ce que Descartes refuse explicitement de présenter comme conceptuel pourrait malgré tout être qualifié de « conceptuel » selon une autre optique. Mais l’absence totale de justification d’un tel vocabulaire rend le propos général insensé.
Ne pourrait-on pas objecter à notre propre objection que, dans la Troisième Méditation, Descartes évoque bel et bien une conceptualisation de l’Idée de Dieu ? Assurément non et ce pour plusieurs raisons.
1 / La première est qu’en latin, le terme de Concipio n’est jamais utilisé en lien avec la perception de l’infini, ce qui est d’autant plus marquant que le Ego sum, ego existo relevait, lui, de la conception [concipitur].
2 / Mais admettons par l’absurde qu’il faille ne pas tenir compte du texte latin et que seul fasse autorité le texte français, validé par Descartes ; celui-ci contient en effet quelques occurrences du terme « conception » là où le latin parle plus volontiers de perception ; or, des deux occurrences françaises de la conception, aucune ne renvoie justement à l’infini. Lisons plutôt : après avoir remarqué que l’idée d’un être infini et souverainement parfait était vraie et dénuée de fausseté, Descartes précise que « tout ce que mon esprit conçoit clairement et distinctement de réel et de vrai, et qui contient en soi quelque perfection est contenu et refermé tout entier dans cette idée. » (Ibid., AT IX, 36) La conception ne porte pas ici sur l’infini mais sur la réalité d’une telle idée ; autrement dit, je ne conçois pas l’idée d’infini, je « conçois » la réalité qu’elle contient ; ainsi n’est-ce pas moi qui donne naissance à cette idée, mais est-ce moi qui suis en mesure d’y percevoir son référent réel. La seconde occurrence confirme également notre lecture : « il est de la nature de l’infini, que ma nature, qui est finie et bornée, ne le puisse comprendre ; et il suffit que je conçoive bien cela [et sufficit me hoc ipsum intelligere] (…) afin que l’idée que j’en ai soit la plus vraie, la plus claire et la plus distincte de toutes celles qui sont en mon esprit. » (Ibid., AT IX, 37). Le latin dit ici fort pertinemment qu’il nous suffit d’intelliger que l’idée de Dieu contient toute positivité sans que nous ne puissions pour autant la comprendre, ce que le français rend par le fait que nous concevons l’idée de Dieu comme contenant toute positivité, bien que nous ne puissions en épuiser le contenu ; nous ne concevons donc pas l’idée d’infini comme telle, mais nous percevons dans cette idée – que nous n’avons pas conçue ! – toute la positivité divine, ce qui est fort différent.
Hautement significative est d’ailleurs la cécité d’Arbib à l’endroit du texte précis des fameuses lettres de 1630, pourtant si abondamment citées, mais si mal exploitées : au sujet de l’infinité divine, Descartes est déjà parfaitement précis dans le vocabulaire employé :
« Je dis que je le sais, et non pas que je le conçois ni que je le comprends ; car on peut savoir que Dieu est infini et tout-puissant, encore que notre âme étant finie ne le puisse comprendre ni concevoir. » (Lettre à Mersenne du 27 mai 1630)
A moins de faire de Descartes un bien piètre philosophe au vocabulaire flottant et indéfini, force est de constater que l’âme finie est incapable de concevoir l’infini, de telle sorte que ce dernier ne saurait être un concept auquel l’âme aurait donné naissance ; l’erreur logique consistant à faire de l’infini un concept désigne celle menant à croire que l’âme serait capable de donner naissance à ce que, par nature, elle ne peut contenir, relation logiquement impossible que Descartes comprit dès 1630 et que n’auront cesse de confirmer les textes ultérieurs. Ce résultat, avait d’ailleurs déjà été repéré par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer : « Bien que l’utilisation cartésienne de conci-pere ne fasse pas preuve d’une grande rigueur, on peut assurer que, pas davantage que comprehendere, concipere n’est accepté pour l’infini. »28
Concluons : au sens propre, l’idée d’infini n’est pas un concept et nous ne la concevons d’ailleurs pas ; non seulement l’idée d’infini est, comme le dit Descartes à de nombreuses reprises, « en moi » par l’action de Dieu et non par ma propre puissance de conception, mais en plus il serait totalement contradictoire que je puisse concevoir une idée que je ne comprenne pas. C’est la raison pour laquelle Descartes n’emploie jamais le verbe concipio lorsqu’il est question de l’infini, et c’est également la raison pour laquelle, dans la traduction française des Méditations, les rares occurrences ne renvoient jamais à une conception directe de l’idée d’infini mais à une certaine perception des renvois d’une telle idée : réalité dans un premier temps, positivité dans un second. On ne saurait donc imaginer plus grand contresens sur l’idée cartésienne d’infini que d’y voir un concept, et la distinction que tente – ou plutôt qu’il reprend à Jeangène Vilmer29 sans jamais le mentionner à ce sujet – Arbib entre intelligible et compréhensible n’y change rien : toute la logique du texte, des Méditations et du cartésianisme contredit la dimension conceptuelle de l’idée d’infini.
F : L’introuvable « infinité de distance »
1°) Examen de la distinction entre « infinité de distance » et « infinité de puissance
Les parties précédentes ont eu pour ambition de montrer quelles erreurs méthodologiques mais aussi quelles erreurs conceptuelles parsemaient l’ouvrage ; la comparaison de textes aux enjeux différents, mais aussi la conceptualisation abusive de l’infini, génèrent des contresens en cascade, dont le moindre n’est pas la prétendue distinction entre « infinité de distance » et « infinité de substance ». Dans cette supposée opposition, qui sent bon la recherche de la formule destinée à faire mouche, se condensent les nombreuses impasses de l’ouvrage.
L’auteur souhaite en effet montrer que la manière dont Descartes pense Dieu en 1630 serait marquée par une « infinité de distance » entre lui et moi, tandis que le texte de 1641 introduirait une « infinité de substance », la distinction rejouant une double source médiévale.
« Retard de l’infinité divine, éclatement cartésien entre infinité de distance et infinité de substance : nos deux paradoxes initiaux s’éclairent à présent de leur situation historique : ils répètent en fait deux paradoxes constitutifs de l’émergence de l’infinité divine au XIIIè siècle, à savoir son apparition tardive et son insertion dans deux types de démonstrations distinctes – démonstrations ad extra et ad intra. »30
Au-delà de la supposée source historique indiquée par l’auteur, cette distinction est reliée à la question de l’incompréhensibilité divine : en 1630, l’incompréhensibilité est présente mais elle disparaît en 1641 :
« Fondamentale en 1630, l’incompréhensibilité ne joue donc plus aucun rôle en 1641 ; en 1630, l’incompréhensibilité dominait l’infini, alors qu’en 1641 l’infini domine l’incompréhensibilité ; en 1630, la doctrine de la création des vérités exige la seule incompréhensibilité, alors que la philosophia prima exige l’intelligibilité. »31
Une fois encore, il s’avère nécessaire de se demander si toutes ces formules ont un sens au-delà de l’intention d’établir des oppositions binaires destinées à être reprises par les pairs de l’auteur. Trois critères peuvent alors être retenus, à savoir les critères logiques, textuels mais aussi ceux inhérents à la logique interne du cartésianisme.
Logiquement parlant, cela-a-t-il un sens d’opposer infinité de distance à infinité de substance ? Autrement demandé, serait-il possible qu’il y eût une infinité de distance qui ne fût pas une infinité de substance ? On ne se demande pas ici s’il est bien question d’une « infinité de distance » en 1630 mais si, en admettant qu’elle soit bien présente, il serait cohérent de l’opposer à l’infinité de substance. Supposons donc qu’il soit pertinent de spatialiser lexicalement le rapport à Dieu, et qu’il y ait une infinité de distance entre lui et moi ; de quoi serais-je alors distant ? Assurément de Dieu. Pour quelle raison serait-il infiniment distant de moi ? La seule raison justifiant la supposée infinité de distance serait précisément que Dieu soit infini, au sens où il serait une substance infinie ; autrement dit, seule l’infinité de substance rendrait logiquement pensable la supposée infinité de distance de 1630, de sorte que l’opposition entre les deux se révèle aussitôt factice : dire qu’il y aurait une évolution cartésienne sur ce sujet est logiquement absurde, l’infinité de distance présupposant logiquement l’infinité de la substance divine et interdisant de parler d’une « bipolarité constitutive » de la métaphysique cartésienne ainsi que l’affirme la conclusion de l’ouvrage.
L’inanité de l’opposition proposée se retrouve textuellement ; à l’exception de la lettre du 15 avril 1630, il est totalement faux, textuellement parlant, de considérer que l’incompréhensibilité « domine » l’infini. Ainsi Descartes reproche-t-il à la plupart des hommes dans la lettre du 6 mai 1630 de ne pas penser Dieu « comme un être infini et incompréhensible », l’infinité venant avant l’incompréhensibilité, l’incompréhensibilité résultant d’ailleurs de l’infinité de la puissance divine et non l’inverse. En effet, toujours dans la lettre du 6 mai 1630, c’est la puissance infinie de Dieu qui fait que ce dernier ne peut être compris par un entendement humain borné, l’infinité fondant l’incompréhensibilité.
Néanmoins, Dan Arbib et, avec lui, tout le commentarisme heideggérien, est condamné à demeurer aveugle à la question de la puissance divine qui est un élément néoplatonicien, dont la résonance plotinienne mais aussi ficinienne, a été maintes fois établie, mais que la doxa heideggérienne, ancrée dans la seule source scolastique, refuse catégoriquement de prendre en compte.
Abordons désormais le troisième critère, celui de la logique interne du cartésianisme. De ce point de vue, la notion levinassienne de « distance », évidemment médiatisée par sa reprise marionienne dans L’idole et la distance, ne semble aucunement pertinente pour penser les textes cartésiens de 1630 et ce pour deux raisons :
1) Bien qu’il soit vrai que soit établie une opposition cruciale entre le Dieu créateur et l’ensemble des créatures, toutes les lettres visent justement à atténuer cette opposition par la proximité ou, plus exactement, par la présence de Dieu en l’une de ses créatures privilégiées, à savoir l’homme. Que dit en effet Descartes des vérités divines ? Qu’il « n’y en a aucune en particulier que nous ne puissions comprendre, si notre esprit se porte à la considérer, et elles sont toutes mentibus nostris ingenitae, ainsi qu’un roi imprimerait ses lois dans le cœur de tous les sujets, s’il en avait aussi bien le pouvoir. » (Lettre du 15 avril 1630). Si Dieu est pur créateur des vérités éternelles, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont présentes à l’esprit, et que par transitivité Dieu lui-même accuse sa présence auprès de l’entendement. On pourrait objecter à cela que Descartes ajoute ceci : « Au contraire, nous ne pouvons comprendre la grandeur de Dieu, encore que nous la connaissions ». Il est donc vrai que la grandeur de Dieu outrepasse notre entendement, mais cette grandeur, quoique non conçue, n’en est pas moins connue. Il en découle que Descartes ménage une place aux connaissances non conceptuelles, c’est-à-dire envisage que la puissance infinie soit connue sans être conçue, c’est-à-dire aperçue sans que l’esprit ne puisse en être l’origine. Il va de soi que le contresens commis par Dan Arbib sur la nature conceptuelle de l’infini lui interdit de saisir le sens réel de cette nuance entre connaissance de la puissance infinie et conceptualisation de cette dernière.
2) L’autre raison tient à la célèbre affirmation du 15 avril 1630 selon laquelle « on peut démontrer les vérités métaphysiques, d’une façon qui est plus évidente que les démonstrations de géométrie ». Cela signifie que la puissance infinie de Dieu peut être connue, c’est-à-dire rendue présente, avec plus de force – plus d’ « évidence » ! – que n’importe quelle vérité mathématique : elle ne sera certes pas conçue, mais elle sera connue, parfaitement connue, c’est-à-dire parfaitement présente comme le signifie le mot « évidence » auprès de la mens, ce que dissimule totalement l’insistance hors de propos de Dan Arbib sur l’idée de « distance » qui ne s’interroge pas suffisamment sur la contradiction qui résulte de son propos entre la priorité épistémique à laquelle il réduit la Métaphysique chez Descartes et la supposée distance dont serait porteuse cette connaissance.
Concluons sur ce point structurant de l’ouvrage de Dan Arbib. Logiquement parlant, la prétendue « bipolarité constitutive de la métaphysique cartésienne » est inepte puisque l’infinité de distance n’aurait de sens qu’à partir de l’infinité de substance supposée n’apparaître qu’en 1641. En outre, l’examen des lettres de 1630 révèle que Descartes ne cherche pas tant à fonder une infinité de distance autonome qu’à établir un équilibre très subtil entre, d’une part, ce qui échappe à l’esprit humain du double fait de l’infinie puissance divine et des bornes de l’entendement humain et, d’autre part, ce qu’il peut connaître, à défaut de le concevoir. De ce fait, la puissance divine infinie est déjà connue en 1630, Dieu est déjà nommé selon l’infini, et c’est l’infini qui rend compte de l’incompréhensibilité, laquelle n’écrase aucunement ce dernier.
2°) Puissance infinie et Causa sui
Il serait injuste de dire que Dan Arbib n’évoque jamais la puissance infinie divine ; toutefois, il la complique d’une étrange réflexion sur la question de l’indépendance qui obscurcit le texte cartésien et semble le surcharger inutilement. L’infinité, affirme l’auteur, serait ainsi fondée sur l’indépendance dans le Discours de la Méthode, ainsi que le prouverait la déficience de l’ego ; en effet, parce que ce dernier n’est pas indépendant, il ne peut être infini ni parfait, de sorte qu’il faudrait en déduire que s’il était indépendant, alors il serait infini ; par induction, Arbib conclut qu’en 1637 c’est l’indépendance qui fonde l’infinité.
Une fois encore, ce raisonnement apparaît pour le moins déroutant et ce pour au moins trois raisons :
1) Rien ne garantit que le raisonnement qui vaut pour moi, et qui consiste à dire que si j’étais indépendant, je m’attribuerais toutes les perfections, peut être étendu sans autre forme de procès à la logique générale régissant le rapport entre indépendance et infinité.
2) Le maître mot du Discours est celui de perfection et c’est elle qui fonde l’infini, pas l’indépendance. Si « je participais de l’être parfait, j’eusse pu avoir de moi, par même raison, tout le surplus que je connaissais me manquer, et ainsi être moi-même infini, éternel, immuable, tout connaissant, tout connaissant, tout puissant, et enfin avoir toutes les perfections que je pouvais remarquer être en Dieu. » (Discours de la Méthode, IV ; AT VI, 35) C’est bien du fait de tenir de l’être parfait que se déduirait la possibilité d’être de soi infini et non de l’indépendance. Ou, plus exactement, l’indépendance est elle-même une conséquence de la perfection et ne possède aucun titre de priorité ni d’éminence au regard de l’infini auquel elle servirait de fondement. Ce n’est pas l’indépendance qui fonde l’infinité mais la perfection qui fonde l’indépendance autant que l’infini. En effet, il est parfaitement possible de concevoir un être indépendant qui, faute de perfection, ne se donnerait pas l’infini ; c’est inversement parce que l’être est parfait qu’il peut être indépendant, l’indépendance n’ayant aucun privilège au regard des autres attributs.
3) La faille centrale de l’argument d’Arbib peut désormais être comprise. Le raisonnement par l’absurde que mène Descartes ne consiste aucunement à montrer que si j’étais indépendant, je me donnerais l’infinité, car il serait absurde de croire qu’un être indépendant, au seul motif de l’indépendance, en serait capable. Les choses sont bien plus subtiles que cela et se présentent ainsi :
1 / Je dispose de quelque perfection
2 / Je me pense néanmoins imparfait au regard de l’idée de parfait dont je dispose.
3 / Supposons que je sois indépendant, alors cela signifierait que je me serais donné moi-même l’idée de perfection mais aussi une réalité imparfaite, situation absurde car si j’avais pu concevoir l’idée de perfection alors je me serais donné les attributs qui l’accompagnent.
4 / Par conséquent, la seule chose que l’on peut en tirer de manière rigoureuse n’est aucunement que l’indépendance fonde l’infinité – cette induction se révèle absurde – mais que la conscience de mes imperfections signifie l’existence réelle d’un être parfait ayant mis en moi son idée à partir de laquelle je me sais imparfait. L’argument par l’absurde de l’indépendance de l’ego n’autorise aucunement à en induire de manière générale que l’indépendance fonde l’infinité ; il permet simplement de montrer qu’il serait absurde qu’un être imparfait et indépendant puisse avoir conscience de son imperfection à partir de l’idée de perfection.
Bref, faute de comprendre le rôle crucial de l’idée de perfection dans l’économie argumentative, Arbib torpille le sens du propos cartésien et croit établir un lien qui n’existe pas, à savoir la fondation de l’infinité sur l’indépendance.
De ce lien qui n’existe pas, Arbib affirme qu’il s’inverse en 1641, l’infinité fondant alors l’indépendance divine. Là, notamment dans la page 153 de l’ouvrage, vont se jouer une série de propos pour le moins stupéfiants : imposant à un Descartes qui se débat autour de la causa sui une préoccupation qui lui est tout à fait étrangère – déterminer si c’est la puissance qui fonde l’infini ou l’infini qui fonde la puissance –, Arbib va de surcroît être obligé de convoquer un texte pour lui faire dire tout à fait autre chose que le sens affiché ; opposant la puissance infinie de Dieu, dénuée de toute négativité, à l’imperfection de l’esprit humain, pétri de négativité et incapable de saisir positivement une telle puissance, Descartes en vient en effet à écrire que « cette puissance inépuisable, ou cette immensité d’essence, est très positive » (AT IX, 182-183), semblant poser une équivalence entre l’essence infinie divine et sa puissance infinie, que l’esprit humain ne peut évidemment pas concevoir ni se représenter avec clarté. Mais le commentaire de Dan Arbib, faisant totalement abstraction du contexte général qui ne cesse de rappeler l’incapacité de l’esprit humain à dire la pleine positivité, introduit quelque chose de sidérant :
« la puissance infinie présuppose elle-même l’infinité divine, puisque la puissance infinie s’identifie exactement à l’essence infinie de Dieu. »32
Si Arbib avait raison, alors l’essence divine ne serait pas première, mais seconde ; elle serait précédée de l’infinité qui serait comme méta-essentielle, fondant l’essence divine de manière dérivée. Non seulement cela est plus que surprenant mais de surcroît l’argument, lapidaire, est incompréhensible : pour quelle raison l’identification de la puissance infinie à l’essence infinie amènerait-elle à penser que l’infini précéderait l’essence ? On ne comprend pas comment, si la puissance infinie s’identifie à l’essence divine, il est possible d’affirmer que « c’est de l’infinité que dépend la puissance inépuisable de Dieu »33 puisqu’en vertu de cette identification revendiquée cela revient à fonder l’essence divine sur quelque chose qui lui serait antérieur.
De manière générale, les propos de l’auteur sur la Causa sui sont systématiquement indifférents aux textes cartésiens ; ainsi, alors que Descartes ne cesse dans les Réponses aux Quatrièmes Objections de rappeler que si Dieu est cause de lui-même, cela ne peut être selon une signification qui « fût entièrement la même » que celle de la cause efficiente, ou encore d’établir dans les Réponses aux Premières Objections qu’il n’entend « pas parler d’une conservation qui se fasse par aucune influence réelle et positive de la cause efficiente, mais qu’[il] entend seulement que l’essence de Dieu est telle, qu’il est impossible qu’il soit ou n’existe pas toujours » (R1O, AT IX, 87), Arbib n’en tient aucunement compte et ose écrire : « Soumettant Dieu à la requête de cause efficiente, elle l’intègre au régime commun des étants quels qu’ils soient. »34
Nous sommes donc ici face à un livre très difficile à recenser car tout se passe comme si les textes commentés n’avaient aucune importance ; Descartes peut à chaque fois expliquer, avec force conviction, que si Dieu est cause de soi, cela ne peut être entendu au sens d’une causalité efficiente, l’auteur n’en a cure : il affirme y lire une causalité efficiente car le dogme de l’univocité, issu de l’école heideggérienne, doit avoir raison contre les faits textuels et la même conclusion doit inlassablement être obtenue, quelle que soit la réalité du corpus cartésien : « La causa sui répond ainsi (de manière univociste) à une exigence (univociste) d’une cause (elle-même univoque) pour toute existence. Soumettant Dieu à la requête de cause efficiente, elle l’intègre au régime commun des étants quels qu’ils soient. »35
Toutefois, après avoir défendu contre le fait textuel la dimension efficiente de la causa sui dans les Réponses aux Premières Objections, Arbib va juger différente la nature des Réponses aux Quatrièmes Objections et y lire l’introduction d’une analogie de proportionalité, soustrayant Dieu à l’univocité métaphysique afin de ménager un terrain d’atterrissage pour Levinas. Nous y reviendrons sous peu.
G : L’incompréhensibilité en 1641
Allons plus loin et revenons en 1630 : la véritable tension des lettres de cette même année est interne et non rétrospectivement conquise par comparaison avec 1641. Elle réside dans l’hésitation cartésienne entre deux types de discours, à savoir un premier inscrit dans la continuité des Regulae et qui se demanderait ce que l’esprit peut dire de Dieu ; à cet égard, l’incompréhensibilité en relèverait pleinement puisque l’incompréhensibilité ne peut être un attribut absolu de Dieu ; elle n’est par définition que la manière par laquelle l’esprit se représente la réalité divine. Cela n’a évidemment aucun sens de dire de Dieu qu’il serait en-soi incompréhensible ; il ne l’est que relativement à un entendement borné. Mais à côté de cette réflexion sur ce que l’entendement peut dire de Dieu semble apparaître une réflexion sur Dieu lui-même, comme créateur des vérités éternelles, affirmation qui ne semble plus relative à la mens ou, plus exactement, qui est accessible à la mens mais qui n’en dépend pourtant pas. Il n’est plus ici question de ce que l’entendement peut connaître mais de l’action absolue et réelle de Dieu, raison pour laquelle Alquié en fait le fondement véritable de la métaphysique de Descartes. On n’est pas seulement dans une noétique mais bel et bien dans l’affirmation positive de la puissance divine, de ce que nous avons appelé l’ens ut potentia, et par ce biais Descartes produit peut-être son premier discours sur l’absolu, sur ce qu’Alquié appelait l’Être.
La vraie question est alors de se demander si ce balancement, ce va-et-vient entre un discours sur l’absolu comme tel et le rappel permanent du fait que c’est l’esprit qui pense Dieu, demeure en 1641. Autrement demandé, y a-t-il en 1641 encore trace du rappel de l’incompréhensibilité de Dieu, c’est-à-dire trace du rappel du fait que si l’esprit peut connaître absolument l’existence de Dieu mais aussi sa dimension créatrice, il ne peut néanmoins concevoir ni comprendre la puissance infinie de Dieu ? Toute l’entreprise de Dan Arbib se révèle factice au regard de cette question : les Méditations seconde et troisième envisagent de démontrer quelque chose qui soit absolument vrai, qui atteigne l’Être ; de ce fait, il est absolument évident qu’il serait absurde de mentionner l’incompréhensibilité dans la preuve de l’existence de Dieu puisque cette preuve atteint une existence absolue, non relative à la manière dont la mens pense Dieu, bien que ce soit par la mens que l’existence divine soit connue sans que cette médiation ne soit une dépendance. Autrement dit, consacrer un chapitre entier à remarquer que l’incompréhensibilité « ne joue aucun rôle positif dans la preuve a posteriori cartésienne »36 est une perte de temps : cette absence est impliquée par la logique même du propos : l’incompréhensibilité étant une manière humaine de penser Dieu, elle ne peut être convoquée au moment d’établir l’existence absolue de Dieu, car ce serait conditionner celle-ci au point de vue humain.
Toutefois, si Arbib consacre autant de place et d’énergie à établir un truisme, c’est que le résultat importe moins que l’argumentation qui se révèle fautive ; autrement dit, il établit un constat juste à partir d’un argument faux. Ne comprenant pas que la démonstration de l’existence de Dieu est une rencontre avec l’absolu interdisant la relativisation de celle-ci selon une manière humaine de penser, il croit que se joue un énième « paradoxe » auquel Descartes voudrait échapper :
« Et pourtant, il se pourrait que Descartes ne confère pas à l’incompréhensibilité de rôle aussi déterminant que le commentaire lui a très souvent attribué. Pour une raison fort simple au demeurant : comment les Meditationes, qui entendent suivre l’ordo rationum, c’est-à-dire, si l’on osait la formule, l’ordo cogitarum, pourraient-elles intégrer l’incompréhensible sans le nier comme incompréhensible ou compromettre la cogitatio ? L’incompréhensibilité peut-elle se donner dans une cogitatio ? »37
La multiplication des locutions latines ne doit pas ici faire illusion : l’infini et la puissance infinie divine ne sont pas des concepts mais sont des connaissances ; confondant connaissance, représentation et conceptualisation, Arbib finit par croire qu’il serait contradictoire que la cogitatio pût accueillir l’incompréhensibilité, témoignant ainsi qu’il ne comprend ni la logique cartésienne de la distinction entre connaissance et conceptualisation, ni la pensée cartésienne qui s’interdit au moment de découvrir l’absolu de formuler ce dernier en des termes relatifs à la pensée humaine…
Une ultime preuve réside dans la Quatrième Méditation qui réactive l’incompréhensibilité, puisqu’elle fait retour au mode de fonctionnement de la mens dans la détermination du vrai et du faux, abandonnant le point de vue de l’absolu qu’avaient caressé les Méditations seconde et troisième, pour réactiver le point de vue de l’intelligence :
« Considérant cela avec plus d’attention, il me vient d’abord en la pensée que je ne me dois point étonner, si mon intelligence n’est pas capable de comprendre pourquoi Dieu fait ce qu’il fait, et qu’ainsi je n’ai aucune raison de douter de son existence, de ce que peut-être je vois par expérience beaucoup d’autres choses, sans pouvoir comprendre pour quelle raison ni comment Dieu les a produites. Car, sachant déjà que ma nature est extrêmement faible et limitée, et au contraire que celle de Dieu est immense, incompréhensible et infinie [immensam, incomprehensibilem, infinitam], je n’ai plus de peine à reconnaître qu’il y a une infinité de choses en sa puissance, desquelles les causes surpassent la portée de mon esprit. » (Méditations Métaphysiques IV, AT IX, 44).
Se tournant vers son entendement borné, Descartes rappelle que cette puissance divine infinie ne saurait être conçue par celui-ci, l’incompréhensibilité étant donc explicitement corrélée au point de vue humain sur Dieu, à la manière dont l’esprit fini et borné se représente la nature divine, là où l’existence de Dieu établie dans la 3ème Méditation se révèle comme une réalité absolue ne nécessitant plus le prisme du point de vue humain.
H : Sortir de la Métaphysique avec Levinas
Si nous avons jusqu’à présent considérablement insisté sur la dimension heideggérienne de l’ouvrage, encore faut-il ménager une place à son inspiration levinassienne, sensible dès le vocable de l’infinité de distance, mais surtout évidente avec la lecture des Réponses aux Quatrièmes Objections autour de la causa sui.
Prisonnier de cette position de symptôme d’un rapport à la Métaphysique, Descartes est comme destitué une seconde fois de son rôle de philosophe singulier ; s’il était d’abord symptôme de l’onto-théo-logie, le voici ramené à la question de l’excès et de la sortie de la Métaphysique et au renversement de cette dernière. Quant à l’infini, il serait la double détermination par laquelle Dieu entrerait « en » métaphysique (moment associé à Duns Scot dans le récit heideggérien) mais aussi par laquelle il en sortirait (moment levinassien). C’est ce que l’auteur résume en ces termes :
« l’idée d’infini est à la fois idée du fondement qui outrepasse la rationalité, et l’idée qui s’intègre à la rationalité pour conquérir ce fondement. Surgit ainsi, au cœur de l’infinité divine, une tension d’autant plus puissante et insoutenable que Descartes l’a étrangement tue ; sa métaphysique tout entière en acquiert une sorte de dualité interne dont elle paraît inconsciente et à laquelle, comme interprète, nous n’avons pas voulu rester aveugle. Descartes a ainsi associé en un même nom une détermination métaphysique et une détermination non métaphysique de Dieu. »38
L’idée, séduisante, s’avère pourtant décevante car bancale. Tout cela n’aurait tenu, en effet, que si les fameux « paradoxes » relevés initialement étaient fondés et pertinents ; or, ainsi que nous l’avons montré, l’auteur crée de toutes pièces de faux problèmes qu’il baptise « paradoxes » et qui n’existent qu’à partir de la mutilation et de l’abstraction qu’il fait subir aux textes de Descartes. Pis encore, ce sont essentiellement des erreurs de grammaire philosophiques, nées de la juxtaposition de textes appartenant à des périodes et à des enjeux différenciés chez Descartes, qui font naître les prétendus paradoxes et qui donnent bien souvent l’impression que l’auteur cherche à résoudre ses propres erreurs de méthode desquelles naissent les difficultés qu’il se propose d’examiner, et que la double détermination de l’infini serait censée expliquer. Dès lors, viciée en son principe, la convocation de Levinas destinée à résoudre les pseudo-paradoxes se révèle décevante et vaine, en dépit de développements intéressants sur la volonté ou l’ego.
Conclusion
Nous avions commencé cette recension en nous demandant ce qu’était une mauvaise monographie. Il serait injuste de prétendre que tout est faux ou mauvais dans cet ouvrage ; certains passages sont inspirés, notamment ceux consacrés à la volonté chez Descartes, où les arguments de Denis Kambouchner nous paraissent intelligemment utilisés[cf. Denis Kambouchner, Descartes n’a pas dit. Un répertoire des fausses idées sur l’auteur du Discours de la méthode, Paris, les Belles Lettres, 2015. On peut consulter [l’entretien avec Denis Kambouchner sur le site Actu-Philosophia.[/efn_note] ; de même, la réinterprétation de la preuve de l’existence de Dieu par Anselme comme découvrant l’indéfini est extrêmement convaincante.
Néanmoins, l’ensemble du propos fait subir de telles violences à la pensée cartésienne qu’il en devient rapidement révoltant. Le premier critère de la mauvaise monographie était celui du manque de fidélité à l’œuvre commentée. Il est malheureusement abondamment rempli, tant du point de vue méthodologique que du point de vue de l’interprétation. Méthodologiquement, l’auteur procède par une espèce de sautillement permanent entre des textes distincts de plusieurs années aux enjeux différenciés, et picore çà et là des mots comme si le cartésianisme se résumait à un lexique. Dan Arbib fait abstraction des raisonnements et des arguments cartésiens, et lorsqu’il y consacre quelques lignes, c’est pour les isoler de leurs enjeux locaux, et leur faire dire ce qu’ils ne disent pas : la manière dont la preuve de l’existence de Dieu de 1637 est utilisée pour « justifier » une prétendue fondation de l’infinité sur l’indépendance divine est à cet égard exemplaire. Tout se passe au fond comme si, à ses yeux, le refus de prendre l’argumentation linéaire de Descartes pour y prélever au gré des rencontres un ou deux mots en latin constituait le nec plus ultra de l’analyse en histoire de la philosophie.
Le second critère était l’utilisation d’une langue verbeuse et obscure destinée à masquer la paraphrase ; ce critère est lui aussi satisfait à de très nombreuses reprises. De manière exemplaire, nous pouvons penser au commentaire de la lettre du 15 avril 1630 qui, lorsqu’il ne déforme pas le sens de cette dernière, se contente de le reformuler sans y apporter le moindre gain : « Métaphysique est donc la question de la fondation par création divine des vérités mathématiques. La métaphysique se donne donc comme un savoir qui énonce le fondement de toutes les autres sciences – et d’abord de la rationalité elle-même, puisque parmi les créatures se comptent tant les vérités mathématiques que le principe de causalité ou de contradiction. »39 Quant à la raison pour laquelle les vérités métaphysiques se démontrent plus aisément que les vérités de géométrie, l’auteur refuse d’y apporter une explication, laissant au fond la lettre tant de fois convoquée dans une certaine obscurité.
Nous avions également posé la prévisibilité du résultat, dicté par la dimension idéologique de l’étude ; ici, la matrice heideggérienne du texte brise toute surprise, tout étonnement, toute nouveauté également. La racine picrocholine de l’ouvrage – une discussion avec Marion sur la base de présupposés heideggériens quant à l’onto-théo-logie – condamne celui-ci à ne produire que du convenu : surdétermination de l’univocité, de la question de la nature d’un discours, de la question de la nature de la métaphysique, mais aussi surdétermination de la notion même de paradoxe, avec surimposition finale d’une problématique levinassienne elle aussi prévisible, aussi bien à travers les notions de distance que de « sortie de la métaphysique ». Même dans le style adopté, tout s’y laisse deviner, du vocabulaire choisi surspatialisé – « trouer », « dépasser », « distance », « creuser », « latéralité », « centre », « rapatrier » – à l’usage inflationniste d’adverbes simulant la rigueur – « précisément », « exactement » – en passant par la syntaxe si marionienne faite de « X ne fait Y qu’à la condition de Z », le tout toujours articulé autour de prétendus paradoxes. Cela est si récurrent que l’on a parfois l’impression de lire le texte qu’un ordinateur, configuré avec une liste très restreinte d’adverbes et de tournures, aurait produit. Exemplifions :
« si paradoxale que paraisse cette hypothèse, l’idée d’infini creuserait la philosophia prima de l’intérieur, la trouerait tout en la validant à plein, en la compliquant, non dans ses latéralités, mais en son centre : ce serait en validant les déterminations historiques de la métaphysique, déterminations confirmées et fondées par Descartes, que l’infinité lui échapperait et la démembrerait. »40
Ou encore :
« Descartes n’intègre donc l’infini à sa métaphysique qu’à la condition d’inverser exactement le dispositif de la théologie mystique : la confusion laisse place à la clarté, la secondarité à la primauté, l’incompréhensibilité à l’intelligibilité. »41
Enfin, tous les faux problèmes relevés, déduits de l’idéologie adoptée – heideggérianisme pour la majeure partie de l’ouvrage, pensée de la sortie de la métaphysique avec Levinas de manière moindre – adressent de mauvaises questions aux textes cartésiens, et finissent par faire de ceux-ci un simple prétexte destiné à valider l’idéologie bien davantage qu’à éclairer la pensée de Descartes. Ni la Métaphysique ni même l’infini ne sont des problèmes cartésiens au sens propre, et ils ne sont pas même des thèmes. Les paradoxes que croit relever l’auteur ne sont que des manières de picorer quelques mots épars, abstraits de leur contexte, paradoxes construits à partir des lunettes idéologiques retenues : convoquer le commentarisme heideggérianisant et Levinas, c’est dès le départ choisir les résultats. Une lecture heideggérianisante conduira nécessairement à imposer l’onto-théo-logie et l’univocité, tandis que Levinas imposera lui aussi nécessairement la recherche d’un excès et donc d’une prétendue sortie hors de la supposée Métaphysique. La combinaison des deux fera croire à un paradoxe au sein des textes cartésiens, là où il n’y a que la contradiction d’avoir choisi deux grilles de lecture incompatibles, quoique toutes deux chères au cœur de l’auteur.
Peut-être la conjugaison des quatre critères se cristallise-t-elle dans l’analyse que mène l’auteur de la notion de substance chez Descartes. A travers le problème si compliqué du sens des substances dans les Principes, Descartes explique en effet que seule la substance divine est substance au sens propre, sans pour autant renoncer à l’usage du terme pour les créatures ; Arbib, en bon heideggérien convaincu que Descartes est resté dans l’univocité initiée par Duns Scot par laquelle se définirait la Métaphysique, se demande alors pourquoi Descartes n’a pas davantage promu l’équivocité ; et sa réponse est édifiante :
« parce que l’affirmation d’une radicale équivocité eût suspendu le projet métaphysique lui-même : d’une substantialité divine strictement équivoque à la substantialité du fini, on ne pourrait ni ne devrait rien dire. »42
Cette interprétation remplit tous les critères susmentionnés : d’abord, elle trahit l’intention cartésienne en refusant de prendre en compte la distinction explicite entre discours sur l’Être et discours relatif à l’imperfection de l’esprit, pourtant convoquée de manière explicative par Descartes pour rendre compte de la distinction proposée. Ensuite, en surimposant un vocabulaire que Descartes n’utilise qu’avec grande parcimonie, à savoir celui de l’univocité et de l’équivocité, l’auteur surcharge le commentaire de manière verbeuse et fait perdre de vue l’essentiel du sens du texte. En outre, le résultat de l’interprétation est ici totalement prévisible puisque dicté par l’idéologie heideggérienne qui le sous-tend : il faut trouver de l’univocité puisque le discours cartésien serait métaphysique en son sens heideggérien, de sorte que la préservation de la nature métaphysique du discours devient presque la finalité cachée des écrits cartésiens. Pure pétition de principe, cela n’a pas à être prouvé, mais à être admis et pris comme tel, un peu comme l’analyse heideggérienne de la causa sui dont l’auteur nous dit qu’elle est incontestable et qu’il « n’y a pas lieu d’y revenir ». Enfin, nous sommes typiquement dans un faux problème dicté par l’idéologie – univocité vs. équivocité – imposant une problématique scolastique à une réflexion sur les limites de l’esprit humain. Arbib ne comprend pas la spécificité du propos cartésien sur la substance : absolument parlant, la substance ne convient qu’à Dieu ; mais dans l’ordre de la pensée, nous devons instaurer des distinctions au cœur du créé, entre ce qui n’est soutenu que par Dieu et ce qui n’en est qu’un attribut. De ce fait, le problème cartésien n’est pas de statuer sur le problème scolastique de l’univocité mais bel et bien de revenir une fois encore à la distinction entre un discours qui saisit l’absolu et un discours qui se rappelle qu’il ne peut être qu’un discours, c’est-à-dire un point de vue. Absolument parlant, seul Dieu est substance, mais relativement à ce que nous pouvons et devons concevoir, nous devons utiliser la notion de substance pour penser des distinctions au sein du monde créé.
A notre tour, donc, de raisonner selon l’idée de symptôme : cette monographie en est un, et un double : symptôme général d’un certain nihilisme, ricanant devant l’exigence de probité et de vérité – il serait d’ailleurs bon de chercher à déterminer pourquoi un penseur comme Heidegger, si fin analyste du nihilisme, donne lieu à tant de lectures inconsciemment nihilistes de l’histoire de la philosophie –, mais aussi symptôme d’une certaine vanité, celle consistant à croire que l’on commente les grandes œuvres depuis une position de surplomb embrassant l’entièreté de l’histoire de la Métaphysique – rien que cela –, l’historien ne se mettant pas au service des œuvres mais révélant le sens caché, le fil secret qui en tisse la trame, comprenant au fond les forces presque inéluctables structurant les écrits philosophiques auxquelles les auteurs seraient restés aveugles.
Oublier l’exigence cartésienne de la Recherche de la vérité, la démonétiser sans cesse, et prétendre bien mieux comprendre Descartes qu’il ne s’est compris lui-même, telle est l’entreprise avouée de Dan Arbib dans cet ouvrage. « brillant ! » applaudira peut-être l’époque en découvrant l’ouvrage ; mais, comme mue par un savoir inconscient, jamais elle n’ajoutera que pareille entreprise est vraie ni juste. Et elle aura raison.
- Dan Arbib, Descartes, la métaphysique et l’infini, Paris, PUF, coll. Épiméthée, 2017
- cf. Principes de la Philosophie I, § 30
- Laurence Devillairs, Descartes, Paris, PUF, coll. Que sais-je, 2013, p. 52
- Ferdinand Alquié, La découverte métaphysique de l’homme, Paris, PUF, 1966², p. 93
- René Descartes, Lettre à Mersenne du 11 novembre 1640, AT III, 233
- Jean-Marie Beyssade, La philosophie première de Descartes. Le temps et la cohérence de la métaphysique, Paris, Flammarion, 1979, p. VI
- Ibid., p. 1
- Ferdinand Alquié, Descartes, l’homme et l’œuvre, Paris, Table Ronde, 2017, p. 13
- Dan Arbib, op. cit., p. 21
- Ferdinand Alquié, Descartes, l’homme et l’œuvre, op. cit., p. 93
- Dan Arbib, La métaphysique…, op. cit., p. 343
- Ibid., p. 257
- Thierry Gontier, Descartes et la causa sui, Paris, Vrin, 2005
- cf. Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. « Le paradoxe de l’infini cartésien », Archives de Philosophie, vol. tome 72, no. 3, 2009, pp. 497-521
- note 1, p. 17
- Dan Arbib, op. cit., p. 17
- Ibid.
- Jean-Luc Marion, Sur le prisme métaphysique de Descartes, Paris, PUF, Coll. Épiméthée, 1986, p. V
- Olivier Boulnois, « La destruction de l’analogie et l’instauration de la métaphysique », in Duns Scot, Ordinatio I, dist. 3 et 8, Traduction Olivier Boulnois, PUF, coll. Épiméthée, 1988, p. 12
- Ibid.
- Ibid., p. 77
- pour une discussion critique en français, cf. François Loiret, Volonté et infini chez Duns Scot, Paris, Kimé, 2003
- Arbib,op. cit., p. 17
- Jean-Luc Marion, Sur le prisme métaphysique…, op. cit., p. 288
- Dan Arbib, op. cit., p. 64
- Ibid., p. 65-66
- Ibid., p. 95
- Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, art. cit., p. 44
- « Mais si donc, des trois modes du connaître – intelligere, comprehendere et concipere – je n’en reconnais qu’un seul – le premier – pour l’infini, que puis-je dire de ma connaissance de l’infini ? La question qui finalement est posée à Descartes, à travers les diverses objections, reste la même : si l’infini est à la fois le plus clair et distinct et le plus incompréhensible, quelle en est ma connaissance ? Pour répondre, Descartes n’aura plus qu’à distinguer, dans le genre « connaissance », deux modes : dire que l’infini ne peut pas être compris mais peut être entendu, c’est dire que ma connaissance de l’infini est une connaissance d’un certain genre (l’intelligere), et que je lui refuse un autre genre (le comprehendere). […]. Car si, chez Descartes, l’infini est connu, c’est seulement en un certain genre : l’intelligere. », art. cit., p. 47
- Arbib, op. cit., p. 59
- Ibid., p. 107
- Ibid., p. 153
- Ibid.
- Ibid., p. 264
- Ibid., p. 264
- Ibid., p. 103
- Ibid., p. 103
- Ibid., p. 343
- Ibid., p. 61
- Ibid., p. 79
- Ibid., p. 113
- Ibid., p. 215








