REMARQUES LIMINAIRES SUR L’AUTEUR
Le présent ouvrage 1 s’inscrit dans l’œuvre déjà très riche de Philippe Grosos, professeur à l’Université de Poitiers, qui embrasse de multiples domaines allant de l’idéalisme allemand à la phénoménologie en passant par l’esthétique. C’est le «retour aux choses mêmes » de Husserl qui fournit le point de départ de la pensée de Ph. Grosos, ainsi que l’influence décisive des travaux d’Henri Maldiney. En s’intéressant pour la première fois à la préhistoire, dans une trajectoire intellectuelle déjà fort riche, Ph. Grosos réalise une intéressante déconstruction des discours théoriques qui ont surchargé l’approche de ce phénomène originaire. Comment repenser la situation de l’homme qui s’y joue, et la signification d’un art qui déborde sa seule signification esthétique pour nous dire quelque chose de la présence de l’existant au monde ?
INTRODUCTION
Comment se fait-il que les philosophes aient si longtemps ignoré l’art paléolithique malgré leur intérêt pour la philosophie de l’art ? Voilà la question à laquelle Philippe Grosos s’attaque dans cet ouvrage d’une grande érudition. D’après lui, cela s’explique avant tout par le fait que les philosophes ont longtemps été tributaires des discours des préhistoriens sur le sujet. L’auteur nous rappelle dès l’introduction que ce n’est qu’en 1902 que prirent fin les polémiques relatives à l’authenticité de l’art du paléolithique supérieur. C’est en effet de cette année que date un célèbre article des préhistoriens Emile Cartailhac et Henri Breuil intitulé « La grotte d’Altamira. Mea culpa d’un sceptique » dans lequel les deux auteurs reconnaissaient pour la première fois l’authenticité du premier chef-d’œuvre d’art pariétal découvert en 1879 par Marcelino Sanz de Sautuola à proximité de Madrid. Mais en revenant sur leur erreur, ces deux préhistoriens en commettaient une seconde lourde de conséquences pour l’étude de l’art rupestre. Ils présentaient cet art avant tout comme le signe d’une vie sociale développée et oubliaient sa dimension esthétique et donc formelle.
Depuis 1902, le discours des préhistoriens sur le sujet a évidemment évolué mais sans que la philosophie de l’art n’en prenne véritablement acte de par l’aspect de plus en plus technique et spécialisé de l’étude de la préhistoire. Philippe Grosos ne dénombre que quatre philosophes qui se sont intéressés à l’art pariétal en fonction de motivations qui dépassaient bien souvent la philosophie : le psychologue Georges-Henri Luquet, l’historien d’art Max Raphaël et l’essayiste Georges Bataille. La philosophie de l’art dans son écrasante majorité a ignoré l’art pariétal en faisant comme si l’art n’avait pas existé avant les Égyptiens voire la Renaissance italienne. Ainsi, tout aspect formel a été refusé à l’art pariétal. Par-là, c’est sa singularité et son individualité qui ont été niées et donc sa dimension esthétique au sens de Henri Maldiney. Car l’art est avant tout la vérité des formes et ne peut se réduire au seul message des signes.
1) MECONNAISSANCE DES FORMES
Dans le premier chapitre de son ouvrage, Philippe Grosos démontre en s’appuyant sur de nombreux exemples que la philosophie de l’art a reproduit depuis le début du XXe siècle une même méconnaissance des formes de l’art paléolithique. Pour autant, son exposé des différentes théories de l’art pariétal n’est pas entièrement écrit à charge contre les préhistoriens qu’il critique. L’auteur sait aussi valoriser les avancées induites par chacune des écoles interprétatives qui se sont succédé au cours du XXe siècle.
L’approche « magique » de Salomon Reinach est remise en cause de façon particulièrement convaincante. De fait, il semble peu probable que toutes les peintures répertoriées de nos jours puissent rendre compte d’une pratique magique visant à exercer une influence sur des animaux que l’on chassait alors : le renne est absent de nombreuses compositions alors qu’il constituait la base de l’économie de l’époque. Mais Philippe Grosos reconnaît à Salomon Reinach et à tous les partisans de l’ethnographie comparée un rôle salutaire dans la conception de la spécificité des mentalités préhistoriques.
L’approche dite de « l’art pour l’art » est rejetée pour son aspect naïf et anachronique car elle projette sur la préhistoire les préjugés esthétiques du XVIIIe siècle. Cependant, l’auteur salue l’œuvre originale de Georges-Henri Luquet qui a su entrevoir les limites de l’approche magique et plus particulièrement de l’argument du locus remotus tout en proposant une analyse esthétique originale des formes préhistoriques. Cette dernière s’appuie sur un rapprochement fructueux avec les dessins d’enfant dont la valeur ne peut être reconnue qu’en distinguant le « réalisme visuel » du « réalisme intellectuel » ou « émotionnel » qui est celui de l’art primitif :
« L’art classique des civilisés adultes n’est point, comme l’a cru longtemps l’esthétique, la seule forme possible d’un art figuré. En fait, il en existe une autre, caractérisée par des tendances opposées. Elle se rencontre à la fois chez nos enfants et chez les adultes, même des professionnels, de milieux humains nombreux et variés sur lesquels nous sommes renseignés par la préhistoire, l’histoire et l’ethnographie. Ces productions artistiques ayant comme caractère commun leur opposition à celle des civilisés adultes, il est légitime de les réunir en un genre unique, auquel convient le nom d’art primitif. »2
De fait, les dessins pariétaux expriment de façon spécifique et émouvante le regard porté par l’homme sur sa condition spécifique de bipède.
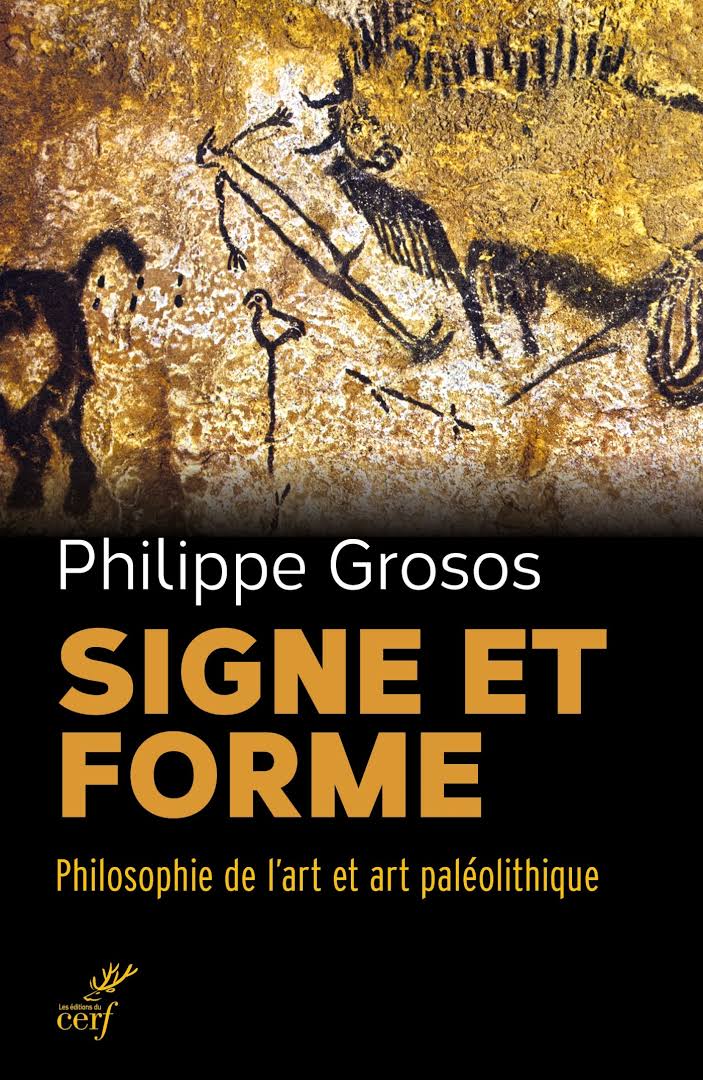
L’approche « structurale » attribuée à Max Raphaël est celle qui enthousiasme le plus l’auteur car elle parvient à mettre en évidence la modernité des compositions picturales des différentes grottes préhistoriques en refusant de les identifier systématiquement à des palimpsestes :
« [L’hypothèse du palimpseste] affirme que dans tous les cas où ont été superposées à un même endroit du plan pictural plusieurs figures animales ou signes, nous sommes en présence d’une séquence chronologique : la couche inférieure qui comporte les figures recouvertes est la plus ancienne, celle qui la recouvre est la plus récente. Il s’agit là d’une des idées fondamentales qui conduit l’abbé Breuil à mettre en place et à préciser la chronologie relative de l’art paléolithique. Mais l’on n’a pas le droit d’attribuer à l’hypothèse du palimpseste une validité absolue.[…] Si l’image ancienne a donc été conservée, en partie ou en totalité, on peut supposer que les artistes l’ont incluse à propos délibéré dans l’organisation de leur oeuvre. Bien que nous ayons là une élaboration historique par couches successives, l’ensemble peut toutefois avoir une unité globale d’un point de vue iconographique. »3
Ainsi, c’est bien la cohérence interne du système de représentations présent dans la grotte d’Altamira qui permet à Max Raphaël d’y voir une « bataille magique » opposant le clan de la biche au clan du bison. Il est intéressant de citer ici la synthèse magistrale par son mélange de concision et de précision qu’en livre l’auteur :
« Ce dont il est […] question c’est bien du récit d’un conflit qui, en des temps préhistoriques, opposa deux clans se représentant eux-mêmes par les animaux totémiques que sont l’un la biche, pour l’autre le bison. […] Mais pour cela et, puisque la peinture devient récit, il lui faut interpréter ses formes comme des signes.
Tout commence donc par l’affrontement des regards entre biche et bison. Voyant l’image comme on suivrait un texte rédigé de gauche à droite, Raphaël entend mettre en évidence le progressif effondrement du bison, en notant tout d’abord sa fuite – figurée dans l’axe central par un animal qui, tourné vers la droite, montre à la biche sa croupe plutôt que son museau –, puis sa capitulation – figurée par cet animal étrangement vertical et recroquevillé sur lui-même dont Katharina Marr avait produit une si remarquable copie, et enfin son exécution, au moins symbolique, que suggère la représentation d’un animal acéphale. Ici, un récit est visuellement mis en évidence à l’instar d’ailleurs de ce que les tapisseries et peintures à motif religieux feront voir dans l’occident chrétien, de l’époque médiévale à l’époque moderne. »4
Cependant, Philippe Grosos considère que la systématisation de l’approche structurale proposée ultérieurement par Leroi-Gourhan a abouti à des dérives réduisant les compositions picturales à des pseudo-langages où la forme est réduite au signe.
Enfin, l’auteur aborde l’approche « chamanique » développée par Jean Clottes en soulignant l’influence qu’a pu exercer sur lui le travail de David Lewis-Williams sur les San :
« Si afin de nourrir son propos Clottes mentionne Mircea Eliade, l’intuition d’une interprétation chamanique de l’art pariétal ne lui est toutefois pas venue en le lisant mais, comme il s’en explique, en ayant connaissance des travaux que David Lewis-Williams a pu consacrer aux tribus San d’Afrique du Sud. »5
Son originalité ne consiste pas dans le fait d’identifier des sorciers parmi les représentations paléolithiques comme l’avait déjà fait Henri Bégouën en 1939 (cf. le sorcier de la grotte des Trois frères) mais dans le fait d’y associer les neurosciences qui permettent de mieux comprendre les différents états de la transe chamanique. Les « mains scellées » soufflées sur les murs sont ainsi interprétées comme la volonté de franchir la paroi en direction du monde des morts. Aussi séduisante soit-elle cette interprétation fait disparaître la dimension purement artistique de l’art pariétal au profit de sa dimension magique et religieuse.
2) SIGNE ET SYMBOLE
Dans le deuxième chapitre, Philippe Grosos explore de façon logique les conséquences de la réduction de la forme au signe dans l’étude de l’art pariétal. L’œuvre d’André Leroi-Gourhan est alors étudiée de façon approfondie après avoir souligné le rôle déterminant que ce dernier a pu jouer dans l’évolution des méthodes scientifiques des préhistoriens : décapage horizontal, carroyage fixe, utilisation de passerelles, remplacement des calques par les photos numérisées.
Dans l’approche structurale, les formes sont systématiquement rapportées à des signes capables de répartir le règne du vivant en fonction d’un dimorphisme sexuel fondamental. L’auteur du livre reconnaît à cette théorie l’intérêt d’être systématique mais considère qu’elle repose sur une sexualisation parfois subjective pour ne pas dire arbitraire des représentations pariétales. Dans cette perspective, les formes ne sont plus que des pictogrammes ou des symboles qui renvoient à autre chose qu’eux-mêmes et s’inscrivent alors souvent dans une pensée religieuse selon une logique qu’a bien décrite le philosophe allemand Ernst Cassirer :
« La religion et l’art sont très proches l’un de l’autre dans leurs effets purement historiques, ils s’entrepénètrent de telle manière qu’il semble parfois impossible de les distinguer quant à leur contenu et quant au principe formateur qu’ils comportent. »6
Il n’est pas étonnant que les successeurs de Leroi-Gourhan comme Emmanuel Anati aient fini par employer les termes de langage symbolique voire de proto-écriture pour qualifier l’art paléolithique. Anati va même encore plus loin en estimant que « l’homme d’aujourd’hui devrait pouvoir le lire » :
« Alors que la lecture des écritures phonétiques est réservée aux initiés, dans les écritures idéographiques primordiales non phonétiques la compréhension dépend de la logique élémentaire. Ainsi, les peuples sans écriture « lisaient » sans problème l’art des origines et, en théorie, à moins que cet art ne comporte des formes très dialectales, l’homme d’aujourd’hui devrait pouvoir le comprendre. »7
Puis quelques pages plus, le même rapporte l’anecdote suivante :
« Dans une zone rupestre de l’Arizona, un guide indien a été surpris de constater que les Européens ne comprenaient pas la signification « évidente » d’une gravure rupestre représentant un petit anthropomorphe avec un point près des pieds. Dans le langage visuel, le point signifie « faire » et « faire pied » veut donc dire « marcher » ou « aller ». De même, un personnage avec un arc à la main et un point à côté de l’arc est en train de « chasser ». »8
Cependant, l’assimilation de l’art pariétal à une écriture aboutit d’après Philippe Grosos à un gommage préjudiciable des différences entre histoire et préhistoire et ne nous permet pas de comprendre les logiques expressives propres aux Préhistoriques.
3) STYLE ET FORME
Dans le troisième chapitre de son ouvrage, l’auteur insiste sur le fait que la différence radicale entre art pariétal et écriture n’implique pas pour autant que l’art paléolithique pictural ou mobilier n’ait pas d’histoire. De fait, les formes évoluent dans le temps et dans l’espace par la succession des styles au sens que Maldiney donne à ce terme :
« [Le style consiste à] déceler dans les œuvres d’une époque la même intentionnalité sous-jacente dont chacune est une expression sensible. Un style est une fonction dont les éléments constitutifs sont les variables. Il est la matrice des formes. Son unité est celle d’un entier systématique, mais qui n’a pas de signifiant propre […]. Il n’a que des signifiants partiels ou synchrones. »9
Philippe Grosos montre cependant à quel point la chronologie héritée de Leroi-Gourhan ne semble plus aujourd’hui pertinente. D’une part, la découverte de la grotte Chauvet et de ses peintures figuratives datées de 37000 ans BP ne rend plus crédible l’idée d’une naissance de l’art figuratif à la période qu’avait déterminée le préhistorien (32000 ans BP). D’autre part, Philippe Grosos estime nécessaire de reprendre la question de la naissance de l’art là où l’avait laissée l’écrivain Georges Bataille en 1955 dans ses écrits sur la grotte de Lascaux :
« Nous voyons à Lascaux une sorte de ronde, une cavalcade animale, se poursuivant sur les parois. Mais une telle animalité n’en est pas moins le premier signe pour nous, le signe aveugle, et pourtant le signe sensible de notre présence dans l’univers. »10
Malgré son aspect daté, le texte de Bataille semble avoir ouvert une voie que confirment et dépassent les travaux récents de certains préhistoriens comme Michel Lorblanchet. Ce dernier reconnaît l’importance de la forme irréductible au signe mais ne pense pas que la naissance de l’art soit aussi récente que la grotte de Lascaux. Pour lui, le genre humain est préoccupé par les questions esthétiques depuis son apparition il y a trois millions d’années. Le souci esthétique existe jusque dans la fabrication des outils dont la forme ne peut bien souvent se déduire de leur seul intérêt pratique. Philippe Grosos regrette cependant en fin de chapitre que Michel Lorblanchet rattache de façon arbitraire l’apparition de l’art figuratif à l’émergence des premières cosmogonies religieuses en ces termes :
« Les images rupestres qui s’offrent aux regards sont liées à l’émergence des premières cosmogonies, des premiers systèmes religieux ou mythologiques expliquant la création du monde qui suscitent la figuration parce qu’ils ont un contenu à raconter avec des images et à enseigner et cet enseignement s’effectue dans les premiers sanctuaires. L’art rupestre figuré est probablement né avec la religion et de la religion. L’antique Homo estheticus progressivement s’est doublé d’un Homo religiosus… »11
Georges Bataille a quant à lui ouvert une approche plus originale de la valeur expressive des représentations préhistoriques : l’étude de la présence sensible de l’être humain au monde.
4) FORME ET EXISTENCE12
C’est donc tout naturellement que le dernier chapitre de l’ouvrage est consacré aux rapports entre formes de l’art pariétal et existence des Préhistoriques. L’auteur insiste tout d’abord sur la difficulté de qualifier une telle démarche sans revenir au sens étymologique du mot esthétique. Le concept apparaît en effet comme piégé car il renvoie aux travaux du philosophe allemand Alexander Gottlieb Baumgarten, entre 1735 et 1750, qui y voyait une forme de sémiotique, c’est-à-dire d’étude des signes. C’est du moins la conclusion que tire Philippe Grosos de la citation suivante issue de l’article « Über die Ästhetik » :
« Veut-on proposer d’écrire au lieu de « science de l’exposition », « science de l’expression par signes » [proponenda significenda] ? C’est là une notion qui est déjà contenue dans notre définition. »
Or, c’est bien vers une esthétique de l’univers des formes cher à Malraux que tend tout le travail de Philippe Grosos. La forme est ce qui ne se rapportant qu’à soi permet à l’homme d’exprimer son expérience du monde et donc son existence singulière. C’est à partir des formes de l’art pariétal que l’auteur souhaite retracer l’évolution des logiques expressives des Préhistoriques en dehors de tout présupposé psychologique, symbolique ou religieux. Il y parvient de notre point de vue de façon élégante en s’appuyant sur deux exemples précis et bien illustrés.
Le premier exemple est celui de la grotte de Lascaux (17000 ans BP) pour lequel l’auteur utilise les travaux récents de Nicolas Aujoulat. Les peintures pariétales presque entièrement consacrées à la faune la plus noble y témoignent de la virtuosité stylistique des artistes, de leur sens du détail et du mouvement comme cela a souvent été répété par la suite. Tout cela justifie sans aucun doute le titre de « Chapelle Sixtine de l’art pariétal » que cette grotte se dispute avec celle d’Altamira. Mais l’essentiel est ailleurs dans la présence absente de l’homme qui n’est là que par la fascination pour la beauté et la puissance de la nature dont témoigne la précision de ses formes. Si Lascaux est une chapelle, il s’agit donc d’une chapelle dédiée à la nature où l’homme est présent sur un mode participatif sans encore être tourmenté par son identité. Philippe Grosos cite alors une anecdote relatée par Jean-Pierre Mohen dans Art et histoire qui nous permet de mieux saisir toute la dimension émotionnelle d’un tel lieu dès lors qu’il parvient à renvoyer les spectateurs à leur existence :
« Des aborigènes Ngarinyin sortis pour la première fois de leur territoire australien lors d’un voyage sur le continent européen en 1997, à la fois surpris et indifférents à leur immersion occidentale, se sont mis à pleurer lors de la visite de la grotte de Lascaux […] car ils ont cru que leur territoire sacré et peint d’Australie, qu’ils ne reconnaissaient pourtant pas exactement, s’était déplacé à leur rencontre. […] Au-delà de la signification des symboles des peintures, ils retrouvaient un environnement et une démarche cosmologiques proches des leurs. Le sens des signes est alors secondaire par rapport à un espace primordial, lieu de source vitale correspondant à la symbiose de l’homme et de la nature… »
Gravure du vieil homme, relevé Jean Airvaux
La Marche, 14000 BP
Tout autre est le cas du site de La Marche dans la Vienne (14000 ans BP) que les préhistoriens semblent avoir trop souvent ignoré. Les animaux y sont présents aux côtés des figures humaines représentées en grand nombre suivant les différents âges de la vie. La question de la finitude de la condition humaine de la naissance à la mort semble ici angoisser les artistes. Parmi ces portraits se trouve celui d’un vieil homme barbu et dégarni qui n’a rien d’un type physique mais paraît être le portrait d’un individu pris dans sa singularité. De manière générale, ce que traduisent ces formes c’est une humanité concrète en mode présentiel à travers les péripéties de son quotidien dans un rapport au monde inversé à celui qui semble être celui de Lascaux. L’auteur s’interroge : est-ce un hasard si ces dessins et gravures ont été réalisées à l’air libre sur des surfaces mobiles et non pas au fond de la caverne ? Un art qui met l’homme au grand jour n’a-t-il pas besoin de lumière ?
CONCLUSION
En conclusion de cet ouvrage, l’auteur ne prétend pas fournir un nouveau paradigme qui devrait s’imposer aux dépens de tous les autres. L’attention pour les formes ne fait pas disparaître la question des signes ou de la dimension symbolique de l’art au sens d’Ernst Cassirer. De fait, il ne s’agit pas pour Philippe Grosos de renoncer à la notion d’interprétation au profit d’une observation passive et improductive de l’art mais de remplacer la question du sens caché par celle plus philosophique de l’expression formelle et affective d’une expérience humaine.
Cette façon d’appréhender la philosophie de l’art amène l’auteur à proposer sa propre définition de l’œuvre d’art qui peut être conçue comme le soubassement et le produit de son ouvrage :
« Mais l’œuvre d’art, quant à elle, n’est pas signe ; elle est la mise en forme d’une émotion qui même lorsqu’elle a valeur de signe n’y est pas réductible. »13
Identifier les logiques et les expériences relatives à la condition humaines qui accompagnent l’Homo estheticus depuis 3 millions d’années apparaît comme le cœur de l’esthétique des formes que Philippe Grosos appelle de ses vœux et qui ne sera pas sans impact sur notre compréhension de l’art contemporain. Guernica bouleverserait-il autant le spectateur sans la violence anguleuse de ses formes expressives ?
- Philippe Grosos, Signe et Forme, Philosophie de l’art et art paléolithique, Les Editions du Cerf, mars 2017
- G.-H. Luquet, L’art primitif, Paris, Doin, 1930, p. 248.
- M. Raphaël, L’art pariétal paléolithique, Kronos, 1986, pp. 120-121.
- Philippe Grosos, SIGNE ET FORME. Philosophie de l’art et art paléolithique, Cerf, 2017, pp. 71-72.
- Philippe Grosos, SIGNE ET FORME. Philosophie de l’art et art paléolithique, Cerf, 2017, p. 84.
- E. Cassirer, La philosophie des formes symboliques, t. 1, Minuit, 1972, p.23.
- E. Anati, Aux origines de l’art, pp. 37-38.
- E. Anati, Aux origines de l’art, pp. 355.
- H. Maldiney, « L’art et l’histoire », dans F. Felix et Ph. Grosos (dir.), Henri Maldiney : phénoménologie et sciences humaines, Lausanne, L’âge d’homme, 2010, p.13.
- G. Bataille, Lascaux ou la naissance de l’art, Skira, 1955, p. 91.
- M. Lorblanchet, La Naissance de l’art, Errance, 1999 p. 272.
- Cette partie de l’ouvrage est en grande partie issue de conférences réalisées à l’invitation de l’historien de l’ethnologie allemande Jean-Louis Georget.
- Philippe Grosos, SIGNE ET FORME. Philosophie de l’art et art paléolithique, Cerf, 2017, p. 226.








