Dame Fortune est parfois ironique. Deux ans après la commémoration du quatre centième anniversaire de la mort de Giordano Bruno sur le bûcher – le 17 février 1600 à Rome – tous les exemplaires de l’édition bilingue de ses œuvres italiennes partaient en fumée dans le terrible incendie des entrepôts de stockage des Belles Lettres qui, le 29 mai 2002, réduisit en cendres près de trois millions de livres. La prestigieuse maison dut lancer un immense programme de réimpressions sur plusieurs années. Les ouvrages de la collection « Giordano Bruno », initiée au début de années 1990, n’était pas prioritaire. Il fallut donc patienter. Après De l’infinito, universo et mondi / De l’infini, l’univers et les mondes en 2006, puis De gli eroici furori / Des fureurs héroïques en 2008, le De la causa, principio et uno / De la cause, du principe, et de l’un est de nouveau disponible depuis la fin de l’année 20161.
I. Une nouvelle édition
Plus qu’une simple réimpression, c’est bien une nouvelle édition qui nous est proposée et ce sont 374 pages inédites qui s’ajoutent à l’édition de 1996. L’ancienne introduction de Michele Ciliberto (43 pages) a été remplacée par une nouvelle introduction de Thomas Leinkauf (240 pages). La notice philologique de Giovanni Aquilecchia a été conservée, ainsi que ses notes au texte mais, à celles-ci, s’ajoute une nouvelle série de « Notes complémentaires » de Thomas Leinkauf (58 pages). Deux pages inédites sont consacrées à la pagination de l’édition princeps (Londres, 1584), pagination qui a été indiquée par Zaira Sorrenti en marge du corps de texte de Bruno. Enfin, c’est également à Zaira Sorrenti que l’on doit les deux nouveaux appendices (117 pages).
On peut commencer par la fin et s’interroger sur la présence, la nature et la pertinence de ces appendices. Deux des six exemplaires du De la causa ayant servi à la première édition critique de Giovanni Aquilecchia (en 1973) portaient des soulignements et des apostilles : douze très courtes notes, à peine quelques mots, de Pierre de Cardonnel (XVIIe siècle) pour l’un ; vingt-neuf notes, un peu plus longues, d’un lecteur anonyme du XVIe siècle pour l’autre. Dans le premier appendice (116 pages), Zaira Sorrenti en redonne le relevé, ainsi qu’Aquilecchia l’avait fait dans son édition critique. Mais cette retranscription s’accompagne de 98 pages de reproductions photographiques de ces apostilles et soulignements. Il nous semble que de tels documents auraient peut-être eu davantage leur place en appendice d’une étude particulière que dans l’édition bilingue du texte.
Le second appendice, la « Table métrique » des cinq poèmes de Bruno – situés entre son épître liminaire et les cinq dialogues du De la causa –, est aussi bref que le premier est long : huit courtes lignes, titre compris. Y sont indiqués la forme de chacun des poèmes : « distiques élégiaques » et « sonnets », cette dernière indication étant assortie de la précision « ABBA-ABBA-CDE-CDE ». Ces informations sont intéressantes mais, données telles quelles, on se demande à quel lecteur elles s’adressent car soit elles ne lui disent rien, s’il ne sait à quoi cela correspond, soit, s’il le sait, elles ne lui disent rien de plus qu’il n’ait constaté tout seul. En revanche, si l’indication de la forme des sonnets avait été brièvement commentée, même de façon minimaliste, il aurait pu être signalé qu’il s’agit de la forme régulière du sonnet privilégiée par Pétrarque dans son Canzoniere, ce même Pétrarque dont la poésie est sans cesse reprise et critiquée, raillée et continuée par Bruno. Et l’on aurait pu signaler, éventuellement, combien l’expression poétique était essentielle dans le discours philosophique de Bruno, pour des raisons aussi théoriques qu’esthétiques. De même, le fait que les trois poèmes en latin du De la causa soient composés en distiques élégiaques est une information qui, également donnée telle quelle, n’informe guère. S’il va sans dire que cela témoigne de la connaissance et du goût de Bruno pour les lettres classiques de l’Antiquité, si caractéristiques de la Renaissance, cela va toujours mieux en le disant. Mais surtout, on pouvait rappeler, là encore très brièvement, que ce couple de vers est constitué d’un hexamètre – le mètre par excellence de l’épopée homérique, mais aussi de l’écriture d’Hésiode, de Parménide et d’Empédocle, de Lucrèce et d’Ovide, des auteurs sources fondamentaux dans la philosophie de Bruno et clairement désignés par lui – suivi d’un pentamètre dactylique propre à l’élégie, à la poésie lyrique. Et peut-être pouvait-on rappeler, tout aussi brièvement, que cette métrique irrégulière produit un effet de syncope dans la scansion, l’alternance d’une envolée et d’une retombée du souffle et de l’esprit, un rythme passionnel en accord, dans sa forme même, avec la philosophie de Bruno pour qui l’être et son expression, comme la nature et la pensée, se meuvent en miroir. On regrette donc que les huit lignes accordées à la métrique brunienne des poèmes présents dans le De la causa n’informent guère le lecteur sur la poésie de Bruno, ni sur sa philosophie, ni leur lien intrinsèque. Plus généralement, on regrette que les 117 pages d’appendices soient d’un intérêt limité, tout en augmentant considérablement la taille d’un volume déjà imposant. A ce compte, une ou deux pages supplémentaires exploitant brièvement ces données brutes, n’auraient pas matériellement modifié ce gros volume mais auraient produit du sens et justifié leur présence.
La seconde innovation de cette nouvelle édition est l’excellente introduction de Thomas Leinkauf. Le professeur de l’Université de Münster présente l’œuvre de Bruno de façon exemplaire2. Le De la causa est replacé dans son contexte biographique, historique et philosophique. Les œuvres antérieures de Bruno – De umbris idearum, Cantus Circaeus, Sigillus Sigillorum, Candelaio et La cena de le Ceneri – sont présentées relativement à ses thèses majeures que le De la causa va tout à la fois développer et fonder métaphysiquement. La construction et les thèmes principaux du texte sont analysés de façon claire mais non simplifiée et cette finesse d’analyse fait apparaître des points de divergence interprétative entre la lecture de Leinkauf et celle d’autres spécialistes. La réception du De la causa et de la philosophie de Bruno au cours de l’histoire est restituée – de Mersenne à Blumenberg en passant par Bayle, Toland, Goethe, Scheling, Hegel, Jacobi, Schopenhauer, Dilthey ou encore Cassirer. Ce sont pas moins de 343 notes de bas de page, dont certaines sont plus que consistantes (30 lignes), qui apportent références textuelles et précisions. Enfin, une bibliographie de 44 pages achève cette introduction d’une très grande qualité qui constitue presque un ouvrage à part entière à l’intérieur de ce volume III des Œuvres Complètes de Bruno.
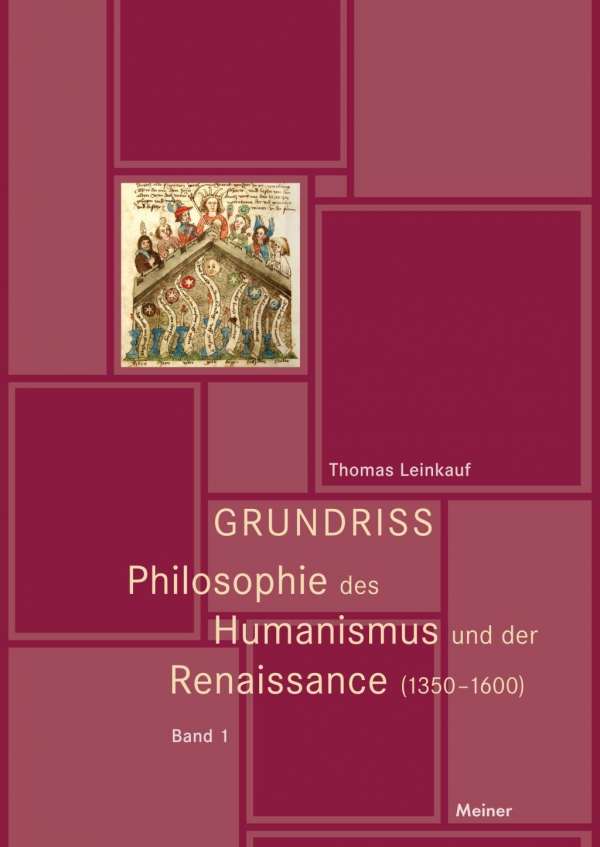
Enfin, autre innovation de cette nouvelle édition que nous avons déjà mentionnée, Thomas Leinkauf a également rédigé des notes complémentaires au texte de Bruno, ajoutées en fin de volume à celles de G. Aquilecchia pour l’édition de 1996. Elles sont tout à fait remarquables : Leinkauf commente, à l’occasion de leur apparition dans le texte de Bruno, certains termes techniques, expressions et thèses, en les expliquant dans la perspective générale de l’histoire de la philosophie antique et médiévale et/ou dans la perspective propre de la philosophie de Bruno.
II. La « nolana filosofia »
C’est Bruno qui désigne ainsi sa philosophie, se nommant lui-même, par la voix des protagonistes de ses dialogues, « le Nolain » – il est né à Nola, une petite ville proche de Naples, en 1548. Si certaines de ses idées ont déjà été exposées par Bruno dans ses premiers ouvrages, publiés à Paris en 1582 et 1583, c’est un ensemble des six œuvres, écrites en italien et publiées à Londres en l’espace de deux ans (1584 et 1585), qui établit le programme de cette « philosophie nolaine » 3. Il s’agit, écrira-t-il dans le troisième des six ouvrages, d’une philosophie nouvelle qui « […] ouvre les sens, contente l’esprit, magnifie l’intellect et reconduit l’homme à la vraie béatitude qu’il peut posséder en tant qu’homme et dont je vais dire ce qui la compose : elle libère des soucis présents des plaisirs, comme du sentiment aveugle des douleurs ; elle le fait jouir de l’être présent, sans plus craindre ni espérer du futur4. On retrouve ici l’expression du bonheur philosophique poursuivi par la grande majorité des écoles antiques et la nouveauté revendiquée semble fort peu nouvelle, dira-ton. Mais en cette fin du XVIe siècle, l’accent mis sur la vérité de cette béatitude, dont l’homme se serait écarté puisqu’il s’agit de l’y « reconduire », ne suggère pas seulement que cette vérité a été connue et oubliée (c’est-à-dire recouverte par une fausseté, selon Bruno). S’y affirme la possibilité, ici et maintenant, de cette béatitude, exemptée de la vertu d’espérance en un salut futur. Ces quelques lignes revendiquent une rupture avec la parole chrétienne. Plus largement considérée, la philosophie de Bruno entend produire une révolution, au sens étymologique de mouvement circulaire et de retour à un point d’un cycle. « Tu crois qu’il ferait mal, celui qui voudrait mettre sens dessus-dessous le monde renversé ? »5 répond ironiquement l’un des protagonistes à celui qui s’inquiète des conséquences d’une telle philosophie. Il faut inverser le renversement du monde car, selon Bruno, les successives « dé-formations » de l’image et du discours porté sur la réalité ont produit, au fil des siècles6, des conceptions proprement « difformes » du rapport entre le divin, l’univers et l’homme, du rapport des hommes entre eux, du rapport de l’homme avec lui-même. Les six ouvrages publiés à Londres exposent donc un programme philosophique qui se présente comme une « ré-forme ».
Le texte qui introduit ce programme réformateur de Bruno, La cena de le Ceneri, en présente l’aspect immédiatement polémique et spectaculaire qui est, aujourd’hui encore, ce qui fait la célébrité de Bruno : sa cosmologie infinitiste et décentrée. La conception aristotélico-ptoléméenne d’un monde fini, orienté, séparé en deux régions (sub-lunaire et supra-lunaire) hétérogènes par la nature des éléments qui les composent, centré sur une terre immobile et clos par une ultime sphère d’étoiles fixes, est révoquée par Bruno. Non seulement il défend l’héliocentrisme copernicien – le De revolutionibus orbium coelestium a été publié en 1543 à titre d’« hypothèse mathématique » – mais encore il dépasse la structure et la clôture du cosmos conservée par Copernic. Ainsi, Bruno argumente, en philosophe, la conception d’un univers infini, homogène, sans orientation, constitué d’une infinité de mondes dont chacun est un système dont les planètes, comme la terre, tournent autour de leur soleil respectif. Cet univers décentré, où tout fait centre puisqu’il n’y en a pas, est l’effet nécessairement infini de sa cause infinie et le produit nécessairement infini de son principe infini. En tout point, la génération et la corruption y suivent un processus identique, manifestations de la mutation perpétuelle de la matière universelle qui développe l’infinité de ses formes possibles. Enfin, tout y est animé (au double sens du terme, « mobile » car « plein d’âme »). C’est pourquoi toutes choses y sont en continuelle métamorphose. Bruno prévient son lecteur dans le premier des six ouvrages londoniens : « on promet d’ajouter dans d’autres dialogues ce qui semble manquer encore à cette philosophie pour être parachevée »7. S’il est en mesure de reconstituer une conception de l’univers à ce point opposée à celle qui s’impose sans alternative depuis des siècles, s’il dépasse les limites du système copernicien, s’il peut réfuter les principes de la physique aristotélicienne et remettre en cause si radicalement les principes métaphysiques afférents, c’est que Bruno est déjà possession d’autres principes. Il avait déjà exposé ses premières thèses psychologiques et épistémologiques dans les textes parisiens, puis La cena de le Ceneri a proposé les grands traits de sa cosmologie, De la causa, principio et uno, le second ouvrage de Londres, présente son ontologie. Sur ses fondements, il pourra, ensuite, revenir plus précisément sur les thèses de sa cosmologie et de sa physique dans De l’infinito, universo e mondi. Dans une tonalité davantage ironique, parfois même sarcastique, les deux ouvrages suivants, Spaccio della bestia trionfante et Cabala del cavallo pegaseo, tireront les conséquences morales, politiques et religieuses de ces fondements théoriques. Enfin, De gli eroici furori viendra conclure l’ensemble, non pas au sens où serait donné là le mot de la fin – les six textes londoniens indiquent un horizon que Bruno poursuivra dans ses ouvrages postérieurs – mais au sens où tous les acquis des textes précédents s’articulent entre eux dans une dernière étape de présentation : donner à percevoir et concevoir, expliquer et analyser l’expérience d’une âme humaine en proie à une héroïque folie qui conduit l’intellect vers une relation, nécessairement jamais aboutie, avec l’infini principe du réel.
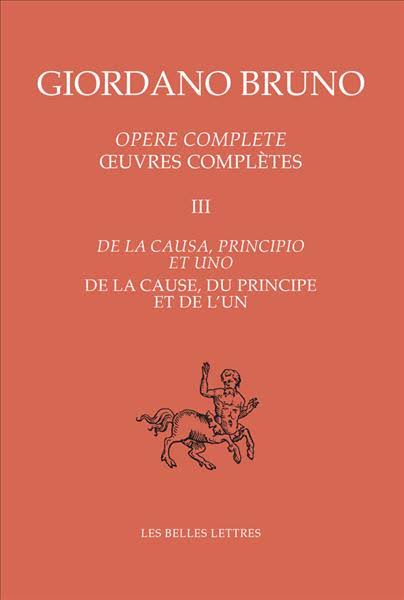
Il existe une profonde unité entre les six ouvrages en italien publiés à Londres, et plus largement dans l’œuvre de Bruno, si variée dans ses sujets et dans ses formes. L’unité de cette philosophie est théoriquement fondée sur l’unité du réel, si pluriel et varié dans sa manifestation. C’est précisément le processus dialectique du rapport qu’entretiennent l’unité et la multiplicité, qu’on le considère du point de vue physique, ontologique, épistémologique ou psychologique qui constitue le socle de la recherche philosophique de Bruno. Et c’est cette dialectique à l’œuvre dans le réel que le De la causa, principio et uno entend démontrer, au cours de cinq longs dialogues entre plusieurs protagonistes, hauts en couleurs et aux noms évocateurs, dont Filoteo, le « fidèle rapporteur de la philosophie du Nolain »8.
III. De la causa, principio et uno ou la fondation ontologique de la philosophie nolaine
En conclusion de son épître liminaire Bruno écrit au dédicataire de l’œuvre9 : « Voilà, très illustre seigneur, d’où il faut partir avant de vouloir pénétrer dans la connaissance plus spécifique et plus appropriée des choses. C’est là que, comme en son germe propre, est contenue et expliquée la multiplicité des conclusions de la science naturelle. C’est de là que dérive la texture, la disposition et l’ordre des sciences spéculatives. Sans une telle propédeutique, toute tentative, toute pénétration, toute entreprise restent vaines »10.
Avant de chercher à connaître les choses en tant qu’elles sont ceci ou cela, de tel ou tel point de vue, il faut savoir ce qui est, et il faut savoir quelle connaissance nous pouvons en avoir. De même que l’on ne voit pas la lumière en elle-même mais ses manifestations plus ou moins intenses dans l’éclairage apporté aux choses sur lesquelles elle se porte, la vérité ne nous est accessible ni en elle-même, ni directement, ni immédiatement, mais indirectement, à travers les choses naturelles, et médiatement, par les représentations mentales que sont nos idées. Cela signifie que la vérité de l’être est partout disponible, comme la lumière, mais elle ne nous parvient que dans les ombres qui se dessinent dans notre esprit des ombres des choses. Nous sommes (comme toutes choses) des ombres, et connaissons des ombres d’ombres11. Mais l’ombre est un concept positif chez Bruno. Car d’une part, l’ombre participe de la chose dont elle est l’ombre et de la lumière dont elle est une apparition, d’autre part notre connaissance indirecte – ou conjecturale, pour le dire selon l’expression de Nicolas de Cues qui est sans doute le philosophe qui a le plus apporté à la construction originale de la pensée de Bruno – est une connaissance valable.
C’est à partir de ce cadre que De la causa propose un scénario très complexe, qui fonde métaphysiquement une réalité « infiniment infinie », où l’unité et la pluralité diverse, de même que l’ordre et le chaos entretiennent une relation que l’on a désignée comme dialectique. L’élucidation de cette relation se fera par l’examen des notions classiques de la métaphysique (et de ce à quoi elles renvoient), qu’elles appartiennent à l’aristotélisme, à la scolastique ou au néoplatonisme : matière et forme, cause et principe, acte et puissance, enveloppement et développement, participation et échelle de l’être, substance, unité. Ces notions reconsidérées dans le prisme de certains thèmes de l’hermétisme égyptien et pythagoricien (eux-mêmes transformés), il en résulte une métaphysique qui n’est ni aristotélicienne, ni scolastique, ni néoplatonicienne, ni hermétique mais véritablement brunienne. Il s’agit, par ailleurs, d’une métaphysique qui ne porte pas sur un autre objet que celui de la physique mais qui porte un autre regard sur le même objet : la phusis. Parce que, selon Bruno, il n’y a pas de réalité autre que la phusis, si ce n’est l’unité absolue qui complique en soi tout ce qui est sans différenciation et en laquelle tout coïncide, unité absolue dont il n’y a rien à dire de plus que son concept. L’univers est la trace unitaire dans l’être de cette unité absolue, l’unité dynamique de la nature en est l’explication réalisée par des unités médiatrices (la matière universelle, l’âme universelle, l’intellect universel) en une infinité d’unités relatives et transitoires, composées par l’association et la dissociation d’unités minimales (les atomes). C’est en ce sens que la philosophie naturelle (i.e. physico-métaphysique) de Bruno est bien une « nova filosofia », une élaboration nouvelle qui retisse une pensée avec les intuitions majeures des penseurs pré-platoniciens.
Si Bruno annonce qu’il va présenter dans son ouvrage « tout ce qui paraît convenir à la contemplation réelle de la cause, du principe et de l’un »12, c’est qu’il entend rompre avec leur considération logique (qui conforme la nature à la raison et non la raison à la nature) autant qu’avec leur examen philologique (apanage des pédants qui, selon lui, ont remplacé les vrais philosophes). Que faudra-t-il donc comprendre pour contempler réellement l’un, le principe et la cause ? Il faudra déjà savoir de quoi l’on parle : le réel est de nature processuelle et il est constitué d’effets, de leurs causes (prochaines ou premières), de principes et de ce qui en participe, les choses principiées. Laissons un protagoniste du dialogue s’exprimer à la place du lecteur désireux de s’initier à la philosophie nolaine : « […] puisque vous employez fréquemment les termes de « cause » et de « principe », je voudrais savoir si vous prenez ces mots comme synonymes »13. Évidemment non. Bruno ne l’exprime pas mais donne des exemples qui rendent compte de l’idée communément admise selon laquelle si toute cause est principe, tout principe n’est pas cause. Il va définir précisément un principe comme « ce qui concourt intrinsèquement à la constitution de la chose et demeure dans l’effet, comme on le dit de la matière et de la forme qui demeurent dans le composé, ou bien des éléments dont une chose se compose et en lesquels elle se résout » »14. Et il définit une cause comme « ce qui concourt extérieurement à la production des choses et qui a son être en dehors de la composition, comme c’est le cas de l’efficient et de la fin auxquels est subordonnée la chose produite »15. Définitions dans lesquelles on reconnaît quelque chose des fameuses quatre causes aristotéliciennes repensées dans un rapport perturbé puisque la matière et la forme semblent se retrouver au rang de principes quand seuls l’efficient et la fin semblent avoir le statut de cause. Mais, d’une part, dire que tout principe n’est pas cause n’exclut pas que certains le soient, d’autre part, lorsque l’on se situe, comme c’est le cas ici, au niveau des premiers principes et des premières causes naturelles, les choses sont, à la fois, beaucoup plus simples ontologiquement et beaucoup plus complexes à comprendre.
Ces définitions ont donné deux premières causes, l’une efficiente et l’autre finale, ainsi que deux premiers principes, l’un formel et l’autre matériel. Quelle est la première cause efficiente ? C’est, selon Bruno, l’intellect universel, c’est-à-dire « la faculté ou la partie en puissance la plus intérieure, la plus réelle et la plus propre de l’âme du monde, laquelle est forme universelle de celui-ci. »16. Laissons l’âme du monde de côté pour l’instant. En suivant une analogie que Bruno a déjà utilisée, on dira que l’intellect universel est le sculpteur du monde car il est le dator formarum : « Quant à nous, nous l’appelons « l’artiste intérieur » parce qu’il informe et façonne la matière de l’intérieur »17. Cette détermination est un peu plus explicite plus loin dans le texte, mais en même temps plus problématique car l’intellect universel est doublement désigné, de manière apparemment contradictoire, comme cause extrinsèque et cause intrinsèque. Mais lorsque l’on pratique les textes de Bruno, on sait que la contradiction apparente fait sens si l’on fait varier le point de vue de l’examen : ainsi, on peut comprendre que l’intellect universel est dit « cause extrinsèque » en tant qu’on peut le distinguer de la substance et de l’essence des choses qu’il produit (il n’est pas les choses), et il est dit « cause intrinsèque » par son opération, parce qu’il agit depuis l’intérieur de la matière et non pas depuis une extériorité.
Venons-en maintenant à l’âme du monde. Elle a été désignée comme sa forme et donc, d’après les définitions posées plus haut, on devrait la considérer d’abord comme principe. Or, Bruno entend considérer deux sortes de formes. En effet, en tant que la forme est ce qui permet à l’efficient de produire son effet, elle est est une cause. Mais en tant que l’efficient ne fait que la susciter à partir de la matière et ne la crée pas de l’extérieur, la forme est un principe. Aussi, lorsqu’il est dit que l’âme du monde est sa forme, il faut donc entendre qu’elle est à la fois son principe formel et sa cause formelle. Une fois encore, il faut varier la perspective de l’examen pour mieux saisir ce qui est considéré. Et une nouvelle analogie, bien connue, peut nous aider à le faire, à savoir celle qui considère que l’âme est au corps ce que le pilote est à son navire. En tant qu’il est mû avec le navire, le pilote en fait partie formellement, mais en tant qu’il le dirige et le meut, il s’en distingue comme cause du mouvement du navire. De la même manière, « l’âme de l’univers, en tant qu’elle l’anime et l’informe, se trouve être une partie intrinsèque et formelle de l’univers, mais en tant qu’elle le dirige et le gouverne, elle n’est pas une partie, elle a valeur non pas de principe, mais de cause. »18. Si l’on se rapporte aux définitions initiales, en tant que principe formel universel, l’âme du monde concourt intrinsèquement à la constitution du monde et demeure tout entière dans la totalité du monde et en toute chose. En tant que cause formelle universelle, elle concourt comme extrinsèquement à la production du monde et elle a son être distinct du monde, elle n’est pas le monde. Mais un nouveau problème nous apparaît : l’intellect universel étant « la faculté la plus intérieure, la plus réelle et la plus propre » de l’âme universelle, celle-ci doit-elle aussi être considérée comme la première cause efficiente, opérant nécessairement ce qu’opère sa faculté ? Il faut répondre oui. Mais il convient de distinguer l’efficience de l’intellect universel, qui consiste à susciter l’infinité des formes des choses de l’efficience de l’âme universelle, qui consiste à être la forme unique et infinie de la totalité. Elle est sa vie.
Quelle est alors la première cause finale, le but de l’efficient ? Il s’agit de l’actualisation de la totalité infinie de ces formes, autrement dit la perfection de l’univers : être tout ce qu’il peut être. Et l’intellect universel « se délecte et se plaît tant à poursuivre cette fin que jamais il ne se lasse de susciter toutes sortes de formes à partir de la matière. »19. Ceci laisse entrevoir une dimension non abordée encore, à savoir la nature essentiellement désirante de l’âme universelle. Le désir est le moteur de tout mouvement et de tout processus selon la philosophie de Bruno, que ce soit dans le domaine ontologique, physique, épistémologique ou éthique.
Il reste un premier principe universel à examiner, qui est la matière. Et l’on entre ici dans ce qui constitue le cœur le plus profondément subversif de la pensée de Bruno. Selon l’ordre des raisons, Bruno reprend les distinctions métaphysiques héritées d’Aristote qui distingue la forme de la matière, dont le composé constitue la substance. Toujours selon l’ordre des raisons, Bruno distingue une matière corporelle et une matière incorporelle, une matière naturelle et une matière artificielle. Mais dans l’ordre de l’être, ces distinctions se ramènent, dans sa conception, à une unique matière principielle, qui n’est pas en puissance, pure passivité réceptrice de formes, mais une puissance en acteengendrant ses formes :
[…] aucun sage n’a jamais dit que les formes fussent reçues par la matière comme du dehors, mais que c’est la matière qui, les expulsant pour ainsi dire de son sein, les produit de l’intérieur. Elle n’est donc pas une prope nihil, une presque rien, une puissance pure et nue, puisque toutes les formes sont contenues en elle et par elle-même produites et enfantées grâce à la vertu de l’efficient (lequel, du point de vue de l’être, peut même ne pas être distinct de la matière).20
Ce que Bruno récuse de la doctrine aristotélicienne, c’est donc la passivité de la matière et, en conséquence, l’idée que sa réalité en acte soit tributaire d’une autre instance qu’elle-même. La matière principielle n’est pas potentiellement tout ce qu’elle peut être, elle l’est activement. Mais c’est également la conception néoplatonicienne qui est récusée, car l’indétermination de la matière n’est plus chez Bruno ce qui la définit comme le plus bas degré sur l’échelle ontologique. Elle acquiert, au contraire, une dignité ontologique exceptionnelle car, dans un renversement radical, si la matière est indéterminée ce n’est pas parce qu’elle n’est « presque rien » mais parce qu’elle devient tout :
Comme cette matière est en acte tout ce qu’elle peut être, elle a toutes les mesures, elle a toutes les espèces de figures et de dimensions ; et, parce qu’elle les a toutes, elle n’en a aucune, puisque ce qui est tant de choses différentes ne doit être aucune d’elles en particulier.21
Pour synthétiser, il faudrait donc dire que la substance réelle est l’auto-production par trois causes intrinsèques à un premier principe. Il n’est pas aisé de rendre compte de cette idée sans recourir à des formulations qui semblent paradoxales et qui paraissent entrer en divergence avec les définitions dont on est parti. A ce niveau spéculatif, ces définitions générales ont été quelque peu bouleversées. Elles demeurent cependant valides : c’est la distinction entre l’intrinsèque et l’extrinsèque qui n’a plus de sens au sein de cette matière intelligente et proprement vivante. La matière est la matrice active de l’univers, l’âme en est le principe vital, l’intellect en est l’efficient créateur de formes, mais ces trois instances sont une seule et même réalité substantielle considérée selon des raisons distinctes. Son principe vital est ce qui permet à la matière d’être son propre efficient, d’être l’agent et le sujet unique de la totalité infinie de ses déterminations. La puissance de faire et la puissance d’être fait coïncident et rien ne les limite. A l’échelle de l’infini spatial et temporel, toutes les formes sont toujours déjà « s’actualisant », tous les possibles sont toujours déjà « se réalisant ». La perfection universelle n’est pas un telos à atteindre mais toujours déjà atteint. C’est pourquoi la matière de cette perfection s’auto-produisant n’est pas une chose : elle est, écrit Bruno, « un être divin dans les choses »22.
Mais qu’est-ce que l’être dans cette perspective ? C’est l’unité de la substance (matière/forme/vie), le tout qui est, éternel et infini. Les individus concrets, quels qu’ils soient, pierre, arbre, fourmi, homme ou planète, sont les modes singuliers d’être, pluriels, finis, temporels et changeants de la substance23. L’unité de l’être et la multiplicité de ses développement particuliers, instanciée dans une infinité de choses singulières, s’articulent dans le continuum d’une participation hiérarchisée mais radicalement immanente. L’être unitaire n’est ontologiquement ni antérieur ni extérieur à l’infinité multiple de ses façons d’être. Mais plus encore, l’unité, comme totalité de l’être, ne serait rien sans la multiplicité et la diversité de ses conditions et circonstances d’être en lesquelles il s’explique.
[…] tout comme l’âme (pour reprendre une façon de parler commune) est présente dans la totalité de cette grande masse à laquelle elle donne l’être tout en restant indivise de sorte qu’elle est identiquement présente tout entière dans le tout et en n’importe quelle partie, de même l’essence de l’univers est une et dans l’infini et en n’importe quelle chose prise comme membre de l’univers ; de sorte que substantiellement, le tout et chacune de ses parties ne font qu’un. […] du plus bas degré jusqu’au degré suprême de la nature, depuis la totalité naturelle que connaissent les philosophes jusqu’à l’archétype auquel croient les théologiens, si tu y tiens : on parvient alors à une seule et même substance originelle et universelle du tout, qu’on appelle l’être, le fondement de toutes les espèces et formes diverses. […] C’est pourquoi tout ce qui fait la diversité des genres, des espèces, des différences, des propres, tout ce qui consiste dans la génération, la corruption, l’altération et le changement n’est pas l’être, n’est pas l’essence mais condition et circonstance de l’être ou de l’essence, lequel est infini, immobile, substrat, matière, vie, âme, vrai, bon.24
Pour conclure, il faudra dire que la cause (la forme ou l’âme) et le principe (la matière) ne sont pas seulement indissociablement conjoints : ils coïncidents dans l’un, suprême agent et patient de lui-même, l’un qui est le tout et qui est en tout. Voilà, avait annoncé Bruno au tout début, « d’où il faut partir avant de vouloir pénétrer dans la connaissance plus spécifique et plus appropriée des choses ». Cette connaissance constitue le fondement réel de notre connaissance des choses réelles. Il faut partir de là. Mais, une fois cette connaissance acquise, et le livre terminé, il nous faut bien entendre aussi, qu’il faut partir de là. Une fois ce fondement établi, il ne faut pas y demeurer, comme fasciné par ce que l’on comprend et frustré de ce que l’on ne peut pas comprendre. La formulation de Bruno en italien le dit littéralement, « bisogna uscire », il faut « en sortir ». Il faut en tirer des conséquences théoriques et pratiques, en produire de bons fruits, afin de rendre meilleures, autant que faire se peut, nos existences individuelles et collectives.
Conclusion
L’entreprise des directeurs de la collection « Giordano Bruno » aux Belles Lettres, Yves Hersant et Nuccio Ordine, est aussi ambitieuse qu’elle est indispensable. Depuis 1993 – outre la sous-collection des « Documents »25 – il s’agit de produire la première édition bilingue, et mieux encore, l’édition bilingue de référence des Œuvres Complètes du Nolain. Entre 1993 et 1999, les œuvres en italien de Bruno ont été traduites et publiées, accompagnées d’un appareil critique de qualité. Elles sont en cours de réédition. Il reste encore toutes les œuvres en latin, c’est-à-dire, quantitativement, la majeure partie de l’œuvre brunienne. Si la pensée de Bruno n’est pas aisée à saisir, sa langue latine, à l’image de sa langue italienne, d’une incroyable richesse et variation de formes et de registres, n’est pas facile à restituer. Or, on ne comprend la pensée d’un auteur que par sa langue et sa langue que par sa pensée. C’est pourquoi traduire les textes de Bruno, avec l’exigence conceptuelle et l’attention littéraire qu’ils imposent, est d’une difficulté redoutable. Il faudra donc patienter encore.
En dépit des réserves que nous avons pu formuler à propos de cette nouvelle édition du De la causa, principio et uno – d’un volume peu justifié et d’un prix justifié mais assez décourageant –, il faut saluer avec enthousiasme cette parution, plusieurs fois repoussée au cours des dernières années. Giordano Bruno est un auteur célèbre qui est très peu lu. Son histoire et son sort tragique ont davantage assuré sa postérité que la connaissance de sa philosophie. La nouvelle disponibilité de cette œuvre majeure, dans l’édition bilingue de référence, est une opportunité pour ceux qui ne la connaissent pas encore et une grande satisfaction pour ceux qui la connaissent et souhaitent que d’autres puissent la découvrir.
- Giordano Bruno De la causa principio et uno / De la cause, du principe et de l’un, éd. bilingue, texte établi par Giovanni Aquilecchia, trad. fr. par Luc Hersant, Paris, les Belles Lettres, coll. « Giordano Bruno – Opere complete / Œuvres complètes », 2e éd. revue et corrigée, 2016.
- On lui doit déjà la traduction, l’introduction et le commentaire de l’édition allemande du De la causa (Felix Meiner Verlag, 2007). Il faut signaler la récente parution de son dernier ouvrage, une véritable somme (1972 pages en deux volumes) sur la philosophie de l’Humanisme et de la Renaissance, conçue suivant une méthodologie originale : Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance : 1350-1600, Hamburg, Felix Meiner Verlag, janvier 2017.
- Successivement : la cena de le Ceneri (Le souper des Cendres), De la causa, principio et uno (De la cause, du principe et de l’un), De l’infinito, universo e mondi (De l’infini, de l’univers et des mondes), Spaccio della bestia trionfante (Expulsion de la bête triomphante), Cabala del cavallo pegaseo (Cabale du cheval pégaséen) et De gli eroici furori (Des fureurs héroïques)
- De l’infinito, « Épître liminaire », éd. bilingue Les Belles Lettres, 2006 (2e éd.), p. 40.
- Ibid., 3e dial., p. 238.
- Selon Bruno, cette déformation s’est opérée à partir des problèmes posés et non résolus par Aristote, multipliés par ses successeurs, réinterprétés et amplifiés par la doctrine chrétienne, complexifiés par la scolastique, menant la philosophie à n’être plus, au XVIe siècle, qu’une pédante, stérile et néfaste caricature d’elle-même.
- Cena, Épître liminaire, p.10.
- De la causa, 5e dial., p. 316.
- Il s’agit de Michel de Castelnau, l’ambassadeur de France à la cour d’Élisabeth 1re, que Bruno a accompagné en Angleterre pour échapper à une situation devenue peu sûre pour lui en France.
- Ibid., Épître liminaire, p. 30.
- C’est la thèse que développait un des textes latins antérieurs, De umbris idearum (De l’ombre des idées).
- De la causa, Épître liminaire, p. 8.
- Ibid., 2e dial., p. 108.
- Ibid., p. 110-112.
- Ibid., p. 112.
- Ibid..
- Ibid., p. 116.
- Ibid., p. 122.
- Ibid., p. 120.
- Ibid., Épître liminaire, p. 22.
- Ibid., 4e dial., p. 244.
- Ibid., 4e dial., p. 266.
- Même si l’on perçoit le lien conceptuel qui les relie, il ne faut pas comprendre la conception de Bruno à la lumière rétrospective de Spinoza.
- Ibid., 5e dial., p. 284-286.
- Luigi Firpo et Alain Philippe Segonds, Le procès, 1993 (2014) ; Maria Cristina Figorilli, Per una bibliografia di Giordano Bruno (1800-1999), 2003 ; Giovanni Aquilecchia, Giordano Bruno, 2007 ; Nuccio Ordine, Trois couronnes pour un roi, 2011 (2017).








