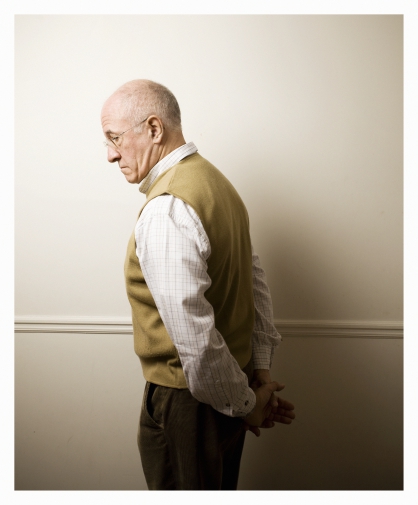Professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et à l’université de Munich, spécialiste de la philosophie médiévale arabe et juive, membre de l’Institut, polyglotte, Rémi Brague est l’auteur d’une vingtaine de livres, dont Europe, la voie romaine (1992), La sagesse du monde (1999), La Loi de Dieu (2005), Le règne de l’homme (2015). Erudit autant qu’éveilleur, ce n’est pas le moindre de ses mérites que d’avoir voulu s’adresser au plus grand nombre via des essais lumineux et roboratifs et dont il espère, écrit-il dans l’avant-propos du Règne de l’homme, qu’ils pourront « fournir au lecteur de quoi vérifier qu’[il] n’extrapole pas trop par rapport à ce qu’on peut aller vérifier, et l’assurance qu’il pourra [le] piller en toute sécurité. »
Actu-Philosophia – Cher monsieur Brague, si Actu Philosophia m’a demandé de faire cet entretien avec vous, à moi qui ne suis qu’un gueux en philosophie, c’est parce que l’on a considéré qu’un lecteur fervent de vos livres, j’allais dire « un civil », pouvait avoir une approche plus directe de votre œuvre et être, plus qu’un professionnel de l’université, susceptible de mieux comprendre de l’intérieur les enjeux existentiels que vous y développez. Vous lire, en effet, ce n’est pas simplement affermir sa culture philosophique et religieuse, c’est trouver des réponses claires et profondes à des questions, parfois naïves, que l’on se pose vraiment et qui dépassent largement la simple érudition. C’est se confronter aux problèmes fondamentaux de sa propre présence au monde, sinon de sa survie. C’est interroger ses bonnes ou mauvaises croyances à l’aune des hautes vérités métaphysiques qui grâce à vous se révèlent à la portée de tous. C’est se demander où l’on en est avec l’amour que nous avons (ou pas) de la vie, et comme vous le dites-vous-même, savoir si la vie est suffisamment une bonne chose pour avoir envie de la donner. C’est enfin prendre le risque, qui est toujours un bonheur, du conflit intellectuel et spirituel avec tel ou tel – vos essais étant, derrière leur apparence « débonnaire », redoutablement polémiques. L’on pourrait dire de vous ce qu’André Maurois disait de Chesterton (dont nous allons d’ailleurs parler tout à l’heure) : « Après trois pages de Brague, le sang et les idées circulent mieux ».
I – Sur La loi de Dieu (Gallimard, 2005)
AP – Dans La sagesse du monde, vous étudiiez comment l’agir humain a d’abord été pensé en fonction du cosmos. L’univers était « le précepteur de l’homme ». La loi était avant tout physique et mythique. Dans La loi de Dieu, vous examinez comment ce même homme a eu, après coup, besoin non seulement du cosmos mais aussi du théos pour se définir. De « naturelle », la loi est devenue « divine », et, de fait, on est passé de la « cosmonomie » (la loi à partir du monde) à « l’hétéronomie » (la loi à partir de l’autre, en l’occurrence, de Dieu). Dit plus poétiquement ou plus psychologiquement, cet ouvrage explique comment nous sommes passés de la mère nourricière et terrestre au père céleste et législatif. Et cela avant la révolution moderne, « prométhéenne » ou, si l’on veut se faire peur, « satanique », de « l’autonomie » qui aura lieu en Europe à partir de la Renaissance.
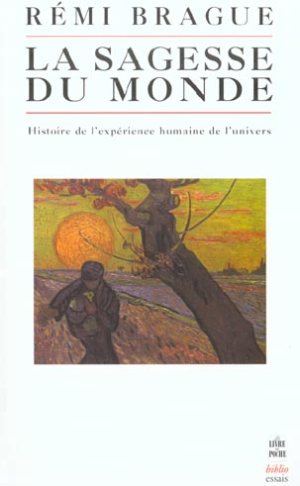
Ma première question sera donc triplement morale, culturelle et diabolique : Pourquoi l’homme aurait-il besoin d’une loi divine pour se définir et se gérer ? Pourquoi une loi humaine ne serait-elle pas suffisante ? Pourquoi ce qui viendrait de nous serait forcément mauvais ?
Rémi Brague – Tout dépend de ce que l’on veut faire et de ce dont on a besoin pour le faire. C’est comme dans une voiture : vous n’avez pas besoin de passer la surmultipliée si c’est pour ne rouler qu’à 30 à l’heure ; sur autoroute, en revanche, il vaut mieux le faire. Une loi humaine est parfaitement suffisante là où il s’agit seulement d’assurer la coexistence pacifique des hommes entre eux en formulant des règles. Je dirais même que prétendre que c’est une loi divine qui réglemente le quotidien, que Dieu s’occupe directement de la façon dont nous devons manger, nous laver, nous habiller, etc. me répugne. Dieu, tel que je me le représente, fait confiance à l’homme, à qui il a donné la raison et la liberté ; il n’intervient que pour révéler à l’homme ce que celui-ci n’aurait pas pu trouver tout seul. Ce qui vient de nous est-il « mauvais » ? Non, si l’on me dit d’abord : « bon » à quoi ?
Ce dont nous avons besoin n’est pas une loi qui nous dise comment il est bon d’agir, mais une légitimation de notre existence même, qui nous dise qu’il est bon d’être.
AP – Cette légitimation vient donc d’ailleurs et même d’autrui. Mais puisque nous nous sommes, pour une large part, et depuis maintenant à peu près trois siècles, affranchis de cet Autre qu’est Dieu, comment pouvons-nous y revenir ? Pouvons-nous réellement revenir en arrière ? Pouvons-nous rendre le feu de Prométhée ?
RB – Le bavardage sur l’impossibilité de revenir en arrière, de « faire tourner à l’envers la roue de l’histoire » repose sur une confusion assez courante, mais très grossière, entre l’irréversibilité du temps et celle de ses contenus. Bien sûr, on ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu. Mais on peut revenir à un état de choses antérieur. Je dirais même : Dieu merci ! L’Allemagne est revenue à la démocratie en revenant en arrière après le nazisme, la Grèce après les colonels, l’Espagne après le franquisme, et la Russie après soixante-dix ans de léninisme, etc. Revenir en arrière est la conduite la plus intelligente quand on s’aperçoit qu’on s’est engagé dans une impasse. Au lieu d’écraser l’accélérateur et d’aller dans le mur, il vaut mieux revenir prudemment à l’embranchement et changer de direction, pour pouvoir continuer.
Quant à Prométhée, attention à ne pas tomber dans le contresens typiquement XIXe siècle qui y voyait le paradigme de la révolte, celui de Marx ou de Victor Hugo. Chez Eschyle, l’histoire ne s’arrête pas avec le Prométhée enchaîné que les hasards de la transmission des textes anciens, eux-mêmes liés aux goûts des critiques littéraires de l’Antiquité tardive, nous ont seul laissé. La trilogie se poursuivait par un Prométhée délivré par Héraclès, et s’achevait avec un Prométhée porte-feu. Le héros, réconcilié avec Zeus, devenait une sorte de saint patron de la corporation athénienne des forgerons. La trilogie est un peu l’histoire d’une naturalisation : Prométhée devient athénien, de la même façon que, dans une autre trilogie du même auteur qui, elle, nous est parvenue en entier, les déesses de la vengeance qui commencent par pourchasser Oreste, meurtrier de sa mère et vengeur de son père, s’acclimatent à Athènes sous la forme du tribunal de l’Aréopage.
AP – Le paradoxe épistémologique est que nous nous sommes d’abord pensés selon la nature et la raison (certes sur fond divin mais d’un divin « naturel », physico-mythique), et que nous avons eu « ensuite » besoin d’une divinité supérieure, « biblique », pour légitimer tout ça. Qu’est-ce qui a fait que nous sommes passés de cet ordre divin naturel (et grec) à cet ordre divin historique (et juif) ?
RB – Je ne sais pas trop. D’autant moins que ledit passage a été fort graduel : judaïsme et hellénisme sont en contact au moins depuis Alexandrie, où d’ailleurs la Bible a été traduite en grec. D’autre part, la nature et la raison sont des concepts qui ont permis aux philosophes de penser la loi. Mais jamais ils n’ont réglementé le comportement concret des cités antiques. La vie de celles-ci était saturée de divin, et la piété était indissolublement obéissance aux usages de la cité et culte de ses dieux. Fustel de Coulanges a été l’un des premiers à le souligner. Donc, le passage en question a été aussi une désacralisation de la cité.
AP – Pour Platon, notez-vous, aucun homme n’a jamais créé une loi. Ce sont les rencontres (tukhè) et les coïncidences (sumphora), qui les créent. Mais loin de s’en référer au hasard, il en conclut que ces rencontres et ces coïncidences sont le fait d’un dieu « providentiel », « qui tient le gouvernail ». Le hasard, dont on est en droit de penser comme Nietzsche qu’il est la seule réalité, est-il irrécupérable car trop insupportable pour l’homme ?
RB – Le hasard n’est de toute façon pas un principe agent. Il ne « fait » rien. Le mot n’est qu’un sobriquet pour la coïncidence de séries causales indépendantes constituées de facteurs aveugles, c’est-à-dire irrationnels et inconscients.
Si nous sommes le produit de réalités irrationnelles, comment expliquer notre rationalité ? Et pourquoi devrions-nous continuer de faire de façon consciente et libre ce qui nous a produits sans le savoir ni le vouloir ?
AP – Donc, ce qui nous a produits était aussi conscient et libre que nous, CQFD… L’histoire de la loi serait alors une longue personnalisation qui va de « la loi divine » à « la loi de Dieu », de l’adjectif qualificatif mais impersonnel au nom propre et personnel. Celui-ci sera créateur dans le judaïsme, incarné dans le christianisme, politique dans l’islam.… C’est bien cela ?
RB – En très gros, oui. Sauf que le mot « personnel » est ambigu. Ce n’est pas au même sens qu’un homme et que Dieu sont personnels. L’Egypte ancienne fut plutôt le lieu d’une « désincarnation » (A. Assmann) de la loi, d’abord supposée la parole d’un homme, certes exceptionnel, le roi (pharaon).
Le Dieu de l’islam n’est pas politique en ce sens qu’il serait le garant d’un régime particulier. Même si la quasi-totalité des pays musulmans sont aujourd’hui des monarchies ou des dictatures, une démocratie islamique est tout à fait pensable. Le Dieu de l’islam est plutôt juridique, il est législateur, et même le seul législateur légitime.
AP – La lettre devient sacrée dans le judaïsme, le verbe s’incarne dans le christianisme, le livre est dicté par Dieu lui-même dans l’islam. Le génie du monothéisme ne fut-il pas d’abord celui de la divinisation de l’écriture – et cela même si les Grecs avaient Homère ?
RB – Ils avaient Homère, dans lesquels les enfants grecs apprenaient à lire. Mais ils n’avaient pas de texte doté d’une autorité divine. Les païens tardifs s’en sont bricolé un avec les Oracles Chaldaïques, que les néoplatoniciens tardifs prenaient pour une sorte de message révélé. Ils y retrouvaient d’ailleurs d’autant plus facilement leurs idées que le texte avait été composé exactement pour cela.
AP – Divinisation de la parole, donc, et, parallèlement, entrée de Dieu dans l’Histoire ?
RB – Peut-être, mais aussi, ou plutôt, si j’ose dire, « parolisation » du divin, « verbalisation », si vous préférez, du divin. Cela veut dire que le divin n’est plus une force obscure, du « numineux » comme disait Rudolf Otto, mais un discours qui a un sens, qui s’adresse à l’homme, lequel est donc supposé pouvoir le comprendre. La création n’est plus représentée sur le modèle d’une fabrication, par exemple sur celui du meurtre d’un gigantesque animal primitif dont le cadavre découpé forme le ciel et la terre, comme dans le mythe babylonien – mais comme un acte de parole, un ordre donné à ce qui n’est pas encore. L’ennui du terme de Big Bang pour désigner l’origine de l’expansion de l’univers, terme dont je rappelle qu’il était au départ ironique, est qu’une explosion produit un bruit dépourvu de sens. L’Evangile de Jean, en son premier verset, dit que ce qu’il y avait au commencement n’était pas un bruit, mais du logos, du sens, du rationnel.
AP – Je ne trahis pas vos analyses en disant qu’Israël naît de l’exode, la chrétienté de la romanité, l’islam de la conquête arabe ? Le Juif sera donc errant, le chrétien impérial (« sur place », allais-je dire), le musulman national (« nation » = umma) et d’ailleurs international ?
RB – Il faut distinguer selon les époques. L’israélite de l’ancien Israël se comprend comme fils d’un « araméen errant » (Deutéronome, 26, 5) installé sur une terre bien à lui. Son histoire commence par un exode, puis se continue par une sédentarisation. Le juif d’après la destruction du Temple se comprend comme lancé dans un second exil. En fait, la dispersion avait commencé bien avant, des communautés juives, poussées par la pression démographique, s’étaient installées sur tout le pourtour de la Méditerranée pour y commercer.
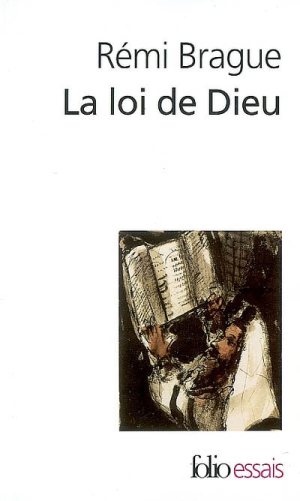
La chrétienté s’est effectivement logée dans le monde romain, mais avait dès le début une vocation universelle. D’où la mission des premiers apôtres, qu’on a longtemps crue légendaire, et qui a peut-être un fond de vérité, vers les Indes, voire vers la Chine. Le christianisme déborde la chrétienté historique et se propose à tout homme.
AP – Peut-on dire alors que politiquement le Juif a tout perdu, le chrétien tout gagné, le musulman tout pris (« Allah paie », dites-vous) ?
RB – Ma formule est raide, je le reconnais. Mais elle ne vaut que pour le premier siècle de la conquête arabe, pour lequel elle ne fait au fond que synthétiser les résultats d’historiens que je cite comme Hichem Djaït. Je cite également un court texte d’un musulman qui voit dans l’enrichissement fantastique des conquérants arabes, partis de rien, d’une « vie de sable et de poux », et devenus en Syrie ou en Irak de gros latifundistes, une preuve de la vérité de l’islam 1
AP – Au fond, par l’Alliance, l’Incarnation et la révélation coranique, Dieu est devenu un intime qui donne sans cesse de lui-même ? Le rapport avec Lui, bien plus que « légal » est assurément « partenarial », sinon passionnel, amoureux… On aime Dieu bien plus qu’on aimait Zeus ou même Aphrodite ?
RB – A vrai dire, ce qui change est bien plutôt le fait que Dieu soit Celui qui nous aime, et d’une certaine façon. Ce n’est pas un amour passionnel, comme les affaires des Olympiens avec des mortel(le)s. Il n’aime pas non plus en faisant d’un individu ou d’un peuple son chouchou auquel il passe tout – on n’a pas de peine à démasquer derrière l’élection divine une stratégie de légitimation, par exemple quand un roi se déclare favori d’un dieu. Le nom de David, probablement Dôd-YHWH (« chéri de YHWH ») en est un exemple. Le Dieu biblique aime ceux qu’Il aime comme un père, c’est-à-dire aussi comme un éducateur qui cherche à élever jusqu’à lui.
L’amour de Dieu pour l’homme n’a pas beaucoup de place dans le Coran. Le mot y figure. Dieu aime ceux qui l’aiment, et hait ceux qui lui associent d’autres êtres (XL, 10). L’image nuptiale des rapports de Dieu avec son peuple n’y figure pas, pas plus que l’idée d’alliance qu’elle illustre.
AP – Et c’est ici que vous faites cette comparaison « osée » qu’on retrouvera dans vos autres livres et qui est au cœur de la compréhension que vous avez de la « la loi de Dieu ». Celle-ci est plus « un kit de survie » qu’un arsenal juridique contraignant et tyrannique et tel que beaucoup de croyants sincères se l’imaginent. Le Décalogue, expliquez-vous, n’est pas plus pesant que « le règlement d’un immeuble ». C’est un code général de bonne conduite qui ne possède pas de singularité particulière. Doit-on alors considérer que dans cette « loi de Dieu », l’essentiel n’est pas tant la loi, somme toute assez banale, que sa personnalisation en « Dieu » ? La loi, « pré-texte » de Dieu ?
RB – La comparaison, que je risque avec un sourire, du décalogue avec le règlement d’un immeuble n’a pas pour pointe de montrer que le joug de la loi serait lourd ou léger. Elle sert à montrer que la loi biblique n’est pas une série d’ordres qui tomberaient du ciel et qui ne nous apprendraient rien sur Dieu. Au contraire, elle enseigne quelque chose sur la façon d’agir de Dieu. Connaître le règlement d’un immeuble permet de savoir comment se comporte le propriétaire.
AP – Le judaïsme fonde sa communauté sur le respect de la loi, le christianisme sur la seule foi. Et l’islam ?
RB – Le judaïsme et l’islam, qui sont des religions de la loi, ont également une forte dimension de peuple. La judéité se transmet par filiation, par la mère pour laquelle celle-ci est incontestable. Ce pourquoi il est très difficile de se convertir au judaïsme. L’islam constitue une « nation », en arabe umma, mot qui vient de la racine du mot « mère » — un peu d’ailleurs comme le latin natio, qui signifie originellement la portée d’un animal. Là, la conversion est au contraire très aisée, puisque l’islam est censé être la religion originelle de la famille humaine tout entière, dès Adam, et même avant la création du monde (Coran, VII, 172). Il combine donc une vision familiale de l’humanité avec un universalisme.
AP – Beaucoup de gens, chrétiens ou non, ont du mal à comprendre que dans les Epîtres, Paul parle parfois au nom de Dieu et parfois au nom de lui-même, et qu’il faut savoir faire la différence, comme par exemple sur la question du voile, entre les commandements divins et les conseils purement humains.
RB – Paul fait le départ entre ce qu’il dit, lui, et ce que dit le Christ, à propos des règles du mariage (1 Corinthiens, 7, 10.12). Le Christ lui-même présente ses exigences sous forme d’une hypothèse quand il dit au jeune homme riche : « si tu veux être parfait… », et non « sois parfait ! » (Matthieu, 19, 21). La question n’est pas de savoir si le voile dont parle Paul (1 Corinthiens, 11, 5) est un commandement ou un conseil. Même s’il constituait un commandement, il ne serait couvert que par l’autorité de Paul, un homme situé à une époque et dans une culture déterminés, avec des habitudes vestimentaires déterminées. On pourrait donc comprendre : habillez-vous décemment, selon les modes de votre époque. Le commandement coranique, en revanche, est censé être dicté par Dieu, qui est éternel et qui sait tout. Il faut donc s’exécuter.
AP – Question délicate : quid des versets pauliniens sur l’homosexualité ? Commandements ou conseils ?
RB – A vrai dire, ni l’un ni l’autre. Il n’était pas nécessaire de revenir sur l’interdiction des pratiques homosexuelles, qui était déjà assez claire, et même assez raide, dans la Torah. Paul ne dit donc pas que l’homosexualité est un mal et ne condamne personne. Il y voit le signe d’une inversion des rapports de l’homme à Dieu typique du paganisme des Romains, l’homme se soumettant la vérité divine, la tenant comme captive. Gaston Fessard a écrit là-dessus des pages profondes 2
AP – Le point capital, c’est l’interprétation des textes. La Bible est inspirée par Dieu mais écrite pas des hommes (forcément faillibles), elle est donc interprétable. En revanche, comme vous le rappeliez à l’instant, le Coran est dicté par Dieu lui-même, il est donc infaillible, et par conséquent difficilement interprétable, sinon inimitable. On ne va pas annoter Dieu ! Pourtant, vous rappelez que l’interprétation (tafsîr) était couramment pratiquée au début de l’histoire de l’islam. C’est après qu’elle est devenue suspecte (dès le Ier siècle, quand même). Que s’est-il passé pour que le diable impose aussi rapidement sa littéralité mortifère ?
RB – L’interprétation n’a jamais cessé en Islam, depuis Tabari, dont le commentaire est le premier à nous être parvenu en son intégralité. Certains commentaires tardifs sont restés célèbres, comme celui du Manâr, dans l’Egypte de la fin du XIXe siècle. Ce qui a été suspecté dans l’islam sunnite, c’est l’interprétation allégorique (ta’wîl) qui risquerait de relativiser les exigences de la sharia.
Mais il faut s’entendre sur le sens du mot « interprétation ». Le gros problème est que le Coran est censé avoir été dicté mot-à-mot par Dieu. Il a donc pour auteur Dieu, et en aucun cas Mahomet qui n’aurait fait que transcrire. Dans aucun cas on n’a tenté de pratiquer l’interprétation au sens qui est le nôtre, et qui est modelé sur la pratique juridique du jugement d’équité. Il s’agit de remonter de la lettre d’un texte de loi à son « esprit », aucun législateur humain ne pouvant prévoir tous les cas possibles. Si le législateur est Dieu, interpréter ne pourra consister qu’à se demander ce que les mots désignent. Dans le cas du voile, que je viens de mentionner, on pourra varier la longueur et l’opacité du voile, mais voile il y aura…
AP – C’est Chesterton, dans Hérétiques, qui a dit que « tout était d’origine chrétienne sauf le christianisme qui est d’origine païenne » 3, et c’est Simone Weil dans Lettre à un religieux qui a montré les dizaines d’occurrences qu’il y avait entre le christianisme et les mythes antiques : affinité entre le pain et Déméter, le vin et Dionysos, le Christ avec Osiris, et même l’idée qu’ « au moment où le Christ a été crucifié, le soleil était dans la constellation du Bélier ». Autant de signes que la rupture chrétienne fut d’abord une rupture avec le judaïsme plutôt qu’avec le paganisme. Vous-même écrivez que « le christianisme sort du judaïsme, au double sens qu’il provient du judaïsme et le quitte – expulsion et sécession. » 4. Comment se débrouiller avec tout cela ?

RB – La situation est en effet complexe. Si la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, s’est fait homme en Jésus de Nazareth, et que celui-ci, comme le dogme le proclame, est « vrai Dieu et vrai homme », alors il devra assumer en lui la totalité de la nature humaine. Et celle-ci est spontanément « païenne ».
Je ne cesse de méditer une formule de C. S. Lewis selon lequel l’histoire du Christ est un mythe qui a eu lieu. Non pas un mythe qui contient de « profondes vérités », ce qui ne mange pas de pain, mais bien un mythe qui est arrivé. Son histoire a toute la richesse d’un mythe classique, mais en même temps elle est arrivée en un lieu précis, à une date précise. Les mythes grecs, par exemple, n’ont pas de date. Il serait absurde de se demander si c’est avant ou après la Guerre du Péloponnèse que Zeus a enlevé Ganymède. En revanche, la Passion a eu lieu « sous Ponce Pilate ». On comprend pourquoi Paul-Louis Couchoud disait qu’il acceptait tout le Credo, sauf justement ces trois mots, qui interdisent que l’on réduise l’événement à un pur symbole.
AP – Je me demande si cette rupture initiale n’en suscite pas une autre entre les catholiques, qui acceptent volontiers la dimension païenne du christianisme, et les protestants, de ce point de vue-là plus « juifs » que les premiers, à qui elle fait horreur ?
RB – Croire que les catholiques acceptent la dimension païenne du christianisme est déjà une façon de voir protestante… et qui suppose une double caricature, du paganisme et de l’Eglise catholique.
AP – A propos de rupture ou d’abolition, pourriez-vous nous expliquer cette phrase mystérieuse du Christ : « je ne suis pas venu abolir mais accomplir la loi ».
RB – Je ne prétends en effet pas apporter mon écot à l’exégèse de cette phrase en effet obscure. Elle se trouve dans l’Evangile selon saint Matthieu (5, 17). Aucun juif pieux, et Jésus provenait d’un milieu très observant, n’aurait songé à l’époque abolir la loi, ni en sa totalité, ni même en une de ses dispositions. Maintenant, « accomplir » (plèroun) peut signifier bien des choses. Soit simplement se soumettre, soit porter à une plénitude qui implique une sorte de débordement.
AP – Et tant que j’y suis, pourquoi dites-vous que la célèbre phrase de Saint Augustin « aime et fais ce que tu veux » est « ironique » 5 ?
RB – Je le dis moi-même ironiquement, sans nullement prétendre que saint Augustin la prenait ainsi. Je veux dire : aimer, vaste programme ! Le verbe est court, il est fréquent, tout le monde croit le comprendre. Mais rien n’est plus difficile que d’aimer authentiquement.
AP – Pour revenir à la sécession entre christianisme et judaïsme, l’autre raison fondamentale de celle-ci n’est-elle pas dans l’idée paulinienne, d’ailleurs inspirée des Grecs, que la loi est dans le cœur de chacun – y compris de ceux qui n’en ont jamais entendu parler ? Autrement dit, les juifs n’en ont plus l’exclusivité. Quiconque a une conscience morale peut l’accomplir sans la connaître. On comprend qu’ils l’aient eu mauvaise, non ?
RB – Le judaïsme classique a lui aussi une réponse à la question de savoir pourquoi il y a des gens tout à fait décents qui ne respectent pas la Torah de Moïse, parfois parce qu’ils n’en ont tout simplement pas la moindre idée. Il ne fait pas appel, comme Paul, à la notion de conscience, empruntée au vocabulaire stoïcien. Cette notion est dans le judaïsme, comme d’ailleurs dans l’islam, peu utile, voire carrément suspecte. Yeshayahu Leibowitz disait même qu’elle était étrangère au judaïsme. Quoi qu’il en soit, le judaïsme préfère expliquer que les non juifs, les « gentils », sont eux aussi soumis à une loi, mais édictée avant celle de Moïse. Ce sont les sept commandements qui auraient été donnés à Noé au sortir de l’arche. Les générations précédentes ayant été nettoyées par le déluge, celui-ci est donc l’ancêtre de tous les hommes actuellement vivants. Ses commandements s’imposent donc à tout homme. Ils sont d’ailleurs extrêmement intéressants et constituent une sorte de minimum anthropologique : on y trouve l’interdiction de l’inceste et la cuisine.
AP – « Minimum anthropologique » – cela signifie-t-il que la loi peut se « traduire » dans toutes les langues et se retrouver dans tous les cœurs, autrement dit qu’elle n’est plus affaire de lettre mais d’esprit ?
RB – Oui. Mais attention. Les Juifs reprochent souvent aux Chrétiens d’avoir abandonné la Torah de Moïse, ce qui est en partie vrai. Disons que les Chrétiens en ont relativisé ou allégorisé la plupart des commandements. Certains y voient une pure et simple « anomie », un rejet de toute loi. Cela n’est pas vrai, mais cela représente une tentation constante et pas toujours tenue en respect : confondre l’amour qui accomplit parfaitement la loi avec un vague sentimentalisme qui se croirait dispensé des obligations les plus élémentaires de la morale.
AP – Pire – ou mieux : non seulement la loi peut être reçue par toutes les cultures mais encore la notion de « culture » naît dans ce mélange d’idées, d’affects et de forces. La culture, invention paulinienne, allez-vous jusqu’à avancer ?
RB – Cette thèse volontairement provocatrice ne veut évidemment pas dire que Paul, ou le christianisme en général, aurait inventé la poésie, etc. Certains ont fait mine de le croire et se sont indignés devant une telle énormité. J’avais pourtant essayé d’être clair. Je veux dire qu’une culture qui ne serait que culture, qui serait déconnectée de la religion dans laquelle elle baignait de manière à pouvoir coexister avec une autre, est rendue possible par le reflux de la Torah, laissant libre un espace qu’une culture (droit, philosophie, etc.) profane va pouvoir remplir.
AP – Sur bien des points, l’islam n’est-il pas un retour au judaïsme primitif dans la mesure où pour lui, nul ne peut connaitre la loi sans livre et nul ne peut lire le livre sans comprendre l’arabe ?
RB – Ce qui est vrai est que l’islam a repris des pratiques primitives. On raconte même que Mahomet aurait rappelé aux juifs de Médine que la Torah prescrivait de lapider les adultères et les aurait mis en demeure de montrer le passage afférent de la Torah. Or, le judaïsme avait considérablement atténué cette disposition de la loi de Moïse, et les juifs auraient voulu cacher le passage. Mahomet l’aurait alors exhibé et appliqué. Les coupables auraient alors été lapidés.
AP – Au bout du compte, la véritable religion du Livre, c’est l’islam – et dont « le livre », le Coran, a la particularité de se citer et de se sacraliser lui-même, contrairement à la Bible. Le Coran comme livre sacré littéraliste et autoréférentiel – j’allais dire méchamment, mais corrigez-moi si je me trompe, « totalitaire » ?
RB – On pourrait dire en effet « totalitaire » si l’adjectif n’avait pris une coloration péjorative. Il ne l’avait d’ailleurs pas initialement, puisque ce sont les théoriciens du fascisme italien qui l’ont forgé pour désigner la façon dont tout devait se faire par l’Etat et pour l’Etat. L’islam, comme d’ailleurs le judaïsme, a pour idéal la possibilité de répondre de façon précise sur toutes les questions de comportement : pouvoir déterminer en toute circonstance quelle conduite est voulue par Dieu. La différence d’avec le judaïsme étant que la Torah et la halakha qu’on en tire ne vaut que pour le peuple élu, alors que la sharia musulmane vaut pour tout homme. En ce sens, l’islam combine le légalisme juif et l’universalisme chrétien.
AP – Il y a aussi la question du « second verset ». Comme le Coran ne peut par définition se « contredire », lorsque l’on tombe sur deux versets contradictoires, c’est le verset postérieur (celui de Médine) qui doit l’emporter sur le verset antérieur (celui de La Mecque). Le problème est que les versets de Médine, ceux qui ont la primeur donc, ont été écrits dans un moment de politique dure, de guerre, de sanction, si fait que toute la douceur (et la poésie ?) du Coran « première version » ont été édulcorées. Serait-ce possible de « dé-médiniser » (j’allais dire « déminer » !) le Coran et de le re-« mecquiser »?
RB – Le problème est le suivant : d’une part, le Coran affirme que, s’il contenait des contradictions, il ne saurait venir de Dieu (IV, 82) ; or, il en fourmille. Il fallait donc sauvegarder l’origine divine du Livre. La solution est celle que vous dites : considérer que le contenu normatif des versets postérieurs puisse être remplacé par celui des versets antérieurs. La proposition de renverser l’ordre de l’abrogation, en considérant que les versets mecquois, au contenu surtout moral, auraient une valeur permanente, alors que les versets médinois ne porteraient que sur l’organisation de la cité primitive et ne seraient plus d’actualité, a déjà été faite. Ce fut le cas de Mahmoud Mohammed Taha, qui a été pendu pour cela au Soudan, en 1985. Espérons que d’autres reprendront l’idée et auront plus de chance.
On pourra lire la suite de l’entretien ici.
- D. Sourdel, Un pamphlet musulman anonyme d’époque abbasside contre les chrétiens, Revue des études islamiques, 34 (1966), p. 1-33.
- G. Fessard, De l’Actualité historique, I. A la recherche d’une méthode, s.l., Desclée De Brouwer, 1960, p. 186-194.
- Chesterton, Hérétiques, Climats, page 142
- La loi de Dieu, Gallimard, « L’esprit de la cité », page 108
- La loi de Dieu, page 115