Penser le populisme de manière philosophique relève d’une gageure. Vilipendé par une modernité certaine de ses principes moraux et très prompte au dégoût, au rejet, et à la mise au ban de toute opinion ne s’inscrivant pas dans sa démarche, le mot même de populisme est de nos jours entaché d’une réputation négative. Une large partie de l’œuvre de Chantal Delsol, aujourd’hui composée de plus d’une trentaine d’ouvrages, porte sur la situation de l’homme contemporain et la crise de la démocratie moderne. Mettant en évidence l’hébétude et le désarroi dans lequel est plongé l’homme contemporain face aux problèmes existentiels qu’il a désormais à affronter seul, comme sur la scène d’un théâtre vide, la philosophe montre que le seul combat qui vaille est celui qui consiste à assumer les contradictions de la condition humaine et à transformer les figures de l’existence que l’on croit figées. C’est à l’aune de cette exigence qu’elle a entrepris de comprendre le phénomène populiste, dans un livre à la fois dense et exigent. Interroger le populisme n’est pas en faire l’éloge, mais souligner que la crise démocratique dans laquelle se trouve les pays européens peut trouver une explication rationnelle dans cette propension qu’a la modernité de nier à celui que les Grecs nommaient l’idiotès ((l’homme privé, celui qui s’oppose au roi : le simple citoyen) la possibilité d’émettre des opinions contraires à celles qu’elle impose comme étant le Bien.
Dans un précédent ouvrage intitulé Le Souci contemporain, Chantal Delsol examinait l’idéologie à l’oeuvre, selon elle, dans les sociétés occidentales : la promotion d’un individualisme déraciné et hédoniste. L’individualisme d’un individu libéré de toute appartenance, ne souhaitant plus répondre à rien d’autre qu’à ses propres désirs. Cette idéologie est celle de démocraties qui se pensent indépassables et ne doutent absolument pas d’elles-mêmes. Or, véritable miracle en équilibre instable, la démocratie contient un paradoxe : elle est « toujours à défendre, pendant que, comme source de bien-être, elle endort et démotive ses bénéficiaires » 1 Constamment menacée, elle se trouve très souvent en crise, et laisse souvent la place à une sacralisation de ses propres principes. Ainsi déteste-t-elle la vérité et craint les certitudes, tout en se faisant forte de tolérer tous les comportements. Son désintérêt pour les fondements la pousse à n’établir de politique que sur des objectifs à courte vue, ressemblant ainsi aux courants idéologiques les plus obtus. Une forme d’intolérance naît paradoxalement du fait qu’elle se fonde sur l’évidence d’un agrément commun magique, car indéterminé. « La fin des idéologies, écrivait Vaclav Havel, révèle que nous n’attendons plus Godot. Mais nous donnons l’impression, avec la démocratie, d’avoir enfin trouvé Godot. » Cette certitude a pour conséquence l’émergence d’une « rationalité unique » 2, marginalisant tous les mouvements protestataires, les rejetant « sur les bords de l’officialité. » 3 Ainsi le populisme naît-il sur les ruines d’une politique devenue technique, gestion économique au sens ancien de l’administration, l’homme contemporain se révélant indifférent à toute conception anthropologique globale. La démocratie souffre alors d’une « fuite générale du sens » 4, laissant s’effondrer la politique de conviction, pourtant « l’un des plus brillants produits de notre culture. » 5
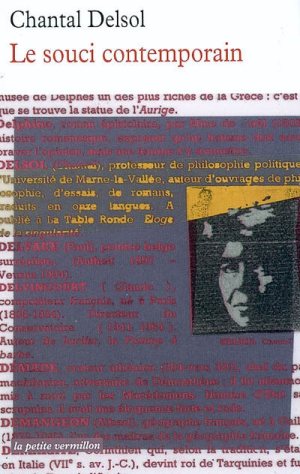
Une des explications du mépris catégoriel d’une frange de la population à l’endroit de ce qu’il est convenu d’appeler le peuple peut sans doute trouver une explication dans l’apparition d’un fossé entre deux sortes de citoyens : d’un côté les défenseurs d’une véritable idéologie de l’émancipation (dont Chantal Delsol montre les fondements) ; de l’autre ceux qui projettent sur le monde un regard fondé sur l’identité, la particularité, et, de fait, revêtent au regard des premiers une forme de rusticité considérée comme de l’imbécillité. Ce sont les raisons historiques et philosophiques du long glissement sémantique qui s’est opéré depuis l’idiotès grec jusqu’au soupçon sur la capacité des peuples à déterminer la nature du Bien que Chantal Delsol analyse dans son ouvrage intitulé Populisme. Les demeurés de l’Histoire. 6, et ce avec la justesse et la profondeur de regard qu’il convient de lui reconnaître.
La thèse du livre est la suivante : l’auteur entend montrer que la vision contemporaine du populisme provient d’un jugement moral posé sur la défense du particulier, de l’enracinement, position que la gauche rejette tout en regrettant, à juste titre, de ne plus être entendue par ce peuple qui fut pourtant sa grande affaire. L’absence de réflexion de fond sur les critères éventuels permettant de suivre ou non la voix populaire – soit, en réalité, sur les fondements même de la démocratie, sur ses limites – donne lieu à une « instrumentalisation qui permet aux gouvernants, selon leur convenance, de mettre le peuple en avant ou au contraire de le réduire au silence. » 7 Or, nous dit Chantal Delsol, comment ce qui est populaire, dans le peuple, a pu devenir aussi décrié ? D’où vient qu’a pu s’installer dans la tête des élites un véritable mépris de classe ?
1- La grande peur des foules
Le personnage du démagogue et de la foule dont il est censé être le chef (selon son sens originel) ont été analysés par les penseurs grecs, de Platon à Aristote, en passant par Homère ou les comédies d’Aristophane, en des textes qui ont constitué le socle même des analyses contemporaines de l’ère des masses. La démocratie grecque a pensé la psychologie des foules, notamment en mettant en évidence non seulement leur versatilité, mais encore cette propension à se soumettre aux promesses chimériques de beaux parleurs. Les nombreux ne pensent pas, leur affectivité étant bien trop prégnante, ils sont privés du noos (la raison). Platon lui-même dénonce la multiplicité qui « entretient les penchants les plus enfantins de l’âme humaine : le désir de s’exprimer spontanément et d’être libre. » 8 La démocratie est le régime des pitres, le règne des opinions capricieuses et des passions : elle est un régime sans grande valeur car accessible à tous. Aristotélicienne, Chantal Delsol souligne que le fondateur du Lycée est le seul penseur grec ayant tempéré cet élitisme repoussant tout espoir d’expression populaire et annonciateur du point de vue contemporain sur le populisme. Faisant preuve d’une grande modernité, celui-ci considère que dans la masse, les lucidités s’additionnent, puisque sa conception du gouvernement se fonde sur la prudence (sagesse humaine) – concept central dans la pensée politique d’Aristote – qu’il croit partagée. 9 Il convient néanmoins de remettre les propos de Platon dans le contexte historique et politique de la société holiste ancienne. Il y a chez Platon un lien très étroit, une appropriation de la politique par la philosophie, dont le rôle majeur est de quêter derrière la « bigarrure des opinions et la multiplicité des relatifs, le logos, ou la parole universelle. » 10
Il s’ensuit une distinction entre deux types d’hommes : l’élite, les meilleurs (aristoi), qu’il oppose au nombreux. Il existe dans la littérature grecque ancienne d’innombrables textes ridiculisant l’inculture des masses. Chez Aristophane, ou bien chez Héraclite, qui compare les nombreux à des animaux, tandis que les hommes meilleurs songent, de leur côté, à l’immortalité. Xénophon s’insurge contre un élargissement du droit de vote, le danger étant de voir les esclaves et les miséreux vendre la ville « pour une drachme ». 11 Il faut lire aussi Platon, qui dans le Gorgias 12 imagine une compétition entre un médecin et un cuisinier arbitrée par un jury d’hommes déraisonnables comme des enfants, c’est-à-dire les nombreux, qui, dans la République 13 ont des jugements « profondément risibles » , ignorants qu’ils sont de l’unité du logos et du bien commun.
Notre conception du populisme se rapproche très clairement de celle des Athéniens : un chef de parti flatte le peuple considéré comme une masse, et le citoyen ordinaire, confit dans son enracinement, est jugé depuis une position qui se veut supérieure. Mais si ce que nous pensons défendre aujourd’hui contre les populistes est le logos des grecs, celui-ci, rappelle Chantal Delsol, est « une vérité introuvée et probablement introuvable. Elle est toujours en attente : un idéal. » 14, c’est un « parcours d’obstacles » 15, car « le dialogue est une aventure, une errance » 16, une constante remise en cause des certitudes acquises. Ces reproches nourrissaient, chez les Grecs, une critique de la démagogie qui ne s’arrêtait pas à l’anathème : elle était une tentative de faire sortir les citoyens de leur statut d’idiotès. Il s’agissait alors d’une question à la fois morale et politique, sans être encore une idéologie. Ce qui s’est joué, à l’ère moderne, c’est la remise en cause de « la raison interrogative primesautière, toujours échappée des certitudes où l’on voudrait l’enfermer, espérant l’absolu comme réalité encore innommée….. […] La raison grecque, qui était l’une des pièces maîtresse d’une anthropologie, est devenue, à l’âge moderne, une idéologie. Le passage de la démagogie ancienne au populisme moderne s’enracine précisément dans cette métamorphose. » 17
2 – Le mépris du peuple
La question même du meneur, du chef demeure une question peu posée dans l’histoire des idées philosophiques, sans doute parce que le populiste est une figure politique qui inspire la crainte : opérant un « rapt » 18 par détournement du « système rationnel-légal » 19, il surgit au cœur même de l’appareil institutionnel démocratique, profitant des déceptions inhérentes à tout système politique basé sur la représentation. Mettant à nue la béance qui sépare gouvernants et gouvernés, le chef populiste est souvent une figure charismatique, qui créé un lien avec le peuple au travers du sentiment de trahison ressenti par celui-ci. Le XIXème siècle vit apparaître des mouvements populaires tels que la Parti du Peuple Américain (ou Parti des Grangers, légaliste) ; ou les Narodniki, jeunes anarchistes qui, en réaction à l’oppression du peuple par la Russie tsariste, allèrent vers celui-ci afin de le libérer de son joug, « sans pour autant lui enlever son mode propre. » 20. Jeunes intellectuels citadins idéalistes, leur idéal fut noble, avant que d’être détourné par le bolchevisme. Mystiques ou athées, socialistes ou nihilistes, romantiques ou rationalistes, « ils se rejoignirent dans une passion souffrante pour le peuple russe souffrant, une apologie de la douleur rédemptrice, l’amour de la justice sociale, l’exaltation maladive et le goût de l’excès en tout. » (ibid.)[/efn_note]. Encore un peu verts, ils n’auraient sans aucun doute rien réussi une fois au pouvoir, mais « la masse des paysans russes ressemblait davantage à leur vision bucolique et communautaire qu’à la vision léniniste du prolétaire délivré de tous ses biens et prêt à abandonner sa formule pour semer par le monde des Lumières dont il n’avait pas aperçu l’amorce de l’avantage. Malgré leur ignorance romantique des réalités, les Narodniki se trouvaient plus proches du peuple que les vainqueurs définitifs de la révolution rouge. » 21 Ils ressemblaient, souligne l’auteur, bien plus à Michelet et à son amour attendri du peuple qu’à un Lénine perdu dans les guerres picrocholines des révolutionnaires sur la question du peuple.
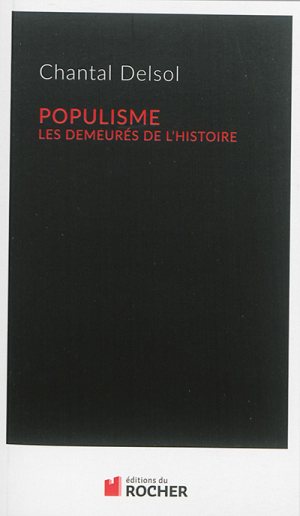
Très subtilement, Chantal Delsol rappelle que dans son livre Que faire? (1902), Lénine s’interroge : le peuple veut-il vraiment son propre bien ? Le connaît-il ? Faut-il l’écouter ? Dans la deuxième partie, voilà qu’il se surprend à comprendre que les masses n’émettent pas toujours les mêmes volontés que les partis : le prolétariat industriel demande syndicalisme, augmentation de salaire et conditions de travail décentes. Le Parti communiste quant à lui, souhaitera abolir le capitalisme et par là même la notion de salariat. Spontanément, les masses, attachées à leurs traditions et à leur religion, s’opposent aux velléités abolitionnistes du parti. Le but des intellectuels communistes sera donc de la remettre dans le droit chemin d’un Bien dont elles ne sont pas encore conscientes. C’est l’invention du bonheur du peuple malgré lui. L’homme réel est dès lors sacrifié à un homme imaginaire, au profit de la révolution totale. Le bolchevisme est donc un « despotisme éclairé » (op.cit., p.74[/efn_note] : le peuple n’est pour lui qu’un concept. Nous retrouvons, affirme l’auteur, cette même « certitude intime » 22 chez les élites contemporaines. La spontanéité du peuple ne compte pour rien, tout est construit. La réalité n’est pas légitime. Le peuple a, en quelque sorte, cette très fâcheuse tendance à décevoir ceux qui veillent sur lui. L’élite communiste « avait nourri des illusions : non pas sur les capacités du peuple, mais sur la vérité de ses propres doctrines. […] Elle voit un peuple qui fait défection. Qui trahit. Qui refuse d’agréer avec reconnaissance une nouvelle vie qu’on lui confectionne. » 23. C’est là, souligne l’auteur, le début de l’histoire du populisme. Confronté au pouvoir, le mouvement communiste ne se souciera plus des aspirations du peuple, et considérera des penseurs comme Plekhanov, qui se plaçait du côté des aspirations populaires (syndicats, libertés, parlements) comme des réactionnaires, puisque validant le monde tel qu’il est.
Le discours populiste a néanmoins subi de nombreuses évolutions, à l’image des situations des populations (les aspirations d’un russe d’avant la Révolution ne peuvent pas être celles d’un homme vivant dans un État de droit, qui cherchera à conserver ses valeurs fondatrices, son identité et ses appartenances), et il est aujourd’hui évident qu’il concentre ses critiques sur l’individualisme moderne, les valeurs familiales, l’entreprise, la vie civique ou encore la bureaucratie d’État, soit une forme de « romantisme de la solidarité perdue avec la modernité. » 24 A cela s’ajoute un combat pour la moralisation de la vie politique, une critique des élites corrompues, et la défense de l’héroïsme, quand la morale dominante est à la victimisation. 25 Déplorant une souveraineté perdue, le populisme contemporain est aussi méfiant à l’égard de l’Europe, globalement hostile à l’Amérique et à la mondialisation. La tendance post-moderne étant à l’effacement des caractéristiques et à l’égalité universelle, le populisme est souvent réduit à un nazisme larvé. L’avènement d’une censure politiquement correcte appliquée aux idées politiques et à leur formulation a conduit tout un chacun à ne plus exprimer ses opinions de manière crue et violente. Cette censure, pour regrettable qu’elle soit dans ses dérives, s’impose tout de même à un moment où il y a quelques raisons historiques de ne pas accepter les appels à la haine, phénomènes courants au XIXème et au début du XXème siècle, où cette contrainte n’existait pas. Peu de courants politiques peuvent, de ce point de vue, revendiquer une absolue vertu. L’auteur rappelle à cet égard un article de 1849 de Engels à propos de la situation des Hongrois, dans lequel celui-ci appelle très clairement à un génocide. 26
Longtemps, le socialisme a vu dans le peuple un allié haïssant le bourgeois et prêt à cette « vie austère et mystique que seule la classe possédante peut imaginer pour les autres. » 27 Mais pendant les trente Glorieuses, beaucoup s’aperçoivent avec émoi que « l’ouvrier français est devenu le petit-bourgeois qu’il avait toujours souhaité devenir (espoir bien compréhensible), et que sa tendance individualiste et méritocratique le détourne du grand élan vers la révolution. » 28 Tourné aujourd’hui vers le Front National, qui n’hésite pas à présenter aux élections des « gens de la rue », même peu expérimentés, le peuple est devenu aux yeux de certains l’insupportable ignorant bouffi d’égoïsme et de rejet de l’autre, attitude dont l’origine semble prendre racine dans ce que d’aucuns appellent son malaise identitaire. Il ne nous est pas permis d’en développer ici les enjeux, rappelons seulement qu’Actu Philosophia consacra un entretien à Vincent Descombes autour de cette question importante 29, et que des philosophes (Alain Finkielkraut), des géographes (Christophe Guilluy), ou des politologues (tels Laurent Bouvet, qui dans un très bon livre consacré à l’insécurité culturelle, tente de sortir de la vulgate bourdieusienne dominant depuis longtemps la question identitaire 30), se sont emparés du sujet.
Tout se passe comme si, aujourd’hui comme peut-être jamais auparavant dans l’histoire des idées politiques, le populisme faisait l’objet d’un rejet violent de la part d’une élite arrogante, considérant le peuple comme un « ramassis d’apostats » 31 sauvages coincés dans un état primitif. Le discours populiste est jugé brutal et rustique, « à la limite de l’humanité normale, c’est-à-dire moderne. » 32 La revendication de la fierté d’appartenance à un village, une région, ou tout simplement aux coutumes d’un groupe humain, dans les milieux populaires apparaît aujourd’hui comme un repli identitaire aussi ridicule qu’une danse folklorique bretonne. Peu importe que le lien avec un passé soit le fruit d’un attachement fondamental, comme l’écrivait si justement la philosophe Simone Weil, dans ses méditations sur l’enracinement : « L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. » 33 L’homme contemporain ne retient pas les meilleures leçons, et Chantal Delsol de ne pas y aller par quatre chemins : « L’idéologie universaliste et émancipatrice exerce un monopole, laissant penser que l’enracinement est fait pour les ploucs. Finalement, la démocratie qu’apportent les Lumières n’est faite que pour les happy few : elle exige des citoyens « éclairés », c’est-à-dire conformes aux Lumières, et rejette les autres. » [op.cit., p.237[/efn_note]
3 – Le dogme de l’émancipation
Chantal Delsol nomme « nouvelle dogmatique de l’Occident » 34 cette propension des sociétés contemporaines à préférer l’émancipation à l’enracinement, qui est pourtant la « situation de l’homme de toujours » 35, s’identifiant à un territoire, une culture, auprès desquels il estime avoir contracté une « dette impayable ». 36 L’homme nouveau, son contraire, souhaite se détacher de ses racines temporelles et spatiales, afin d’inventer son propre destin, délivré de tout exemplum¬. Plus l’émancipation accroît son hégémonie sur les esprits, plus l’enracinement est vilipendé, discrédité. Les Lumières n’ont pas inventé le concept d’émancipation, mais l’idéologie émancipatrice, faisant de la libération de toute racine un absolu. Toute critique de ce progrès se voulant inéluctable devient de fait apostasie. Tout ce que préconise l’idéologie émancipatrice « prend une valeur cosmique » 37 : elle ne connaît que des hommes se définissant eux-mêmes, sans patrie, sans clan. Elle « arase, s’il le faut, la diversité des mœurs, pour étendre sa loi aussi loin qu’il est possible. « 38 L’homme ancien tenait le sens de sa vie d’une religion commune tenant compte de son enracinement, elle était le contraire d’un peuple-concept et « honorait la réalité du monde (trop, dirait certains) » 39 ; l’homme pouvait « s’approcher d’elle en solitaire, mû par un idéal de sainteté. » 40 Entre conceptualisation et transcendance s’ouvre, affirme Chantal Delsol, un béance que Levinas discernait entre infini et totalité. La foi cherche l’infini hors le monde et non la totalité en ce monde. Plusieurs phases ont conduit à l’effacement de la transcendance en Occident : la première, au XVIIIème siècle, a vu une bourgeoisie prendre le pouvoir sur une aristocratie assise sur la tradition ; la deuxième a vu, au XIX ème siècle, une élite bourgeoise se heurter à une révolte prolétarienne conceptualisée dans le socialisme et ses multiples branches, donnant lieu à une opposition à mort entre deux récits, ainsi que Marx le décrit dans La question juive ; et la troisième a vu l’avènement, au XXème siècle, d’une élite bourgeoise gouvernant au nom d’une version internationaliste de la démocratie et des droits de l’Homme.
Il y a, selon l’auteur, un rapport étroit entre la révolte bourgeoise et les populistes d’aujourd’hui, en ceci qu’ils privilégient la réalité par rapport aux concepts. Si le XIXème siècle a produit un nombre considérable de critiques de la vision du monde par le prisme du concept (qu’elles soient d’origine monarchiste, chrétienne, libérale, anarchiste, fédéraliste, etc.), c’est bien le nazisme qui, par sa démesure, a « contribué à l’élimination des derniers accusateurs des Lumières. » 41 De nos jours, tout appel à la considération de la situation de l’homme réel, toute critique des droits de l’Homme érigés en une dogmatique, tout éreintement d’une liberté humaine décrochée des situations et de la responsabilité, tout grief contre une égalité sans diversité, toute semonce à l’endroit d’une fraternité sans hiérarchie ni connivence – en somme, tout trait de pensée que l’on trouve dans le populisme et qu’il était déjà possible de lire sous la plume d’Edmund Burke – est susceptible de passer sous les fourches caudines de la reductio ad hitlerum, concept désormais célèbre que nous devons à Léo Strauss. Désastreuse réalité, car aucun homme ne peut vivre qu’en jouissant d’une liberté illimitée, prétendant en toutes choses égaler autrui, et aimer avec la même sincérité le lointain et le prochain. L’idiotès refuse les systèmes niant sa situation d’homme enraciné, il « refuse le platonisme comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. » 42 Les grands récits sont finalistes, et se construisent toujours sur un interprétation de la réalité, méprisant les situations. Dans un article ayant initialement paru en mai 1956 dans la revue Commentaire 43, Raymond Aron a montré les modalités de ce qu’il a appelé le doctrinarisme. Origine selon lui de deux erreurs fondamentales de méthode de pensée, celui-ci a pour principal défaut de donner à une doctrine particulière une valeur universelle. La première modalité correspond au doctrinarisme historiciste du marxisme, qui s’oppose au doctrinarisme moralisateur des démocraties libérales. Mettant en évidence la proximité entre l’existentialisme porté par Sartre et Merleau-Ponty et le marxisme, notamment dans leurs conceptions anthropologiques, Aron montre que la pensée de Marx est « affectée d’une erreur radicale : ramener toutes les aliénations à une origine unique et postuler que la fin de l’aliénation économique entraînerait la fin de toutes les aliénations. […] Que les droits formels soient illusoires, pour un prolétaire acculé à un salaire de famine, est vérité profonde. Mais cette vérité profonde se transforme en illusion redoutable si l’on suppose que la libération du travail implique les libertés politiques et se confond avec un certain statut de la propriété. » Fondées sur une philosophie du progrès, comme la pensée marxiste, les démocraties occidentales penchent quant à elles vers un « doctrinarisme moralisateur […] doctrinarisme qui, le plus souvent, est moins explicitement affirmé que confusément ressenti et qui accompagne le rejet explicite de toute hiérarchie de valeurs entre la manière de vivre des Hottentots et des Pygmées et celles des Américains ou des Français d’aujourd’hui. » Profonde vérité que voilà – comme si souvent chez Raymond Aron, dont il conviendrait enfin de reconnaître l’importance dans l’histoire de la philosophie politique – et qui caractérise à merveille la société française actuelle, qui demeure comme coincée entre les deux modalités du doctrinarisme. Cette impasse ayant mené à une technicisation de la politique (renforcée par une construction européenne livrée à une technocratie lointaine aux desseins opaques), le citoyen s’est trouvé de plus en plus exclu du débat démocratique. De ce sentiment légitime naissent, comme de nécessaires conséquences, les velléités populistes. Il s’agit donc de les comprendre, les analyser, sans s’abaisser à l’injure.
4 – L’illusion d’un débat contradictoire
Il existe un conflit, sans doute inhérent à la démocratie, entre idiotès et koinos, mais en lieu et place d’un débat courtois et civilisé fusent anathèmes et insultes. La démocratie, fondée sur l’idée de progrès et sur une idéologie mêlant émancipation et universalisme, a tendance à exclure, symboliquement, ceux qu’elle considère comme des non-citoyens. Depuis l’âge grec, le citoyen est celui qui passe de l’intérêt particulier à l’intérêt général. L’auteur rappelle que le passage de la grande particularité à l’idéal universaliste se situe sans doute entre Rousseau et Kant. Si chez Rousseau la volonté générale « n’est pas encore une vision universelle et absolue » 44 (elle reste « précaire et momentanée » 45) ; chez Kant la raison universelle triomphe dans la volonté générale : l’homme particulier doit écouter ce que lui dicte en lui le vouloir universel. L’homme est contraint de comprendre l’universel, auquel il est voué par nature. Tout ce qui s’oppose à ce dessein n’est que perversion.
Cette position rigoriste s’oppose donc à l’esprit de la démocratie libérale qui renonce à toute vérité politique, et laisse les opinions se heurter. Le populiste est, selon le kantien, un traître à la voix universelle, seule porteuse de vérité politique. Bien malin, néanmoins, qui pourrait dire de manière claire et distincte ce que Kant entendait par « raison pratique ». Ce formalisme sert les intérêts d’une définition d’un Bien ne prenant racine en rien, d’un universalisme pour le moins effrayant, que Benjamin Constant, dans la querelle qui l’opposa à Kant à propos du mensonge, qualifia de morale anti-humaniste. Sans doute faut-il voir d’ailleurs, dans la théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas, le triomphe d’une raison technocratique s’opposant à une conscience située. Le philosophe allemand est d’ailleurs le fervent défenseur d’une Europe que l’on peut qualifier de « monstre technocratique », en ce qu’elle est la preuve historique et institutionnel du mépris des élites pour un peuple rebelle à ses desseins.
Qu’à cela ne tienne, les projets politiques passent souvent au forceps, et les résultats de consultations démocratiques sont parfois littéralement niés (que l’on se rappelle le sort qui fut réservé en France au « non » au Traité établissant une Constitution pour l’Europe en 2005). De nombreux philosophes se sont penchés sur cet épineux problème du rationalisme triomphant se donnant l’illusion de la contradiction pour mieux la nier. Husserl, dans sa célèbre conférence intitulée La crise de la conscience européenne et la philosophie (1935), insiste sur les excès de la rationalité issue des Lumières et son radicalisme. Non qu’il regrette le triomphe de la raison, mais il met en évidence ses déviances et perversions, et craint un retour du naturalisme après lassitude de l’abstraction. Plus tard, le philosophe tchèque Jan Patocka pointera le paradoxe de la recherche européenne de la vérité dans ses Essais hérétiques (1975) qui, par un dégagement de la vie simple, de « l’évidence du sens reçu », aura ouvert la voie à une sorte de « vie nocturne ». Contre l’aventure kantienne de « l’autocratie de la Raison toute-puissante » 46, Patocka remet en cause « la certitude de la Raison des Lumières » 47. Or, si nous avons besoin de renouer avec la recherche de la vérité déjà présente chez les Grecs, il convient d’éviter les excès d’un rationalisme despotique, car, comme l’écrit Chantal Delsol, « la prétention de la marche vers une Raison atteignable engendre un mépris cruel pour celui qui demeure dans la particularité où la nature l’avait inscrit. » 48 Le souci de l’âme, pour Patocka, doit consister en la recherche de la part de vérité que contiennent les particularismes, en dehors du danger du renfermement sur soi que représente la fermeture radicale au koinos (au commun), de l’étroitesse du regard, perversion spécifique au nazisme. Celui-ci a puisé, « au départ, son fond de commerce protestataire dans les courants anti-modernes » 49 ce qui explique, selon l’auteur, « le destin du populisme contemporain ». 50
5 – Le rôle du nazisme dans l’acception moderne du populisme
Le combat hitlérien fut « totémique » 51, et se situa « à l’origine la plus sauvage et la plus arriérée de la particularité : à l’époque où chaque peuple primitif se dénommait »le peuple des Hommes », comme s’il était le seul à pouvoir prétendre à l’humanité. » 52 L’hitlérisme a véritablement « profané le conservatisme » 53, et jeté le discrédit sur tout ce qu’il a porté à l’excès, sur tout ce qu’il a contribué à déformer : l’amour de la patrie, le courage politique, et jusqu’à l’idée de décadence. Le nazisme n’est pas un conservatisme, qui est une philosophie politique comptant de nombreux penseurs de premier ordre (Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Thomas Carlyle, Léo Strauss, Julien Freund, Michael Oakeshott,…), mais une idéologie. Cela étant, d’où vient que les excès que l’on peut attribuer, par exemple, au communisme, ne subissent pas le même rejet de la part des élites intellectuelles ? C’est sans aucun doute parce qu’il se veut être un universalisme, et que le nazisme a précipité toute pensée, toute œuvre liée à un enracinement « dans les ténèbres ». 54 Nous songeons par exemple au traitement que peuvent subir les ouvrages de Maurice Barrès, dont l’influence sur toute une génération d’auteurs fut tout à fait considérable, mais dont la seule évocation du nationalisme provoque le rejet par simple réflexe, sans autre forme de tentative de procès, et suffit à repousser une œuvre majeure dans les limbes de la littérature française. Chantal Delsol souligne qu’un tel sort fut aussi réservé au philosophe Herder, précurseur de Hegel, spiritualiste et romantique qui, pour ne pas avoir fait des Lumières l’horizon indépassable de sa pensée, fut accusé d’avoir contribué à faire émerger le nazisme. Or, on peut toujours chercher quelque ligne raciste chez Herder, l’exercice est voué à l’échec. Il ne faisait pas pour autant de l’enracinement un « ancrage unique » 55, souligne Chantal Delsol, destiné à enrayer « dans sa course la marche au progrès, mais (le considérait) comme un paradoxe auquel l’humanité est confrontée, et l’on pourrait citer maints passages où il s’émerveille de l’ascension vers l’universel. Mais il n’était pas univoque. Il n’avait pas injurié la tradition. Voilà la faute. » 56
Conclusion
Par-delà tout jugement moral, ou moraliste, Chantal Delsol nous offre avec ce livre une très belle analyse de la crise du sens qui préside à l’apparition, dans les démocraties modernes, du populisme. Mais au moment où certains attendraient sans aucun doute qu’elle affirme que cette crise est le fruit du repli du citoyen sur lui-même, la philosophe assure au contraire qu’il existe une rupture nette entre deux peuples : celui qui se proclame d’avant-garde (l’élite, dont les schémas dogmatiques sont encore marxisants et fondés sur une lutte des classes passée du souci pour le prolétariat au souci des minorités) et celui qui s’entend dire qu’il ne l’est pas et devrait l’être (le peuple enraciné, rétif au progrès, traçant son sillon en dehors de l’apologie de l’émancipation issue des Lumières, sillon méprisé mais au tracé pourtant si certain).
Soucieuse de considérer l’homme en sa situation, l’auteur tire des antinomies constitutives de la raison humaine (suivant en cela la méthode de Julien Freund, dont elle fut l’élève) une analyse d’une grande fécondité. L’idiot et le commun, les nombreux et les quelques-uns, le peuple idéal et le peuple réel, le populisme et l’universalisme, les centres et les périphéries ou bien encore les sociétés « froides » ou « chaudes », sont autant de figures de notre existence au travers desquelles la question de l’émergence du populisme est examinée. Julien Freund dénombrait six antinomies constitutives – ou essences – de la structure du monde humain : religion, morale, politique, économie, science et art. Chantal Delsol montre avec une grande virtuosité qu’il est possible de comprendre le phénomène populiste par le prisme de ces tensions multiples, en proposant du même coup une réflexion profonde sur la condition de l’homme, cet « être écartelé entre ce qu’il est et ce qu’il voudrait être, entre ce qu’il n’a pas et ce qu’il voudrait avoir, entre son monde réel et son monde espéré. » 57
- in Chantal Delsol, Le Souci contemporain, Bruxelles, éditions Complexe, 1996, p.110
- op.cit, p.126
- ibid.
- ibid., p. 129
- ibid.
- Chantal Delsol, Populisme. Les demeurés de l’Histoire., éditions du Rocher, 267 pages, 2015.
- op.cit., p.16
- op.cit., p.31
- cf Politique, 1281 b et sq.
- ibid., p.37
- Hélléniques, II, III, 48
- Gorgias, 464d
- République, VI, d, e
- Chantal Delsol, op.cit., p.51
- ibid.
- idid.
- op.cit., p.48. C’est nous qui soulignons.
- op.cit., p.58
- ibid.
- ibid., p.64
- ibid., p.65
- op.cit., p75
- ibid., p.77
- op.cit, p.85
- Dans un bel essai d’anthropologie culturelle, intitulé Héroïsme et victimisation. Une histoire de la sensibilité, Éditions du Cerf (2011), Jean-Marie Apostolidès met en évidence, avec force exemples littéraires et historiques, la métamorphose du héros en victime dans la tradition occidentale. Se concentrant tout particulièrement sur la métamorphose de la sensibilité française, Apostolidès montre le conflit culturel à l’oeuvre, dans les sociétés humaines, entre les valeurs aristocratiques de l’héroïsme et les valeurs démocratiques de la victimisation.
- cf le livre de Georges WATSON, La littérature oubliée du socialisme
- op.cit., p.190
- op.cit., p.190-191
- https://www.actu-philosophia.com/spip.php?
- Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle. Sortir du malaise identitaire français, éditions Fayard, 2015
- op.cit., p.191
- op.cit., p.194
- in Simone Weil, L’Enracinement, ou prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, éditions Flammarion, coll. Champs Classiques, n°1139, 2014, p.113.
- op.cit., p.100
- op.cit., p.102
- ibid.
- op.cit., p.106
- op.cit., p.107
- ibid.
- op.cit., p.107-108
- op.cit., p.109-110
- op.cit., p.115
- Raymond Aron : « Le fanatisme, la prudence et la foi », revue Commentaire, n°109, printemps 2005, pp. 5-19
- ibid., p.131
- ibid.
- op.cit., p.138
- op.cit., p.139
- ibid.
- op.cit., p.154
- ibid.
- ibid., p.156
- ibid.
- op.cit., p.159
- op.cit., p.160
- op.cit., p.162
- ibid., c’est nous qui soulignons
- Chantal Delsol, Le Souci contemporain, op.cit., p.35








