Les PUF ont lancé il y a peu, dans toutes les disciplines, une collection intitulée « une histoire personnelle » avec pour principe qu’un grand spécialiste traite, avec une subjectivité assumée, de son domaine propre. Pour la philosophie de l’art, c’est Carole Talon-Hugon qui a eu l’initiative du projet et qui s’occupe de le mener à bien en étant en même temps l’auteur des volumes qui y sont consacrés ; spécialiste reconnue des questions esthétiques, elle a publié un remarquable « Que sais-je ? » consacré à l’Esthétique1, une réflexion sur le montrable dans l’art2 ainsi qu’une très stimulante conceptualisation des rapports entre l’art et l’éthique, mettant à distance l’espèce d’immunité que l’étiquette « œuvre d’art » pouvait conférer à certaines œuvres présentées comme transgressives3.
Carole Talon-Hugon publie aujourd’hui le premier volume de son « histoire personnelle et philosophique des arts » dont elle assure la direction et la rédaction. Consacré à l’Antiquité grecque4, le volume ambitionne de rendre compte de la conceptualité occidentale, essentiellement grecque à vrai dire, qui anima le monde de la production artistique, c’est-à-dire technique, des cités helléniques, en balayant divers domaines que sont la poésie, le théâtre, la sculpture et la peinture : « le propos de cet ouvrage est de mettre en regard des œuvres et des textes, c’est-à-dire des œuvres et des théories. »5 Ouvrage d’initiation destiné au profane, aux étudiants de première année de philosophie ou à l’honnête homme, il nous semble pleinement réaliser son objectif qui est de rendre compréhensible une série de concepts majeurs et décisifs du monde hellénique, sans jargon, avec un souci pédagogique constant, générant un évident plaisir de lecture.
A : La question de la délimitation
Avant d’entrer dans le cœur de la conceptualité hellénique, il nous semble important de préciser un point lié à la délimitation même de l’objet dont traite Carole Talon-Hugon. Le titre indique très clairement qu’il sera question de l’Antiquité grecque, et non du monde antique en général ; cela ne peut en aucun cas signifier qu’il n’y avait pas d’activité artistique – au sens où nous l’entendons aujourd’hui – ailleurs qu’en Grèce ou, plus généralement, que dans le monde helléno-latin, mais cela signifie que la conceptualité grecque n’est pas comparable à celle des autres cités antiques.
Carole Talon-Hugon a donc tout à fait raison de prévenir, dès l’introduction, l’accusation facile qui pourrait lui être faite que de privilégier à outrance le monde grec déjà connu.
« Toutes les civilisations ont leurs chefs-d’œuvre – je pense aux arts de l’Inde ou de la Chine, parmi beaucoup d’autres –, mais la difficulté de les étudier en même temps que les arts de l’Occident tient à la difficulté de trouver une équivalence entre des notions et des concepts qui appartiennent à des univers mentaux à bien des égard très différents ; si bien que les rapprochements propres à l’exercice de la comparaison sont délicats, et souvent douteux. Je m’en tiendrai donc à l’art occidental. »6
Pour autant, cela n’empêchera pas l’auteur de faire quelques excursions hors de la Grèce, notamment en Egypte, pour penser le fondement de la réflexion platonicienne consacrée à la fonction de la reproduction picturale telle qu’elle est développée dans les Lois. Mais, redisons-le, il s’agit essentiellement de comprendre la singularité hellène du point de vue de la conceptualité, ce qui suppose déjà un effort certain de compréhension et de pénétration.
B : Le problème de la définition de l’art
Une fois passé l’obstacle de la délimitation se pose le problème du sens même d’une œuvre d’art : si celui-ci va aujourd’hui de soi pour nous en ce sens que chacun entend par « œuvre d’art » un certain nombre de domaines comprenant la musique, les arts plastiques, le théâtre, l’opéra, le cinéma, la photographie, voire la bande dessinée, cela n’était évidemment pas le cas pour les Grecs ni pour les hommes du Moyen Age pour qui la notion d’œuvre d’art revêtait un sens tout à fait différent. C’est donc à l’élucidation du sens de l’art selon la résonance qu’il avait pour les Grecs que s’attache l’auteur,
Quand nous parlons aujourd’hui d’art, de technique et d’artisanat, cela ne recoupe en effet aucune réalité grecque pour laquelle l’Ars et la Technè ne constituaient qu’une seule région de l’agir humain. A l’époque classique, donc très récemment, l’ars est devenu les beaux arts dont la finalité est la beauté. Mais, comme le remarque l’auteur, « cette finalité commune a permis de réunir dans un même ensemble des pratiques très différentes les unes des autres. Qu’y a-t-il de commun en effet entre l’activité du poète, qui a à peine besoin de la matérialité du papier, et celle du sculpteur qui, au contraire, s’affronte au marbre dans toute sa dense matérialité ? Les Anciens ne disposant pas de cette idée d’une finalité esthétique de l’art, il n’existait rien qui ressemble à un système des beaux-arts. »7
Le problème qui se pose est donc celui de l’unité d’un domaine au regard de la dispersion de ses pratiques : jusqu’à quel point est-il légitime de parler de l’ art pour qualifier une période qui ne pense pas ses productions sous le signe de l’unité, et qui voit dans ses « œuvres » d’abord le produit d’une activité et d’un savoir-faire. C’est donc le premier mérite de cet ouvrage que d’indiquer cette difficulté et de rendre sensible le glissement de sens qui nous fait presque systématiquement accomplir des contresens lorsque nous nous rapportons à cette période. « L’une des grandes difficultés que nous, Modernes, rencontrons lorsque nous voulons aborder l’art de ces périodes lointaines, c’est précisément de délier l’art du beau. L’art répondait à des valeurs magiques, religieuses, thaumaturgiques, politiques, etc., et pas seulement esthétiques. »8
D’une certaine manière, Carole Talon-Hugon fait écho à cette célèbre remarque de Hegel dans ses Leçons sur la philosophie de l’art voulant que nous peinions à comprendre le sens des œuvres antiques, car nous n’y voyons plus des objets de dévotion ou des médiations vers le sacré ou la transcendance, mais y cherchons à tout prix une jouissance esthétique.
« On peut bien espérer, disait Hegel, que l’art poursuivra toujours son ascension et deviendra toujours plus parfait, mais sa forme a cessé d’être le besoin suprême de l’esprit. Nous avons beau trouver toute l’excellence que nous voulons aux images des dieux grecs, et voir exposés Dieu le Père, le Christ et Marie avec toute la perfection et toute la dignité possibles – rien n’y fait, nous ne ployons plus pour autant le genou. »9
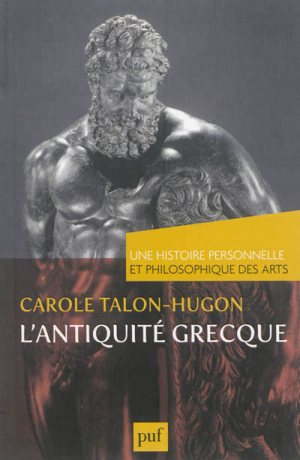
Retrouver le sens antique des œuvres d’art, c’est-à-dire cesser d’y voir au sens moderne des œuvres d’art conçues dans une seule finalité esthétique, et y substituer l’expression d’un savoir-faire dont la finalité est curative ou dévotionnelle, tel est somme toute le but même de cette introduction qui invite le lecteur à modifier ses représentations culturelles. « Laissons donc un moment de côté nos manière de penser modernes, pour analyser ce monde grec ancien de la façon la moins anachronique possible et pour en tirer le plus de profit. »10 Saluons cette introduction qui propose ce que devrait rappeler toute investigation conceptuelle de l’art pré-classique, c’est-à-dire des arts avant qu’ils ne deviennent les « beaux-arts ».
C : L’inspiration
L’élément central des arts antiques est sans doute celui de la mise en relation avec le divin ou, plus généralement, avec une transcendance. La poésie, à l’origine, avant le VIIè siècle, entretient un rapport avec l’au-delà, avec les forces suprasensibles de la nature ; elle instaure un lien entre l’homme et le surnaturel ; elle est donc une activité vitale qui a un lien avec la vie et la mort. Chantée, elle est liée à la musique, et invite les participants à une sorte de transe, dont maints textes antiques donnent une idée assez précise ; le théâtre ancien n’est pas en reste et est, lui aussi, lié au religieux. D’ailleurs, le nom même de « tragédie », rappelle l’auteur, est lié au culte de Bacchus, puisque tragédie signifie le « chant du bouc ». Quant aux dithyrambes, ces hymnes religieux chantés par un chœur d’homme, ils rendaient hommage à Dionysos pour signifier l’emprise de ce dernier sur les hommes ; le terme de dithyrambe renvoie d’ailleurs par son étymologie à la double naissance, ce qui évoque Dionysos et sa sortie hors de la cuisse de Jupiter.
L’auteur analyse l’évolution de la tragédie, et son éloignement progressif hors de la religion ; le mouvement est très net chez Euripide qui propose une conception non héroïque de la tragédie, et presque laïcisée, si l’on nous autorise ce volontaire anachronisme. Les histoires se psychologisent et se naturalisent et Nietzsche y voit le début de la décadence, la défaite de Dionysos et le progressif triomphe de la froide analyse rationnelle d’Apollon. L’auteur s’appuie avec bonheur sur l’interprétation nietzschéenne du phénomène dans La Naissance de la tragédie et montre ainsi combien l’évolution du théâtre antique put hanter la philosophie des millénaires durant. L’organisation du public, si bien comprise par Nietzsche, est elle-même disséquée, pour qu’en jaillisse le sens nouveau : par son éviction du cercle, le spectateur n’est plus partie prenante du spectacle et ne cherche plus à éprouver l’emprise même de Dionysos, mais se voit reléguer en marge, dans les gradins du demi-cercle, avec la distance propice au recul et à l’analyse – donc à la médiation –, brisant de ce fait l’immédiate épreuve de la présence de Dionysos.
Dans ces conditions, quel est le statut du poète, c’est-à-dire de celui par qui sont possibles de telles transes ou de telles communions collectives autour de la figure de Dionysos ? Le poète est-il un homme comme un autre ou présente-t-il quelque particularité qui l’élève au-dessus du commun des mortels ? Force est de constater que le poète n’est pas un être anonyme entièrement écrasé par les effets de son art : pourtant, s’il se distingue de la masse, ce n’est pas tant par son talent ni par son savoir-faire ni par son génie que par sa capacité à entrer en relation avec la divinité, que par son « inspiration ». Le nom propre du poète n’est donc pas passé sous silence mais son mérite n’est pas tant technique que spirituel : il est celui en qui les dieux s’expriment. « Qu’il y ait eu dissociation entre le poète et le prêtre est une chose ; que le poète soit devenu un individu ordinaire en est une autre. Il demeure un être inspiré. »11 Il faut ici se référer au Ion de Platon où l’on voit que le poète n’est pas un technicien possédant un art, une technè, mais un être mû par une inspiration divine.
En outre, cette inspiration ne renvoie pas à un génie mais à une qualité de porte-parole des dieux, il est celui par qui parlent les dieux. « En tant qu’homme, le poète n’a donc rien d’un philosophe ou d’un sage. »12 Et une fois encore, il faut nous méfier du prisme déformant de nos propres catégories conceptuelles : si nous entendons aujourd’hui l’idée de signature comme celle de reconnaissance de l’auteur et de son génie, tel n’est pas le cas de la pensée antique qui y voit d’abord la reconnaissance d’un être de médiation : il est celui par qui se transmet la volonté divine, si bien que le poète inspiré est d’abord affecté d’une certaine forme de passivité ou, à tout le moins, d’une destitution de sa volonté propre : il est un canal par lequel passent des forces qui le dépassent. D’une certaine manière, pourtant, nous pouvons considérer que la définition du génie au sens de Kant dans la Critique de la faculté de juger reprendra cette passivité en thématisant la nature traversant le « génie » au détriment d’une conscience pleine de son activité.
Mais qu’en est-il hors du monde de la poésie et du théâtre ? Là encore, les choses évoluent et ne sauraient être restituées selon une tranquille continuité. Peinture et sculpture sont deux technè, de l’ordre du fabriquer, si bien que les artistes perçus comme techniciens ont donc un statut subalterne. Mais à partir du VIè siècle, les choses évoluent car les signatures, comme en témoigne, entre autres, le cas d’Euphronios. Toutefois, tout l’intérêt de cette partie dans l’ouvrage consiste à montrer que l’ordre des pratiques sociales ne suit pas l’ordre de la conceptualité : en d’autres termes, la reconnaissance sociale dont commencent à jouir certains « techniciens » ne s’accompagne absolument pas de la conceptualisation de leur talent ni d’une valorisation conceptuelle de leur rôle. Sénèque, Plutarque ou Lucien continueront à mépriser ces artisans qui sont englués dans l’ordre du faire.
Pourtant, en dépit de cette dévalorisation, il n’en demeure pas moins qu’émerge une reconnaissance des œuvres à défaut d’en louer leurs auteurs. « L’erreur serait néanmoins de croire que ces œuvres étaient admirées en tant qu’œuvres d’art»13 précise aussitôt l’auteur qui ne cesse de rappeler ce que voit un Grec dans une statue : une statue d’Apollon n’est pas perçue comme une statue d’Apollon mais comme une représentation d’Apollon ou, plus exactement, comme la présence même d’Apollon sous la forme de la représentation. En d’autres termes, les peintures et sculptures ont des fonctions et doivent produire des effets ; donc l’idée d’autonomie du champ artistique est totalement étrangère au monde de l’époque. Les œuvres ne sont pas des objets de contemplation : elles ont une fonction mémorielle de conservation du souvenir et de transmission de la tradition.
D : Le « savoir-faire » ou l’illusionnisme érigé en exigence
Si la peinture et la sculpture sont conçues à partir de la catégorie de la tekhnè, c’est qu’elles impliquent un certain « savoir-faire », une certaine maîtrise auxquels il faut désormais prêter attention : que sait faire le technicien qui peint ou sculpte ?
La première difficulté est que la notion de progrès, aussi étonnant que cela puisse paraître, apparaît rapidement dans les techniques artistiques ; puisque l’art est d’abord subsumé sous la catégorie de technique, et puisque la technique progresse, alors nous pouvons considérer qu’il y a des progrès artistiques. « Et en effet, si la tâche du peintre et du sculpteur consiste à restituer la vie de la manière la plus ressemblante, on peut effectivement dire qu’entre une statue hiératique de l’époque archaïque et telle œuvre de Praxitèle, il y a bien un progrès vers une plus grande restitution de la vie. »14 Le premier élément de réponse est donc le suivant : l’artiste est capable de créer sur des surfaces ou des volumes inertes l’impression du mouvement et de la vie, et ses produits seront encensés ou critiqués selon sa capacité à restituer la vie dans l’inerte.
Carole Talon-Hugon en profite d’ailleurs pour tordre le cou à un usage devenu topique de l’allusion aux raisins de Zeuxis ; s’il est souvent fait mention de la gloire de Zeuxis peignant des raisins tellement ressemblants que les oiseaux s’y seraient laissé prendre, l’auteur rappelle que l’histoire véritable est bien plus complexe que cette anecdote, et restitue la dimension réelle de l’histoire. Après l’épisode des oiseaux, Parrhasios se retrouve en concurrence avec Zeuxis, peint un tableau couvert d’un linge que Zeuxis veut enlever croyant qu’il est vrai alors qu’il est factice, ce qui assure le triomphe de Parrhasios puisque ce dernier berne même l’œil averti d’un peintre ; mais Zeuxis prendra sa revanche avec le troisième épisode : Parrhasios a peint des raisins dans une coupe apportée par un enfant, dans laquelle les oiseaux viennent essayer de picorer, ce à quoi Zeuxis répond que si les enfants avaient été réussis, les oiseaux auraient eu peur et ne seraient pas venus picorer les raisins.
Nous voyons donc que le savoir-faire autour duquel se battent les peintres est celui de l’illusionnisme, de la capacité à tromper l’œil, à duper le regard du spectateur – et même des animaux. Ce n’est donc pas un hasard si Pline classera les peintres selon leur capacité à réaliser des trompe-l’œil : il adossera ainsi son classement à une pratique sociale amplement répandue. Et ce n’est pas un hasard non plus si Platon, dans la République, condamnera autant cette duperie illusionniste, faisant admirer à tort le prétendu savoir-faire du peintre qui n’est jamais qu’une manière de dissimuler son incapacité à se rapporter aux Formes.
Concluons donc en remarquant qu’« à partir du VIè siècle avant Jésus-Christ, et plus encore durant le Vè siècle, s’est développée chez les Grecs une esthétique illusionniste, dont l’idéal est le trompe-l’œil, et pour laquelle le but ultime est de faire croire au spectateur qu’il n’est pas devant la représentation de la chose, mais devant la chose même. »15. Cette situation entraîne un paradoxe car le comble de l’art est alors « de se dissimuler comme art. »16 et tel est le sens du conflit entre Zeuxis et Parrhasios. La maîtrise de l’illusion n’est jamais aussi forte que lorsque l’illusion est parfaite, donc lorsque l’artifice disparaît sous une couche de naturalité, pourtant elle-même totalement factice.
E : La conceptualité des arts : Platon et Aristote
Carole T alon-Hugon aborde évidemment les écrits de Platon et Aristote consacrés à la peinture pour le premier et à la tragédie pour le second. Le point commun entre les deux auteurs est évidemment la reconnaissance de la mimésis comme fondement de l’activité picturale et tragique. Dans le Sophiste, Platon distinguait déjà deux types d’imitation : la simulation et la déformation. En outre, l’art n’est jamais chez Platon un moyen d’accéder à une connaissance supérieure. « Il ne peut en être autrement, puisque les arts plastiques, même les plus légitimes, sont cantonnés à la sphère du sensible et ne sauraient, par nature, s’en écarter. Or, le réel, pour Platon, ne consiste pas tout entier dans le monde sensible ; au-delà du monde sensible, il existe un autre monde, intelligible, qui est celui des Idées, c’est-à-dire des archétypes éternels, transcendants et intangibles de toutes les choses sensibles. »17 Dans de telles conditions, nous comprenons fort bien pourquoi l’imitation condamne l’art à manquer l’Etre puisqu’il imite ce qui se présente déjà dans la matière sensible, ce qui justifie aux yeux de Platon la condamnation de tous les exercices d’illusionnisme qui s’entêtent à prendre pour modèle l’apparence sensible dont ils dédoublent l’existence par une vaine et trompeuse reproduction.
Pourtant, Platon ne condamne pas toute forme d’art et prend l’Egypte comme modèle. « Nous savons en effet que l’art égyptien était soumis à des lois extrêmement strictes, restées probablement inchangées entre 5000 et 2000 ans avant Jésus-Christ : les personnages assis doivent être représentés les mains posées sur les genoux ; les femmes doivent avoir un teint plus clair que les hommes ; le dieu Horus doit être représenté avec une tête de faucon, le dieu Anubis avec une tête de chacal, etc. »18 Ces règles sont intangibles et c’est pour Platon une grande force en tant qu’elles échappent à la corruption des modes et des techniques ; en outre, c’est un art complet, qui montre tout, indépendamment de tout point de vue. C’est peut-être là notre seule réserve sur l’ouvrage, en ceci qu’il n’est pas certain que l’art égyptien soit aussi figé et fixiste que le dit l’auteur. Hornung nous semble au contraire avoir bien monté que l’art égyptien, loin d’être sclérosé en sa représentation, se présente« de manière beaucoup plus différenciée, et ce dès la pré et la proto-histoire. Tout faucon n’est pas un Horus, tout babouin n’est pas le dieu Thot, ou « le Grand blanc » ; toute grenouille n’a pas à voir avec la déesse Héquet, ni tout bélier avec Amon ou Khnoum. »19 Nonobstant cette petite réserve, nous saluons cette référence à l’Egypte et au salut possible des arts imitatifs, rompant avec la doxa d’un Platon condamnant unilatéralement la représentation picturale.
Dans la tragédie, pour que l’art soit imitatif, il faut que les poètes n’imitent que des personnages exemplaires et renoncent à la représentation du mal et du vice. Mais les poètes sont davantage tentés de représenter les hommes passionnés et irrationnels que des hommes mesurés et sages, ce qui indique d’emblée la difficulté de conceptualiser l’art dans sa fonction édifiante et la pulsion du poète de représenter l’être hors du commun qui est d’abord hors de toute mesure. Aristote réévalue pourtant les effets de la représentation tragique sur le spectateur en ceci que l’émotion est feinte et donc ne domine pas la conscience. Par conséquent, nous éprouvons des émotions sans être totalement impliqués, en gardant une distance vis-à-vis d’elles. « Etablissant entre le spectateur et la représentation la distance de la fiction, la tragédie permettrait en ce sens la purgation de nos affects. »20
Conclusion
Nous ne pouvons que vivement recommander ce premier volume de l’Histoire personnelle et philosophique des arts, qui offre une introduction précise, claire, agréable de lecture, informée et maîtrisée, des arts antiques du monde hellène. Les points essentiels sont abordés, et, plus encore, la question du regard est traitée : loin de plaquer de manière anachronique les concepts modernes et contemporains sur des pratiques anciennes, l’auteur ne cesse de nous inviter à comprendre le sens que revêtait pour les Grecs leurs propres productions, ce qui est peut-être l’essentiel.
La question de la beauté, quoique dissociée de celle de l’art dans le monde antique, n’est pas pour autant totalement absente de l’ouvrage. L’auteur rappelle l’importance de la kalogathia, qualité éthico-esthétique de l’homme associant belle apparence extérieure et vertus éthiques. Nous pouvons ainsi conclure en mentionnant le dernier ouvrage de Philippe Nemo, rappelant que, dans la célébration grecque de la beauté se joue une dimension éthique. « Le kalon, ce qui est beau, est indissolublement lié à l’agathon, ce qui est bien, les deux mots étant très tôt associés dans l’expression kaloskagathos, « bel et bon ». Les Grecs trouvent normal, en effet, que celui qui est beau physiquement, beauté qui prouve qu’il a atteint à la perfection de sa forme naturelle, possède également les autres caractères attachés à la perfection humaine, c’est-à-dire des qualités morales. »21
Comprenons par là que la véritable beauté est finalement éthique, qu’elle tend vers le Bien – le suprêmement désirable – et que l’art ne peut finalement être beau qu’en un sens secondaire, et jamais premier. Pour qui souhaiterait en savoir plus sur la reprise de cette question éthique liée à la beauté puis aux beaux arts, il est vivement recommandé de se reporter aux ouvrages déjà cités de Carole Talon-Hugon, notamment au très important Morales de l’art qui, quoique ne traitant pas spécifiquement de l’Antiquité, reproblématise à nouveaux frais cette antique question du bon comportement et la rapporte à l’art moderne et contemporain.
- cf. Carole Talon-Hugon, L’esthétique, PUF, coll. Que sais-je ?, 2013
- Goût et dégoût. L’art peut-il tout montrer ?, Jacqueline Chambon, 2003
- cf. Morales de l’art, PUF, Hors collection, 2009
- Carole Talon-Hugon, L’Antiquité grecque, PUF, « Une histoire personnelle et philosophique des arts », 2014
- Ibid., p. 7
- Ibid., p. 5
- Ibid., p. 14
- Ibid., p. 15
- Hegel, Cours d’esthétique, Tome I, Traduction Lefebvre et von Schenck, Aubier, Paris, 1995, p. 143
- Histoire personnelle et philosophique des arts…, p. 16
- Ibid., p. 30
- Ibid., p. 33
- Ibid., p. 43
- Ibid., p. 53
- Ibid., p. 62
- Ibid., p. 63
- Ibid., p. 69
- Ibid., p. 60
- Erik Hornung, L’esprit du temps des pharaons, Traduction Michèle Hutin, Félin, 1996, Hachette, coll. Pluriel, 1998 p. 166
- Histoire personnelle et philosophique des arts., p. 90
- Philippe Nemo, Esthétique de la liberté, PUF, 2014, p. 20








