Dès l’avant-propos de ce dialogue1, Pierre Magnard nous donne le « la » de ce très beau dialogue avec Eric Fiat : « Il est une mémoire – la vraie mémoire – qui est jachère pour l’éternité ; elle distingue et retient l’essentiel, ce que le temps qui coule n’aura pu emporter, cette rose en idée qui ne saurait faner, ce rossignol intemporel, dont le poète John Keats disait qu’il lance ses trilles depuis la nuit des origines. » Se risquant à l’épreuve de vérité, le philosophe et ami Pierre Magnard ouvre une fenêtre sur le temps retrouvé, sur « ce qui n’a pas cessé d’être vivant. » (p. 6) Il revient alors sur ses années d’enseignement en classe de Terminale à Moulins, puis à l’Université Paris IV, sur cette expérience du renversement de la relation pédagogique où dit-il, « Socrate apprend d’Alcibiade, quand le disciple se fait maître de son maître. Ces dix entretiens avec Eric Fiat laissent entrevoir au lecteur cette « mise en abyme » celle même qui donne « la couleur du matin profond », la lumière même de l’échange – celle qui érige la salle de classe en « théâtre de l’illumination » : « Toute ma vie je devais, dit Pierre Magnard, ré-effectuer cette expérience qui me fit souvent confesser que mes maîtres furent mes élèves… Socrate ne m’avait pas menti, je me voyais entouré de mes élèves, remontant l’Ilissos afin d’apprendre à découvrir avec eux la couleur du matin profond. » (p. 21)
I°) Au-delà de l’idée de Dieu
Dans le premier entretien, Eric Fiat revient sur les philosophes qui ont nourri la pensée de Pierre Magnard, sur ces rencontres décisives qui ont fait le penseur, l’enseignant, des rencontres qui l’ont ébranlé jusqu’au plus profond de son être. Un premier nom important apparaît : celui de Heidegger qui marque un tournant décisif dans le chemin de Pierre Magnard, l’invitant à déconstruire la métaphysique classique et au passage l’idée de Dieu que cette métaphysique se fait. En effet, à l’être cause de lui-même on n’adresse pas de prières, on n’offre pas de sacrifices. C’est avec Pascal que Pierre Magnard fera son deuil du Dieu des philosophes. Il y avait là, dit-il, une démarche du « non seulement mais encore » qui l’amenait à proposer une sorte d’assomption du Dieu des philosophes conduisant au Dieu de la Révélation : « Je ménageais une continuité de ce Dieu des philosophes auquel je ne voulais pas renoncer, au Dieu de Jésus-Christ. » Mais était-ce à cela que le conviait Heidegger ? Le chemin s’avéra beaucoup plus difficile, confie-t-il. Et c’est à la faveur d’une manuductio qu’il put l’opérer : « J’ai eu la chance de connaître un passeur de vérité, Henri Birault. Ce philosophe ami eut Henri Gouhier comme directeur de sa thèse secondaire « Nietzsche et Pascal » – ce même Henri Gouhier qui allait guider Pierre Magnard tout au long de ses recherches pascaliennes.
Le philosophe revient ensuite sur sa rencontre avec l’œuvre de Maurice Merleau-Ponty : « Comme chez Birault, je cherchais chez Merleau-Ponty non pas une doctrine, mais cet air pur dégagé des pesanteurs des systèmes et des fascinations totalitaires où l’on pouvait enfin librement respirer. » Pierre Magnard trouve en ces auteurs l’oxygène qui lui manquait à la Sorbonne. Car tout dogmatisme finissait par se dissoudre sous la critique de Merleau-Ponty. Comme ce fut le cas de l’idéalisme subjectif mis à mal dans la Phénoménologie de la perception ou encore dans Le Visible et l’Invisible, « dans un incessant déplacement de cette fonction « sujet » dont nous étions devenus tributaires, mais qu’il faisait évoluer de sujet constituant en sujet instituant, défini audacieusement comme chair de l’homme. » Au nom de la chair, Merleau-Ponty rejette l’idéalisme subjectif et le matérialisme. Car la chair c’est le vivant de la pensée, c’est la vraie subjectivité – cette instance qui nous permet de ressentir notre être dans le monde sur le mode de la réflexivité du touchant et du touché, du sentant et du senti. L’acte même de la perception implique une passivité. Et c’est l’accent mis sur cette passivité sans laquelle il n’y a aucune activité d’esprit qui lui semble devoir le conduire à réactiver le concept de chair, emprunté à la tradition judéo-chrétienne. Car la chair c’est cette réflexivité même du touchant qui n’est touchant que parce qu’il est touché, du sentant qui ne sent que parce que lui-même ressent passivement une impression venue d’ailleurs. Et Pierre Magnard confie alors : « Cette notion si riche de chair devait sans doute ne jamais me quitter quand j’entrepris mes réflexions sur Pascal. » (p. 19)
Aux rencontres qui ont nourri son enseignement, Pierre Magnard voue une immense gratitude. Et c’est une même gratitude que ses élèves lui vouent, eux qui ont été « accouchés » par ce Socrate des temps modernes : « Force socratique de votre parole, dit Eric Fiat, qui tient à cette capacité d’accueil. » Et cette parole si elle fut orale, a aussi été écrite. Pierre Magnard nous a offert de très beaux livres – des livres qu’il a écrits « dans le cœur et dans l’âme de ses auditeurs. » Des livres qui ont fait l’épreuve de cet accueil, de cette validation et de cette réception qui juge vrai. Pierre Magnard se prête au jeu de l’écriture avec cette arrière-pensée que le sens même de ce qu’il écrit, c’est au lecteur de l’achever, « comme si mon texte, confie-t-il, était une simple ébauche et que quelqu’un d’autre devait parfaire en se l’appropriant et en y reconnaissant sa propre pensée. Autrement dit, c’est ce phénomène en miroir qui me semble la validation de l’écrit. Écrire pour tendre à l’autre ce miroir où il se pourra retrouver en coopérant à ma propre écriture pour lui donner toute sa valeur et tout son sens. » (p. 22)
II°) L’émergence d’une rationalité nouvelle
Dans son second entretien, revenant à l’interrogation ouverte par Martin Heidegger, Eric Fiat se demande comment Pierre Magnard y a répondu avec Pascal. Si, avec Heidegger, il ne s’agit plus de penser l’être comme fondement, comme substrat, mais dans sa fonction propre qui est d’ouvrir le champ de la manifestation – celle-ci ne pouvant s’effectuer qu’à la lumière de l’être. Tel serait bien le paradoxe d’un Dieu qui n’aurait plus son assise dans l’être, existant de ne pas exister : « de n’être rien de ce que nous nommons, croyons ou imaginons » (p. 25) Or Pierre Magnard rappelle que Pascal avait fait de ce paradoxe le mystère par excellence. L’existence de Dieu ne se démontre pas, ne s’éprouve pas dans l’expérience naturelle, ne se rencontre pas dans l’histoire, elle n’est donc pas vérifiable et pourtant Dieu se donne comme la vérité. Mais alors qu’est-ce que la vérité ? « Quand le Christ se nomme comme tel, il n’entend pas ajouter une proposition à notre métaphysique, affirme Pierre Magnard. Il déclare avoir voulu rendre témoignage à la vérité, c’est-à-dire avoir replacé toute existence dans le projet de Dieu. » (p. 26) Pierre Magnard note que « toute proportion gardée, c’est à un déplacement analogue que procède Heidegger. » Car quand Heidegger refuse de définir la vérité par la conformité de la représentation à son objet, « ne nous installe-t-il pas, se demande Pierre Magnard, dans cette problématique, puisque celui qui est d’intelligence avec l’être, de ce fait pourra laisser advenir choses et événements dans cette lumière ? » (p. 26) Pourquoi ne pas voir dans ce déplacement le prélude à un retour ? Avec son ami Henri Birault, Pierre Magnard est convaincu de cette secrète proximité entre Pascal et Heidegger. Un même radicalisme les aura conduits à renoncer à l’arsenal des preuves réduisant Dieu à sa fonction présumée de substrat. De la même façon que Pascal caractérise l’homme comme un être en quête de Dieu, Heidegger dit que l’homme est un être éternellement « en dehors de lui-même vers ». Il y aurait une manière d’analogie entre cet « en dehors de lui-même vers » et cette inlassable quête de Dieu que l’on voit chez Pascal. En effet, Pierre Magnard souligne avec pertinence que ce qui est commun à Pascal et à Heidegger est cette « sortie de l’homme hors de lui-même en direction d’un ailleurs pour que la vérité puisse se faire, pour que la révélation puisse se produire. » (p. 27) Comme Pascal, Heidegger « travaille dans la disproportion. » Disproportion de l’homme. Il n’est pas d’échelle de l’être où l’homme trouverait son barreau. Mais si l’homme est exilé, Dieu l’est aussi : « Quand la nature entière est enserrée dans les chaînes d’une raison-calcul, Dieu n’y a pas sa place. » (p. 28) Comme pour Nietzsche, comme pour Heidegger, tout part de l’apparent retrait de Dieu. Dieu se cache sous le voile de la nature, dans l’Écriture, encore plus dans son incarnation où il se couvre de notre humanité, sans parler de ce secret encore plus obscure que sont les espèces de l’Eucharistie. Quel est donc l’être d’un Dieu qui ne se manifeste qu’a contrario ? « Un Dieu qui se manifeste dans l’infime comme par défaut, sous les espèces d’un silence, affirme Pierre Magnard, d’un imperceptible murmure. » (p. 30)
Mais ce qui touche aussi Pierre Magnard chez Pascal, c’est sa compréhension du libertin comme le souligne Eric Fiat : « De même que Cioran est un génie parce que son prétendu athéisme ne l’empêche jamais de comprendre la plus haute mystique mise en musique par Jean-Sébastien Bach, de même Pascal est génial parce qu’il trouve en lui-même de quoi comprendre l’errance libertine. » (p. 33) Pierre Magnard pense en effet que Pascal est en parfaite consonance avec le libertin quand il affirme que « le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » : « c’est-à-dire que les espaces infinis ne célèbrent pas Dieu, ne disent pas Dieu, ne parle pas de Dieu. » Et c’est pourquoi Pascal peut comprendre le libertin et lui proposer de cheminer avec lui. Or la seule et capitale distinction entre Pascal et le libertin, souligne Pierre Magnard, est que celui-ci semble refuser de s’ouvrir à ce qui pourrait l’aider à surmonter l’effroi, quand celui-là, Pascal, reconnaît son néant sans la grâce. Ainsi pour Pascal il y a bien une vérité de l’athéisme et cette vérité c’est le fait que l’ordre naturel ne prouve rien : « il reste étrangement silencieux ».
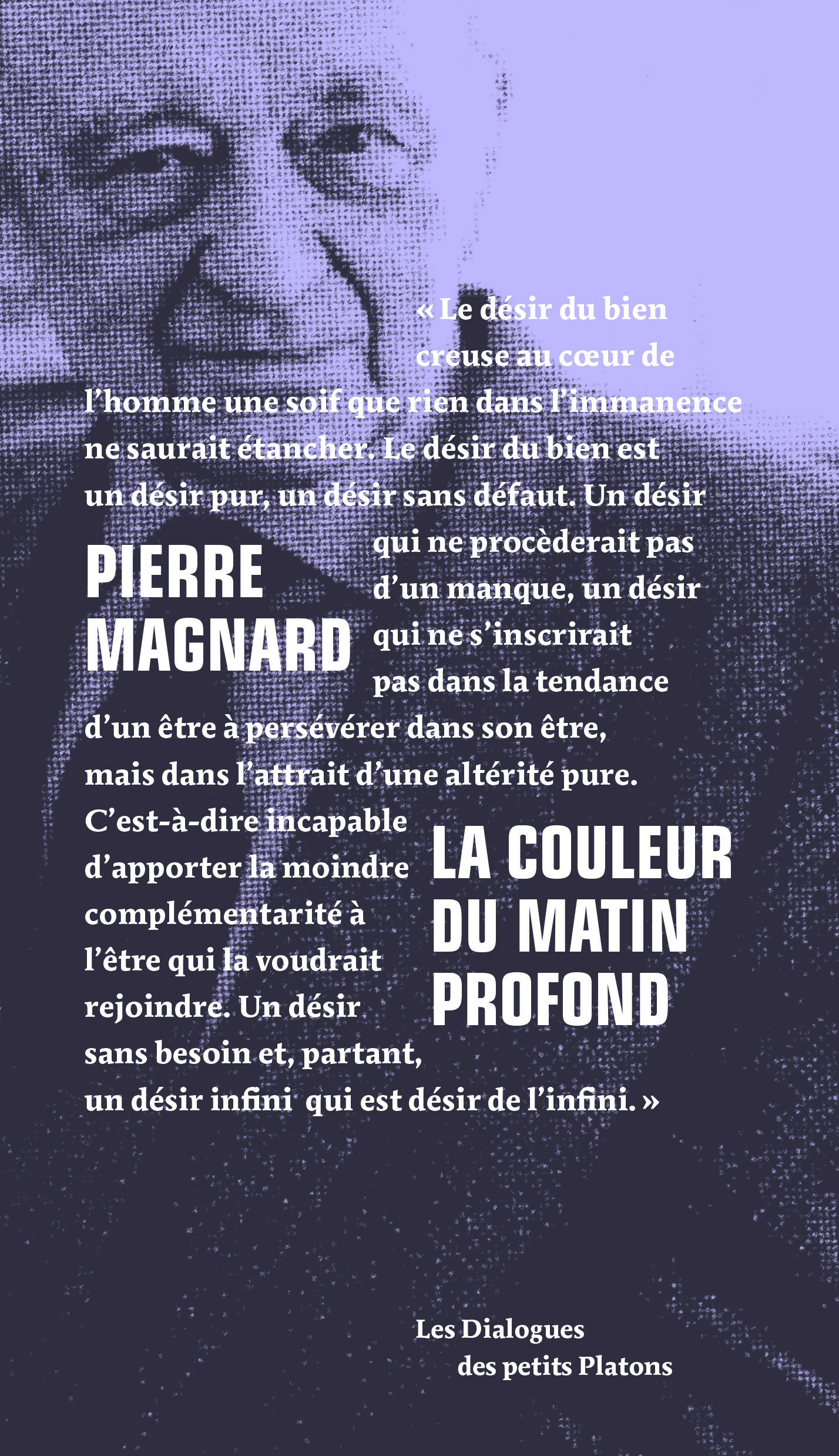
Or on peut dire que ce silence de Dieu, ce retrait de Dieu, met en cause la raison, « cette homonymie que la tradition avait voulu établir entre le logos humain et le logos divin. » (p. 35) Cette analogie avait déjà été critiquée par Montaigne quand il se moquait de cette raison humaine ployable à tout sens, et quand il disait que nous logions notre raison « à fausses enseignes » en prétendant qu’elle habitait le cœur de Dieu. Mais il y a chez Pascal, encore plus que chez Montaigne, une méfiance à l’égard de la raison qui a quelque chose de radical. Cette démystification de la raison peut nous conduire très loin, car s’il y a équivocité entre de la raison humaine à Dieu, nous sommes amenés à pratiquer une radicale disjonction entre raison et foi. En effet, ce qui traditionnellement autorisait le lien entre raison et foi, c’était l’analogie entre la raison humaine et la raison divine telle qu’elle était professée chez Thomas d’Aquin et dans toute la tradition. « Avec Pascal, affirme Pierre Magnard, on a le sentiment qu’une raison purement instrumentale est en train de faire la preuve de ses puissances et de ses limites, à travers une science toute mécaniste et les techniques qui s’en peuvent inspirer » (p. 36) Pascal serait ainsi le premier des penseurs post-modernes, étant allé jusqu’au bout de cette révolution que Descartes inaugurait. Pascal est radical : « la coutume, écrit-il, est notre nature ». Sa critique est terrible : c’est la coutume qui fait l’empire du roi sur ses sujets, c’est elle qui fait notre peur de l’enfer et qui fonde nos certitudes jusqu’en géométrie. Elle contraint la nature au point que nos principes ne seraient que des principes accoutumés. Si la coutume est une seconde nature, notre « première » nature n’est elle-même qu’une première coutume pour Pascal : l’ordre naturel n’est donc au fond qu’un ordre accoutumé. La raison s’offre, mais elle est ployable à tous sens. On est en plein relativisme. L’ébranlement a de quoi faire tressaillir. Nombreux sont les textes où Pascal décrit l’homme en situation de perdition dans un océan infini. L’homme est toujours en passe de se noyer, or comment peut-il échapper à cette noyade si ce n’est en découvrant un point fixe ? Le recherchant, Pascal désespère de le trouver là où il espérait le trouver. C’est le Christ qui sera pour Pascal à la fin de sa vie, le centre où tout tend. Car, comme le souligne Eric Fiat, « dès que Dieu s’absente, il n’y a plus de point fixe. Et seul est fixe l’amour que le Christ a pour l’homme. » (p. 40)
Mais si Pascal se méfie de la raison, il n’y renonce cependant pas, et fait émerger une nouvelle forme de raison. « La nouvelle raison naît des cendres de la raison dogmatique » (p. 41) Notre raison, celle qui a produit la science, se trouve invitée à se taire. Car elle n’a pas autorité à dire le vrai, tout juste peut-elle produire un analogue mécanique de la réalité créée par Dieu. Mais « qu’est-ce donc que cette nouvelle raison que Birault nous dit moins fière et moins prétentieuse, mais aussi plus sérieuse car plus humble, cette raison joueuse qui va prendre le pas sur la raison dogmatique ? » Pierre Magnard répond : « C’est la raison des probabilités, et c’est elle qui soutient l’acte de foi, une foi dans le peut-être que porte la folle espérance pour l’accomplir dans l’amour. » (p. 41) Là encore Pierre Magnard revient sur ce vis-à-vis du libertin et du croyant, qui semblent partager la même crainte, alors qu’en fait elles n’ont plus du tout la même teneur. Car c’est l’espérance qui va distinguer les deux craintes. L’une est sur fond de désespoir, l’autre sur fond d’espérance. Pierre Magnard analyse l’espérance comme cette « vertu du possible », cette « petite fille espérance qui ne l’a jamais quitté » (p. 51). C’est elle qui accrédite le « peut-être » (p. 44) Or le génie de Pascal est bien de ramener l’existence à un grand jeu en offrant dans le pari une sorte de prélude à ce qu’eût été son Apologie. « Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqués » dit Pascal : on est forcé de jouer, et quand on est forcé de jouer, il faut renoncer à la raison si l’on veut garder la vie. Mais est-il déraisonnable de vouloir vivre ? Puisqu’au fond, c’est là-dessus que la raison a à se prononcer. « On ne lui demande pas de parier pour Dieu, on lui demande de parier pour la vie plutôt que pour la mort. » (p. 48) C’est là l’alternative, et il serait déraisonnable de ne pas parier, de ne pas vouloir vivre.
L’échec du dogmatisme permet donc à Pascal de retrouver la saine raison : la raison qui parie et non pas la raison qui prouve, « une raison joueuse, dit Pierre Magnard, qui se risque à quitter le plan de l’être pour celui du peut-être. » (p. 49) Or le peut-être c’est bien la possibilité pure, « noblesse d’une raison plus haute parce que plus hardie et plus fière. Pascal va prendre un malin plaisir à moquer la raison besogneuse en distinguant probabilité et possibilité. Quand la probabilité s’amenuise et que le hasard devient infini, on est dans la possibilité pure. » (p. 49) La probabilité que Pascal a de plus en plus en horreur, voudrait tempérer notre crainte en limitant pour nous la prise de risque. « En fait, remarque Pierre Magnard, elle rassure sans jamais assurer vraiment. » (p. 50)
III°) « L’être n’est que la trace de l’un »
Avec Pascal, Pierre Magnard a risqué le pari, et c’est avec toute la perplexité philosophique qui le caractérise qu’il a préféré la raison joueuse, comme Eric Fiat le rappelle dans ce troisième entretien. Mais ce que Pascal lui laisse c’est une « raison déchirée » (p. 53) Et cette raison déchirée inspire la nostalgie de l’unité perdue, d’un ailleurs, d’un là-bas : « Cette terre où Socrate cheminait avec nous, remontant l’Ilissos, voilà de quoi nous inspirait le retour au pays natal. » Or il est un mot qui est le secret de ce retour : c’est le mot logos, première dénomination de la raison en son originaire unité. « Le logos cueille, recueille, rassemble, totalise. Il suppose l’un dont il procède et dont il est en quelque sorte le fils. Il est l’âme de la parole qui en est la manifestation, le verbe qui distingue pour unir plus certainement. » (p. 54) Nouer et dénouer, dénouer puis renouer, tel sera le travail de tapisserie de Platon et de son école. « Avec l’inoubliable Stanislas Breton, nous parlions, confie Pierre Magnard, de ce travail de Pallas-Athéna dans l’attente d’Ulysse, de ce travail de Pallas-Athéna dans l’attente de l’homme » (p. 54) Distinguant le fondement du Principe, Charles de Bovelles (Le livre du néant) comme Stanislas Breton (Rien ou quelque chose) rappellent que le principe n’est le principe que parce que lui-même n’est rien, un « rien de rien » reprenant la formule de Maître Eckhart. Bovelles impose alors une disjonction à Pierre Magnard, une disjonction qui va l’amener à reconsidérer toute la tradition grecque depuis Parménide. Il se confronte à la disjonction de l’un et de l’être qui ne laisse pas d’inquiéter car elle fait apparaître un défaut dans le système du savoir : le système ne parvient pas à s’enclore sur lui-même. Alors s’ouvre une béance – une béance qui laisse place aux penseurs non systématiques comme Kierkegaard, Pascal, Nietzsche. Et pour Pierre Magnard, « au fond, la raison grecque, le logos hellénique, trouve son origine dans cette divinité même. Car le logos est bien le fils de cet unique, le fils de ce père. » (p. 60)
Au cours de cet itinéraire, Pierre Magnard avoue que dans sa volonté de tenir la disjonction, il s’est laissé rattraper par la conjonction de l’un et de l’être : « Sans doute en raison de cette curieuse rencontre entre le texte de Plutarque et celui de l’Exode 3, 14. Comment en effet ne pas être sensible au fait que le prêtre d’Apollon, c’est-à-dire de l’unique retrouve à Delphes l’intuition profonde de l’auteur du Pentateuque, quand celui-ci met en scène Moïse recevant dans le buisson ardent, la révélation du nom divin ? L’être ne laissait pas d’être un nom de Dieu, et dès lors bien sûr, il s’agissait de retrouver la conjonction avec l’unique. » (p. 63) Avec Plotin, Pierre Magnard insiste sur le fait que l’être n’est rien en regard de l’un qui lui demande sa raison d’être : « Ici, la trace de l’un fait naître l’essence et l’être n’est que la trace de l’un. » (Ennéades V, 5, 5) Seul l’un peut en répondre, car il n’est d’être que sous le couvert de l’un. « L’être, dit Pierre Magnard, est la trace d’un pas qui s’en est allé, l’empreinte d’un sceau qui a marqué son œuvre, le signe indélébile de l’ouvrage accompli. Mais il est aussi le fils qui se souvient du père car il en est l’image vive. » (p. 63) C’est donc une présence d’absence parce qu’il a laissé sa trace. Et Pierre Magnard rappelle que la trace c’est ce que le grec appelle ichnos et qui est précisément le signe par excellence de celui qui s’en est allé. En cet ichnos, il voit la main négative de nos ancêtres préhistoriques, cette main obtenue par la position de la paume sur le rocher, tandis que celui qui veut marquer sa trace souffle un pigment qui permettra à cette main de laisser en quelque sorte le signe vide de sa présence : « Or, je ne trouve pas de symbole plus fort que celui que nous donne l’homme du néolithique quand il pratique cette manière de signifier qu’il fut là mais qu’il en est parti. N’ayant pas rencontré celui qu’il voulait voir, il lui laisse le signe de sa présence passée, la trace de celui qui s’en est allé. » (p. 64)
Or, rappelle Eric Fiat, seule la présence d’absence « sied à l’absolu ». Finalement, il n’y a rien de plus probant que ce tombeau vide. Pierre Magnard rappelle en effet que l’un se donne sans cesse à profusion, mais « il donne ce qu’il n’a pas, il donne ce qu’il n’est pas. Lui-même ne manque à aucun être, car ce à quoi l’un ferait défaut serait néant absolu. L’un est donc présent à tous les êtres. Cette donation pure implique l’absolu dénuement du donateur en même temps que la totale ingénuité du récipiendaire. » (p. 65) Or si l’être est la trace de l’un, le sceau dont il signe son acte, l’image qui accrédite sa présence, si l’ichnos, le topos et l’eikon expriment un principe aussi insaisissable qu’imparticipable, les néo-platoniciens semblent bien avoir établi les conditions de possibilité de la révélation judéo-chrétienne. Comme le dit Augustin : « Le sceau de la bague passe à la cire mais sans quitter la bague. » Dès lors, rappelle Pierre Magnard, la pluralité des créatures est l’expression de la structure dialogique du divin : « Le multiple n’est ni simple apparence, ni réalité dégradée, il a son fondement dans la pluralité des personnes en Dieu. » (p. 67) Or en oubliant le néo-platonisme et en perdant la tradition, l’âge classique de la philosophie occidentale se privera du sens plein de la fonction Dieu pour en donner une interprétation instrumentale. C’est ce que Pierre Magnard appelle le « Dieu fonctionnaire » ou encore le « Dieu vacataire », heureuses formules qui en disent long sur ce Dieu du « petit rationalisme des Lumières », sur cet « embourgeoisement de la transcendance » (p. 68)
IV) Pierre Magnard : un chercheur de Dieu en pays désertique
Si « le grand Pan est mort », le « Dieu fonctionnaire » aussi. Que faire alors après la mort de ce second Dieu sinon oser marcher dans le désert, comme Pierre Magnard qui entreprend une marche dans la nuit, aux confins du silence ? Dans ce quatrième entretien, Eric Fiat souligne quel philosophe audacieux fut Pierre Magnard : un philosophe qui a le courage de s’aventure dans la profondeur de la nuit, espérant la couleur du matin profond. Oui, Pierre Magnard risque le saut dans l’abîme – ce saut qui suppose une totale confiance : « Croire, c’est prendre tous les risques, rappelle-t-il. C’est s’abandonner aux flots « sur mille brasses de fond ». Croire c’est toujours parier sur l’improbable. » (p. 71) Or la foi de celui qui écoute en silence ne saurait s’appuyer sur une raison qui parle et qui veut qu’on lui parle. La foi est simple écoute. Et le cœur est sans doute ce qui met l’âme à l’écoute. Aussi Pierre Magnard souligne avec pertinence qu’ « il faut avoir du cœur pour interroger le silence » (p. 73) Si « Dieu est sensible au cœur, non à la raison », de quelle nature est donc cette sensibilité ? Le cœur désigne cette fine pointe de l’âme, sa cime qui est en même temps son tréfonds, ce fond sans fond où elle est en dialogue avec Dieu. Aussi est-ce cet abîme qui abrite la présence même de Dieu. Pierre Magnard cite alors le journal d’Etty Hillesum : « Le sentiment de la vie est si fort en moi, si grand, si serein, si plein de gratitude, que je ne chercherai pas un instant à l’exprimer d’un seul mot. Ce qui l’exprime encore le mieux, ce sont ces mots : ‘se recueillir en soi-même’. C’est peut-être l’expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je me recueille en moi-même, et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche de moi où je me recueille, je l’appelle Dieu. » Et c’est bien en ce jardin clos, secret, retiré que l’oreille du cœur s’ouvre à la Voix de fin silence qui est la présence infinie de Dieu lui-même dans le tréfonds. Et pour Pierre Magnard c’est bien ce jardin qu’il s’agit de « sauver de l’inquisition d’un monde totalitaire » (p. 75) Revenant à Etty, Pierre cite ces phrases magnifiques de son journal : « Je vais t’aider mon Dieu à ne pas t’éteindre en moi… C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque, et c’est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu… C’est à nous de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. Je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. » Dieu est là avant même qu’on s’en avise. Et sitôt qu’on l’a découvert comme cette source de vie, il faut ménager sa présence en s’interdisant tout ce qui pourrait le chasser de notre enclos. Alors toute notre tâche est de rester fidèle, et être fidèle c’est continuer à réserver toujours en nous-mêmes cette part à Dieu. Et la source de la vie apparaît alors comme cette perpétuelle écoute, au-dedans de moi-même, des autres et de Dieu : « Et quand je dis que j’écoute ‘au-dedans’, ajoute Etty, en réalité c’est plutôt Dieu en moi qui ‘est à l’écoute’. Ce qu’il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l’essence et la profondeur de l’autre. Dieu écoute Dieu. » Pierre Magnard en conclut que Dieu est le plus court chemin d’une âme à une autre car « il ne s’éprouve que dans un cœur à cœur et c’est pourquoi on peut dire avant toute révélation qu’il est amour. » (p. 78) C’est au cœur que revient la primauté, car c’est lui qui sent Dieu et non la raison : c’est le cœur qui donne ses principes à la raison même, c’est le cœur qui juge de l’exercice de la raison. Alors « pourquoi la raison ? » interroge Pierre Magnard : « Pour nous amener à apprivoiser l’intuition que nous venons d’avoir, à l’approcher, en quelque sorte à nous l’approprier… La raison va donc s’approprier ce que le cœur a découvert, seconde en son intervention, ce qui ne veut pas dire nécessairement secondaire. » (p. 77) Dieu touche le cœur, il habite le cœur, il fait de ce cœur le lieu même de son action ici-bas, ce cœur qui est en quelque sorte le lieu natal de Jésus-Christ en notre monde, « et c’est alors seulement, rappelle Pierre Magnard, que la raison prend son essor. » (p. 78) Or Pascal aime mettre l’accent sur le fait que le cœur n’est capable de Dieu que s’il a connu la blessure de la passion. Sinon ce cœur reste « vide et plein d’ordures ». Il faut donc qu’il ait été blessé, il faut qu’il ait été meurtri dans ses affections les plus chères, dans ses penchants les plus naturels, pour devenir capable de Dieu : « Telle est la vraie circoncision dont la circoncision physique ne serait que l’image. » (p. 82) Sans une forme d’oubli de soi, d’effacement de soi, il n’est nul espoir de renouveler son propre cœur, affirme Eric Fiat. Et c’est ce que Maître Eckhart et Nicolas de Cues ont enseigné à Pierre Magnard : « L’homme chez Nicolas de Cues, ne se réalise que dans ce qu’il appelle la christiformitas, c’est-à-dire sa configuration au Christ, ce qui en fait l’image de l’image et non pas l’image immédiate du Père. » Ainsi, en tant que penseur de la médiation, le dernier des médiévaux est aussi le premier des Modernes « humaniste déjà qui sans manquer aux droits de Dieu sait faire leur part aux droits de l’homme. » (p. 84) En revenant sur la notion essentielle de singularité, Pierre Magnard évoque l’anthropologie du regard à travers l’œuvre de maturité du Cusain, Le Tableau ou la vision de Dieu : « C’est sous le regard, du Dieu unique, et du fait de son regard, que l’homme non seulement devient voyant, acquiert cette voyance, mais aussi qu’il éprouve sa singularité comme un absolu. » (p. 85)
Or l’individu qui est toujours « du pareil au même », « banalisation de la réalité humaine dans ce à quoi en tant qu’humaine elle devait échapper, à savoir l’espèce » s’oppose à la singularité qui est « nœud de relations » (p. 86) Et la singularité ne s’éprouve comme telle que sous le regard de Dieu, « ce Dieu qui nous confère voyance en nous regardant, mais qui dans le retour de cette voyance sur elle-même, nous fait prendre conscience de notre singularité. » (p. 87) Dieu porte sur nous ce regard qui nous fait être, chacun d’entre nous, dans notre singularité irremplaçable, dans notre originalité totale, dans ce que nous avons de plus intime, mais aussi dans ce que nous avons de plus universel : « Car l’universel en l’homme, ce n’est pas cet universel comptable dont les sociétés globalisées voudraient faire le décompte. L’universel en l’homme, c’est le reflet de Dieu sur son visage. » (p. 88) A travers cette admirable phrase, Pierre Magnard nous montre donc que c’est le singulier qui fait l’universel et qui constitue précisément notre universalité qui n’a donc plus rien à voir avec la généralité, puisqu’elle coïncide avec ce que toute singularité a d’unique. Ainsi, quand Dieu ne se manifeste plus ni dans la nature ni dans l’histoire, c’est qu’il s’est enfoui dans le cœur de l’homme, « pour ne se révéler qu’à ceux qui ont assez de disponibilité pour ne pas en étouffer le murmure. » Le cœur se doit donc d’être à l’écoute de ce Dieu que le péché du monde a mis en quelque sorte au secret, rappelle Pierre Magnard : « De ce Dieu qui se cache, j’aime l’infinie discrétion qui est, de sa part, suprême délicatesse, s’effaçant devant mon prochain, s’effaçant devant mon semblable, pour ne paraître qu’à travers eux. Ce qu’on appelle la foi c’est d’abord de l’amour, et cet amour suscite la plus grande vigilance. » (p. 88) comme en témoigne le « Choral du veilleur » de Jean-Sébastien Bach ou la parabole des vierges sages de l’Évangile : « De même que nous avons vu dans le silence la plus haute parole, nous devons voir dans cet enfouissement de Dieu en notre cœur la plus haute révélation. » (p. 89)
V°) La communis humanitas
Dans Questions à l’humanisme, Pierre Magnard consacre toute une réflexion sur l’homme de l’humanisme. Or il rappelle que l’homme de la Renaissance ne s’inscrit pas en rupture avec le Moyen-Âge, mais qu’il en est bien plutôt l’accomplissement : « L’homme était déjà là, il venait de très loin, il marchait avec nous depuis l’Antiquité, s’acheminant jusqu’à l’envergure que lui reconnaît le fameux dessin de Léonard de Vinci. » (p. 92) C’est l’affirmation de cet homme qui fait en sorte que toutes les structures politiques, sociales, morales, religieuses, deviennent caduques. Car elle remet en cause l’anthropologie, les sciences de la nature, la cosmologie. Ainsi, Pierre Magnard affirme que « ce qui caractérise la Renaissance, c’est un basculement de ce sur quoi on avait vécu jusqu’alors : l’homologie microcosme/macrocosme, où l’homme microcosmique était défini par son homologie avec le cosmos, en une homologie inverse, où le petit monde devient grand monde, où le microcosme devient macrocosme. » (p. 93) C’est cette rupture de perspective qui va faire de l’humanisme un temps de crise. Car si le microcosme c’est maintenant le cosmos, et si le macrocosme c’est l’homme, on va devoir cesser de mesurer l’homme au cosmos, pour tenter de réévaluer le cosmos en fonction de l’homme. « Si l’essor de l’économie, des échanges commerciaux, du système bancaire, si les grandes découvertes, si les navigations intercontinentales, ont contribué à globaliser la planète, ce fut pour permettre une juste prise de conscience de ce que l’homme était devenu au terme de ces dix siècles de chrétienté – cet homme qui pourrait avoir pour devise : vouloir tout l’humain en tous les humains…homme total, dont les christs romans et gothiques auraient été l’anticipation. » (p. 94) Et pour proportionner l’homme tant à un univers infini qu’à une communauté humaine élargie à la planète entière, il faut tirer toutes les conséquences de sa configuration au Christ. Pierre Magnard rappelle avec beaucoup de pertinence que Grégoire de Nysse et Origène ont posé les fondements de ce que fut l’homme de la Renaissance. Ainsi, « la Renaissance ne pouvait être dûment interprétée que dans un ressourcement à tout le passé dont
Ce que Heidegger reproche à l’humanisme académique est d’avoir voulu définir l’humanité au jardin des espèces, en s’interrogeant sur la supériorité des espèces humaines sur les autres. Mais les humanistes de la Renaissance avaient-ils eu l’incongruité de concevoir l’homme de la sorte ? Le but n’était-il pas de passer outre la spécification et de faire apparaître la transcendance de l’homme par rapport aux espèces ? Pierre Magnard se demande alors quelle a été la raison de la méprise de Martin Heidegger dans sa Lettre sur l’humanisme. Il nous dit que la métaphysique occidentale aurait fait de l’humanisme « un acheminement à la subjectivité » : le sujet serait alors la connotation d’une prétendue maîtrise de soi qui ferait d’un chacun le juge du vrai et du faux, du bien et du mal, dans une téméraire extension des prérogatives du sujet de droit. Cependant, Pierre Magnard rappelle que pour traduire « la dignité de l’homme », Jean Pic de la Mirandole ne parle pas de sujet mais de nœud (nexus), de lien (vinculum) ou encore de copule du monde (copula mundi) : l’homme est celui qui a en charge le nouage. Telle est sa fonction régalienne. « Car c’est cela essentiellement que voyait Pic, l’homme, nouvel Adam, grand ensemblier du monde. » (p. 97) Ainsi, pour Pierre Magnard, il s’agit de repenser la métaphysique du grand siècle non pas selon la pente de son déclin, mais à partir de son aurore, de cette couleur du matin profond. Or s’il est un homme au XVIème siècle qui ne fut pas abusé par la nouveauté, c’est bien Montaigne à qui Pierre Magnard voue une grande admiration : « Il mérite d’être considéré comme le philosophe qui aura le mieux participé à cette belle entreprise de l’invention de l’homme. » (p. 99) Deux influences ont marqué la pensée de Montaigne : Raymond de Sebond et Nicolas de Cues. Pour le premier, il manque une lettre au livre des Écritures comme à celui de la nature, ce qui laisse le texte sourd et muet tant qu’on ne l’a pas trouvée. Il suffit que cette lettre soit restituée pour la Bible et la nature retrouvent tout leur sens. Et cette lettre c’est le Christ. C’est ce qu’il appelle le plenum d’humanité récapitulant en lui tous les hommes et réalisant l’homme total, première expression de l’homme universel : « Le Christ étant venu subvenir au défaut de l’homme pécheur, rend à l’homme le sens de son être au monde, en lui révélant la raison d’être de sa présence sur cette terre. » (p. 100) Or Pierre Magnard interroge le lecteur : « N’est-ce pas le sens même de la Révélation que de vouloir que cette fonction, que le Christ assuma superbement, soit portée par chacun d’entre nous ? » (p. 101) Et c’est bien cette transcendance de l’homme que Montaigne veut remettre en honneur quand il écrit son « Apologie de Raymond de Sebond ». Car la notion de différence ne joue pas chez l’homme comme elle joue au niveau des espèces, non plus agent de spécification mais de singularisation au sein de la communauté humaine. Appariés aux animaux que nous transcendons en les portant tous en nous, c’est de nos congénères que nous nous distinguons : « Il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à tel animal. » La différence joue ici autrement : « non pas vis-à-vis des animaux, mais entre les hommes mêmes, puisque si différence il y a c’est d’homme à homme. Et allant plus loin, Montaigne veut faire valoir que cette coupure que nous voulons faire passer entre les hommes passe en réalité dans le cœur de chaque homme, la différence étant de nous-mêmes à nous-mêmes, plus encore que de nous-mêmes à autrui : « Il se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes, que de nous à autrui. »
Ainsi l’humanité n’est pas une espèce, mais une communauté et même une communion. C’est pourquoi, dit Pierre Magnard, « la notion de différence va passer entre les singularités qui partagent cette communion. » (p. 103) Mais le rassemblement qui semble être la vocation de tout homme, ne relève pas d’une logique du même. Montaigne n’a égard ni à l’identité ni à l’égalité. Ce qui apparie les hommes entre eux, ce n’est pas la similitude, c’est ce que Montaigne appelle la convenance, terme qu’il emprunte à Guillaume d’Ockham. Les êtres humains conviennent entre eux, non en raison d’un commun dénominateur, mais par eux-mêmes. Héritier de Duns Scot et d’Ockham, Montaigne mérite d’être considéré comme le dernier des nominalistes. Ce n’est pas dans la généralité, dans la spécificité ou la particularité que la rencontre se fait mais dans la singularité. « Chacun par sa forme singulière » disait Ockham. De même Montaigne fait l’économie du critère de ressemblance pour désigner le rapport d’homme à homme puisque ce critère ne pourrait qu’uniformiser ceux qui ne laissent pas d’être absolument originaux. Ainsi « ce n’est pas dans un modèle commun, genre ou espèce, que conviennent Montaigne et la Boétie. S’ils conviennent, c’est par eux-mêmes. Cette amitié ne peut se rapporter qu’à soi. » (p. 107) La généralité est impropre dès qu’il s’agit de l’homme. L’homme n’est pas un être générique, si l’humanité est uniquement constituée de singularités. Et c’est pourquoi ce n’est pas l’appellation « homme », en ce qu’elle a de classificatoire, qui désignerait l’être universel, mais le prénom, en ce qu’il a d’absolument singulier, « Michel ». « Le prénom, dit Pierre Magnard, donne congé tant à l’héritage qu’à l’alliance, pour s’élancer vers l’universel. Seule la singularité est capable d’embrasser l’humanité toute entière. » (p. 109) Montaigne va retrouver confirmation de sa conception de la singularité chez Nicolas de Cues. Dans la Chasse de la sagesse où la notion de singularité est mise en honneur, on trouve un itinéraire de vie spirituelle, dont la dernière étape se nomme précisément « le pré de la singularité » où plus rien ne se rencontre sur le mode sériel ou répétitif, puisqu’il ne s’y trouverait que des êtres absolument originaux. Or pour Nicolas de Cues, dit Pierre Magnard, « il faut aller jusqu’au pré de la singularité si l’on veut se découvrir en ce que l’on a de véritablement humain. » (p. 111) On n’est homme qu’à ce prix. Tel est le secret de la reconstitution du tissu relationnel d’une société mise à mal en ces temps difficiles, tissu qui ne saurait se refaire que dans un nouage toujours plus complexe de singularités. « L’auteur des Essais n’aura cessé, dit Pierre Magnard, de mettre en pratique cette éthique de la vie au risque de l’autre, se cherchant sans doute chez les siens mais aussi et surtout aux limites de sa parentèle. » (p. 111) Car l’autre c’est aussi le même et ce serait nous amputer d’une partie de nous-mêmes que de ne pas vouloir le reconnaître.
Ainsi, Pierre Magnard rappelle avec force que le Moyen Âge a été la longue période de gestation de l’homme jusqu’à ce que celui-ci soit parvenu à la plénitude de la christiformitas. Le Moyen Âge c’est donc le long enfantement de celui qui apparaîtra dans toute sa stature au début du XVème siècle. « L’homme a été créé pour qu’il y ait un commencement » disait Augustin, repris plus tard par Hannah Arendt. Mais Pierre Magnard, à la suite de Martin Heidegger, rappelle que le commencement n’est pas l’origine : « L’origine se cache dans le commencement. C’est dire que le commencement la relève mais aussi la recèle, ce qui nous impose une attitude critique envers tout ce qui, dans l’histoire des nations, des familles ou des personnes, a voulu se poser comme inaugural. » (p. 118) Pierre Magnard, pour le dire, revient au si beau livre d’Albert Camus, Le Premier Homme où l’écrivain donne l’image d’une transmission de l’origine, laquelle serait un déplacement selon l’ordre de la filiation. « Le parti que va prendre Camus, c’est d’être, lui qui est sans père, l’homme de la transmission. Se donner une origine, se donner une mémoire afin de pouvoir transmettre, et d’abord à lui-même, ce dont il a besoin pour vivre. Transmettre aux autres pour se retrouver dans une humanité cohérente. » (p. 120) C’est pourquoi Camus donne la parole aux sans voix, aux sans mémoire. Il donne patrimoine à ceux que l’existence a semblé le moins pourvoir d’un héritage. Mais de Camus, Pierre Magnard retient aussi la méditation sur « la relation asymétrique selon l’ordre de la filiation. » (p. 121) C’est précisément cette relation verticale, ce mouvement qui va du plus lointain passé au présent le plus actuel, qui constitue l’essentiel de la transmission. Ainsi « la transmission, dit Pierre Magnard, s’inscrit en faux contre les illusions d’une communication horizontale. » (p. 121) Si cette horizontalité aliène, la verticalité libère, « nous plaçant sous la seule autorité de celui qui est autorisé à détenir la puissance ». Et c’est bien la kénose du principe qui est le signe même de cette puissance, d’une autorité qui n’est pas autoritaire, d’une autorité qui ne s’exerce qu’en se donnant et en s’abandonnant. Pierre Magnard rejoint ici Hans Jonas qui rejoint lui-même Denys affirmant que la kénose du principe rend l’autorité toujours plus légère. Car l’autorité n’est jamais plus légère que lorsqu’elle est exercée dans le dépouillement. Or Pierre Magnard se demande si notre monde ne souffre pas d’un défaut d’origine. D’un défaut d’origine car lorsque tout devient si pesant, c’est précisément parce qu’on est loin aujourd’hui de pouvoir se recommander d’un principe qui a réalisé sa kénose pour être moins pesant sur ceux qu’il administre. « Ce qu’il y a de tyrannique dans le monde d’aujourd’hui, où tout pèse de façon si accablante sur tous les sujets, c’est ce manque de l’origine. Le péché originel c’est cela : le déficit du père. Comment dès lors s’orienter dans la pensée ? » (p. 122-123) Cette perte de l’origine, de l’Orient c’est l’éclipse de l’étoile, étymologiquement le désastre, cette dés-orientation que décrit Descartes en la troisième règle de la morale provisoire. » (p. 123)
L’enseignement de Pierre Magnard, loin d’être l’embaumement d’un passé, fut au contraire la transmission de ce moment originaire, la transmission de cette origine toujours vive et toujours vivifiante, la couleur du matin profond. René Char ne disait-il pas que « seuls les commencements sont beaux » ?
VI°) L’arrière-pays
Comme Platon, il s’agit d’effectuer une sorte de « révolution de la vision » (p. 132) : voir autrement, avec les yeux de l’esprit. Voir un ailleurs qui transporte Platon loin de cette Athènes qui a tué le sage et qui s’est prostituée dans la politique la plus lamentable. L’Idée va alors différer la présence, produire ce délai, ce détour requis de la manifestation de la vérité, cette vérité que le quotidien mensonger a fini par obnubiler : « L’Idée a-t-elle d’autres fins que la découverte de ce qui était caché ? » Et Platon est là encore aujourd’hui pour donner tout son sens à « l’arrière-pays » (Yves Bonnefoy) – au-delà du paysage qui s’intègre dans la réflexion de Pierre Magnard sur la perspective où la question va se jouer dans la relation du point de fuite au point de vue. « Ce que je voudrais vous montrer c’est qu’en fait on accède par cette mise en perspective à une autre dimension, autrement mystérieuse. Faire du point de fuite la projection orthogonale Ainsi dans le Portrait des époux Arnolfini, l’à-rebours du rayon lumineux amène Pierre Magnard à se demander qui voit qui : « Est-ce le spectateur présumé en avant du cadre du tableau, ou bien est-ce regard qui nous vient du fin fond du tableau, de par le miroir qui en quelque sorte récapitule la scène pour nous la renvoyer ? » (p. 135) Quand le thème est repris par Nicolas de Cues dans son De icona, c’est à travers la mise en scène de l’omnivoyant qu’il tente de donner une réponse à cette question. Pour Nicolas de Cues, il ne s’agit pas de multiplier le point de vue, de le redoubler, de lui conférer une autorité indue en imaginant qu’il voit du fin fond de la pièce pour récapituler la scène entière, car seul Dieu voit et fait voir, et c’est du regard même de Dieu que nous voyons quoi que ce soit. L’homme ne peut voir que de l’œil même de Dieu.
L’audace des peintres du Quattrocento aura été de situer l’infini dans le cube perspectif, quand ils sacralisent le point de fuite et la ligne d’horizon, au point d’en faire un accès à cet « arrière-monde ». « Les fonds des primitifs toscans, flamands ou hollandais laissent toujours entrevoir un « au-delà » qui donne sa pleine signification à ce que Léon-Baptiste Alberti appelait l’historia, c’est-à-dire à l’anecdote biblique, évangélique ou mythologique que représente le premier plan du tableau. Sans cette sacralité de l’arrière-plan, le motif rapporté serait privé de la plénitude de son témoignage. Ainsi le passage du fond d’or au paysage à la fin du XIVème siècle, témoignait d’une exacte conscience de l’arrière-pays. » (p. 138) L’historia ouvre une fenêtre sur le monde, sur la scène biblique, évangélique ou mythologique qu’il s’agit de représenter. « Pour les peintres du quattrocento, au-delà de l’image, il faut toujours chercher l’énigme. Entendons que l’image délivrée par le miroir, puisque l’œil est toujours assimilé à un miroir, ne dit pas tout, et que subsiste une part d’énigme à déchiffrer. Or si l’historia recèle une énigme, c’est qu’elle dissimule en même temps qu’elle révèle ce qu’elle est censée nous découvrir. La perspective qui la met en scène pour l’ouvrir sur l’ailleurs est sans doute le ressort de cette interpellation, sans doute aussi le moyen d’en percer l’énigme. » (p. 139) Et cet étrange pays, rappelle Eric Fiat, échappe toujours à l’ordre cadastral de la représentation. La perspective ouvre moins à cette troisième dimension que serait la profondeur qu’à cette quatrième dimension, ce mystérieux arrière-pays ou arrière-monde que l’on retrouve chez Van Gogh et Cézanne : « Or si la montagne sainte-Victoire de Cézanne est pour nous une référence dont nous ne pouvons nous lasser, c’est parce qu’elle constitue une sorte de méditation sur le rocher. Sur la vertu qu’a le rocher d’introduire de la profondeur dans la représentation, une profondeur qui nous conduit non seulement dans la troisième mais aussi dans la quatrième dimension. » (p. 145) Tout est au fond dans une sorte de tension entre l’ici et le là-bas – tension qui est au cœur de l’œuvre de Plotin -. Or ce « là-bas », il faut l’interpréter philosophiquement, religieusement, poétiquement, artistiquement. Or n’oublions pas, nous rappelle Pierre Magnard, que c’est l’ici-bas qui se projette dans le là-bas, que ce là-bas en est la gloire, « comme ce nimbe dont le soleil couchant auréole le contour montagneux qui le dérobe à nos yeux. » (p. 145) L’arrière-pays sacralise alors le pays dont il laisse entrevoir le secret, bien qu’il ne le déprécie : « C’est l’envers doré d’un quotidien, dont nous serions bien fous de vouloir mépriser le visage d’humilité. »
Pour conclure, nous pouvons remercier Pierre Magnard et Eric Fiat de nous avoir offert de si beaux entretiens : des entretiens vivants, sincères et généreux. Oui, ce sont là des paroles qui touchent au cœur et qui fécondent l’esprit, l’invitant au voyage. Comme Montaigne nous regarde et regarde le monde, dit Pierre Magnard, « à son école, nous ne voulons voir, et nous-mêmes et le monde que par ses yeux, c’est-à-dire en intériorisant son regard. Prendre conscience de soi, prendre connaissance des mille et une rencontres de la vie par le regard d’un sage, voilà ce qui doit donner à notre propre regard la lucidité que la nature n’est point parvenue à lui apporter. » (p. 154) Ainsi Pascal et Montaigne sont pour Pierre Magnard dans une sorte de relation interactive : « Les voilà comme entés l’un sur l’autre comme s’ils n’avaient qu’une âme ». Avec l’esprit de finesse qu’on lui connaît, Pierre Magnard décrit Pascal comme ce combattant amoureux qui ne connaît que l’art de la pointe, que l’art du trait, comme s’il voulait faire mouche. L’autre est un amoureux qui cherche à étreindre, étreignant le monde entier d’une seule et unique embrassade : « Je crois qu’on ne peut séparer les deux images, confie Pierre Magnard, car l’amoureux est combattant parce qu’il est amoureux. » (p. 160) Pierre Magnard a nourri son écriture de ces deux pensées vivantes, de ces deux vies pensantes, en trouvant l’expression musicale dans le superbe oratorio de Claudio Monteverdi sur le Combat de Tancrède et de Clorinde. Merci, cher Pierre Magnard, de nous avoir livré ces pages. Tel l’évangéliste Mathieu dans le tableau de Rembrandt, vous nous avez illuminé, revêtu vous-même de cette belle et douce lumière cuivrée que le passage du temps vous a fait gagner, dit superbement Eric Fiat, et que vous n’auriez pas gagnée si vous n’aviez accepté de perdre. « Il faut parfois une longue vie pour percevoir la couleur du matin profond » (p. 188) et celle de Pierre Magnard fut tout entière consacrée à la recherche de cette couleur.







