Le dernier livre1de Bruno Karsenti2 résulte d’un séminaire qu’il a tenu en commun avec Jocelyn Benoist à la fin de l’année 2011. J’ai eu, pour ma part, à l’époque, la chance d’assister à cette rencontre hebdomadaire de deux des esprits philosophiques les plus féconds de notre époque. Le livre restitue nombre des thèses soulevées et ardemment discutées lors de ce séminaire, ainsi que le rappelle Bruno Karsenti en ouverture de son livre, dédié, pour cette raison, à Jocelyn Benoist. Partant d’une lecture de L’homme Moïse et la religion monothéiste de Freud, Bruno Karsenti se propose de dégager de l’ultime texte – mystérieux et testamentaire – de l’inventeur de la psychanalyse, une compréhension renouvelée du concept politique de « peuple » à partir des origines et du destin historiques du peuple Juif décrits par Freud. La problématique d’ensemble vise à travers Freud à dégager le sens de l’entité politique « peuple ». B. Karsenti l’annonce d’emblée : « Freud a fourni à la pensée moderne une grille d’intelligibilité qui me paraît sans égale pour ressaisir le sens du mot peuple, non pas seulement pour les juifs, mais pour la culture occidentale en général, sous la forme qu’elle a donnée à l’existence politique au sein des Etats où elle s’est déployée »3. Se concentrer sur la formation du peuple Juif dans sa singularité, devrait ainsi permettre, selon Karsenti, de dégager le sens général du concept de peuple.
En même temps, l’expérience juive est présentée, sous la plume de Karsenti, comme une incarnation si adéquate de l’idée de peuple, qu’il semble difficile, à plus d’un titre, de détacher celle-ci, l’idée de peuple, de celle-là, l’expérience juive. B. Karsenti souligne le fait que « toute société n’est pas emportée dans un devenir-peuple »4. En associant le devenir-peuple à l’action formatrice d’un législateur, une première question peut se poser à la lecture du livre de B. Karsenti : s’affirmer comme peuple pour une formation sociale définie, est-ce réaliser, comme l’ont fait les juifs, l’acte par lequel un peuple s’accomplit comme peuple par le biais d’un législateur, reproduire en somme cet acte, ou est-ce, pour les sociétés modernes, se déterminer par rapport à cet acte d’affirmation par lequel le peuple juif est né et s’est distingué des autres cultures ? Cette question revient, en d’autres termes, à se demander comment ce peuple au destin si singulier peut représenter un peuple exemplaire pour l’intelligibilité du concept de peuple en général, pour comprendre le fait que « le différentiel de la société et du peuple » est devenu, comme l’affirme Karsenti « notre destin »5, alors que, parce qu’il est aussi une incarnation intégrale de l’idée de peuple – au point de représenter une exemplification non séparable du contenu de cette idée -, le peuple juif paraît incarner, par bien des aspects, non pas seulement un peuple unique mais l’unique peuple digne de l’appellation « peuple ».
L’analyse de cette tension constituera l’orientation directrice de ma lecture de Moïse et l’idée de peuple.
1. La question du législateur
L’émergence du peuple juif est indissociable, chez Freud, de la figure de son législateur, Moïse. L’hypothèse d’un Moïse Egyptien, avancée par Freud, permet d’apporter une précision décisive sur l’action législatrice accomplie par Moïse : « Moïse est le meilleur guide dans une enquête sur le législateur » 6. L’action de Moïse s’inscrivant en effet dans un rapport d’hétérogénéité ethnique de l’homme Moïse vis-à-vis du peuple qu’il contribue à faire émerger : « il aura fallu qu’un fondateur intervienne qui n’appartient pas au peuple, et que, corrélativement, le peuple s’affirme à travers lui tout en se l’appropriant. Les juifs sont juifs en Moïse, qui ne l’était pas » 7. Ce trait d’hétérogénéité de Moïse vis-à-vis des hébreux, loin de représenter une contingence accidentelle, se révèle en fait un trait constitutif du législateur en son action fondatrice de peuple. La position du législateur vis-à-vis de la société sur laquelle il opère, doit ainsi être comprise comme celle, d’« un grand étranger concerné » 8, suivant la formule heureuse de Karsenti. Chez Rousseau, rappelle Karsenti, l’intervention du législateur s’accomplit en ce point précis qu’« au Contrat (social) comme exposition des « principes de droit politique », il faut adjoindre un personnage pour ainsi dire hors droit (…) l’intervention paraît nécessaire d’un grand individu – le miracle d’une « grande âme » – doté d’une autorité « d’un autre ordre » que celle qui est justifiée par le contrat lui-même »9. Dès lors, si Moïse apparaît comme la figure tutélaire de l’intervention d’un grand homme hétérogène à un groupement social déterminé, mais dont la puissance d’agir, par son hétérogénéité même, se révèle constitutive du devenir « peuple » d’une telle formation sociale, alors, nécessairement, il devient légitime de se demander « s’il n’y a pas, sur une trajectoire qui s’élance depuis le monothéisme juif, un héritage politique particulier que la culture occidentale a recueilli dans sa constitution politique, dans la façon dont les peuples se sont formés, à la fois en eux-mêmes et les uns par rapport aux autres – c’est-à-dire dans la façon dont ils ont conçu leurs rapports, à l’intérieur desquels s’est justement placée en position stratégique et éminemment sensible leur relation à ce peuple singulier que sont les juifs »10. Le peuple Juif, par la figure et l’action de son législateur, Moïse, dirait ainsi quelque chose d’essentiel sur le concept de peuple en général, et donc, nécessairement, permettrait d’interroger le type de liens que les peuples, dans la culture occidentale, entretiennent à l’endroit de cette formation politique archétypique qu’est le peuple Juif, dans la relation que lui-même entretient à son législateur, ce grand homme étranger, qu’est Moïse. Il n’y aura donc pas de définition moderne de la politique, ou de politique chez les modernes, qui puisse s’exempter de la question – apparemment archaïque – du lien qui rattache une formation sociale à la figure du législateur, qui, seul, assure à cette formation sociale son devenir politique. Chez Rousseau, « le souvenir de Moïse, Lycurgue, Numa, Solon et Mahomet, circonscrit un besoin et permet de le préciser » souligne Karsenti. En effet, « il est l’outil emprunté aux anciens pour la définition d’une tâche moderne » : la nécessité de renouer avec la figure du législateur pour l’établissement d’un collectif politique fondé sur le contrat social, ce que Karsenti appelle « un législateur pour les modernes »11. Karsenti montre que cette nécessité de renouer avec la figure du législateur, a tout à gagner de l’hypothèse freudienne d’un Moïse non-juif, car contrairement à ce que l’on pourrait penser, la figure du législateur chez Rousseau, va aussi dans le sens d’une hétérogénéité constitutive du législateur vis-à-vis du peuple qu’il contribue à faire émerger politiquement : « A prendre à la rigueur les lois telles que le Contrat les définit, il est certain que le législateur est exclu de leur fabrication. Il n’est pas un « faiseur de lois ». Il est même tout le contraire. Il a donc, pour reprendre une expression de Carl Schmitt, un « nom trompeur » (…) Antérieur à la constitution, il se tient en fait hors de la distinction du législatif et de l’exécutif, de la souveraineté et du gouvernement, su fortement distingués par Rousseau. Sa nécessité est celle d’un personnage en surplus de la volonté générale, voire en surnombre par rapport au peuple lui-même, à la manière d’un grand étranger venant l’éclairer de l’extérieur. Sa fonction est nodale : il agit comme connecteur entre la volonté et l’entendement du corps politique.
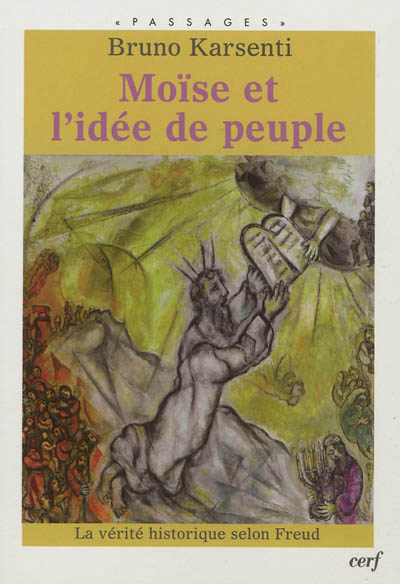
Car, dit Rousseau, « les particuliers voient le bien qu’ils rejettent : le public veut le bien qu’il ne voit pas » (Liv. II, chap. VI). Il manque une lumière au public, qui a une volonté, et il manque une volonté aux particuliers, qui ont pourtant quelque lumière quant au bien commun. Le législateur résout le chiasme, il en fait une correspondance : il transporte la lumière disséminée dans les particuliers au niveau du peuple qu’ils forment, en voulant ensemble, en visant un « intérêt commun », l’intérêt à être un corps »12. Fixer comme tâche aux modernes de renouer avec la figure archaïque du législateur, paraît pourtant remettre au goût du jour ce « que la modernité a repoussé de toutes ses forces : une fonction politique matricielle attribuée à une personne, à quelqu’un de supérieur, singulier entre tous, et dont la singularité l’oppose au peuple – non certes comme son ennemi, mais tout au moins comme son vis-à-vis » 13. Le législateur, dans cette conception, est dans un rapport d’hétérogénéité par rapport au peuple qu’il contribue à faire émerger, occupe une position en vis-à-vis. La question qui se pose est évidemment celle de la raison de cette position d’extériorité du législateur pour le devenir peuple, au sens politique du terme, d’un groupement social d’individus. C’est que le législateur ne s’occupe qu’en surface de l’édification du droit civil. Sa tâche véritable est souterraine, les règles qu’il édicte sont d’ordre culturel : « L’artifice du législateur est un « art caché », dans la mesure où l’on ne voir que ce qui n’est pas dans le cœur, mais dans le marbre et l’airain – dans la mesure où l’on ne voit pas son opération sur les mœurs »14, « le législateur ne dit pas ce qu’il fait réellement. Sa vraie tâche se tient en deçà de sa tâche manifeste »15.
La position en vis-à-vis du législateur est donc plus complexe que ce que l’on pourrait croire. Le législateur édicte des lois positives – dans le marbre ou l’airain – pour modifier les mœurs d’une société, c’est-à-dire pour rendre celle-ci politique au sens propre. L’édification positive des lois – ce qu’on appelle traditionnellement le travail législatif – ne suffit donc pas à l’émergence de l’entité politique peuple, il faut que l’acte d’édifier les lois serve le dessein caché d’instaurer des mœurs nouvelles, que Karsenti présente comme la « forme suprême de la loi »16.
D’où « la lenteur de l’œuvre du législateur – lequel serait donc un agent politique qui n’a rien de ponctuel ni d’inaugural, mais dont la présence est requise sur ce temps long de la formation et auquel convient beaucoup mieux le nom de guide, de conducteur sur un long chemin moral, que d’instituteur primordial dont la voix tonne puis retombe dans le silence »17. En ce sens, le législateur, certes, fait les lois, mais sa véritable fonction est de produire des mœurs, ou d’accomplir la loi par le biais de l’instauration d’une culture nouvelle. Cela signifie que le sens politique de l’édification des lois ne s’achève que dans la production de mœurs nouvelles, à travers l’intervention non directement légale d’un personnage extérieur mais directement concerné par l’ouverture d’une société à son destin politique. Les mœurs ne précèdent donc pas l’édification du droit, elles n’ont rien d’un « pré-droit », elles assurent en réalité l’accomplissement de la loi, en tant que celle-ci dépasse le plan légal du droit et de son instauration, par le biais du travail souterrain accompli par cet individu « hors-droit » qu’est le législateur. Le droit ne résume donc pas la production de la loi émanant du législateur. Il faut que ce dernier parachève la loi dans la fabrication de nouvelles mœurs : « Le peuple qui entre dans la politique moderne ne peut accéder à l’acte fondamental d’affirmation de soi que s’il tient historiquement, si son comportement se répète, et si cette couche de réalité fait elle-même l’objet d’un travail » 18.
C’est par ce travail, secret et patient, que l’habitude, l’acceptation tacite et informulée de la loi, remplace progressivement l’autorité et ses prescriptions juridiques explicites. Le législateur agit dans l’édification lente, cachée et secrète, d’une culture nouvelle à partir de laquelle un peuple émerge en sa destination politique. Le remplacement de l’autorité par l’habitude, autrement dit l’inscription de la loi et de son obéissance dans le secret du cœur, ne devient effectif que par l’intervention de « cette « autorité d’un autre ordre » du législateur sans autorisation légale, autorité qu’avec Max Weber on est tenté d’appeler charismatique – non sans préciser qu’elle tient en l’espèce à sa capacité à faire résonner une structure légale, à dire la loi, à la rédiger et à l’écrire, à dire les petites lois tout en s’occupant en secret de la grande » 19. En d’autres termes, souligne Karsenti, le législateur serait moins « le gardien de la loi que le gardien d’un inconscient dont la loi se soutient – de l’inconscient opératoire dans l’idée de loi (…) Secrètement, le législateur est un faiseur de culture politique, structurellement inconsciente. Plus précisément, il fabrique la politique comme culture »20. Or c’est en ce point précis, d’après Karsenti, que l’objectif théorique fondamental que se fixe Freud dans le Moïse rejoint Rousseau, puisque, contrairement à Totem et Tabou, ce qui intéresserait désormais Freud, aux dires de Karsenti, « c’est moins le rôle de la religion, ses origines, son caractère de névrose de contrainte, etc., que ce qu’on a appelé la culture politique – entendant par là, la politique d’avant la politique, la culture dans ce qu’elle peut avoir d’intrinsèquement politique » 21.
Reste à Karsenti à affronter l’objection majeure de son propos destiné, après Rousseau et avec Freud, à la réhabilitation de ce personnage « hors droit » qu’est le législateur. En quoi est-il légitime d’attribuer à l’œuvre d’édification d’une culture religieuse produite par le législateur un rôle proprement politique ? Sa position « hors droit » ne suffit-elle pas à exiger une claire et saine séparation de l’autorité religieuse et du pouvoir temporel ? Ne faut-il pas accroître la différence du politique et du théologique plutôt que de chercher à travers la réhabilitation de la figure archaïque du législateur à les réconcilier ? Dans la lecture que Leo Strauss propose de Rousseau, rappelle Karsenti, la figure du législateur reste « une anomalie à conjurer ». Toutefois, Strauss cherche à comprendre les raisons de son maintien, lequel constitue la source du hiatus entre la philosophie d’une part, et la société, de l’autre, attachée aux préjugés de la tradition. Il y aurait pour la philosophie deux dynamiques adverses qui s’affronteraient sans résolution apparente : d’un côté, la tâche que se fixe le philosophe, de réfuter les croyances irrationnelles sur lesquelles s’établissent les sociétés, et d’autre part, la reconnaissance de l’impossibilité d’anéantir entièrement le plan de telles croyances, en tant qu’elles représentent une couche nécessaire à la constitution politique de ces mêmes sociétés : « Une société libre joue son existence sur un aveuglement spécifique contre lequel la philosophie se révolte nécessairement. Le problème posé par la philosophie politique doit être oublié pour que tienne la solution à laquelle mène la philosophie politique »22. Karsenti tente de démontrer ainsi que la figure du législateur, loin de nous faire régresser vers les temps reculés du préjugé, peut trouver sa place dans l’horizon des modernes, en tant qu’une telle figure n’entre pas en totale contradiction avec l’effort philosophique visant à libérer les populations du préjugé : « Rousseau, c’est là sa grandeur, a combattu en philosophe les préjugés politiques jusqu’au bout. Mais jusqu’au bout, cela ne veut pas dire jusqu’à l’anéantissement : cela veut dire jusqu’au point de leur requalification, de leur intégration à une pleine conscience politique de soi »23. Pour Karsenti, le législateur n’est pas forcément du côté du préjugé et le philosophe du côté de la lutte de la raison contre le préjugé, ou plutôt leur rapport ne s’arrête pas à cette polarité. Une prise de conscience philosophique du rôle de l’autorité du législateur doit permettre une intégration du préjugé dans la conscience de soi d’un peuple, laquelle, intégration, définirait sa conscience politique en tant que telle. Il ne s’agit donc pas pour le philosophe d’abolir le préjugé mais de faire en sorte que celui-ci puisse « être socialement récupéré – réassumé une seconde fois par la société qu’il s’est efforcé d’éclairer. Ce à quoi il engage la société, ce n’est pas seulement à renaître, c’est à renaître à elle-même, depuis elle-même » 24. En ce sens, le législateur n’est pas forcément l’adversaire du philosophe, « c’est aussi un allié objectif, si tant est que le philosophe sache à quoi il doit renoncer pour que le droit politique ne reste pas une forme vide, mais passe effectivement dans la réalité »25. Mais l’instauration d’une telle complicité entre le philosophe et le législateur « ne vaut, précise Karsenti, que pour un législateur nouveau » 26. Pour Strauss, ce rappel de la figure du législateur « ne peut plus avoir cours (…) le législateur ne peut pas être un véritable allié du philosophe, parce qu’il obscurcit la souveraineté populaire » 27. Cependant, aux yeux de Karsenti, si Strauss invalide la nécessité de fixer au législateur une tâche politique proprement moderne, c’est parce que l’interprétation de Strauss passe à côté de la définition rousseauiste de la tâche du législateur. Strauss réduit en effet le législateur à « un agent légal concurrent au pouvoir législatif – ce que Rousseau ne voulait pas (…) le problème du législateur n’est pas tant la loi que la volonté générale, en tant qu’elle serait à même de voir le bien qu’elle veut, et de formuler la loi sur cette base » 28. La tâche du législateur s’inscrit en effet au niveau précis où comme l’avait formulé Rousseau « les particuliers voient le bien qu’ils rejettent : le public veut le bien qu’il ne voit pas » (Liv. II, chap. VI du Contrat Social). Il a donc bien pour tâche de servir la volonté générale, non de l’obscurcir. Mais ce qui reste vrai, c’est qu’il ne saurait le faire tant qu’il tient l’accomplissement de la loi loin des mœurs, des habitudes et du préjugé, bref, tant que le droit se dissocie de la culture. Le législateur travaille ainsi à même le préjugé culturel, là où le philosophe voudrait l’écarter, tout en sachant que sa mise à l’écart entraînerait une déréalisation de la politique dans une dissolution de la volonté générale. Le détour par le Moïse de Freud permettra-t-il cependant de rejoindre le projet de mise au jour d’une fonction et d’une orientation proprement modernes de la figure du législateur, « celle de l’entrée dans la politique moderne, en ce qu’elle s’accomplit, souligne Karsenti, réellement en politique du peuple » 29 ?
2. Moïse et la « vérité historique »
Comme le rappelle Karsenti, « le livre de Freud n’est pas directement un livre sur la politique, mais sur l’idée de tradition »30. La tâche du législateur consiste à travailler sur le préjugé pour l’infléchir dans le but de faire naître une nouvelle culture politique, sans laquelle, l’adhésion du peuple à sa loi demeure formelle et infra-politique. En effet, « une société devenant un peuple est une société appelée à vivre sa tradition d’une manière déterminée par le législateur »31. C’est par Moïse, que la réalité « politique » du peuple juif, en tant que celle-ci est « immanente aux coutumes, mœurs et opinion », « reste en éveil et demeure vivante »32. Moïse illustre parfaitement le rôle imparti au législateur : donner sa consistance de peuple à un groupement social par le biais d’un travail sur la tradition. Car, dans le cas de Moïse, on ne peut pas séparer la force d’imprégnation des pratiques et des opinions, qu’il a contribué à faire exister, en identifiant un peuple à la Loi du monothéisme, de l’idée de soi du peuple juif, et de l’idée du Dieu unique, qui, dans les deux cas en découlent. C’est à ce point très précis qu’il s’agit de distinguer la « vérité historique », invention freudienne capitale pour Karsenti, de la « vérité matérielle ». La première, la « vérité historique », concerne en propre le type de rapport à sa tradition qu’entretient un peuple par le biais du travail sur les mœurs et les coutumes accompli par le législateur. En elle, la réalité et la fiction s’entremêlent, elle est la tradition telle qu’elle se raconte et se transmet de génération en génération et dans laquelle se lit non pas le passé réel du peuple (les événements matériels), mais le passé réel transformé en une vérité paradoxale incluant la part fictionnelle que le récit de soi élabore et implique pour se transformer en authentique tradition historique. A ce titre, le législateur n’est pas un historien, mais « le témoin privilégié de la vérité historique, qui est le réel du peuple, irréductible à la vérité matérielle, et fonctionnant à travers l’irréalité de la « fiction pieuse » »33. Autrement dit, la vérité matérielle n’est pas en mesure de donner accès au « réel » du peuple, elle ne permet de comprendre qu’une série d’enchaînements dans lesquels le peuple en tant que tel – forgé en son caractère par la tradition – est absent. On voit donc bien que le rôle du législateur tient dans le différentiel de l’historique et du matériel. Par le biais du législateur, un groupe d’individus se dissocie de sa facticité sociale pour se constituer en peuple, et le politique tient dans ce différentiel qu’engendre la présence du législateur au sein d’une formation sociale : « Si telle culture comporte le législateur, alors il y a du peuple, alors le différentiel de la société et du peuple a commencé d’opérer, alors la société est travaillée par sa politisation (…) le différentiel de la société et du peuple est devenu notre destin, le destin des modernes » 34. Il faudrait alors chercher le noyau du politique, non dans l’origine de la formation des Etats constitués, mais dans cette expérience infra-étatique, où un peuple se lie à sa Loi en s’identifiant à sa vérité historique par la médiation de ce formateur de culture qu’est le législateur. En ce sens, « ce qui fait du caractère des juifs un cas heuristique particulièrement intéressant, c’est qu’il favorise, à raison de son histoire singulière, une sorte d’expérience de pensée. Il permet à l’analyste de pratiquer une isolation de la culture politique, non recouverte par l’édification institutionnelle dans laquelle la politique semble généralement se réaliser » 35. Non seulement le politique n’est pas en mesure de s’émanciper du théologique, mais bien plus « la politique ne serait touchée que dans la structure de la religion monothéiste »36, en tant qu’en elle, le rapport d’un peuple à sa loi désigne un rapport d’accomplissement, soit tout le contraire d’un « rapport de formation sociale au phénomène légal dans sa généralité »37.
3. La levée du monothéisme
L’hypothèse freudienne est que Moïse était un Egyptien, héritier d’une phase extrêmement courte de l’histoire égyptienne, au sein de laquelle on assiste à un suspens du polythéisme à la faveur de l’émergence brève d’un culte monothéiste. Après la restauration de l’ancien culte polythéiste, Moïse quitte l’Egypte avec un peuple d’émigrés, subalterne et inculte, en leur imposant les préceptes nouveaux du monothéisme. Or cette vision portée par Moïse « est rapidement insupportable à cette population arriérée, tout comme la religion d’Akhenaton avait été insupportable aux Egyptiens. Mais cette fois-ci, cela conduit les proto-juifs à tuer leur guide »38. Ce qui va compter dans le déroulement du processus qui conduit à l’émergence du peuple juif à proprement parler, tient, selon Karsenti, dans le compromis de Cadès, qui, effaçant les traces du meurtre du premier Moïse, remplace ce dernier par le prêtre d’un culte « vulgaire et arriéré du Dieu Yahvé, puissance naturelle volcanique d’une grande banalité »39. Ce qui va ainsi s’avérer décisif dans l’expérience juive, et constitutif de sa longévité de peuple – ainsi que de l’antisémitisme qui résulte de celle-ci -, n’est autre que cette forme d’étrangeté du premier Moïse vis-à-vis du peuple qu’il contribua – par sa mort et sa reconstitution historique en un second Moïse – à faire naître. Cette étrangeté, dont nous avons vu qu’elle jouait un rôle capital dans le processus de formation d’une culture nouvelle par le législateur, marque tout l’écart entre la scène originelle du meurtre décrite par le Moïse et celle décrite par Freud dans Totem et Tabou. En tuant Moïse, les « proto-juifs » ont répété l’expérience primordiale de l’humanité vis-à-vis du Père primitif décrite dans Totem et Tabou, à ceci près, et cette différence est absolument cruciale, que les proto-juifs n’ont pas ingéré dans un repas totémique l’homme qu’ils ont mis à mort :
« L’humanité enracinée dans le repas totémique – consommation du père tué, réactivation de l’interdit dans sa transgression qui est aussi répétition du meurtre d’où l’interdit, le renoncement pulsionnel qui cultive les hommes, est sorti – cette humanité-là a une culture, elle se civilise de façon générale, elle n’en a pas pour autant un destin. Un peuple en revanche, a un destin » 40.
Si donc les deux récits, Totem et Tabou et le Moïse, communiquent par l’événement du meurtre, ce qui se passe dans le judaïsme « c’est l’amour du grand homme, du père si l’on veut, mais sans sa dévoration, sans l’opération d’identification avec lui qui passe par l’incorporation dans le repas, la fusion des substances du père et des fils, par consommation rituelle de l’animal totémique »41. En n’ingérant pas Moïse, les juifs n’ont pas cherché à s’identifier à lui, ils l’ont maintenu dans sa transcendance par rapport à eux, laquelle est au principe du renforcement de la religion monothéiste diffusée par Moïse, tournée vers un Dieu unique, non sensible et innommable – et pour cette raison restant hors identification/incorporation dans ce processus de réconciliation immanente qu’est le repas totémique. Là tient la différence fondamentale entre Totem et Tabou et le Moïse, seul le second livre, pour la raison à l’instant soulevée, introduit le différentiel de la société et du peuple, de la culture et de la politique, et s’affirme ainsi comme un livre authentiquement politique : « Un livre comme Totem et Tabou ne parle pas de politique, un livre comme le Moïse ne parle que de cela »42.
Moïse a défendu – et élu un peuple sémitique pour obéir à un tel culte nouveau – l’idée d’une religion résolument coupée du sensible et de toute satisfaction compensatoire pour les efforts considérables exigés par le culte monothéiste. Il a imposé des prescriptions religieuses dont l’exigence était si absolue et insoutenable aux hébreux que ces derniers ont décidé de se débarrasser de cette instance de pression psychique inconditionnelle, en répétant l’histoire primordiale de l’humanité, c’est-à-dire en tuant Moïse. Toutefois, en refusant de l’ingérer, en le maintenant dans son extériorité non-désirée à eux, les hébreux ont en somme respecté la transcendance de Moïse et du Dieu unique dont il était le défenseur. L’extériorité biologique de Moïse a été une chance pour la propagation de la religion monothéiste, puisque c’est d’elle, de cette erreur dans le scénario d’origine, c’est-à-dire par le refus de l’identification/incorporation à soi, que la position psychique de Moïse par rapport au peuple qu’il avait élu, a été retenue comme celle du « grand homme » capable d’inscrire ce peuple dans une tradition culturelle, gravitant autour de l’idée absolue et inconditionnelle du Dieu unique et innommable. C’est pourquoi, pour Karsenti, il ne suffisait pas que Moïse défendît l’idée monothéiste pour qu’une nouvelle religion, et non une simple culture, un peuple avec un destin historique, et non une simple société, puisse voir le jour. Il fallait cette erreur dans le processus culturel qui résulte de la répétition avortée du rituel de meurtre du Père et de son incorporation dans le repas totémique. Moïse pouvait être tué, mais ne pouvait pas être mangé puisqu’il n’était pas le Père des proto-juifs. Cette déviation par rapport au scénario d’origine que les juifs ont répété (meurtre du père primordial), s’explique par le fait que Moïse n’était pas des leurs, n’était pas leur père, ni de leur ascendance biologique. Un tel raté dans la répétition, à cause de l’ascendance égyptienne de Moïse, est à l’origine de la tradition juive en tant qu’elle ne se résume justement pas à une simple culture, mais se produit comme culture différenciée, proprement politique : « la tradition est précisément ce qui épargne la consommation, et avec elle le processus identitaire qui aurait son principe actif dans l’unité substantielle réalisée et éprouvée avec le dieu »43. Le destin juif procède en somme d’une « déviation » anthropologique de l’histoire de la culture : « la ligne culturelle commune n’est pas suivie comme elle aurait pu ou dû l’être. Le mode de réconciliation avec le sensible, de travail interne à la sensibilité, chez eux, n’a pas lieu »44. Un tel décrochage est constitutif de ce que Freud appelle la Geistigkeit, ou vie de l’esprit, laquelle n’émerge qu’en tant que l’amour de soi du peuple juif se trouve « enraciné dans autre chose qu’un rapport identificatoire au père – dans un autre rapport au père qu’un rapport d’identification » 45.
Mais alors, surgit aussitôt une question de fond : pourquoi accorder une place cardinale comme le fait Karsenti au compromis de Cadès ? Puisqu’au fond, ce qui compte dans l’émergence de la tradition c’est ce raté dans le scénario de répétition par rapport au schéma culturel classique. Or, le compromis de Cadès ne représente-t-il pas justement une manière de s’incorporer l’étrangeté du premier Moïse en un second Moïse pleinement incorporé au peuple – aboli en son égyptianité ? Karsenti le reconnaît lui-même : « On voit donc en quoi consiste l’action de Moïse II sur Moïse I : il se l’incorpore »46. Comment une telle « incorporation » n’impliquerait-elle pas une dissolution de la position d’extériorité, voire d’étrangeté constitutive, du législateur et de la transcendance du Dieu unique qui lui est corrélée ? Et par là, comment l’incorporation n’impliquerait-elle pas le retour à la tradition totémique vis-à-vis de laquelle l’expérience juive a prétendu décrocher ? Le compromis de Cadès, en synthétisant l’ancienne religion mosaïque et l’exigence inconditionnelle qui la portait, avec la religion des Madianite, n’actualise-t-il pas un devenir viable et sensiblement – humainement – supportable de la première religion mosaïque ? Ne faudrait-il donc pas admettre que le compromis fait retomber le décrochage monothéiste dans un schéma d’incorporation classique ? C’est là une question que je me pose, car il n’est pas certain sur ce point que la lecture de Karsenti en valorisant le compromis de Cadès, s’accorde entièrement avec le texte freudien. Pour Karsenti, en effet, le compromis ne paraît pas menacer la préservation du décrochage monothéiste par rapport à l’incorporation totémique. Il y voit, au contraire, un événement essentiel pour la formation du caractère juif, en son orientation proprement monothéiste :
« Le prêtre madianite est un protagoniste essentiel du récit, puisque c’est avec lui que commence en réalité l’histoire au sens propre, que le temps prend sa courbe proprement historique, au sens de non matérielle. Jusqu’au compromis de Cadès, on est encore dans l’enchaînement matériel des faits – Akhenaton, Moïse I, choix des proto-juifs, sortie d’Egypte, conversion, puis meurtre. Avec le compromis, s’enclenche un autre type de dynamique temporelle. C’est par rétroaction qu’il imprime aux événements qui l’ont précédé que se forge mentalement le peuple, que le « caractère » de celui-ci acquiert ses contours. En somme, c’est là que commence à se fabriquer la temporalité historique du peuple juif » 47.
La régression chrétienne par rapport au judaïsme, en tant que le christianisme répéterait le rite d’incorporation païen, incarnerait un monothéisme abatardi, re-totémisé en somme, n’est-elle pas déjà en germe dans le compromis de Cadès lui-même ? N’assiste-t-on pas à travers lui à la réintégration du peuple juif dans l’horizon de la culture totémique, culture d’incorporation et de réconciliation de la transcendance avec l’horizon sensible ? N’est-ce pas défendre un judaïsme proto-chrétien que de considérer le compromis de Cadès comme le ferment de la tradition juive ? Si l’on suit l’idée suivant laquelle les prophètes se révèlent être tout au long de l’histoire juive, ceux qui n’ont cessé de rappeler le judaïsme aux prescriptions mosaïques originaires, contre toute adaptation de ces derniers à une logique immanentiste, prenant la forme du compromis, de l’adaptation des exigences du surmoi mosaïque à la réalité sensible – autrement dit, en dénonçant tout retour au principe économique de compensation, alors, sans doute, faudra-t-il distinguer entre l’éthique et le politique, et situer le judaïsme du côté du premier, de l’éthique, et non du second, le politique. Dans la perspective adoptée par Karsenti, il s’agit plutôt de scinder le concept de politique en deux. Si le judaïsme par son décrochage historique permet l’émergence d’un peuple, au sens politique, ce peuple, rappelle-t-il avec justesse n’est en rien une nation, au moins une nation destinée à exister sous la forme d’un Etat, mais procède de ce qu’il appelle « une existence politique d’un genre que les empires ne pouvaient pas connaître »48. Cette existence s’identifie à une instance de mise en question de l’institutionnalisation de l’expérience politique telle qu’elle prévaut en Occident, des Grecs jusqu’à nos jours. Ainsi ce qui « s’avère spécifiquement juif, c’est que l’unité nationale ne se recompose pas au niveau du façonnement épique. Ici le peuple juif sort des rails – et cette sortie, paradoxalement, introduit dans l’Occident un vecteur traditionnel fondamentalement non grec, qui porte en lui une charge critique à l’égard de l’expérience politique des Etats, lorsqu’ils veulent retrouver leur identité sous la forme d’un autofaçonnement (…) Bref, le théologico-politique juif attaché à l’idée de peuple juif vient doubler la tradition politique de l’Occident qui s’enracine en Grèce, sans jamais se confondre avec elle » 49.
Ainsi plus que jamais seul le peuple juif, par ce décrochage hors de la culture totémique, paraît s’ouvrir à l’accomplissement d’un destin historique de peuple, là où, retournant à des formes de consommation totémique, par la réconciliation avec le sensible qu’est la mort d’un Dieu à nouveau sensible, le Christ, le christianisme, par l’expérience politique qu’il rend possible, paraît renouer avec les dispositions pré-monothéistes avec lesquelles le judaïsme avait rompu :
« Avec l’opération paulinienne, l’histoire qui reprend son cours, c’est donc celle de la culture, avec son ambivalence complètement déployée, avec sa violence, avec son jeu forcément tragique de l’incorporation-identification – et, doit-on ajouter, avec son issus dans la forme des nationalismes »50.
Il faut donc voir dans le peuple juif non pas l’archétype du concept de peuple en général, puisque l’on voit bien sur ce point qu’il est l’incarnation d’une expérience unique, mais ce en quoi, en se rappelant à nous dans son unicité, cette incarnation interroge la tradition occidentale en tant que telle, en proposant un sens alternatif de l’expérience politique. La conception classique de l’Etat-Nation ne résume jamais entièrement cette dernière indépendamment de sa confrontation à son autre qu’est le judaïsme. Si l’idée monothéiste a été touchée par le judaïsme et si la suite représente une régression par rapport à elle, cette régression cependant se fait par rapport au judaïsme : « De ce point de vue, l’histoire de l’Occident ne sera pas n’importe quelle histoire – ce sera une histoire mêlée, altérée du fait de ce passage. Cette altération, c’est celle qu’a apportée l’idée de peuple élu, comme composé théologico-politique original »51. On ne peut pas faire comme si le judaïsme n’avait pas existé, et c’est en ce que sens qu’il continue d’agir et d’infuser la culture moderne sur ce mode très particulier ainsi décrit par B. Karsenti, auquel pour finir, nous laisserons le dernier mot :
« Ce qui s’est inventé chez les juifs, ce n’est pas une expérience politique singulière, destinée à s’incarner dans un Etat national, mais c’est plutôt un problème auquel toute politique nationale est contrainte de se mesurer : le fait que son économie interne en termes de pouvoir soit toujours grevée d’un manque, d’autant moins possible à combler qu’on a commencé par lui tourner le dos ; le fait qu’un peuple et sa loi se constituent ensemble, par un travail spirituel rétif à toute traduction et à toute transposition en termes de pouvoir (…) De sorte qu’on doit dire qu’il n’y aura de politique en Occident qu’à l’ombre d’un certain souvenir de ce qu’ont fait les juifs eux-mêmes. Ce qu’ils ont fait ne s’est pas clôturé sur une politique effective – du moins si l’on reconnaît que le type juif parfaitement achevé ne se dessine que sur la longue ligne lévites-prophètes-rabbins, et non sur la ligne, qui n’est qu’un bref segment au demeurant, de la royauté. Fossilité dès que s’amorce le retour de et à l’histoire commune que les chrétiens ont accompli, ce « type » ne peut pas être oublié et laissé derrière soi, parce qu’il a mis la politique des peuples à la question. Une question qu’elle ne se pose à elle-même qu’avec une grande difficulté, et qu’on peut formuler comme suit : quel est l’acte par lequel un peuple est un peuple ? De quel esprit l’entité « peuple » s’alimente-t-elle, et comment le pouvoir politique doit-il se régler par rapport à cet esprit ? » 52.
- Le présent texte a été prononcé lors d’une rencontre-débat autour du livre de Bruno Karsenti, animée par Jocelyn Benoist et Bernard Bourdin le 24 janvier 2013, organisée par les Archives Husserl de Paris (Ecole Normale Supérieure), le Centre d’études du Saulchoir et les éditions du Cerf.
- Bruno Karsenti, Moïse et l’idée de peuple,
La vérité historique selon Freud, Cerf, coll. Passages, 2012 - Ibid., p. 11.
- Ibid.,p. 55
- p. 55
- Ibid. p. 57
- Ibid. p. 13
- Ibid. p. 46
- Ibid. p. 18
- Ibid.p. 14
- Ibid. p. 19
- p. 21
- p. 22
- p. 27
- p. 29
- p. 30
- p. 27
- p. 49
- p. 29
- p. 29-30
- p. 55
- Strauss, Droit naturel et histoire, cité par Karsenti, p. 33
- p. 34
- p. 35
- p. 36
- p. 36
- p. 36-37
- p. 38
- p. 47
- p. 48
- p. 50
- p. 52
- p. 53
- p. 54-55
- p. 56
- p. 64
- Ibid.
- p. 84-85
- p. 85
- p. 97
- p. 160
- p. 54
- p. 166-67
- p. 175-76
- p. 199
- p. 110, nous soulignons
- p. 109
- p. 227
- p. 210
- p. 215
- p. 225
- p. 226-27








