Les dernières années ont vu, dans la réception française de Carl Schmitt, s’accroître le nombre d’œuvres traduites – que l’on songe aux éditions Krisis qui ont publié Machiavel-Clausewitz et Guerre discriminatoire et logique des grands espaces1 ou encore aux éditions du Cerf qui ont fait paraître La Visibilité de l’Eglise2 l’année dernière – tandis que se poursuivait l’inlassable polémique organisée autour de l’adhésion nationale-socialiste de Carl Schmitt dont Yves-Charles Zarka s’est fait le héraut, notamment à partir de 2005 et le détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt3 C’est dans ce contexte somme toute à la fois fécond et agité que s’inscrit le dernier ouvrage de Jean-François Kervégan qui, tout autant circonspect que prospectif, se demande ce qu’il est encore possible de faire de Carl Schmitt4, en assumant ce dernier comme un auteur résolument classique.
A : Ecrire sans indignation sur Carl Schmitt
L’ouvrage se distingue en deux parties d’un intérêt philosophique inégal, ce qui ne signifie en aucun cas que la première partie, philosophiquement plus faible, soit dénuée de tout intérêt. Le terrain étant en effet plus que miné, Jean-François Kervégan est comme acculé à désamorcer ce qui, dans ses recherches ou ses affirmations, pourrait passer pour une marque de connivence avec un auteur qui, pour être classique, n’en demeure pas moins honni quant à ses prises de position politiques. A cet égard, la première partie intitulée « Un penseur essentiellement contestable », s’adresse moins aux philosophes qu’aux faiseurs de polémique, justifiant la légitimité d’une relecture de Carl Schmitt en dépit des choix politiques de ce dernier. Kervégan expédie en quelques lignes le problème et admet d’emblée ce qui, à ses yeux, ne doit plus être discuté, à savoir que Schmitt fut nazi. « Carl Schmitt fut-il nazi ? Evidemment, et on le sait depuis longtemps. »5
Mais, ce rappel historique présenté comme une évidence, a ceci d’original qu’il ne fait pas du national-socialisme de Carl Schmitt une injonction au silence philosophique : Carl Schmitt fut national-socialiste mais sa pensée ne saurait y être réduite, de sorte que l’ouvrage fait le pari d’une transcendance de la pensée schmittienne à l’égard de ses errements politiques. De ce point de vue, la première partie n’apporte guère de nouveautés au regard d’un article tout à fait remarquable qu’avait publié l’auteur dans Le Monde en 2005, alors qu’Yves-Charles Zarka venait de raviver les flammes de la discorde en publiant le détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt qui, rappelons-le, cherchait à montrer qu’au-delà de la définition schmitienne du politique à partir de la relation ami-ennemi, se trouvait thématisée une détermination substantielle de l’ennemi dans le cas du Juif, qui préfigurait selon lui l’extermination effective des Juifs. La stratégie de Kervégan, dès 2005, fut de banaliser ce que Zarka présentait comme une découverte, voire comme un tabou : « Carl Schmitt fut-il nazi et antisémite, s’interrogeait Kervégan ? Evidemment, et tout le monde (c’est une façon de parler…) le sait ou devrait le savoir depuis longtemps. Il a d’ailleurs tout fait, en particulier dans les années 1933-1938, pour que cela se sache ! »6 Neutralisant ainsi l’effet d’annonce de Zarka, Kervégan pouvait embrayer sur une comparaison entre les écrits d’idéologues médiocres du régime nazi et ceux de Carl Schmitt, afin de révéler ce qui, au-delà de cet engagement malheureux, témoignait d’une réflexion philosophique non seulement puissante mais encore féconde pour notre propre temps. « Cette confrontation est éloquente : d’un côté, la non-pensée absolue de ceux qui mettent en oeuvre une vague habileté rhétorique au service de théorèmes puisés dans la lecture de Mein Kampf ; de l’autre, des écrits d’autant plus redoutables qu’ils ne se limitent presque jamais à une simple prestation de service idéologique, en dépit du « zèle de converti » dont ils peuvent témoigner. Même le Carl Schmitt ouvertement nazi (celui des Trois types de pensée juridique ou du Léviathan dans la doctrine de Hobbes) peut malgré tout nous donner matière à penser, c’est toute la différence avec les auteurs précités. »7

Mais si un article de journal suffisait à déployer les arguments en faveur d’une relecture de Schmitt malgré l’engagement national-socialiste, pour quelle raison faut-il ici près de 80 pages pour parvenir au même résultat ? C’est qu’en réalité le débat – que nous caricaturons ici à travers les figures de Zarka et Kervégan – porte sur quelque chose de légèrement différent de ce que Kervégan suggère. Le problème n’est en effet pas de savoir si Carl Schmitt adhéra intellectuellement au national-socialisme – chacun sait qu’il le fit – ni de savoir si la pensée de Schmitt présente quelque intérêt – Zarka lui-même le reconnaît amplement, ses textes sont en soi intéressants – mais bien plutôt de déterminer si la souillure nazie peut être dépassée par la qualité objective d’un texte. Il est clair que pour quelqu’un comme Zarka, l’engagement nazi de Carl Schmitt invalide tous ses écrits, quoi qu’il ait pu écrire ou dire par ailleurs, ce qui revient à faire de l’errance nazie une faute inconditionnelle, suffisant à refuser l’ensemble de l’œuvre de celui qui s’est compromis. Ce que ne reprend pas Kervégan, c’est cette approche inconditionnelle par laquelle l’engagement politique serait tel qu’il annihilerait toute la fécondité intellectuelle de l’œuvre qui serait ainsi réduite au lieu où aurait pris racine ledit engagement. La difficulté dans laquelle se retrouve Kervégan est alors la suivante : s’il reconnaît la fécondité intellectuelle de l’œuvre de Carl Schmitt, c’est donc qu’il lui attribue une certaine pertinence, tant dans son questionnement intellectuel que dans les réponses apportées. Mais si l’engagement nazi s’inscrit dans cette œuvre, alors comment pourra-t-on être certain que cet engagement n’est lui-même pas pertinent, alors même qu’il s’inscrit dans une œuvre précisément sauvée pour sa fécondité et, partant, sa pertinence ?
C’est pour résoudre cette difficulté – ce piège que ne manqueraient pas de tendre tous ceux qui nourrissent une viscérale hostilité à l’auteur du Nomos de la terre – que Jean-François Kervégan se trouve acculé à rédiger toute cette première partie qui résonne comme une justification face à ceux qui le sommeraient de s’expliquer. Ainsi insiste-t-il sur la réception de l’œuvre schmittienne à gauche de l’échiquier politique, comme pour mieux suggérer que l’usage de Carl Schmitt ne fait pas de ceux qui le lisent et le discutent d’infréquentables nazis. De Derrida à Kojève, c’est tout un panthéon contemporain de noms prestigieux qui se trouve convoqué, dans le but d’indiquer au lecteur que ce sont finalement les philosophes mineurs qui refusèrent de dialoguer avec Carl Schmitt. Par ce biais, Kervégan légitime d’un certain côté son entreprise en montrant que les plus grands ont accepté de ne pas réduire l’œuvre de Schmitt à ses errances politiques, mais d’un autre il esquive la question de la cohérence de l’engagement au regard de l’œuvre. Fort habilement, il n’immunise pas l’œuvre de l’engagement puisqu’il reconnaît dès les premières pages le nazisme de Carl Schmitt et se propose d’en élucider la teneur, mais il immunise tout au contraire l’engagement de l’œuvre, ce qui est en effet bien plus subtil. Une fois reconnu comme tel, ce n’est plus l’engagement nazi qui risque de contaminer l’œuvre, mais bien plutôt l’œuvre qui risque de contaminer l’engagement de sa pertinence, de sa fécondité et de sa portée intellectuelle.
B : Le programme de l’ouvrage
La deuxième partie s’ouvre par une présentation programmatique de ce que la première partie a rendu possible : Il faut « faire travailler »8 les concepts de Schmitt, c’est-à-dire « en dégager la texture fine (parfois masquée par la rhétorique qui les enrobe) et en éprouver le potentiel explicatif et critique à l’endroit d’un monde, le nôtre, que Schmitt n’a pas connu, mais dont il pressentait et appréhendait la constitution : un monde où la politique paraît tentée de se cantonner dans l’administration des choses, et où le droit accepte de jouer le rôle de gardien de l’ordre établi. »9
Il s’agit donc, une fois reconnue la fécondité des écrits schmittiens, d’interroger ces derniers en vue de mieux comprendre notre propre actualité ou, plus simplement encore, de mieux l’interroger. Nous le voyons par cette introduction, c’est bien de la pertinence des écrits de Carl Schmitt dont il s’agit et non de leur seule puissance intellectuelle : s’ils servent encore à questionner le monde dans lequel nous évoluons, cela ne peut tenir qu’à l’intrinsèque clairvoyance de ces textes, et le rappeler – ou le démontrer – imposait d’affronter la place de l’engagement nazi au sein d’une œuvre louée pour sa pertinence.
La deuxième partie se distribue alors en quatre interrogations cruciales, chacune faisant l’objet d’un chapitre à part entière. Kervégan interroge d’abord l’origine théologique de la distinction ami/ennemi, puis le sens des normes, le rapport entre légitimité et légalité, et enfin la transformation du politique. C’est ainsi à un parcours transversal de l’entièreté de l’œuvre schmittienne que nous convie l’auteur, clarifiant du même geste bien des concepts parfois complexes que développe Carl Schmitt. Beaucoup plus philosophique et technique que la première, cette seconde partie examine avec une impressionnante clarté les concepts centraux de la pensée de Carl Schmitt et introduit de salutaires distinctions au sein d’une œuvre trop souvent réduite à la caricature ami/ennemi.
C : La nature de la pensée schmittienne et la question théologique
Le premier chapitre vraiment technique aborde un titre intrigant chez Carl Schmitt, celui de théologie politique dont l’auteur se propose d’élucider le sens afin de dessiner les contours de la nature de la pensée de Carl Schmitt. Se veut-il théologien ou ne fait-il usage de ce terme que pour Le problème théologique revient à se demander ce que signifie la théologie dans la théologie politique ; par une habile série d’élucidations, Kervégan reformule le problème à partir de la création, et invite à interroger l’analogie suivante : le décisionnisme constitue-t-il l’avatar politique de l’acte créateur ou, plus simplement, de la Création ?
Avant de répondre à la question précédente, il convient d’opérer une série de détour. Schmitt défend l’idée selon laquelle l’Etat moderne usurpe le terme de représentation qu’il confond avec celui de mandat ou de délégation ; à cet égard, seule l’Eglise peut détenir un mandat de représentation ce qui fait d’elle l’institution juridique par excellence, dès lors que la représentation définit un cadre juridique par éminence. Pour autant, il ne s’agit pas pour Schmitt de re-théologiser le droit ou le politique mais bien plutôt de les questionner comme s’il s’agissait d’objets théologiques. Kervégan introduit à cet effet une nuance fort appréciable que nous pourrions ainsi présenter : Schmitt ne se comporte pas à l’égard du droit en théologien mais « plutôt à la manière d’un théologien »10, ce qui signifie que, loin d’examiner de manière dogmatique les textes juridiques, il recherche néanmoins l’autorité suprême et sonde les transformations du pouvoir étatique au gré des siècles. « Comme le théologien, écrit Kervégan, le juriste savant apporte à ce qui est objet de foi – dans son cas, le droit – l’éclairage de la raison naturelle, une raison dont les raisons parlent à chacun, qu’il soit croyant ou mécréant. »11
Qu’en est-il donc du décisionnisme comme avatar de la création ? A pareille question, il convient d’apporter une réponse nuancée, remarque Kervégan. La décision est certes une création ex nihilo, le miracle ressemble fort à un paradigme de l’état d’exception, de sorte que le décisionnisme peut être assimilé à la création elle-même, ce que confirment les écrits des années 1920 et 1930. Mais une telle interprétation, précise aussitôt l’auteur, sera vite récusée comme étant « théologiquement infondée »12. L’ambiguïté est donc maximale car, d’un côté, Schmitt établit lui-même dans les années 1920 et 1930 le parallèle entre sa démarche et une démarche théologique pensant l’Etat selon des termes qu’il attribue à l’Eglise en priorité (Souveraineté, représentation), mais de l’autre il revendique une rationalité scientifique qu’il ne confond pas avec une démarche théologique. La distinction de Kervégan s’avère alors fort utile pour penser cette ambiguïté d’un Carl Schmitt qui fait comme s’il était théologien, sans jamais présupposer de dogme a priori ni imposer de principes antérieurs à l’analyse de l’objet de son étude : le droit.
D : Le refus du normativisme
La partie suivante rejoint, pour beaucoup, le premier grand livre de Kervégan consacré à Carl Schmitt dont il avait proposé une lecture croisée avec les textes hégéliens13 et où était exposé en détail le refus schmittien du positivisme juridique, sorte de pensée hybride mêlant décisionnisme et normativisme sans parvenir à trancher.
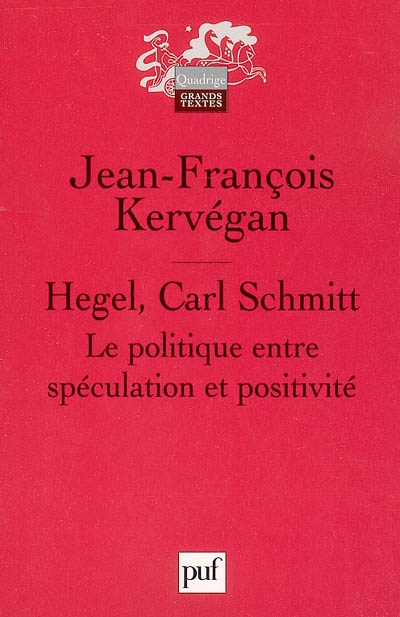
C’est donc contre Kelsen que Schmitt prend position et Kervégan évalue l’actualité de ce différend. Kelsen cherchait à penser une Grundnorm dont découlerait le système de normes, ce qui supposait que la Grundnorm échappât à la normativité et fût métanormative quoique juridique. Ce que montre très clairement Kervégan, c’est le refus schmittien d’une autonomie du droit : le droit ne peut se fonder lui-même, contrairement à ce que pense Kelsen, car il présuppose toujours non pas une métanorme immanente mais bien plutôt l’intervention inaugurale d’une décision hétérogène à l’ordre du droit. Le problème est donc moins celui d’admettre la nécessité d’un moment fondateur que celui de déterminer le lieu de cette fondation. On peut ainsi voir que « la décision joue chez Schmitt un rôle comparable à celui de la Grundnorm dans la théorie pure du droit : l’une et l’autre visent à garantir la consistance et la complétude de l’ordre juridique en évitant à la fois le risque d’un regressus ad infinitum et le recours à une axiomatique jusnaturaliste. »14 Mais ce moment fondateur diffère quant à sa nature : juridique pour Kelsen, il doit être politique pour Schmitt qui refuse par-là même la libéralisation du droit affranchie du politique.
Ce différend quant à la nature de cela même qui fonde le droit témoigne du refus radical de Schmitt d’un ordre juridique auto-suffisant et, partant, du normativisme : les normes ne sont normatives qu’à la faveur d’une origine qui leur est hétérogène ; les normes ne se soutiennent pas elles-mêmes, quand bien même dériveraient-elles d’une norme fondamentale. Kervégan retrouve ainsi une des idées fortes de son premier ouvrage sur Carl Schmitt, au sein duquel il ne cessait de remarquer que Schmitt était moins décisionniste par principe que définitivement hostile à l’idée normativiste. « Contrairement à l’opinion couramment reçue, c’est donc moins le décisionnisme proprement dit que l’hostilité à toute forme de pensée normative qui caractérise l’approche du droit qui est celle de Schmitt. »15
En outre, et c’est là un argument très puissant que restitue Kervégan, le normativisme échoue à penser correctement le concept de norme qui demeure grevé d’une fondamentale ambiguïté qui tient, en fait, au statut de la norme fondamentale. Si cette dernière est objective, comme semble l’indiquer Kelsen, et ne peut être entendue comme une simple idée régulatrice, alors apparaissent de nombreuses difficultés tenant à la cohésion interne de l’ensemble des normes. Soit, en effet, on admet que la Grundnorm procède du seul droit, mais alors il faut renoncer à identifier normes et formes juridiques et comprendre que l’on ne peut pas déduire la portée normative d’une forme au seul motif qu’elle est juridique ; soit, inversement, on fonde le système de normes sur un principe de justice, mais alors la critique du droit naturel s’effondre puisque le système tout entier dépend d’une norme rationnelle inscrite en la nature humaine. Schmitt vise ainsi l’inconséquence du système normatif tel que le défend le positivisme juridique qui, tout à la fois, élude le problème de l’actualisation des normes (ce qui revient à méconnaître l’importance de la décision), élude le problème de l’exception et hiérarchise arbitrairement lesdites normes.
Conclusion : Le terrorisme à venir
Nous ne reprendrons pas dans le détail chacun des trois derniers chapitres de l’ouvrage, mais nous proposons d’en prélever ce qui en fait tout l’intérêt du point de vue d’une problématisation contemporaine. A l’aide de Carl Schmitt, et c’est sans doute là son actualité la plus manifeste, Kervégan cherche à penser ce que doit être le politique. Celui-ci ne possède pas de substance propre, il n’est jamais qu’une certaine relation entre l’ami et l’ennemi, de sorte que tout peut devenir politique, dès lors qu’on l’investit de cette catégorie relationnelle. Mais en même temps, tout en n’ayant pas de substance, le politique a ceci de propre qu’il instaure le droit, si bien que la dépolitisation du droit revient à le déjuridiser, idée qui prend le contrepied exact du positivisme juridique. Kervégan ne se laisse donc pas hypnotiser par la caricature de la pensée schmittienne sans cesse ramenée à cette opposition ami/ennemi mais il l’ouvre bien plutôt à la sphère juridique dont il note qu’elle dépend tout entière de ce politique pourtant désubstantialisé. « Le politique, note joliment l’auteur, c’est l’acte de l’institution toujours révocable du juridique. »16
Reposons donc la question inaugurale de cet article et demandons-nous ce que la pensée de Schmitt conserve de pertinent et comment ce dernier peut nous instruire. « Il le fait, répond Kervégan, en nous contraignant à reformuler nos questionnements. Montrer, par exemple, qu’une pensée élargie de la normativité (juridique) doit prendre en compte l’argument décisionniste (quel geste politique institue l’espace normatif ?) et s’efforcer de le faire dialoguer avec son pendant normativiste (une fois existant, l’espace normatif est auto-fondateur). »17 Il le fait également en interrogeant le sens de la distinction croissante entre le politique et l’Etat : si l’Etat perd le monopole du politique, c’est donc que la distinction ami/ennemi explose hors des cadres étatiques classiques et peut prendre de nouvelles formes dont la plus patente est, à n’en pas douter, celle du terrorisme appelé, à en croire Schmitt, à considérablement croître à mesure que s’affaiblira l’Etat. C’est peut-être là, d’ailleurs, l’ultime leçon de ce grand philosophe que de nous faire comprendre que le dépérissement de l’Etat ne signifie pas, comme le déplorent beaucoup, la fin du politique, mais bien plutôt sa perpétuation par de tout autres moyens, au sens propre terrifiants.
- cf. Carl Schmitt, Machiavel-Clausewitz. Droit et politique face aux défis de l’histoire, Krisis, 2007 et Guerre discriminatoire et logique des grands espaces, Krisis, 2011
- cf. Carl Schmitt, La visibilité de l’Église – Catholicisme romain et forme politique – Donoso Cortès. Quatre essais, Paris, Cerf, 2011
- Yves-Charles Zarka, Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, PUF, 2005
- Jean-François Kervégan, Que faire de Carl Schmitt ?, Gallimard, coll. Tel, 2011
- Jean-François Kervégan, Que faire de Carl Schmitt, op. cit., p. 10
- Jean-François Kervégan, Peut-on lire Carl Schmitt ?, Le Monde, 5 avril 2005
- Ibid.
- Que faire de Carl Schmitt ?, p. 80
- Ibid.
- Ibid., p. 108
- Ibid., p. 109
- Ibid, p. 100
- cf. Jean-François Kervégan, Hegel, Carl Schmitt : le politique entre spéculation et positivité, PUF, coll. Quadrige, 2005
- Ibid, p. 131
- Hegel et Carl Schmitt, op. cit.,, p. 48
- Que faire de Carl Schmitt ?, p. 193
- Ibid., p. 250








