Thierry Ménissier est maître de conférences de philosophie politique au Département de philosophie de l’Université Pierre Mendès France – Grenoble 2, chargé d’enseignements à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et Président de la Société alpine de philosophie.
De quoi parle-t-on au juste quand on se rapporte à la République ? Et pourquoi la rhétorique républicaine enfle tellement les discours politiques, à l’heure même où son modèle n’a sans doute jamais été autant discuté par la philosophie ?
Thierry Ménissier propose, dans son dernier ouvrage, une réflexion sur le républicanisme en portant d’abord le soupçon sur l’abondance du lexique républicain, sans doute symptomatique du caractère usé du modèle auquel il renvoie. Il aborde le thème, désormais classique, de l’actualité de ce modèle. Sa réflexion s’affirme selon une orientation double : la genèse critique du républicanisme, d’un côté, et une proposition normative qui pourrait participer de ce qu’on appelle désormais le néorépublicanisme 1, de l’autre. A mi-chemin entre la philosophie politique et la science politique, nous avons ici affaire à un ouvrage qu’on pourrait dire de théorie politique : soucieux de solidifier la réflexion théorique par une connaissance aiguisée des réalités politiques et économiques contemporaines. L’ouvrage ne propose pas véritablement une utopie politique néorépublicaine construite de toutes pièces. Il inspire plutôt des trajectoires possibles pour la transformation d’un modèle qui prendrait acte de ses failles.
La faillite du Léviathan
Le point de départ de la réflexion est un constat relatif à l’actualité de la rhétorique républicaine. Ses effets « largement démagogiques », masqueraient des angoisses devenues insupportables suscitées par un modèle qui n’en est plus un. Plus la république est invoquée, plus alors il faudrait s’en méfier. L’inflation de l’usage du vocable « république », à l’heure même où le modèle républicain est en crise, appelant soit un renouveau soit un remplacement, serait de l’ordre du symptôme psychanalytique.
Cette invocation récurrente d’une terminologie « incantatoire » est d’autant plus suspecte, explique Thierry Ménissier, que le terme « république » est l’un des moins clairs de la philosophie politique. Il est en même temps un des plus usités par les élites politiques, revendiqué « aussi bien par la droite sarkozyste que par le socialisme fortement marqué à gauche d’un Jean-Luc Mélenchon » 2.
La république et le républicanisme signifient-ils, ou, ont-ils, alors, jamais signifié quoi que ce soit ? Plus qu’un courant systématique, le républicanisme désigne tout de même, d’après l’auteur, un « tour d’esprit particulier ». Celui-ci consiste à mettre au cœur du politique les idées d’une destination communautaire de l’humanité et d’un « espace public organisé » . Pour autant, le républicanisme ne se réduit pas à un simple holisme politique ; s’il a pu l’être dans l’esprit de ses pères fondateurs grec et romain (Aristote et Cicéron), l’individu y est aussi une notion centrale ou le devient, dans le cadre de l’humanisme civique du XVème siècle. Si bien qu’un souci de l’individu proprement républicain rapprocherait parfois davantage le républicanisme du libéralisme que du marxisme.
Le républicanisme a donc bien un noyau dur, qu’il s’agit d’identifier, mais il se prête à une fécondité et une ubiquité théorique qui sont déjà les signes de sa possible renaissance. Très tôt dans l’ouvrage, il est sensible que Thierry Ménissier plaide en faveur d’un renouveau républicain, entendant lui offrir de nouveaux outils normatifs. Ce renouveau est rendu nécessaire par la complexité d’un réel en mouvement qu’on pourrait identifier comme désormais postnational. Que peut devenir le républicanisme dans le cadre d’une perte de légitimité de l’Etat et du transfert de l’autorité à des niveaux supérieurs, bien éloignés du souci quotidien des citoyens ? En répondant à cette question, l’auteur relève un défi lancé au républicanisme.
La réflexion sur un modèle néo-républicain se fait ainsi à partir d’un double bilan : d’une part, celui de la « faillite du Léviathan », entendu comme machine étatique-nationale traditionnelle en crise, et d’autre part, celui de l’ouverture théorique de la philosophie politique républicaine. Le républicanisme a signifié et signifiera encore des options théoriques différentes pour la philosophie politique. L’auteur met en évidence la supériorité du souci de la res publica sur la privatisation des valeurs du libéralisme.
Le républicanisme renouvelé serait à même de fournir une troisième voie entre le républicanisme « standard », auquel s’accrochent en vain les élites, et un libéralisme politique qui fait éclater la vérité de son insuffisance dans sa métamorphose en « néo-libéralisme » économique.
La réflexion du philosophe politique se déploie en trois moments : le premier procède à la genèse du républicanisme qui en envisage les limites, le deuxième offre une pensée de la « liberté des contemporains » comme sortie de la division paradigmatique et sclérosante opposant la liberté des Anciens à celle des Modernes. Enfin, il est proposé une recomposition de la république à la hauteur des défis actuels du monde globalisé et prenant acte de l’exigence pluraliste démocratique.
1. Le patrimoine théorique républicain et ses limites
République et modernité
Le premier temps de la réflexion consiste à saisir la conceptualité républicaine qui appelle une rénovation. L’auteur propose un tour d’horizon historique qui permet de circonscrire le noyau dur de toute théorie républicaine, en dépit de la diversité d’une tradition écartelée entre l’Antiquité et la Modernité.
Mais Thierry Ménissier définit au préalable son idée de « républicanisme standard ». Il s’agit de la version actuelle du républicanisme français. Le « républicanisme standard » sert ainsi de concept de référence de l’ouvrage, à l’aune duquel se mesureront les avantages d’une théorie normative républicaine inédite. Ce concept méthodologique constitue une catégorie mixte qui est le résultat d’une sédimentation progressive de certains traits hérités de l’histoire du républicanisme.
Le républicanisme standard se définit selon trois dimensions : idéologique, morale et technique.
– L’idéologie républicaine standard est caractérisée par l’héritage des Lumières et de la Révolution française compris comme fort pouvoir de résistance à la tradition. Cette dimension serait aujourd’hui devenue « en grande partie incantatoire ».
– La dimension morale républicaine concerne la relation entre le citoyen et l’Etat via l’obligation civique, cette fois qualifiée de « désuète ».
– La dimension technique renvoie à une discipline de l’individu pris dans la collectivité. Elle est déterminée par l’appareillage objectif du pouvoir de l’Etat aussi bien que par l’auto-contrainte individuelle.
Les trois dimensions conjuguées, d’ores et déjà soulignées comme « démodées », expliquent une « culture politique fortement moniste » 3.
Thierry Ménissier dessine aussi quelques traits de la « culture du républicanisme standard ». Elle est renvoyée à une tradition philosophique débutée avec Rousseau et qui trouve ses penseurs jusqu’à la Troisième République. Elle n’échappe pas non plus à la qualification de « monisme ». Elle est « peu ouverte à la pluralité » alors même que « revendiquant l’universel » 4.
Si pour de nombreux historiens 5, il y a une difficulté à rapprocher le républicanisme antique et sa version moderne, pour Thierry Ménissier le républicanisme standard entre bien en congruence avec la réalité politique des cités antiques. L’essentiel du noyau républicain transhistorique s’identifie à l’articulation particulière du sujet politique à la collectivité, déjà signalée dans l’étymologie républicaine 6.
Dès lors, est autorisée la genèse historique du républicanisme actuel.
L’élément essentiel légué par le républicanisme antique à la modernité républicaine est l’identité entre res publica et res populi. La notion de peuple, héritée de cette période, réfère déjà à un sujet mythique. Elle renvoie l’individu à l’égalité de chacun et à la conscience de la communauté qui le dote de sa teneur identitaire. La rhétorique de la vertu civique, elle aussi venue de l’antiquité, imprègne ensuite tout le courant républicain.
Entre réception et invention, le républicanisme moderne reprend à bien des égards des thèmes antiques. L’humanisme civique les adapte aux conditions nouvelles de la modernité : par le mouvement de sécularisation, l’évolution de la notion d’égalité comme consécration d’une égalité naturelle ou métaphysique, et enfin, par l’apparition de l’Etat comme entité différenciée.
La pensée de Rousseau a une place prépondérante dans la modernité républicaine en tant que point d’aboutissement d’une problématique issue du XVIème siècle et des « guerres de religion ». Elle opère alors comme un « point de repère inoubliable du républicanisme moderne» 7. Rousseau apporte une réponse complexe au problème de l’obéissance civile comme modèle d’intégration sociale. Il hérite de Hobbes deux idées qu’il articule ensuite : la distinction entre peuple et multitude et l’idée d’une volonté abstraite. Rousseau formule dès lors l’idée de volonté générale qui fait passer de l’agrégation des volontés à une volonté unique qui donne son mouvement au corps politique. En guise d’exemple de sa manifestation empirique T. Ménissier mentionne la joie publique de la fête de Saint Germain, souvenir impérissable exprimé dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles : « après le dîner, les soldats et les citoyens dansèrent ensemble, la joie commune mit en ordre la foule initialement amorphe, les Genevois se reconnurent et s’élirent réciproquement dans le mouvement de leur corps transfigurés par ce transport heureux » 8. De cette articulation du général et du particulier découle la notion de fraternité. Cette dernière constituera ainsi un autre trait spécifique du républicanisme standard.
Rousseau réalise ainsi le tour de force de concilier le principe immanent de la volonté populaire à la construction d’une souveraineté institutionnelle, trouvant ainsi « la formule recherchée par tous les théoriciens classiques depuis Bodin garante de la stabilité politique » 9. Pour autant l’héritage rousseauiste ne va pas sans poser problème. Lors même que Rousseau trouve la solution quasi-algébrique à la coïncidence des volontés, il ouvre une problématique nouvelle, qui place de plain-pied dans le problème actuel de la légitimité démocratique. Le paradigme de la volonté générale, consacré par le système représentatif pourtant condamné par Rousseau, ne correspondrait à aucune expérience tangible.
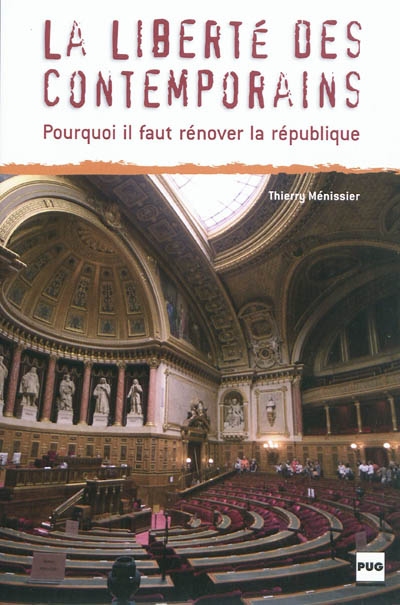
L’héritage de Rousseau donnerait ainsi lieu à deux attitudes différentes : soit déplorer la trahison de la volonté générale et son détournement opéré par les élections, soit composer avec une légitimité de délégation en lieu et place de l’adhésion de tous 10.
Nations et peuples : les protagonistes de la communauté civique
Une fois effectuée la genèse du républicanisme standard, l’auteur propose d’en envisager les limites en se concentrant sur certaines des notions politiques exclusivement modernes qu’il porte.
Une refondation de la république devrait encore se charger de la critique des notions de peuple et de nation. Ces produits de la transformation des cultures traditionnelles en Europe consacrés au XVIIIe siècle 11 sont désormais mis en question dans le cadre de l’Union Européenne et de la globalisation.
Un lien complexe entre le champ culturel et le champ politique est révélé par ces « protagonistes » traditionnels de la vie politique que sont les notions de peuple et de nation. La communauté politique est, et doit être, selon un minimum culturel, une communauté de langue. L’action politique se voit ainsi subordonnée à l’adhésion à une forme sine qua non de monisme culturel.
Cette idée est ancrée dans la tradition républicaine autour de la thématique patriotique. Selon l’humanisme civique, le patriotisme donne sa consistance à l’être humain, qui, ancré dans le passé, peut mieux agir dans le présent. Le citoyen républicain, actif, est un citoyen conscient de l’histoire de la communauté politique et adhérant à la symbolique patriotique. La communauté culturelle, dans laquelle il se reconnaît, offre ainsi à l’humain républicain un terrain d’action, qui permet « la création continuée de l’histoire de la communauté ». Pour soutenir ce caractère fondamental du culturel au cœur du politique, T. Ménissier renvoie à l’analyse par Arendt de la condition d’apatride dans Les Origines du totalitarisme12. La condition « dangereuse » de celui qui n’a pas de patrie le prive d’une donnée fondamentale de l’existence : la condition politique nécessairement rivée à un terreau culturel. Apparaît ici, encore une fois, le noyau républicain : « les hommes ne peuvent être dits libres (et par suite pleinement humains) que s’ils sont citoyens »13. La liberté étant faite pour s’exercer, ou du moins, la liberté en tant que praxis politique, elle se joint alors nécessairement à un terreau culturel auquel s’attache le républicanisme.
Voulant cependant mettre en exergue le rapport problématique des champs culturel et politique, et opérer une critique des idées de peuple et de nation, T. Ménissier note que l’inhérence du politique au culturel représente une conception contingente au sein de la philosophie politique.
Le libéralisme n’envisage pas l’importance anthropologique de la citoyenneté. La liberté (négative), favorisée par ce courant politique, offre aussi la possibilité du refus de l’engagement politique. La consistance particulière de la réalité humaine pour l’individualisme libéral ne se trouve pas plus qu’ailleurs dans une destination politique.
Que devient alors l’idée de communauté nationale ? Elle devient absurde. Si la dimension politique n’est pas essentielle, la dimension culturelle qui lui était liée ne le saura pas plus. La nation, notion politique, qui pense l’articulation entre la dimension civique de l’existence et la dimension culturelle, est alors rabaissée, dans le cadre libéral, à son seul versant culturel. Il n’y a plus de communauté nationale ou alors elle se réduit à la communauté culturelle : la communauté nationale est d’ailleurs soulignée par le libéralisme, non pas comme nationale mais comme strictement culturelle.
Néanmoins, d’après T. Ménissier, une difficulté de la séparation entre les domaines civiques et culturels naît du fait que l’appartenance à un domaine culturel est une condition nécessaire mais non suffisante de l’existence politique. Le fait de se voir conférer par la naissance dans un pays un droit politique immédiat engendre ainsi une « illusion d’optique ». On croit à tort au recouvrement de la nationalité (rabattue sur son versant seulement culturel) et de la citoyenneté. Cette confusion entraîne la croyance en la simultanéité de la naissance et de la citoyenneté alors que cette dernière est une dimension du devenir humain. Le phénomène de dépolitisation dans les sociétés occidentales contemporaines est « l’exemple parfait » manifestant l’écart réel entre la nationalité et la citoyenneté.
En dehors de ces questions posées par la communauté culturelle, s’ajoutent des interrogations spécifiques nées du contexte de la globalisation et de l’Union Européenne.
La globalisation est comprise comme « l’extension et l’approfondissement des relations économiques et financières de type capitaliste » 14. Ce facteur entraîne la perte d’efficience non seulement de l’idée nationale mais aussi du politique. Ce dernier est encore vécu à l’échelle nationale alors que le niveau d’action est devenu mondial. Une érosion combinée affecte ainsi les registres culturels et politiques.
Sur le plan culturel, l’effacement des cultures nationales peut céder le pas à une culture mondiale. L’appartenance de l’individu à la communauté pourrait se faire par exemple sur le nouveau mode analysé par M. Mafessoli 15, d’un « néo-holisme tribal ». L’individu choisirait sa communauté d’appartenance mais à une échelle infranationale. Le domaine de la culture se verrait appauvri en tant que réduit aux choix symboliques des individus, qu’il s’agisse des « tribus » de M. Mafessoli ou des « religions sans cultures », coupées de leur terreau culturel analysées par Olivier Roy dans la Sainte Ignorance. Devant la recrudescence de nouvelles communautés possibles – tribales, virtuelles ou religieuses – la culture nationale semble désormais en voie de « folklorisation ».
L’Union Européenne agit de son côté, comme un laboratoire d’expérimentation post-national. Il est constaté qu’elle réactive « l’ethnique ». Selon T. Ménissier, le pluralisme démocratique rend nécessaire la reconnaissance de nations plurielles au sein des Etats dans le cadre européen. On peut regretter ici que les cas, invoqués ad hoc, pour défendre cette idée ne soient pas nécessairement représentatifs des traditions variables au sein de l’Union Européenne. Pour illustrer la nécessité d’une reconnaissance des nations à l’intérieur même des Etats sous peine « que les grands Etats-Nations soient appréhendés comme des ethno-démocraties », Thierry Ménissier reprend la critique par Sammy Smooha de la vie civique israélienne, qui a donné lieu au concept d’ethnodémocratie, désignant une démocratie où, de fait, une majorité décide du destin d’une minorité culturelle. Appliquant ce concept à l’Europe, il cite alors les cas allemand et espagnol, qui ont fait du « régionalisme un antidote au centralisme » 16. Il semble ainsi y avoir un déséquilibre entre la reconnaissance, toute en nuances, par l’auteur, du fait que le régionalisme crée bien lui-même de nouveaux problèmes et l’affirmation concomitante, favorable au régionalisme de l’impérative reconnaissance de nations plurielles infra-étatiques. Il peut être opposé la relativisation de cet « impératif » à des situations européennes particulières. La construction identitaire même des citoyens dans le cadre national varie d’un Etat Européen à l’autre, compte tenu du contenu particulier accordé à l’expérience nationale, variabilité sans doute incarnée simplement par l’opposition traditionnelle entre l’idéal-type de la nation allemande de Tönnies et celui de la nation française de Renan. Tous les Etats européens ne verraient pas d’urgence à reconnaître des nations régionales, de surcroît si cette reconnaissance entraîne des problématiques nouvelles.
En tout cas, l’Europe serait devenue le lieu idéal pour affronter ces difficultés multiples issues de l’ambiguïté qui s’attache aux idées de communauté culturelle, de nation et de peuple. Trois positions théoriques peuvent être finalement envisagées selon l’auteur : le multiculturalisme (inapproprié parce qu’insuffisant pour concevoir l’intégration politique), une forme commune de démocratie parlementaire européenne fondée sur le consensus, la discussion et les droits de l’homme (l’UE peut être envisagée comme la terre d’élection du cosmopolitisme kantien, la patrie serait dissoute dans un patriotisme constitutionnel), enfin on pourrait songer à un patriotisme rationnel fidèle à l’idée nationale de Renan.
Le républicanisme aujourd’hui
Le contexte du brouillage de l’idée républicaine est désormais posé : la république à repenser se voit devant l’exigence de la pluralité démocratique et ouverte aux évolutions internationales. Reste à savoir comment la recomposition est possible. Ce thème est abordé par l’auteur pour clore sa revue génétique et critique du républicanisme et des notions qui y sont associées. Il s’agirait alors de « purifier » l’idée républicaine de son attachement traditionnel à des entités étatiques nationales et belliqueuses.
La pluralité démocratique impose, en première instance, une variété des conceptions du bien théoriquement très contraignante. La période contemporaine connait l’effondrement des postulats métaphysiques à la base des théories du politique, il est néanmoins difficile de trouver une normativité totalement affranchie de tels postulats. Ainsi les théories du XXe siècle, échappant aux présupposés métaphysiques, ont ceci de commun qu’elles affirment la primauté d’une approche référée à la raison pratique ou même strictement procédurale 17. T. Ménissier suggère que les droits de l’homme pourraient constituer un invariant possible de la théorie politique contemporaine, un ensemble minimal de valeurs adaptées à la pluralité démocratique.
Le scepticisme pourrait offrir, quant à lui, une réponse à la crise des fondements. Sans repousser les valeurs ni consacrer des dogmes métaphysiques, le scepticisme doterait le républicanisme d’un outil équilibré. En effet, un scepticisme méthodologique, inspiré de Montaigne, pourrait constituer un instrument de tri des valeurs qui interagissent. Il s’agirait de reconnaître selon un « rationalisme sceptique » 18 la pluralité des motifs de l’action, comme par exemple, le fait que la création d’une loi obéit à des valeurs multiples et parfois contradictoires. Il s’agit alors non pas d’harmoniser les différences, mais de permettre la coexistence de pratiques différentes et l’expression de valeurs variées. 19. Une autre figure du scepticisme, celle de « l’ironiste libéral » de Rorty 20 pourrait en revanche servir comme repoussoir au républicanisme, dès lors que cette radicalité sceptique conduit à l’abandon pur et simple de toute exigence normative.
Le défi du républicanisme consisterait alors à construire un imaginaire commun plutôt qu’une identité pleine et entière.
Pour autant, délester la notion de république de sa pesanteur culturelle habituelle ne doit pas signifier l’affranchissement pour la démocratie de l’exigence républicaine fondamentale. En d’autres termes, la démocratie doit affirmer le « postulat républicain » de l’affirmation des compétences de la communauté civique.
Les raisons de la nécessité d’une démocratie républicaine sont les suivantes :
– le républicanisme conserve l’aspiration égalitaire,
– la démocratie seule ne comprend pas de formule véritablement politique d’un pouvoir collectif.
2. Penser la « liberté des contemporains »
La supériorité du républicanisme et ses limites, expliquées dans la première partie, rendent nécessaire d’envisager désormais les moyens pour le républicanisme de redevenir une « théorie politique efficace ». Il est possible à partir de ce point de l’ouvrage de mieux saisir les traits originaux de l’analyse de l’auteur.
En premier lieu T. Ménissier examine le dépassement de la dichotomie traditionnelle entre liberté négative et positive.
Si le dilemme des deux libertés doit être dépassé, c’est parce que cette distinction, qui fait encore s’opposer le républicanisme et le libéralisme, fige le paysage de la réflexion politique. Cette lunette, qui d’après l’auteur opère « comme le lit de Procuste » 21, empêche de considérer objectivement le paysage en mouvement de l’histoire contemporaine. Le jeu dialectique des deux termes s’épuise en vain sans donner naissance à une nouvelle catégorie heuristique. La catégorie que T. Ménissier propose, pour sa part, est celle de « liberté des contemporains », dépassant ainsi à la fois la positive des Anciens et la négative des Modernes.
L’auteur propose encore un détour généalogique, chez Benjamin Constant et Isaiah Berlin, qui n’a pas qu’une simple vertu pédagogique. En sus du rappel conceptuel sur le sens de la distinction entre les deux libertés, T. Ménissier propose la contextualisation historique des thèses des deux auteurs. La dépendance des deux thèses à leurs terrains historiques respectifs permet ainsi de limiter le caractère anhistorique de leur portée et de mettre en exergue la nécessité d’un réalignement des distinctions conceptuelles.
La thèse de Constant, développée en 1819 sous la Restauration, est qualifiée de « thèse de combat ». Elle se trouve en effet dans le discours d’un politicien en campagne en vue des législatives. Benjamin Constant, futur parlementaire, désire par la dénonciation de la liberté des Anciens, solder « l’épisode révolutionnaire coupable du centralisme administratif dont avait bénéficié la tyrannie impériale de Napoléon Ier » 22. La mise au premier plan de l’individualité par Constant, en ceci fidèle à Locke, donne lieu à la privatisation de la liberté. Celle-ci est entendue comme puissance d’action qui se confond avec l’identité du sujet. Contre l’idée que Constant confisquerait purement et simplement la dimension politique de la liberté, T. Ménissier souligne l’évolution qu’il permet à la pensée du problème de la liberté dans un contexte de réaction. Contre la réaction, ce sont bel et bien des droits politiques qui sont défendus par Constant : le droit pour chacun d’influencer l’administration et le gouvernement et le refus de la thèse de l’extension illimitée de la souveraineté populaire visant l’épisode de la Terreur, conçu comme un moment d’égalitarisme extrême.
Quant à Isaiah Berlin, son éloge de la liberté a lieu à Oxford en 1958, en plein cœur de la Guerre Froide. Dans un bastion idéologique du « monde libre », la défense de la liberté négative se fait contre la perspective menaçante depuis 1914, d’idéologies envisageant la possibilité de changer la nature de l’homme.
Les vestiges théoriques de la dichotomie des deux libertés façonnent toujours la pyschè contemporaine, de manière critiquable pour T. Ménissier, à l’heure du possible dépassement du libéralisme politique par le néolibéralisme. Sans doute alors, à cette heure même où la liberté négative, pertinente selon ses multiples contextualisations historiques, risquerait de s’abîmer dans la pure licence néolibérale.
Une dialectique de la liberté, comme remise en cause de la dichotomie, devrait dès lors assumer un caractère « postidéologique » propre à notre époque. Le « profilage » des caractéristiques des deux libertés permet d’abord de dresser le constat de deux conceptions pareillement réductrices. Deux « exemples saillants » de l’inefficacité des deux libertés sont présentés. La négative aurait raison de dénoncer le dirigisme étatiste excessif qui entend forcer les individus à adhérer à ses options. La positive aurait quant à elle raison de critiquer « l’indifférence libérale à l’égard de l’éducation du citoyen », condition nécessaire au souci de la chose publique.
En second lieu, T. Ménissier propose une généalogie de la conduite intéressée. Il s’agit d’aborder la notion, classique pour la défense libérale de l’individu, de l’intérêt. D’après l’auteur, elle est négligée à tort par la dichotomie classique entre les deux libertés 23. De la Modernité à l’époque contemporaine, la notion d’intérêt tend à prendre une place prépondérante dont le néorépublicanisme se devrait encore de prendre acte.
La notion d’intérêt trouve son point de départ dans l’idée machiavélienne de la naturalité du désir d’acquérir. Sa théorisation connaît ensuite des versions plus complètes chez des auteurs comme Hobbes, Locke, Smith et certains utilitaristes. T. Ménissier reprend chacune des versions dont il explique les apports importants.
On retiendra le rôle de Hobbes pour l’intégration de l’intérêt dans le cadre juridico-politique. Ce serait avec l’auteur anglais qu’est véritablement remplacée l’ancienne « matrice théologico-politique » par un cadre politique strictement économique et législatif. En d’autres termes, le modèle anthropologique hobbésien (celui de l’homme comme machine désirante) est consacré par le droit qui donne une teneur juridique à la notion d’intérêt : le sujet responsable s’engage devant la loi pour son intérêt propre. Locke opère quant à lui une véritable identification entre l’intérêt et la subjectivité avec la surdétermination de l’appropriation du monde et de l’élément du travail. Enfin Smith, qualifié d’ancêtre de l’utilitarisme, effectue un dépassement à la fois de Hobbes et de Locke. L’utilitarisme récuse la régulation politique des intérêts qui n’en ont nul besoin (ils s’autorégulent). Le parachèvement de la doctrine de l’intérêt se trouve alors dans cette indépendance consacrée de l’intérêt, porté en haut de l’échelle des valeurs politiques. L’utilitarisme soustrait ainsi la question de la justice sociale au droit naturel et permet de définitivement bâtir l’ordre politique en dehors de tout cadre métaphysique.
La société démocratique serait ainsi la fille d’une telle manière de « concevoir le jeu des intérêts, libéré de toute tutelle théologique ou morale » 24. Encore une fois, ce sont les analyses d’Arendt 25 qui confortent cette conception de la démocratie. Celle-ci consacre la victoire de l’opinion sur la vérité : « dans une société pleinement démocratique, ce qui compte, c’est davantage l’opinion que la vérité, car celle-là est fondamentalement plurielle, tandis que celle-ci ne garantit pas la pluralité »26. La démocratie refuse ainsi toute forme de « totalisation politique » et provoque en même temps la faillite des paradigmes traditionnels de la communauté.
Le lobbyisme, dernière notion abordée par T. Ménissier, représente alors une mise en forme possible de la décision publique affranchie de ces paradigmes traditionnels. La mise en perspective du lobbyisme dans le cadre plus large d’une modernité « intéressée » permet de sanctionner le statut de l’intérêt dans la république nouvelle. Le lobbyisme est à la fois un fait social et une technique politique qui sont sujets à de nombreux débats. Il est tour à tour garanti par les droits fondamentaux aux Etats-Unis ou condamné comme factieux en France. L’Union Européenne a cependant changé la donne en généralisant cette pratique politique.
D’après T. Ménissier le lobbyisme peut être envisagé comme une représentation « bis », un complément officieux de la représentation politique, un « couloirage » (disent les Canadiens) par lequel les citoyens, engagés dans la vie sociale et économique, peuvent agir. Un « lobbyisme éclairé » pourrait venir informer le parlementaire et contribuer à sa décision.
L’intérêt et le lobbyisme qui lui est associé, sont tous deux des manières de remettre le politique au plus près du citoyen. Il s’agit en même temps de reconnaître ce même intérêt au cœur d’une « liberté des contemporains » repensée. Cette liberté devrait ainsi engager à l’action politique tout en se dégageant des apories de la liberté positive traditionnellement préférée par le républicanisme.
3. République et culture démocratique
La dernière partie de l’ouvrage donne en quelque sorte la clef attendue de la solution normative prônée. Jusqu’à présent les analyses généalogiques avaient la part belle et permettaient de dresser un bilan des attendus d’une normativité politique refondée. Le dessin de cette théorie ne se trouve véritablement que dans la dernière partie de l’ouvrage.
Recomposer l’intérêt général
Le constat premier de l’auteur concerne la prééminence de la notion d’intérêt, ne se réduisant pas au simple calcul personnel. L’élargissement de la notion, à partir de la réflexion sur le thème républicain de la participation civique, permettrait de repenser la notion d’intérêt général.
Repenser l’intérêt général passe d’abord par une réflexion sur les modèles de la participation publique. Combler les défauts actuels de la représentation, ce pourrait être intégrer des modèles participatifs, déjà en discussion en France depuis quelques années, et des modèles délibératifs d’origine nord-américaine. T. Ménissier reprend l’idée de Habermas d’une démocratie délibérative qui serait un au-delà aussi bien du libéralisme que du « républicanisme standard ».
Ces modèles, nouveaux en Europe, autorisent la formulation d’un intérêt général inédit à partir d’une désubstantialisation du bien commun. Ils favoriseraient la reconnaissance d’individus politiquement actifs mais pourtant bel et bien séparés, intéressés et n’ayant pas vocation à fusionner dans la volonté générale.
La composition originale des intérêts sociaux et publics servirait de surcroît à combler les défauts de la représentation. Selon cette composition proposée par l’auteur, l’expression de la volonté populaire par les représentants doit correspondre à l’intérêt public tandis que l’instauration de jurys populaires permettrait l’expression des intérêts sociaux. Un républicanisme procédural aurait une fécondité véritable et permettrait de résoudre les apories d’une généralité univoque dont l’incarnation concrète est en réalité impossible. Le républicanisme refondé rendrait possible la « composition » de l’intérêt général en abandonnant l’idée illusoire d’une expression possible d’un intérêt immanent à la volonté populaire.
Cette solution se situerait contre deux excès : soumettre l’intérêt social à l’intérêt public d’une part ou l’inverse d’autre part. La dialectique unissant les deux types d’intérêts aurait l’avantage de traduire le « jeu tumultueux des humeurs de la cité divisée » 27 selon une conception agonistique de la démocratie fortement valorisée par l’auteur. L’institution serait refondée périodiquement par ce biais et l’expression régulière des intérêts sociaux constituerait un avantage non négligeable pour la proximité du politique, la confiance en sa vertu et enfin pour la séparation des pouvoirs.
La dynamique des lois et des mœurs
Que faire enfin de la question des mœurs qui oppose radicalement le républicanisme et le libéralisme ? Le républicanisme peut-il encore s’inquiéter de la question des mœurs sans être taxé de « culture moniste aveugle » ou de « dirigisme moral injustifiable » ? L’ambition morale du républicanisme est-elle compatible avec la pluralité des conceptions du bien ?
Procédant de manière négative, selon la méthode sceptique déjà mise en œuvre au troisième chapitre, T. Ménissier note la dangerosité d’une citoyenneté dépassionnée. Pour ce faire, il prend l’exemple des années 1930 en Allemagne où le nazisme a opéré comme « re-émotionalisation » brutale de la psychè collective venant interrompre un état de citoyenneté dépassionnée. La neutralité éthique du libéralisme serait finalement illusoire et qui plus est dangereuse face aux risques d’irruption de courants politiques jouant sur la manipulation des émotions excessives et brutales qui demeuraient en sommeil. Une conception agonistique du politique serait alors paradoxalement un moyen de juguler la violence.
Le rapport entre les lois et les mœurs est alors posé comme fondamental : les bonnes lois seraient le produit de bonnes mœurs. La république doit encore éduquer aux vertus démocratiques. L’idée du choix de l’individu et de son épanouissement dans la communauté politique serait en ce sens la valeur souveraine. Elle est finalement commune au républicanisme et au libéralisme dans la manière dont l’individu est hissé sur un piédestal. Prenant l’exemple de l’alternative entre laïcité républicaine et tolérance libérale, l’auteur insiste sur le point commun des deux courants dans la manière dont le religieux est minorisé dans les deux cas, selon un rationalisme critique. La vertu démocratique à laquelle la république peut éduquer, tout en évitant le défaut du monisme, serait le respect des choix individuels.
Les mœurs culturelles se manifestent finalement dans le jugement esthétique, selon l’assertion suivante : la « délibération esthétique permet une citoyenneté culturelle » 28. Une politique publique culturelle ouvre un espace politique riche et favorise l’amélioration d’un « esprit public ». Une des idées (parmi les nombreuses qui concernent la politique culturelle) qui représente bien le dessein de Ménissier est la suivante : faire des prix littéraires des prix publics pour politiser à nouveau la société.
La culture, posée au cœur du politique, participe d’une vision générale du citoyen actif, conscient, en dialogue constant dans une république participative. Le citoyen a vocation à se situer dans un espace « repolitisé », tout à la fois holistique et agonistique.
Communauté civique et communauté sociale
Le dernier chapitre du livre est consacré au programme social de la république rénovée, envisageant le problème d’une égalité toujours en chantier.
L’auteur propose une refondation du droit de propriété pour sortir de certaines impasses engendrées par le « propriétarisme » qui « empoisonne le libéralisme ». Il s’agit de repenser les fondements individuels d’un droit de propriété.
Reprenant en partie la critique de C. B. Macpherson 29, T. Ménissier commence par mettre au jour les fondements du droit de propriété individuel moderne. Un certain nombre de présupposés des penseurs de l’état de nature que sont Hobbes et Locke vont dans le sens d’une articulation de la fiction théorique moderne à une justification de la propriété. L’individu est ramené à la détermination première de la préservation de la vie, la nature est conçue comme un champ d’action neutre où l’appropriation n’a de valeur qu’à partir de la transformation laborieuse, enfin les relations interindividuelles sont envisagées sur le mode de la compétition et dans la perspective d’une constitution du moi par le travail ou la possession. Selon l’analyse de l’individualisme possessif de Macpherson, « tout se passe comme si les deux auteurs avaient pour dessein de transformer la nature en marché », dans un espace au sein duquel les relations humaines sont déterminées par le jeu indéfini des désirs.
La modernité absolutise alors la personne humaine en tant que possédante et crée une disjonction entre égalité formelle et inégalité réelle. La capacité à posséder pourrait pourtant être encouragée par le républicanisme sans pour autant être absolutisée. Le traitement de Rousseau offrait une vision paradigmatique de ce point de vue. Le droit de propriété est condamné (par le Second Discours) puis restauré (par le Contrat social) selon une perspective non-absolutisante. Ce droit est collectivement discuté et instauré pour l’avantage du plus grand nombre. Le républicanisme connecte alors la reconnaissance de l’utilité sociale de la propriété et l’impératif de la solidarité.
Conclusion
C’est l’élargissement de la communauté civique et son approfondissement qui est évoqué en conclusion pour résumer la république nouvelle. Finalement l’usure sémantique de la grammaire républicaine ne marque pas la mort de la forme politique mais la nécessité de la refonte conceptuelle et normative de ses notions cardinales : peuple, égalité, liberté politique et légitimité étatique.
La république, si elle signifie l’expérience de la communauté civique, n’est pas complètement désuète : son noyau dur existe bel et bien et peut être débarrassé de ses scories historiques. C’est la culture de la participation et de la délibération qu’il faut mettre en œuvre pour sauver la république et contrer le monisme culturel hérité de la tradition française standard. Plutôt que l’idée républicaine, riche de possibles, c’est l’expression politique par le vote qui s’épuise. La réinvention de la république devient en définitive son approfondissement même. Thierry Ménissier invite pour finir à la réflexion sur l’usage des technologies innovantes pour rendre possible cet approfondissement.
La République renforcée par le bas et par l’usage raisonné d’Internet est-elle alors appelée à devenir la VIème République ?
- Bien que le néorépublicanisme regroupe des auteurs très différents, Thierry Ménissier n’emploie pas lui-même ce vocable. L’ouvrage, comme les auteurs néorépublicains, critique pourtant les faiblesses de la pensée libérale et participe bien d’une réflexion favorable à un renouveau républicain
- Thierry Ménissier, La liberté des contemporains. Pourquoi il faut rénover la république, Presses universitaires de Grenoble, octobre 2011. p.11
- Ibid p. 24
- Ibid p.24
- Notamment Moses Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, 1976 cité p. 25
- La liberté des contemporains. Op.cit, p.26
- Ibid., p.47
- Ibid., p.52
- p.59
- Ibid., p.60
- Ibid., p61
- Ménissier pp.65-66, H. Arendt, Les Origines du totalitarisme, tome II, L’impérialisme
- La liberté des contemporains. Op.cit., p.66
- Ibid., p.72
- Le temps des tribus cité par Ménissier, ibid., p.74
- p.79 et suivantes
- Ibid., p.99
- Ibid., p.101
- Ibid., p.102
- Ménissier ibid., p.100. R. Rorty, Contingence, ironie et solidarité.
- Ibid., pp.112-115
- Ibid., p.115
- Ibid., p.134
- Ibid., p.154
- Hannah Arendt, « Vérité et politique » dans La crise de la culture, cité par Thierry Ménissier, op.cit. p 155
- La liberté des contemporains. Op.cit, p.155
- Ibid., p.193
- Ibid., p.211
- C. B. Macpherson La théorie politique de l’individualisme possessif Gallimard, 2005








