On ne dit pas suffisamment le bien que Ferdinand Alquié avait fait à la connaissance de la pensée cartésienne ; outre l’édition en trois volumes des œuvres de Descartes chez Garnier, Alquié avait dispensé des cours d’une clarté extraordinaire consacrés à Descartes, et les éditions de la Table Ronde dans la collection Petite Vermillon décidément excellente ont proposé, en 2005, au grand public, les leçons du grand professeur.
L’ordre d’exposition retenu par Alquié est chronologique ; un tel choix permet de faire ressortir les évolutions de la pensée cartésienne, ses éventuels revirements, et surtout les clarifications opérées par Descartes tout au long de sa vie philosophique ; naturellement, dans des leçons ayant pour ambition de traiter la totalité de la pensée cartésienne, la place réservée à l’analyse des détails est congrue ; il n’empêche que ces leçons demeurent excellentes et proposent un abord exceptionnellement intelligent des œuvres cartésiennes.
La première partie, consacrée aux années 1619-1628, cherche à dépasser un conflit interprétatif classique parmi les lecteurs de Descartes ; d’un côté, les tenants d’un Descartes avant tout scientifique, passionné par les mathématiques et la mécanique, s’organisent autour de Gilson (qui, au fond, n’aura eu cesse de ramener le Descartes philosophe à la pensée médiévale, cherchant ainsi à réduire considérablement son originalité) et Adam, qui font de Descartes un physicien qui puisera sa philosophie dans les textes les plus canoniques ; à l’opposé, Guéroult et Gouhier chercheront à réhabiliter toute l’originalité de la pensée cartésienne et, partant, de rétablir la force de sa philosophie. Face à ces deux possibilités, Alquié semble ne pas choisir, ou plutôt choisir une troisième voie qu’il décrit en ces termes : il s’agit d’examiner « comment Descartes lui-même a conçu le rapport, la relation, entre ces deux disciplines. »1 Ne pas figer Descartes donc, dans un rôle préconçu, mais restituer la force de son questionnement autour des rapports qu’entretiennent les deux directions possibles de sa pensée. Un tel choix fait évidemment écho à La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes où Alquié cherchait à établir l’évolution de ces rapports, d’une proéminence de la science à l’assise progressive de la métaphysique au détriment de la première : une « découverte » donc de la métaphysique, au fur et à mesure que la science s’estompait de ses préoccupations primordiales.
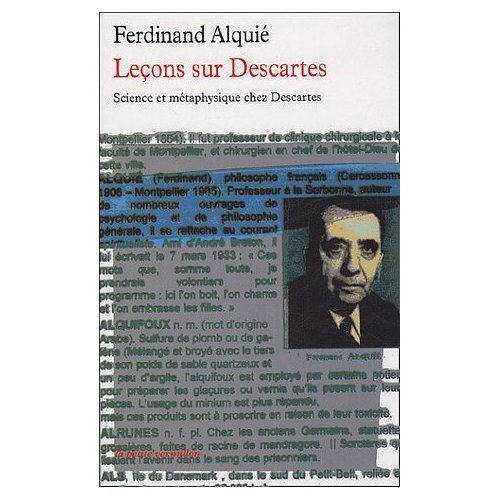
Alquié commence par relativiser l’innovation scientifique de Descartes, remarquant qu’il baigne déjà dans une atmosphère mécaniste, offerte par Galilée et Kepler et révélée par Beeckman. Le mécanisme cartésien n’est pas une particularité de Descartes, c’est la position normale des penseurs progressistes ; où se situe alors l’originalité cartésienne en matière scientifique ? Elle réside tout entière dans la mathématique, au sens où le geste philosophique majeur consiste à penser l’extension de la méthode mathématique hors de la mathématique. Ainsi, les cours d’Alquié ne s’interrogeront-ils jamais qu’autour de cette question majeure : « comprendre comment Descartes a pu tenir pour universelle une méthode qui, en fait, est de style mathématique, et qui, en fait également, n’a jamais été appliquée de façon stricte que dans le domaine mathématique. »2 Le centre du questionnement s’organise donc autour de la possibilité de la mathesis universalis ; pourquoi souhaiter étendre une méthode d’une région particulière à l’ensemble des sciences ? La seule réponse possible consiste à remarquer que le champ d’application de la méthode mathématique a été, à tort, restreint à la seule mathématique, alors que cette méthode indubitable devrait connaître une extension radicale à tous les objets de la science ; cela signifie donc que les méthodes inhérentes à chacune des sciences ne sont pas équivalentes ; celle de la mathématique surpasse toutes les autres ; nous disons bien la méthode et non la science, distinction capitale car l’écueil majeur est celui de croire que le privilège proviendrait de la science elle-même. Ce n’est absolument pas le cas, et Alquié insiste à juste titre sur ce point : il n’est pas possible de trouver l’unité de la science dans la science. La science admirable, unifiée, ne provient pas d’une unité de son objet mais d’une unité de sa méthode ; or, d’où provient la méthode ? De l’esprit répond Alquié. Ainsi, et nous sommes ici déjà en 1628, l’unité de la science admirable n’est autre que la transcription de l’unité de l’esprit.
Une telle interprétation, bien qu’Alquié ait annoncé qu’il ne s’engagerait pas dans les débats Gilson / Guéroult, est évidemment aux antipodes de celle de Gilson ; Alquié, en affirmant que l’unité de la science cartésienne provient de l’esprit, fait de Descartes celui qui instaure une rupture radicale avec la Scolastique : « Ici, Descartes s’oppose tout à fait à la philosophie de l’Ecole. Il ne se place plus au point de vue des choses connues, et l’on peut déjà trouver en cela un certain pressentiment du « je pense ». Il admet que les choses connues sont diverses, mais il se place au point de vue de l’esprit connaissant qui, lui, est un. »3 En d’autres termes, loin de puiser ses présupposés dans une philosophie scolastique passée, Descartes annonce au contraire les Temps modernes, la révolution copernicienne de Kant, l’indexation de l’objet sur la forme même de l’esprit. « C’est déjà le commencement de la fameuse révolution copernicienne de Kant, c’est déjà l’idée que, l’esprit étant un, s’il a trouvé la certitude dans un domaine, il pourra, en étendant sa méthode à tous les domaines, trouver la même certitude, car l’esprit étant un, sa connaissance est toujours de même nature. »4
En 1628, dans les Règles pour la direction de l’esprit, nous avons ainsi une préfiguration de la révolution copernicienne aux yeux d’Alquié, mais il convient de se demander ce que recouvre une telle préfiguration ; de quelle nature est-elle ? Y a-t-il une assise métaphysique de cette révolution ? Y a-t-il un privilège explicite du cogito ? Ce qu’il y a en 1628, c’est l’idée d’une science unifiée grâce à l’unité de l’esprit, certes, mais sans que cela ne s’accompagne d’une fondation métaphysique de l’unité de l’esprit ; en d’autres termes, l’unité de l’esprit n’est qu’une vérité parmi d’autres, elle n’a pas encore acquis sa dimension fondationnelle, son pouvoir ultérieur ; la certitude de soi comme fondation indubitable manque, la réflexivité de la pensée n’est pas encore thématisée. Cette vacuité métaphysique indique donc que Descartes demeure, en 1628, d’abord physicien tout en ayant le « pressentiment » d’un nécessaire retour à l’esprit et à ses formes. Donc « en 1628, dans les Règles pour la direction de l’esprit, les vérités métaphysiques ne sont à aucun degré des fondements. Elles sont placées parmi les autres. »5
Après cette première période où se révèle un frémissement du sujet mais sans que ce dernier ne soit thématisé comme tel, Alquié aborde les années 1629-1637. De la sorte, les Regulae vont être présentées comme cette œuvre majeure où se profilent de nombreuses questions dont l’absence de fondation métaphysique rend impossibles les réponses. Les Regulae désignent donc ce moment de la pensée cartésienne où les interrogations soulevées nécessitent une réponse métaphysique mais où, en même temps, la dimension encore scientifique des thématisations cartésiennes interdit l’accès aux réponses souhaitées. Pourquoi, par exemple, l’esprit est-il frappé de toutes ses erreurs, pourquoi compose-t-il si mal alors que l’impératif est celui du simple ? Comprendre les problèmes de composition de l’esprit nécessite un traitement métaphysique de la question que Descartes ne peut offrir en 1628. De la même manière, que signifient les « natures simples » ? Elles ne sont jamais clairement définies, si bien que, en règle générale, nous sommes face à une « redoutable indétermination des notions. Tout paraît clair, et en fait rien n’est clair. »6 L’absence de métaphysique de cette période rend impossibles les réponses aux questions soulevées au cours de cette même période, et il me semble clairement établi par Alquié que les Regulae évoluent dans un cercle de tâtonnements, où affleurent à chaque instant le besoin métaphysique et le doute ontologique sur fond d’une confiance encore intacte dans la possibilité de la science.
Comprendre quel est le sens de cet affleurement non thématisé de la métaphysique de 1629 à 1637, telle sera la tâche d’Alquié dans le troisième chapitre, largement consacré à la création des vérités éternelles. On se rappelle que La découverte métaphysique…avait posé ce thème – celui de la création des vérités éternelles – comme point nodal de la pensée cartésienne. « Rien, écrivait Alquié, ne nous semble donc plus fondamental, en la philosophie cartésienne, que la théorie de la création des vérités éternelles (…). »7 Etrange primauté que celle de la création de ces vérités dans la mesure où celles-ci n’apparaissent jamais dans les œuvres publiées de Descartes. Cette doctrine, née dans un échange épistolaire de 1630, constitue aux yeux d’Alquié l’articulation centrale d’une libération de la physique à l’égard de la théologie. En quoi consiste l’idée d’une création des vérités éternelles ? Cela revient d’une part à libérer Dieu d’une passivité à l’égard des vérités intangibles (Suarez, par exemple, faisait de Dieu un Etre soumis aux principes logiques dont il prenait connaissance par la ratio reddenda) et donc à faire de Dieu une pleine activité. Mais d’autre part, se crée une dualité ontologique entre d’un côté, Dieu, pleine activité, et le reste de l’être soumis à l’activité divine ; les vérités éternelles ne sont plus un domaine particulier, elles relèvent de la création comme le reste de l’être. Par conséquent, cela même qui participait des vérités éternelles se trouve libéré de leur privilège et donc de la théologie car il n’est plus besoin de se référer à celle-ci pour appréhender de telles vérités. « La théorie de la création des vérités éternelles chante la gloire de Dieu, mais, distinguant encore davantage Dieu de sa création, elle libère la physique de la théologie, elle rend la physique indépendante. »8. N’oublions pas que dans la Découverte…, Alquié avait déjà posé l’extraordinaire rupture que constituait à ses yeux la thèse de la création des vérités éternelles : « La doctrine de la création des vérités éternelles, si elle est celle du Dieu souverain, est aussi celle du Dieu absent, et la séparation qu’elle implique est si caractéristique de l’esprit moderne qu’elle se retrouvera, sous d’autres formes, dans le jansénisme, refusant de voir en un mouvement naturel, en un sentiment proprement humain un élan vers Dieu, ou dans le kantisme, séparant radicalement l’ordre moral et celui de la Nature. »9
Si l’on comprend aisément pourquoi la théorie de la création des vérités éternelles génère une rupture fondamentale dans les rapports de Dieu et du monde, encore faut-il comprendre en quoi une telle théorie est si importante dans l’économie interne du système cartésien. Certes, nous l’avons compris, cela institue une séparation radicale entre ce qui est créé et le créateur ; mais en quoi cette séparation est-elle si fondamentale ? Elle est fondamentale en ceci qu’elle introduit les mathématiques dans le même plan que celui des autres sciences et donc des autres connaissances ; la mathématique n’est plus cette science à part, tirant son privilège de l’éternité de ses vérités, mais bien une science parmi d’autres dont le statut est analogue à celui de tout le reste de la création ; en d’autres termes, Descartes crée un plan unique où évoluent toutes les sciences, unifiées par leur statut de création. Par conséquent, nul obstacle ontologique ne s’oppose à l’application de la méthode mathématique à l’ensemble de la connaissance de la création. En somme, le retour des vérités éternelles à l’être créé fait de la méthode mathématique cela même qui peut s’appliquer à l’ensemble de la création, car se trouve dépassé le hiatus ontologique qui menaçait une telle possibilité.
Quelle est la conséquence immédiate de ce constat ? Elle est celle du risque d’une désontologisation radicale du monde de la science ; si, en effet, se séparent si fondamentalement la création du Créateur, et si l’on ne peut jamais connaître que le monde créé dont Dieu s’est considérablement éloigné, le monde connu perd toute consistance ontologique. Il devient une « fable »10 tant que Dieu n’en a pas assuré la réalité. On le voit, ce que cherche à montrer Alquié, c’est la nécessité d’un support permanent apporté par Dieu à un monde dont la théorie de la création des vérités éternelles assure la fuite de celui-ci hors de celui-là. Le monde désenchanté requiert paradoxalement une garantie divine que la présence universelle de Dieu rendait jadis inutile. Descartes prive la nature de toute espèce d’efficacité, et il annonce par là la théorie de Malebranche sur les causes occasionnelles, selon laquelle Dieu seul est cause, la cause naturelle étant seulement l’occasion de l’action divine. »11 Cette présence divine, Alquié l’identifie dans le temps, ou plutôt dans la création continuée : Dieu recrée à chaque instant le monde, maintenant celui-ci dans l’être, faisant du mouvement une simple suite d’instants discontinus.
Où en sommes-nous à présent ? Il est manifeste que les lettres sur la création des vérités éternelles appellent une métaphysique, à partir d’une réflexion sur le statut des vérités mathématiques. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si le Discours de la méthode de 1637 offre une réponse métaphysique à ces questions. Alquié appréhende ce texte de 1637 sous l’angle du doute ; que signifie douter ? Cela ne signifie pas douter de l’objet, mais bien plus douter de l’opinion que l’on a sur l’objet. Il faut impérativement comprendre la différence qui se joue ici : Descartes ne statue pas sur la réalité du monde ni de l’objet mais il statue sur la possibilité d’avoir une opinion certaine quant aux objets. D’où la difficulté fondamentale de cette démarche car le doute radicale impose que l’on puisse douter réellement que deux et deux fassent quatre ; est-ce réellement faisable ? Spinoza en doutera… Mais au-delà de ce problème de faisabilité, la question du doute impose à Alquié de se demander si, en 1637, la formulation de celui-ci est déjà métaphysique ; autrement demandé, est-ce que, de 1629 à 1637, Descartes a pu conceptualiser clairement cela même qui manquait aux Regulae et dont le besoin se faisait sentir dans les lettres de 1630 ? Alquié a toujours répondu non à ces questions. En 1637, Descartes ne dispose pas d’une métaphysique claire. En d’autres termes, le doute ne permet pas d’opérer un renversement des rapports de subordination de sorte que l’objet soit enfin réglé et subordonné au sujet. « Il faut donc convenir que le cogito du Discours répond seulement à des préoccupations scientifiques et méthodologiques. Il n’a pas le caractère d’un moi libre se séparant de l’Etre, et ne pouvant être réconcilié avec lui que par la véracité divine. »12 Le doute du discours chercherait donc à établir la différence entre le vrai et le faux, à discriminer entre ceux-ci, sans qu’une réflexion sur la nature du vrai et du faux ne soit menée ; bref, Descartes ne s’élèverait pas à une réflexion permettant de penser une méta-vérité, à partir de laquelle se déduirait cela même qui est vrai, le doute échouant à quitter le plan des énoncés vrais et faux pour se hisser à leur condition de véracité.
Une telle interprétation a été contestée par Jean-Luc Marion dont les présupposés heideggériens réduisent néanmoins fortement la portée de la critique ; en effet, Marion reprend une identification de la métaphysique à l’onto-théo-logie, identification qui n’est pas celle d’Alquié, si bien que Marion conteste l’absence de métaphysique selon Alquié à partir d’un sens de la métaphysique qui n’est pas celui que retient Alquié. Aux yeux de Marion, Alquié veut dire que le « je pense » était incapable d’assurer, en 1637, la transcendance du cogito à l’égard de ses objets, mais Marion ne considère pas que ce fait signe l’impossibilité d’une métaphysique du Discours. Si ce dernier rate la métaphysique, c’est en fonction de critères bien plus heideggériens, dont celui de causalité. Descartes ne fait pas appel à la causalité pour asseoir Dieu, et échappe donc, de ce point de vue à la métaphysique ; en revanche, le discours donne au je le titre de substance, ce qui est une appellation métaphysique ; le « je pense » fixe la substance et Marion y voit, dans un présupposé ultra-heideggérien, la trace d’une métaphysique possible. S’appuyant sur la substantialité de l’ego proposée par le Discours, Marion pose donc le caractère métaphysique de celui-ci, selon trois critères : « la permanence de l’existence, le titre de premier principe, le statut de première substance. »13 Marion parvient ainsi à ce paradoxe voulant que le Discours soit plus métaphysique que ne le sont les Méditations, en raison de cette substantialité de l’ego moins immédiate en 1642 qu’en 1637. Mais cette interprétation paradoxale n’est valable que si l’on adopte le sens heideggérien de la métaphysique qui n’était pas celui que retenait Alquié ni, a fortiori, celui que Descartes pouvait imaginer. Il est donc permis de douter que cet article, par ailleurs brillant, de Marion constitue une véritable réfutation de l’interprétation d’Alquié.
Le cinquième chapitre d’Alquié cherche à cerner, puisque se joue une différence métaphysique entre les Méditations et le Discours, la différence fondamentale entre le cogito ergo sum du Discours et le egosum ego existo des Méditations. Si, en effet, de 1637 à 1642 se trouve introduite une métaphysique claire, alors le statut de ces deux principes ne peut plus être parfaitement identique. Le « je pense donc je suis » du Discours n’est pas la conclusion d’un raisonnement mais c’est inversement dans cette formule qu’apparaît l’évidence du « pour penser il faut être ». De ce fait, on peut dire que le « je pense donc je suis » est une vérité innée qui révèle sa structure logique, a priori. On a là une pure induction passant de la saisie du particulier au fondement général. Qu’est-ce que cela signifie fondamentalement ? Cela signifie que la nécessité porte, en 1637, sur la liaison déductive ; il est nécessaire que soient reliés l’être et la pensée, que pour penser je doive être, mais il n’est pas nécessaire que je sois ni que je pense. Bref, si je pense je dois être et si je suis, je pense mais rien n’assure la nécessité ni de la pensée ni de l’être. Métaphysiquement, ce qui est fondamental ici, c’est le fait que le cogito ne se saisisse pas lui-même de façon originaire, il s’agit d’une liaison logique et non d’une intuition de l’être. C’est là toute la différence avec le ego sum ego existo des Méditations ; il ne s’agit plus d’assurer une liaison logique, mais bien de poser la saisie de l’être, de l’existence comme fondement métaphysique de la connaissance. L’ego devient le fondement absolu de la connaissance, et se trouve thématisé comme tel. « Donc, ce qui frappe ici, c’est le caractère absolument unique, absolument simple de l’acte par lequel la pensée se saisit. »14 Ce qui est découvert, ce n’est plus le nécessaire conditionnement de la pensée par l’être mais bien plutôt la fondation métaphysique de la connaissance dans l’ego, de sorte que le moi, le sum devient « l’unique support ontologique de mes idées. »15
L’ego étant ainsi devenu le fondement de toute certitude, Alquié va se concentrer sur la seconde méditation et donc aux passages les plus célèbres de la pensée cartésienne : analyse du morceau de cire. Contre Guéroult, Alquié rappelle que le cogito ne saurait en rien se réduire à la pensée, tant il contient également la sensation, l’imagination, et surtout la volonté ce qui, certes, déconcerte, mais ne permet néanmoins pas de refuser cette extension du cogito bien au-delà de la seule pensée intellectuelle. « Donc (…) il faut bien admettre que le moi du « je pense », l’ego du cogito, réalise l’unité indécomposable et peu claire, je vous l’accorde, d’une imagination, d’une volonté et d’un entendement. »16
Comment le morceau de cire est-il conçu ? A ce stade des méditations, l’existence du monde extérieur n’est pas encore assurée ; par conséquent, il est exclu que Descartes parle de la cire réelle ; ce point est crucial ; Descartes ne va pouvoir parler que de la cire sentie (par les yeux), en tant que la sensation est un mode du cogito. Il ne faut en aucun cas croire que Descartes aborde, dans un premier temps, la réalité de la cire ; il n’en décrit que ce que la représentation issue du cogito lui permet de dire. La réflexion porte donc sur l’acte par lequel je saisis la cire. « Ce n’est pas la réduction du cogito à l’intellectus, c’est le rappel du cogito comme cogitatio. »17 Il s’agit moins de penser ce qu’est la cire que de découvrir le fonctionnement de l’esprit humain dans la diversité de ses rapports au monde, donc dans la variété de ses représentations. « Le vrai primat, c’est donc, non pas celui de l’intellect, mais celui de l’être du moi pensant. »18
Alquié se penche ensuite sur l’étude de la troisième méditation puis sur les preuves de l’existence de Dieu ; la seconde retient particulièrement son attention, car elle met en œuvre la cause du moi, donc de l’ego en tant qu’instance finie ; si le moi n’était pas affecté de cette finitude, il pourrait être lui-même cause de Dieu, ce qui est exclu ; par conséquent le moi ne peut être que fini et l’ensemble des modes du cogito seront autant de marques de cette finitude. « Par conséquent, la preuve par la causalité de l’idée repose sur l’affirmation explicite du cogito comme ego et comme sum, et non seulement comme intellectus, elle suppose le moi comme moi doutant, comme moi désirant, comme moi voulant, puisque (…) Descartes invoque, pour prouver que le moi est fini, le fait que je désire, et que par conséquent, je ne possède pas ce que je veux, et donc que je me sens moi-même comme fini. »19 Ainsi, par essence la cogitatio se trouve-t-elle toujours déjà insérée dans un jeu de renvoi ontologique, sa finitude faisant qu’elle doit ouvrir à l’infini divin. Mais il y a plus : l’homme se sachant fini sait aussitôt qu’il y a Dieu. L’originalité de Descartes consiste à penser le fini à partir de l’infini, si bien que l’on ne se ressaisit comme être fini que parce que l’on a en amont l’idée de l’infini divin. Ainsi, se savoir fini ce n’est rien d’autre que se comparer à l’idée de Dieu de sorte qu’« on peut dire que les Méditations ne démontrent pas l’être, elles le retrouvent, et elles le retrouvent comme la condition même de toute pensée. »20
Le dernier chapitre se clôt sur l’une des plus irréductibles difficultés du système cartésien, la matière. Peut-on avoir une idée de la matière ? Descartes échoue à fonder la substantialité de l’étendue car il ne dispose plus de la substance aristotélicienne et ne parvient pas encore à la notion de force leibnizienne. La certitude de la matière ne sera jamais garantie comme celle de Dieu ou de l’ego, ce qui amène une faille radicale dans l’économie de sa pensée : rappelons que le projet cartésien était celui d’une unification méthodologique par le biais de la mathesis universalis, l’échec de la substantialisation de la matière montrant qu’un tel projet était peut-être, dès le départ, caduque. « Et vous voyez, constate Alquié, par tout ceci, que la véracité divine, malgré le rêve premier de Descartes, qui était, rappelons-le, d’étendre à toutes les sciences la certitude mathématique, ne saurait fonder une science universelle ayant le caractère de certitude des mathématiques. »21 Que peut-on en conclure ? Que le projet d’établissement de la métaphysique cartésienne ne fonde pas la science puisque les conséquences physiques de cette métaphysique sont celles d’un échec ; les Principes de la philosophie ne parviennent pas à assurer par la véracité divine la réalité de la matière, si bien que la métaphysique cartésienne ne saurait être conçue comme une quête de fondation universelle de la science. Radical, Alquié conclut en ces termes : « aucun être n’est chez Descartes scientifiquement connu. »22 Pourquoi ce constat d’échec ? Alquié, dans La découverte métaphysique… l’attribuait au Dieu lointain, au Monde désenchanté, à la séparation de l’être et de Dieu ; il ne suffit plus de connaître Dieu pour comprendre le monde, lequel acquiert une ontologie propre que la véracité divine n’épuise pas. « La place que prennent, en la dernière philosophie de Descartes, la notion de substance, l’expérience passivement subie, le caractère inconnaissable du réel témoignent du poids que fait sentir à l’homme un Monde qui n’est plus le clair langage que lui parle Dieu, mais qui possède lui-même l’être. »23
On pourrait formuler une réserve, à l’issue de ces leçons : Alquié n’a eu cesse de poser l’importance de la création des vérités éternelles pour en conclure à une désontologisation du monde ; or, ses leçons s’achèvent sur un monde qui aurait conquis son ontologie propre, indépendante de Dieu, et donc inconnaissable. Je dois avouer que j’hésite à voir ici un paradoxe ou une contradiction : paradoxe si l’on part du principe que la désontologisation du monde, le retrait du divin ne signifie pas l’impossibilité de toute ontologie, contradiction si l’on pense que l’être est univoque, ce qui reviendrait à dire que le monde se désontologise et s’ontologise tout à la fois. Cette difficulté n’est, au fond, que la marque de la surdétermination de la création des vérités éternelles par Alquié, paradigme herméneutique fort, qui est le signe d’un très grand commentateur.
- Ferdinand Alquié, Leçons sur Descartes, La Table Ronde, 2005, p. 12
- Ibid. p. 27
- Ibid. p. 32
- Ibid. p. 33
- Ibid. p. 37
- Ibid. p. 65
- Ferdinand Alquié, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, PUF, 1950, 1966², p. 7
- Alquié, Leçons…, op. cit., p. 77, sq
- Alquié, Découverte métaphysique…, op. cit., p. 91
- Ibid. p. 102
- Alquié, Leçons…, op. cit., p. 88
- Alquié, La découverte métaphysique…, op. cit., p. 153
- Jean-Luc Marion, Quelle est la métaphysique dans la méthode ?, in Jean-Luc Marion, Questions cartésiennes I, PUF, 1991, p. 62
- Alquié, leçons…, op. cit., p. 146
- Ibid. p. 156
- Ibid. p. 167
- Ibid. p. 171
- Ibid. p. 175
- Ibid. p. 201
- Ibid. p. 205
- Ibid. p. 274
- Ibid. p. 279
- Alquié, La découverte métaphysique…, op. cit., p. 279








