Deux ans après Au lieu de soi, lecture de Saint Augustin que l’on qualifiera pudiquement de surprenante1, Jean-Luc Marion a choisi de publier son dernier ouvrage chez Grasset, dans la collection Figures, où officient Bernard-Henri Lévy et Michel Onfray. Son nouvel opus, Certitudes négatives2, ne présente guère de nouveautés réelles, et synthétise un certain nombre de principes déjà énoncés auparavant, exception faite de la « certitude négative », qui n’apparaît en réalité qu’au début de l’ouvrage, et dont l’usage se trouve rappelé d’une phrase en conclusion. Il est donc question comme d’habitude de réduire le don à la donation, d’explorer la notion de saturation – repensée à l’aide de l’événement – et de défendre ce qui était déjà annoncé dans Réduction et donation et qui avait été accompli pleinement par De surcroît. Essai sur les phénomènes saturés.
A : Quelques gimmicks sémantiques
On ne saurait lire un ouvrage de Marion sans prêter attention au style qui a quelque chose à la fois de séduisant et d’irritant. Les textes de Marion, quels qu’ils soient, souffrent de démonstrations souvent peu convaincantes, voire indéfendables ; nonobstant ce problème, la stratégie mise en place par l’auteur s’avère efficace : se trouvent ainsi disséminés de nombreux marqueurs qui simulent la rigueur, et qui procurent une impression de maîtrise totale. Par exemple, et parmi bien d’autres, l’usage de l’adjectif « exact » ou de l’adverbe « exactement » frappe par sa récurrence. Dans Etant donné, par exemple, l’emploi de l’adverbe « exactement » est tout à fait remarquable ; on lit ainsi, au § 1, et en tout début d’ouvrage, avant même que toute démonstration n’ait été apportée, la phrase suivante : « Montrer implique de laisser l’apparence apparaître de telle manière qu’elle accomplisse sa pleine apparition, afin de la recevoir exactement comme elle se donne. »3 L’identité entre monstration et donation est ici présentée comme parfaite, en vertu de l’usage de l’adverbe ; mais en réalité, il ne s’agit que d’une assertion, dont la radicalité de l’adverbe dispense de la démonstration. On retrouve le même procédé un peu plus bas, toujours dans la même optique : « la manière dont le don se donne coïncide exactement4 avec la manière dont le phénomène se montre ; ce qui s’accomplit comme don réduit se décrit aussi comme phénomène constitué. »5 Mais si la valeur rationnelle de cet adverbe demeure douteuse, son usage stratégique est limpide.
Cet usage se retrouve également dans des expressions comme « dans l’exacte mesure », qui donne là aussi une impression de rigueur dans la démonstration ; Certitudes négatives n’est pas avare de ce procédé, particulièrement lorsqu’il est question de justifier une assertion dans un cadre théologique : « seul Dieu, écrit ainsi Marion, peut tout pardonner, précisément parce qu’il a tout créé. Paradoxalement il apparaît comme le miséricordieux dans l’exacte mesure6 de sa transcendance. »7 En réalité, du point de vue de la démonstration rationnelle, tout cela n’est guère convaincant et à défaut de faire usage d’un argument, Marion utilise bien souvent l’arme sémantique dont les effets illusionnants s’avèrent fort efficaces. En effet, ici ne se trouve nulle démonstration du rapport entre miséricorde et transcendance, mais l’assertion selon laquelle il existerait un rapport d’une « exacte mesure » entre les deux génère une illusion de rigueur argumentative qui dispense stratégiquement de l’argumentation.
Parfois, cet emploi devient amusant ; les assertions non démontrées cèdent la place aux tautologies et l’on se retrouve alors confronté à de singulières déclarations : « L’objet se laisse connaître exactement, parce que sa définition consiste précisément à se laisser connaître exactement – le reste, qui ne peut se reconduire à l’exactitude et à sa permanence, se trouvant renvoyé au domaine indéterminé de la « subjectivité ». »8 Que signifie réellement une telle phrase ? Là aussi,il faut mesurer combien la présence de termes comme « exactement » ou « exactitude » voire comme « parce que » occulte complètement le non-sens ; tout se passe comme si l’usage de mots à connotation rigoureuse croissait à mesure de la décroissance du sens des phrases dans lesquelles ils sont employés. Et ce n’est sans doute pas un hasard si la dernière phrase du texte emploie cet adverbe : « Une pensée se mesure exactement aux paradoxes qu’elle endure et qu’elle appelle. »9 Remarquons enfin que cette brève analyse opérée autour de l’adjectif « exact » et de ses dérivés, aurait tout aussi bien pu être menée autour de l’adjectif « strict » ou de l’adverbe « strictement », voire autour de l’adjectif « bon », dont Marion aime à rappeler qu’il s’accole volontiers au substantif de « théologie » ou de « métaphysique », ce qui sature ses écrits d’expressions telles que « en bonne théologie » ou « en bonne métaphysique », comme si l’auteur cherchait à rappeler qu’il maîtrisait et surplombait admirablement ces dernières.
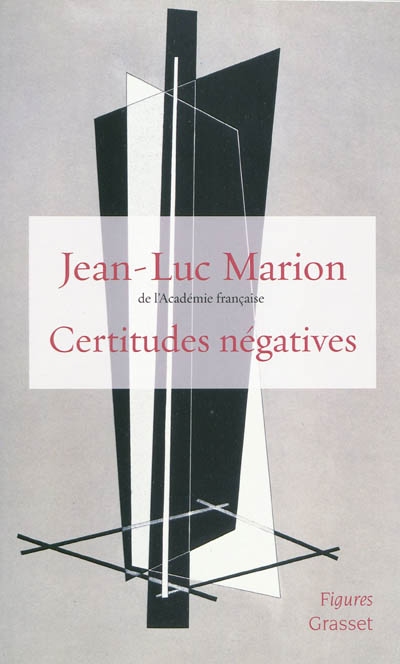
On ne saurait clore ces quelques remarques sémantiques sans aborder les jeux de mots et les répétitions. Mgr Dagens avait, lors de sa réponse ambiguë adressée à Marion au moment de la réception de ce dernier à l’Académie française, souligné le côté parfois comique des répétitions marionesques : citant une phrase saturée de répétitions organisées autour du « don », Mgr Dagens concluait en ces termes : « on pourrait avoir l’impression que vous jouez avec les mots, en les faisant cliqueter à plaisir. » Mais, l’homme charitable ajoutait aussitôt qu’il fallait dépasser cette trompeuse impression et comprendre que Marion « luttait intérieurement », qu’il livrait son « combat intime », fût-il parfois déroutant, voire inintelligible. Certitudes négatives n’est pas exempt de ce « combat intime », de cette difficulté à dire, de cette manie consistant à répéter sans fin les mêmes radicaux : « Le sacrifice fait la redondance du don dans l’abandon. »10 Ou encore : « Cet abandon par Abraham du don d’Isaac, abandon qui le rend à son donateur et le reconnaît comme donné, accomplit tout ce que Dieu attendait en fait de sacrifice. »11 Et le nec plus ultra : « Le pardon outrepasse au contraire l’échange, parce qu’il le compense, en établissant ce que celui-ci avait toujours déjà manqué : que le don se trouve reçu comme tel, par un donataire qui le reconnaisse comme donné, et donc s’admette lui-même d’abord comme adonné : le pardon suppose donc la faute (son injustice morale) du donataire, pour pouvoir alors établir par redondance le don dans son statut (phénoménologique) de don donné. »12 Don, donné, donataire, donation, abandon, redondance, adonné, pardon, telle est la technique sémantique dont Marion se sert fréquemment afin de suggérer une liaison entre ses concepts, liaison qui s’avère en réalité davantage rhétorique que conceptuelle.
B : La science recherche-t-elle encore des certitudes ?
Au-delà de ces questions formelles – mais qui engagent le sens de l’œuvre – il faut désormais prêter attention à ce que le livre essaie de dire. Le § 1 éclaire de manière assez nette le sens de l’entreprise, et semble d’abord s’orienter vers quelque chose de l’ordre d’une réflexion épistémologique. Pour le dire simplement, Marion remarque que nous sommes restés cartésiens, que nous entendons par la connaissance quelque chose de certain et que la certitude scientifique passe par la construction d’objets. « Rien ne devient certain qui ne devienne aussi un objet. Par définition, l’objet apparaît connaissable sans reste, puisqu’il ne retient rien de plus que ce qui, de la chose, peut se connaître. »13 Mais, remarque aussitôt Marion, il existe aussi des connaissances qui se dispensent de l’objet, et toute la question tourne alors autour du problème suivant : ces connaissances non objectales méritent-elles le nom de « certitudes » ? Oui, répond l’auteur, à condition de préciser qu’elles sont négatives. « Ainsi, nous pouvons atteindre une science non seulement par certitude positive en objectivant la nature d’une chose jusqu’alors inconnue, mais aussi, si cette affirmation se révèle inatteignable, par la certitude négative que soit la chose même, soit notre condition finie, rend l’expérience impossible et la réponse inconnaissable. »14 Autrement dit, une certitude négative consiste à poser le fait que je suis certain de ne pas pouvoir connaître ce qui, jamais, ne sera objectivé.
Ce 1er paragraphe pose d’emblée une série de problèmes totalement inaperçus par Marion. A commencer par le présupposé général voulant que la science contemporaine soit encore cartésienne, qu’elle recherche encore des certitudes. Marion semble croire que la science fonctionne selon un modèle positiviste plat, comme si les expériences intrigantes de la mécanique quantique n’avaient pas rebattu les cartes et justement fait éclater la notion même de certitude. Il me suffit simplement de rappeler le titre du célèbre ouvrage de Prigogine, La fin des certitudes pour signaler à quel point l’idée selon laquelle nous serions encore cartésiens, de ce point de vue là, constitue une méconnaissance fondamentale de ce qui se joue actuellement dans les sciences physiques. Il n’est jusqu’à la causalité qui ne se trouve menacée par les résultats de la mécanique quantique, mais Jean-Luc Marion répondrait sans doute à cette objection qu’il n’a que faire de la vulgarité des sciences ontiques. Une attention portée auxdites sciences lui aurait néanmoins évité d’asséner pareil non-sens. En somme, il n’est tout simplement pas vrai que la science contemporaine recherche des certitudes positives, cela fait près d’un siècle qu’elle a intégré la notion d’incertitude, et que cette dernière est désormais constitutive de la démarche scientifique.
En outre, Marion se demande si l’homme est de l’ordre de la connaissance objective, si donc l’on peut former une certitude positive à l’égard de l’homme lui-même. Prolongeant sans le dire un débat avec Jean-Marie Schaeffer autour de la fin de l’exception humaine15, Marion cherche à maintenir l’idée d’une exception humaine en posant l’inconnaissabilité de l’homme. S’appuyant sur une lecture très personnelle d’Augustin, Marion remarque que je suis à moi-même une terre de difficulté, que je ne me connais pas. D’où la déduction de Marion : « L’inconnaissance de soi constitue justement l’exception humaine. »16 Et un peu plus loin : « Il faut comprendre que toute autre chose peut et doit se connaître, sauf l’homme. »17 Il y a ici deux sophismes :
– D’une part, Jean-Luc Marion parle d’exception, c’est-à-dire d’une singularité humaine, discriminant entre l’homme et les animaux. Or, si l’inconnaissance de soi constitue l’exception humaine, cela signifie aussitôt que ce qui n’est pas humain se connaît soi-même ; sinon, il n’y aurait aucune raison de parler d’exception humaine quant à la connaissance de soi. Et l’on voit bien à quel point une telle affirmation serait absurde. En d’autres termes, de ce que l’homme ne puisse pas se connaître, Marion en déduit que l’homme est la seule entité ne pouvant pas se connaître, ce qui n’a aucun sens ; peut-être aurait-il fallu insérer un « exactement » pour dissimuler la chose…
– D’autre part, il y a une confusion permanente entre le rapport à soi, et la connaissance objective. Lorsqu’Augustin ou Montaigne évoquent la connaissance de soi, ils songent non pas à une science objective mais bien plutôt à la capacité de se comprendre soi-même, et à comprendre sa provenance. Il n’est donc pas question chez eux d’évoquer une connaissance scientifique, c’est-à-dire une certitude objective, positive, au sens où Marion la définit plus haut. Ainsi Marion confond-il allègrement l’incompréhensibilité de mon être, et l’incognoscibilité de mon corps afin de défendre sa thèse.
De manière plus générale, l’ouvrage fonctionne, particulièrement dans le premier chapitre, sur une série de confusions dont les analyses consacrées aux sans-papiers constituent sans aucun doute l’acmé. Le § 5 défend l’idée suivante : puisque l’homme est inconnaissable – au sens de : inobjectivable –, alors vouloir objectiver l’homme consiste à le déshumaniser. Il est intéressant de noter l’extraordinaire glissement logique opéré dans cette démarche puisque, d’une analyse inaugurale sur la réflexivité, Marion passe à l’objectivité puis, de l’objectivité il passe à l’ontologie, sans jamais justifier de tels passages. Ces passages indus trahissent leur manque de rigueur lorsque Jean-Luc Marion se met à analyser la signification d’un sans-papier, sans-papier révélant la structure métaphysique de l’administration.
« Le sans-papiers contredit son essence, en se montrant incapable de la décliner, de la restituer, de la produire (…). Au contraire, le citoyen en règle démontre son identité et sa bonne foi en exhibant son papier d’identité dûment numérisé et justifie qu’il n’est pas un autre que soi, qu’il est égal à soi. Le papier d’identité applique donc strictement le principe métaphysique d’identité à celui qui s’identifie par lui en s’y identifiant et le faisant reconnaître comme tel. »18
Quel est le problème qu’il dénonce ? Il dénonce un système fondé sur le principe d’identité, où le citoyen s’identifie aux papiers qu’il exhibe, c’est-à-dire que le citoyen en règle dirait « je suis moi-même » ; si principe d’identité il y a, cela signifie implicitement aux yeux de Marion que la légalité est à combattre puisqu’elle ne serait qu’un avatar archaïque de la métaphysique. Pis que cela, dit Marion, le papier provient d’un tiers, d’une transcendance à l’individu, si bien que l’attestation de ce que je suis ne m’est pas donnée par moi-même. « Donc le papier d’identité, qui assure cependant seul l’identité de son porteur à lui-même, selon le principe métaphysique d’identité, ne fonctionne, par un étrange renversement, qu’à condition de venir d’ailleurs, de dépendre justement d’un autre que celui qui pourtant y atteste son identité à soi. »19 Le sans-papier est alors formidable car, incapable de dire qu’il est lui-même, il vient perturber le principe d’identité, et révèle par là même la structure scandaleusement métaphysique de la légalité. « Le sans-papiers, dépourvu de cet autre, rend manifeste l’aliénation requise au fondement de l’identité (de soi à soi) telle que la carte d’identité en interprète, d’ailleurs justement et en parfaite cohérence métaphysique, l’absolue nécessité. »20
Quelle étrange analyse ! Que fait en réalité Marion ? Il tente de cerner les conséquences de ce que serait une objectivation de l’homme, c’est-à-dire d’un homme soumis à une description à la troisième personne, donc réduit à quelque chose d’objectivable. Le monde médical transformerait, par cette description à la troisième personne, l’individu en simple corps qu’il convient de manipuler et de la même manière l’administration réduirait l’individu à un statut administratif objectivé par des papiers. L’humanité serait donc bafouée à chaque réduction à son corps ou à ses papiers que subirait l’individu. Le problème, c’est que ces analyses sont, lorsqu’on y regarde de plus près, absolument fausses. Ce que critique Marion, si on le suit bien, c’est l’idée selon laquelle, pour l’administration, l’individu est réductible à ce qu’il peut objectiver de lui-même par l’intermédiaire de ses papiers. Cela est sans doute vrai ; mais ce qu’il confond allègrement, ce sont la citoyenneté et l’humanité. Ce que manque de manière très générale Marion, c’est le « en tant que » : lorsque je vais à l’hôpital, j’y vais en tant que malade ; de la même manière, exhiber mes papiers n’est possible qu’en tant que citoyen. Cela ne signifie pas que mon humanité se réduise à ma maladie, ni que l’humanité ne se réduise à la citoyenneté, cela signifie simplement que dans certaines circonstances, j’entre en relation avec autrui par l’intermédiaire de médiations : il y a une croyance naïve chez Marion consistant à dire que, quelles que soient les circonstances, je devrais imposer à autrui, par mon apparition même, l’exigence de mon humanité. Mais dire cela, c’est complètement oublier le fait que l’on se présente toujours à autrui sous des médiations, et l’erreur consiste à croire que ces médiations sont des réductions de l’humanité.
De ce fait, son analyse du principe d’identité est intrinsèquement erratique : lorsque je présente mes papiers, je brise précisément le principe d’identité au lieu de le conforter ; il n’y aurait identité que si je présentais ces papiers comme étant ce que je suis, comme étant le plus profond de mon humanité ; or, au contraire, présenter ses papiers, c’est justement médiatiser son rapport à autrui par celui de la citoyenneté, ou de la régularité. Cela est vrai aussi bien du point de vue de celui qui présente ses papiers que du point de celui qui les demande. Le policier ne demande pas si je suis humain, mais si je suis citoyen. Ce que révèle cette erreur, c’est un paradoxe violent mais récurrent dans certains discours : c’est ce paradoxe voulant finalement que l’on ne soit pleinement humain que lorsqu’on est régularisé. Le véritable principe d’identité, c’est celui qui anime le défenseur des sans-papiers, c’est celui qui considère que, tant que les papiers n’ont pas été accordés, l’individu n’est pas pleinement humain – sinon il n’y aurait aucune raison de voir de l’inhumanité dans le refus de régulariser de pauvres gens. La ruse du principe d’identité, c’est donc celle qui consiste à faire croire que l’homme n’est pleinement humain que s’il est français, et Marion succombe à cette ruse, au moment même où il croit y échapper « dans l’exacte mesure » où il ne voit pas que le principe d’identité consiste à associer le papier à l’humanité même.
C : Dieu, derechef
On ne saurait clore l’analyse de ce livre sans évoquer la manière dont Marion introduit Dieu au sein de ses analyses. Là encore, on y trouve des choses troublantes, des remarques pour le moins étonnantes. On se doute bien, dès les premières lignes de l’ouvrage, que s’il est une certitude négative, c’est celle de Dieu ; je ne peux objectiver ce dernier, mais il demeure une certitude. Il va donc falloir exposer l’existence d’une entité dont on ne peut rien dire, et c’est le rôle du § 8 que d’assurer la nécessité de Dieu, tout en ne cessant de dire qu’il ne faut rien en dire. « Dire, ou même vouloir dire « Dieu », suffit déjà à nous faire constater sa caractéristique première, radicale et définitive – l’inaccessibilité. »21 Il y aurait beaucoup à dire dans cette façon de procéder, puisque caractériser une entité par son inaccessibilité consiste à poser d’emblée son existence, sans même la démontrer. Mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus ennuyeux ; le plus grave me semble être l’usage qui est fait de Descartes et, plus précisément, de l’infini. Je n’ai pas d’intuition de Dieu, nous dit Marion, ce qui veut dire que, si Dieu existe, il excède la phénoménalité ; pourquoi pas. Mais Marion va beaucoup plus loin : « Et puisque l’on peut aller jusqu’à appliquer la finitude à l’être lui-même, comment ne pas conclure que Dieu doit faire exception aux normes de la finitude, et que, surtout, cette exception elle-même constitue encore une manière d’expérience – une expérience impraticable selon les normes de la finitude, ce qui, dans ce cas seulement, pourrait mériter le titre de Dieu et, une fois retraduit en termes épistémologiques, s’énoncerait ainsi : si l’incompréhensibilité atteste l’impossibilité de phénoménaliser l’infini, elle postule encore, certes, sur un mode négatif, une expérience positive de l’infini. »22
Il convient de prendre la mesure de ce qui se produit dans le passage précédent ; du fait même que la phénoménalité obéisse à des conditions finies, que Dieu ne se phénoménalise pas, Marion en déduit que Dieu est infini. En d’autres termes, le fait même que je n’intuitionne pas Dieu prouve que ce dernier est infini, ce qui est un choix interprétatif asséné, et jamais démontré. En somme, je n’intuitionne pas l’infini, je ne sais même pas ce que c’est, mais au lieu d’en déduire qu’il n’y a que du fini, j’en déduis que je sais que Dieu est infini, et la meilleure preuve de cela est le fait que Dieu n’apparaît pas. Cette thèse peut être défendue, certes, mais encore faudrait-il la justifier, et non la présenter comme une démonstration.
Le même coup est rejoué dans le paragraphe suivant : ma raison ne comprend que ce qui est possible, or ma raison ne comprend pas Dieu, donc Dieu est l’impossibilité même. Comment donc cerner Dieu ? « Précisément en le reconnaissant comme le privilège de Dieu – car lui, et lui seul, se laisse définir par l’impossibilité elle-même. »23 Cette démarche est philosophiquement scandaleuse ; le problème n’est pas tant de définir Dieu comme infini ou comme l’impossibilité que de poser une gigantesque pétition de principe, consistant à admettre ce qui fait justement problème sans jamais le démontrer. Plus précisément, si l’on affirme que l’intuition concerne le fini, en réalité on admet d’emblée l’existence de l’infini car, comme le faisait remarquer à très juste titre Hegel, on ne peut parler de fini que si l’on sait que le domaine est fini, et que donc on a vu les bornes de la finitude, ce qui revient à admettre implicitement qu’il y a quelque chose au-delà du fini. Poser le domaine phénoménal comme fini, c’est d’emblée admettre l’infini et c’est produire une gigantesque pétition de principe qu’on espérait définitivement ruinée depuis Hegel.
Conclusion
Le reste du livre est assez classique du point de vue marionesque puisque sont rappelés les principes comme la donation ou la saturation, et il est inutile d’y insister. On trouve néanmoins, à de très fréquentes reprises, d’étonnantes analyses. Celle de la naissance, par exemple, est inintelligible ; Marion la décrit comme un événement, précisément parce qu’elle ne serait pas objectivable pour moi. « Ma naissance me donne à moi-même. Je suis le seul qui en provienne, mais à condition de rester le seul à ne pas la voir. »24 La naissance n’étant pas un objet, elle n’aurait pas été appréciée à sa juste valeur du point de vue philosophique, et Marion déplore le fait que la phénoménologie en ait si peu parlé ; mais ce qu’il ne voit pas, c’est qu’il n’est même pas certain que la naissance soit un phénomène selon sa propre description, puisqu’elle n’est pas visible pour celui qui la vit. Le problème n’est donc pas son statut d’objectité, mais son statut de phénoménalité !
Une autre analyse étonnante porte également sur la naissance, dont Marion veut révéler la profondeur événementielle, ce qui suppose une occultation du donateur afin que l’événement soit pur. Pour ce faire, il faut que la maternité devienne accidentelle ou, pour le dire plus clairement, que la mère disparaisse ; et comment faire disparaître la mère du don de la naissance ? Le donateur peut disparaître puisque, écrit Marion, on peut accoucher « sous X, etc. »25 Mais quel est le sens de cet argument ? Depuis quand une possibilité positive et juridique révèle-t-elle la structure intime de la phénoménalité ? Cela ne se comprend guère.
Si l’édition française n’était pas dans l’état qui est le sien, on se dirait que certains auteurs écrivent des livres alimentaires comme l’on tourne des films à la va-vite pour payer ses impôts ; mais cette excuse ne peut même pas être invoquée dans le cas présent, compte-tenu des chiffres de vente de l’ouvrage et de la rémunération qu’apporte celui-ci à l’auteur. Alors, pourquoi ?
- pour un compte-rendu laudatif, on se réfèrera à Henri de Monvallier, https://actu-philosophia.com/spip.php?article66 et pour une critique plus sévère, on lira avec profit les analyses de Maxence Caron dans Pages. Le sens, la musique et les mots, Séguier, 2009, pp. 176-179
- Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, Grasset, Paris, 2010
- Jean-Luc Marion, Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, PUF, coll. Epiméthée, 1998², p. 13
- Je souligne.
- Ibid., p. 164
- Je souligne.
- Marion, Certitudes négatives, p. 230
- Ibid. p. 245
- Ibid. p. 318
- Ibid. p. 204
- Ibid. p. 209
- Ibid. p. 213
- Ibid. p. 13
- Ibid. p. 17
- cf. une présentation du débat à l’adresse suivante : https://actu-philosophia.com/spip.php?article102
- Ibid. p. 41
- Ibid.
- Ibid. pp. 60-61
- Ibid. p. 61
- Ibid. p. 62
- Ibid. p. 87
- Ibid. p. 94-95
- Ibid. p. 100
- Ibid. p. 294
- Ibid. p. 298








