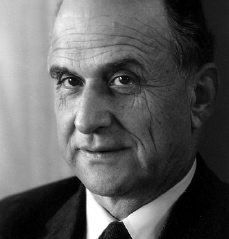Les éditions Vrin ont créé il y a peu une nouvelle collection, « essais d’art et de philosophie », qui a vocation à penser le lien presque consubstantiel qui unit la philosophie et l’art ; placée sous la très compétente direction de Jacqueline Lichtenstein, cette collection se propose donc de faire le point sur un certain nombre de débats qui agitent la philosophie de l’art, dont celui du naturalisme et du conventionnalisme dont traite Laure Blanc-Benon dans La question du réalisme en peinture1. Le problème que charrie cet ouvrage est qu’il soulève une certaine ambiguïté quant à l’intitulé de la collection dans laquelle il s’inscrit ; il s’agit d’à peu près tout sauf d’un essai. En effet, Laure Blanc-Benon dresse plutôt un état des lieux assez scolaire des débats autour de la ressemblance picturale, de Goodman et Gombrich, sans que la thèse défendue ne constitue une matière suffisante pour que l’on puisse parler au sens propre d’un « essai » : il s’agit plutôt d’une initiation à la question du conventionnalisme, initiation qui serait certes parcourue par une thèse récurrente, mais qui ne me semble pas suffisamment forte pour constituer un essai.
A : Distinguer l’image de la peinture : une évidence ?
Comme je l’ai dit en introduction, Laure Blanc-Benon défend une thèse dans son ouvrage, qui peut ainsi être résumée : la querelle entre naturalisme et conventionnalisme est stérile et appelle son propre dépassement, car toute œuvre picturale contient à la fois une part de nature et une part de convention. Le naturalisme se trouve défini comme le fait de voir dans le tableau une reproduction de la réalité sensible, en oubliant la dimension précisément matérielle de la toile. Le conventionnalisme sera au contraire la thèse consistant à dire que toute reconnaissance d’image ne procède pas d’une reconnaissance de la nature mais d’un acte codé, acquis par convention, faisant voir un visage là où il n’y a que quelques coups de pinceau ; ainsi, le naturalisme oublierait précisément le caractère peint du tableau, tandis que le conventionnalisme oublierait la représentation imagée de la toile. Selon la thèse de l’auteur, « toute toile est abstraite et figurative parce qu’elle est toujours à la fois image et peinture. La théorie de la représentation picturale que je défends permet de considérer que le degré de réalisme d’une toile est lié à l’équilibre entre son pôle « image » et son pôle « peinture ». »2 Concrètement, cela revient à dire que toute œuvre peinte prétend produire une image, mais que cette prétention à l’image ne dispense pas de l’élaboration picturale de l’image.
Il serait excessif de voir en cette thèse une quelconque originalité ; d’ailleurs l’auteur le reconnaît puisqu’elle affirme explicitement développer les intuitions de Dominic Lopes, contenues dans Understanding pictures, à tel point que l’ensemble de l’ouvrage constitue presque un commentaire de Lopes, si bien que le concept de « reconnaissance d’aspect » élaboré par ce dernier constituera un moment majeur de l’articulation du livre. Là encore, il est délicat de dire qu’il s’agit d’un essai, tant le texte adhère à des thèses déjà énoncées, déjà débattues, et il est difficile de comprendre en quoi il est question d’autre chose que d’un éclairage sur les débats contemporains concernant le rapport à l’image dans le cadre pictural.

De surcroît, les distinctions qui vont être proposées, quoique certainement valides et opérantes, ne seront pas d’un grand secours tant elles apparaissent comme évidentes et disons même tellement évidentes qu’il devient inutile de les formuler. Ainsi Laure Blanc-Benon distingue-t-elle l’illusion de l’illusionnisme, c’est-à-dire le fait que parfois certains tableaux nous trompent de la prétention qu’ils auraient à nous tromper. Pour le dire clairement, ce n’est pas parce qu’un tableau trompe la vue qu’il prétend nous tromper, ce n’est pas parce qu’il y a illusion qu’il y a illusionnisme car, dans le cas du tableau, nous savons qu’il s’agit justement d’un tableau et donc d’une facticité. « Le trompe-l’œil en peinture ne trompe pas l’œil comme une fenêtre peinte sur une façade peut tromper le passant. Il y a une différence de nature entre le véritable trompe-l’œil et la peinture en trompe-l’œil. En effet, le tableau ne peut être qualifié de parfaitement ressemblant à la réalité que pour autant qu’on voit qu’il s’agit d’un tableau et non de la réalité. »3 Il suffit qu’il y ait un cadre pour que nous sachions que nous n’avons pas affaire à la réalité, mais bien à une représentation factice de cette dernière. La thèse de Laure Blanc-Benon est dès lors claire : « C’est parce qu’on oublie que le tableau est peinture et pas seulement image qu’on crée de faux problèmes. »4 Le problème qui me semble se poser c’est que cette distinction qu’élabore l’auteur est une évidence et que nul ne peut l’oublier ni ne la voir.
B : Un Platon introuvable
Cela étant posé, il faut évidemment que l’auteur étaye sa thèse à l’aide d’une illustration concrète de penseurs qui auraient confondu image et peinture, qui auraient donc pensé concrètement que le tableau prétendait reproduire une nouvelle réalité, sans prendre en compte le fait qu’il s’agissait d’une réalité d’ordre pictural et non d’ordre chosique. Ce penseur, l’auteur croit le trouver en la personne de Platon, lequel aurait confondu image et peinture, et serait tombé dans une confusion un peu absurde. « Nombre d’impasses philosophiques sont dues à l’amalgame suivant : l’abstraction est à la figuration ce que la non-représentation est à la représentation, ou le non-réaliste au réaliste. Mais avant cela, il convient de remonter aux origines de cette assimilation de la représentation de la réalité à l’imitation comme mimésis. »5 La mimésis est donc d’emblée incriminée, et serait coupable de la confusion entre image et peinture. « L’image, écrit Laure Blanc-Benon, n’est ressemblante comme image qu’en étant dissemblante comme chose. Chez Platon, l’existence même des images remet en question l’unicité et l’homogénéité du réel, puisque dans l’image, le réel se duplique en un autre qui lui ressemble. L’unicité de l’Etre, sa singularité ou son isolement, rendent très difficile toute pensée de l’image, de l’altérité, de la ressemblance. »6 Or, cette analyse est extrêmement contestable au moins pour deux raisons : la première est qu’elle fait de Platon un auteur dont la naïveté serait tout de même surprenante et la seconde est qu’il n’est pas certain que ce soit exactement ce que Platon a souhaité montrer.
Dans un premier temps, il n’est pas du tout certain que l’image remette en cause l’unicité du réel : dire cela, ce serait dire que l’image est réelle, alors que c’est précisément cela qui est en jeu : si l’image n’est pas réelle, elle ne remet pas en cause l’unicité du réel. Ensuite, lorsqu’on regarde les propos de Platon sur la notion de simulacre (eidolon), il apparaît clairement qu’il ne vise que le contenu d’une parole ou d’un tableau. Le mensonge par exemple, est décrit comme « l’ignorance en son âme de celui qu’on a trompé. Parce que le mensonge dans les paroles n’est qu’une certaine imitation d’une affection de l’âme, un simulacre qui se produit par la suite, ce n’est pas un mensonge sans mélange. »7 Il est clair, ici, que la manifestation sensible du mensonge – la réalité au sens où l’emploie Laure Blanc-Benon – n’est aucunement en cause ; en revanche, ce que la parole exprime lorsqu’elle est mensongère est factice si bien que la parole, elle, est réelle, mais son contenu ne correspond à rien dans l’ordre de la Réalité. De la même manière, le célèbre passage du livre X de la République ne dit pas que l’apparence sensible du menuisier est une illusion, il regrette que la représentation du menuisier ne dise rien de l’art du menuisier. « C’est ainsi par exemple, que nous dirons que le peintre peut nous peindre un cordonnier, un menuisier, et tous les autres artisans, sans rien maîtriser de leur art. »8 Que veut dire ici Platon ? Il ne veut en aucun cas dire que ce que peint le peintre est, du point de vue sensible, irréel ; il veut dire que le contenu de sa peinture est doublement éloigné de l’idée de la menuiserie. Par conséquent, il me semble que la critique de Laure Blanc-Benon ne porte pas contre Platon, car si l’on suivait le raisonnement de celle-ci, il faudrait croire que dans la reproduction picturale du menuisier, il y aurait une prétention à avoir un autre menuisier ; or ce n’est pas absolument pas ce qui est en jeu, puisque Platon ne s’intéresse qu’à l’art du menuisier et donc à la capacité d’une peinture à exprimer une idée. Pour le dire clairement, Laure Blanc-Benon travestit le texte de Platon en faisant croire que l’image est dévaluée au prétexte qu’elle est ontologiquement incapable de ressembler parfaitement au modèle qu’elle reproduit ; or, présentées ainsi, les choses sont biaisées car elles font croire que Platon évoque une ressemblance formelle : en réalité, ce que Platon pointe comme problème fondamental de la peinture, c’est sa radicale inaptitude à transposer non pas la forme mais le contenu du menuisier, du cordonnier ou des artisans, c’est-à-dire leur art. Savoir dessiner un cordonnier ne signifie pas une maîtrise de l’art de la cordonnerie. Si donc il y a une idée de la cordonnerie, le cordonnier en est une première dégradation sensible, de même que la représentation du cordonnier en est une seconde matérielle.
Soyons clair sur ce point qui est crucial et qui constitue hélas l’occasion de très nombreux contresens : si je vois un cordonnier, comment puis-je reconnaître le fait qu’il s’agit effectivement d’un cordonnier ? Cela n’est possible que si j’ai une idée de ce qu’est l’art du cordonnier, et un certain nombre d’éléments identifiés à son art me permettent de reconnaître qu’il est question d’un cordonnier ; la peinture constitue alors un simulacre car elle représente un art qu’elle ne maîtrise pas : c’est là que se trouve la condamnation de la peinture, et non dans le fait qu’elle ne reproduirait de manière sensible qu’imparfaitement son modèle. Comme le dit admirablement Stanley Rosen dans un bel ouvrage dont j’avais rendu compte ici même9, si je reconnais la vache, c’est parce que j’ai l’eidos de la vache qui préexiste en moi : il en va de même pour le cordonnier que je ne peux reconnaître que si, en moi, se trouve son eidos, lequel s’identifie à son art qui ne peut être reproduit par la peinture.
Résumons-nous parce que la question est d’importance : Laure Blanc-Benon croit que Platon confond image et peinture, qu’il refuse la peinture parce que celle-ci aurait la prétention de reproduire la réalité sensible et y échouerait ; et, dit l’auteur, si Platon avait distingué image et peinture, il aurait compris qu’il n’y avait pas que la question de l’image ou de la mimésis, mais qu’il y avait aussi la question de la peinture au sein du tableau. « En assimilant la production de l’image ressemblante à l’image dans un miroir, Platon passe sciemment sous silence toute la part de technique du dessin et de la couleur nécessaires à la production d’une image peinte. »10 C’est vraiment prendre Platon pour un naïf désarçonnant que d’oser écrire de telles choses ; le problème est tout simplement que l’auteur ne comprend pas ce que Platon condamne : elle croit lire une condamnation de l’incapacité de la peinture à reproduire le monde sensible tel qu’il est, alors que Platon condamne l’incapacité de la peinture à reproduire l’eidos des choses ; cela ne signifie pas que Platon confonde peinture et image, ni et encore moins qu’il pense que la représentation d’un cordonnier prétende reproduire à l’identique un cordonnier, mais cela signifie qu’aux yeux de Platon, la peinture manque l’eidos, l’art du cordonnier, et non son aspect matériel. De ce fait, la prétendue confusion entre illusion née de l’image et illusionnisme n’existe que dans l’esprit de l’auteur : ce que refuse Platon, ce n’est pas la prétention du tableau à représenter l’artisan, c’est la prétention du tableau à représenter l’art de l’artisan ce qui supposerait un mensonge énorme, à savoir qu’il existât un peintre qui maîtrisât l’ensemble des arts. « Quand quelqu’un vient nous annoncer, écrit Platon, qu’il est tombé sur une personne qui possède la connaissance de toutes les techniques artisanales et qui est au courant de toutes les détails concernant chacune, un homme qui possède une connaissance telle qu’il ne connaît rien avec moins de précision que n’importe quel expert, il faut lui rétorquer qu’il est naïf et qu’apparemment il est tombé sur un enchanteur ou quelque imitateur (…). »11 On ne saurait être plus clair.
On peut donc dire que Laure Blanc-Benon identifie une thèse qui n’existe pas : personne ne confond la peinture et l’image, et surtout pas Platon ; il est vrai que ce dernier condamne davantage l’image que la peinture, mais sa condamnation ne repose en aucun cas sur la confusion de l’image et de la peinture. Cela hypothèque d’emblée la démarche générale de l’ouvrage : à vouloir démontrer une thèse évidente que nul n’a jamais contestée, l’auteur se condamne à s’inventer des adversaires philosophiques qui sont le produit de sa démarche et non des personnages réels. Mais, bien pire encore, cela occulte de vraies questions qui auraient dû être les siennes et qui sont finalement laissées de côté ; ainsi, il aurait fallu se demander pourquoi lorsque nous sommes face à un dessin de Rockwell il nous est difficile de nous dire que nous ne sommes pas face à une photographie. Je sais bien que je ne suis pas face à une réalité sensible immédiate, mais comment dire que je ne suis pas face, au moins, à une photographie, donc à une certaine imitation fidèle du réel ? La distinction entre peinture et image, ou entre illusion et illusionnisme est en fait tellement évidente qu’elle ne résout rien ou, plutôt, résout des questions qui ne se posent pas.
C : Dépasser l’opposition de la nature et de la convention
La méthode consistant à faire passer une banalité pour une thèse forte va se retrouver dans le traitement de Goodman et Gombrich ; l’auteur va montrer qu’il faut prévenir à la fois l’excès de conventionnalisme et l’excès de naturalisme, ce qui, là encore, est une évidence. On ne peut pas comprendre une œuvre à partir de la seule convention ou du seul illusionnisme, et dire cela ne constitue pas une thèse réelle ; c’est au mieux un prétexte pour aborder la pensée de Gombrich et Goodman, ce que d’ailleurs l’auteur accomplit avec un bonheur certain, notamment en établissant de précieuses distinctions : « Pour Gombrich comme pour Goodman, créer l’illusion demande beaucoup d’artifices, de procédés, et n’a rien d’immédiatement naturel. Le naturel et l’illusion sont atteints au prix de maints détours. Mais là où Gombrich s’écarte de Goodman, c’est lorsqu’il considère que s’il y a toujours une multitude de façons de représenter quelque chose de façon plus ou moins ressemblante, il n’y en a qu’une qui suscite chez le spectateur le jugement unanime d’une ressemblance parfaite. »12 Toute la partie intitulée « une approche symbolique de la représentation » constitue ainsi une excellente introduction à la pensée de Goodman, dont finalement tout l’ouvrage constitue une discussion. Et toute la thèse de l’auteur, inlassablement répétée, consistera à prendre acte d’une nécessaire constitution conventionnelle du tableau, tout en refusant de réduire celui-ci à un pur conventionnalisme. « Nous voudrions montrer que la ressemblance est certes relative au système symbolique employé, mais que la représentation réaliste n’est pas une simple affaire de convention. »13 Bref Laurent Blanc-Benon est goodmanienne mais pas trop.
A partir de ce constat, toutes les thèses posées par l’auteur consisteront à sauver la convention tout en expliquant que la convention n’épuise pas l’œuvre : or, si la convention n’épuise pas l’œuvre, c’est donc que se joue quelque chose dans le regard du spectateur et dans le tableau lui-même. La première conséquence est ainsi exprimée : « A ce stade de notre enquête, nous pourrions soutenir la thèse suivante : si les images sont des symboles, la référence de ces symboles dépend de l’exercice de certaines aptitudes perceptives chez le spectateur. »14 Le spectateur est donc sollicité pour recréer l’illusion à laquelle convie le tableau, sans que cette illusion n’ait une quelconque prétention à la vérité. La position du spectateur sera, elle aussi, primordiale pour l’exercice, puisque l’illusion ne naîtra que de l’impression d’ensemble, donc d’un certain éloignement à l’égard de la toile : « c’est en opposant vision de loin et vision de près (et non pas nature et convention ou bien abstraction et figuration) que l’on parvient le plus adéquatement à penser le réalisme en peinture, qui est autant une affaire de toucher (…) qu’une affaire de vision. »15
Mais en même temps, si le réalisme doit surgir dans le tableau lui-même, et non seulement dans le regard, alors il faut supposer que l’artifice pictural est sollicité : la peinture elle-même met en jeu l’illusion réaliste, c’est-à-dire qu’au-delà de l’illusion iconique se joue une illusion picturale, pigmentée, qui participe de l’illusion réaliste. C’est le sens du dernier chapitre dans lequel l’auteur combine, à l’aide d’une étude d’artistes contemporains, l’illusion mimétique et l’illusion picturale. « Dans ce dernier chapitre, nous avons voulu défendre l’idée d’un réalisme de peinture contre le seul réalisme d’image (…). »16 Soit ; mais est-ce véritablement une thèse à proprement parler ? Là encore, nous sommes reconduits à la distinction initiale entre peinture et image, laquelle serait dans la philosophe de l’art l’analogue de l’Etre dans la métaphysique selon Heidegger : dans les deux cas, ce seraient les victimes d’un oubli. Mais, ainsi que j’espère l’avoir montré, nul n’a oublié la distinction entre peinture et image et cela donne une impression cervantesque de lutte contre les moulins. Evidemment, « la double dimension image / peinture est constitutive de tout tableau qui ne se veut pas une simple image trompeuse telle que la dénonçait Platon. »17 Mais qu’y a-t-il ici de véritablement original ?
D : Un cadre immanentiste inapproprié
Je crois finalement que le problème de ce livre réside dans son cadre référentiel : il n’envisage comme modèle à imiter que des modèles sensibles, et immédiatement sensibles, ce que suppose d’ailleurs l’étude des ressemblances. Bref, il n’envisage qu’un gigantesque plan d’immanence, au sein duquel le réalisme consisterait à reproduire certains éléments. C’est ce plan d’immanence qui entrave la réflexion de l’auteur et qui lui fait manquer, à mon sens, la question platonicienne qui consiste précisément à condamner la peinture, non pas au nom d’une incapacité à reproduire fidèlement un élément immanent, mais bien plutôt son incapacité à reproduire la transcendance de l’eidos dont l’auto-manifestation se trouve interdite au sein du cadre pictural. De la même manière, pourquoi l’auteur prend-elle tant de soin à distinguer la peinture de l’image ? Parce qu’au sein d’un plan d’immanence, il est vrai qu’une telle distinction ne va plus de soi ; mais, non seulement il suffirait de changer de cadre implicite pour retrouver l’évidence de la distinction, mais, de surcroît, au regard de la tradition picturale, la distinction est absolument évidente, car la transcendance va de soi, si bien qu’il me semble que le cadre retenu pour traiter la question du réalisme en peinture est tout simplement inadéquat. Il amène à problématiser ce qui ne pose pas problème, à retrouver par de laborieuses distinctions des évidences basiques, et manque finalement l’essentiel des questions inhérentes au réalisme.
A cet égard, la discussion de la perspective selon Gombrich est éclairante : « Toute la difficulté, écrit cette dernière, consiste donc à nier le fait que le caractère réaliste de la représentation en perspective soit uniquement une affaire d’habitude sans tomber dans une conception qui fait appel à l’identité de deux types de perception, celle du tableau et celle du monde extérieur. »18 En clair, la perspective n’est pas uniquement affaire de convention, mais dire cela ne doit pas nous faire croire que la perspective reproduit la perception du monde extérieur. Mais dire cela, c’est encore une fois énoncer une évidence : analytiquement, l’auteur nous dit que si la perspective linéaire est justifiée, elle n’en est pas pour autant identique à une perception habituelle. Mais qui pourrait soutenir l’inverse de manière raisonnable ? Le problème du réalisme perspectif n’est en fait pas abordé : la vraie question est de comprendre pourquoi ce système, quoique conventionnel, est plus adapté que d’autres ; et s’il faut savoir gré à l’auteur de poser la question, il faut aussi s’étonner de la totale absence de réponse. Tout se passe comme si la question basique constituait l’aboutissement du raisonnement, alors qu’elle devrait en être le point de départ. Et s’il en est ainsi, c’est une fois de plus en raison du plan d’immanence que retient l’auteur : il est très difficile, dans un tel plan, d’établir ce qui relève de la convention culturelle fabriquant le regard, et d’en distinguer ce qui relève de la naturalité du regard, précisément parce que l’immanence écrase l’ensemble sous la seule idée de regard ; raisonner dans ce type de cadres amène donc à s’enfermer dans de faux problèmes, et à redécouvrir des évidences présentées comme le résultat d’un long travail.
On peut même aller plus loin : les problèmes de ressemblance dont traite l’auteur, loin d’être des problèmes philosophiques nés d’une réflexion sur le réalisme, ne sont jamais que les difficultés inhérentes à un système aplani où toute extériorité apparaît finalement comme problématique ; les questions de ressemblance, omniprésentes, reviennent à penser la possibilité d’un renvoi d’une œuvre à un objet au sein d’un même champ, ce qui suppose d’établir des distinctions au sein du champ alors même que le champ a pour ambition d’aplanir les distinctions. L’effort fourni pour arriver à la distinction entre peinture et image apparaît ainsi démesuré compte tenu de l’importance de la distinction qui, dans un autre cadre, eût été évidente. Le problème dont traite l’auteur me paraît donc être, en fin de compte, bien moins le problème du réalisme en tant que tel, que celui des difficultés abyssales que soulève l’introduction d’un cadre immanentiste, lequel génère en effet des problèmes qui n’ont de sens que pour lui et non dans l’art en général. La question de la ressemblance, à cet égard, n’est pas le problème du réalisme, il est celui du plan d’immanence : deux choses ne se ressemblent que si elles appartiennent à un même champ, si bien que l’immanence du champ est la condition de possibilité du problème de la ressemblance ; je crois profondément que c’est cela qui biaise intégralement la démarche de l’auteur qui ne comprend pas la dimension extrêmement régionale de ses interrogations, et qui croit y voir une interrogation universelle. Ainsi, la question de la ressemblance ne peut être celle de Platon, par exemple, en tout cas pas au sens d’une ressemblance visuelle et sensible, précisément parce que Platon ne raisonne pas en termes immanentistes. En régime platonicien, la ressemblance est un non-problème précisément parce que la peinture n’est pas une simple copie sensible d’un modèle sensible ou, plutôt, l’échec même de la peinture platonicienne provient du fait qu’elle en reste à la ressemblance alors que l’auteur croit Platon incapable de penser la ressemblance. Il y a une erreur de diagnostic absolue sur la ressemblance, qui gouverne cet ouvrage et qui est ainsi exprimée : « L’unicité de l’Etre, sa singularité ou son isolement, rendent très difficile toute pensée de l’image, de l’altérité, de la ressemblance. »19 Cela est absolument contestable : la ressemblance n’a précisément de sens qu’au sein de l’univocité de l’Etre, dans un domaine où tout être est comparable à tous les autres, et c’est parce que l’auteur raisonne dans cette univocité immanentiste qu’elle soulève la question de la ressemblance, tout en croyant à tort introduire de l’altérité et de l’équivocité.
Conclusion
On peut donc se demander pourquoi tant d’efforts ont été déployés pour retrouver des questions extrêmement basiques qui avaient déjà été formulées ; par ailleurs, on peut se demander en quel sens il est ici question d’un essai, étant donné que toutes les thèses défendues – en fait, il n’y en a qu’une : le débat entre convention et naturalisme est un faux problème, il faut en revenir à la distinction entre peinture et image –, sont pratiquement évidentes par elles-mêmes et ne constituent en rien des réponses aux problèmes que pose le réalisme. Là où l’ouvrage est nettement plus convaincant, c’est dans sa présentation – très scolaire – de thèses de philosophies de l’art contemporaines : Goodman bien sûr, mais aussi Lopes, Wollheim, Willats, et Evans. Cela constitue donc un vade mecum utile pour aborder certaines problématiques contemporaines tournant autour de la ressemblance, des critères d’identification et de l’aspect. En somme, le lecteur y trouvera bien plus un manuel qu’un essai, ce qui est d’ailleurs confirmé par les très longues et très nombreuses citations qui jalonnent le texte.
- Laure Blanc-Benon, La question du réalisme en peinture. Approches contemporaines, Vrin, 2009
- Ibid. p. 18
- Ibid. p. 23
- Ibid. p. 26
- Ibid. p. 35
- Ibid. p. 37
- Platon, République, 382b-c, Traduction Georges Leroux, GF, 2002, p. 160
- Ibid., 598b-c, p. 486
- cf. https://actu-philosophia.com/spip.php?article113
- Laure Blanc-Benon, op. cit., p. 38
- Platon, République, 598c-d, p. 486
- Ibid., p. 70
- Ibid. p. 125
- Ibid., p. 165
- Ibid. p. 284
- Ibid. p. 347
- Ibid. p. 276
- Ibid. p. 236
- Ibid. p. 37