Anne Devarieux, agrégée, docteure en philosophie, maître de conférence à l’Université de Caen, est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Maine de Biran, dont Maine de Biran, l’individualité persévérante (Jérôme Millon, Grenoble, 2004, 2e éd. 2017). Elle est, de cet auteur, l’une des plus éminentes spécialistes à ce jour. À l’occasion du bi-centenaire que nous célébrons cette année, Anne Devarieux a organisé à Caen un colloque intitulé Maine de Biran dans ses lectures (6 & 7 novembre), dont les actes paraîtront aux éditions Jérôme Millon, en 2026.
Maine de Biran, la force de l’âme : entretien avec Anne Devarieux
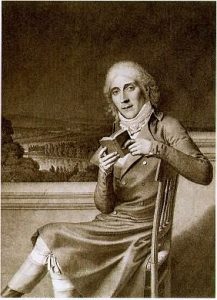
1/ Maine de Biran n’étant pas, même parmi les philosophes de formation, l’auteur le plus lu, j’aimerais commencer par vous poser une question de contextualisation historique. Dans son cours consacré à « l’union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson », Merleau-Ponty s’est longuement arrêté au rapport de Maine de Biran avec ceux qu’ils nommaient « les philosophes du cogito », Descartes en tête bien sûr, mais aussi Malebranche et Kant. Puisque nous allons parler d’âme, de force et d’effort, peut-être serait-il bon de nous y arrêter également, au moins à Descartes. De ce dernier, Maine de Biran écrivait dans son Mémoire sur la décomposition de la pensée qu’il ne lui a manqué « que de lier la pensée à l’action, comme l’existence à la pensée ». On voit bien tout que ce que la formulation peut avoir d’ironique, volontairement ou bien involontairement : il ne manquait à Descartes « que » cela, mais pour Maine de Biran, c’est là l’essentiel. Quelle lecture Maine de Biran a-t-il donc fait de l’auteur des Méditations métaphysiques, et quelle carence constate-t-il dans le cogito cartésien ?
 Permettez-moi d’abord de vous remercier de commémorer à votre façon le bicentenaire de la mort de Maine de Biran (1766-1824). En effet la méconnaissance de Biran, déjà soulignée au XIXe et jusqu’au XX e siècle (cf. un article de Victor Giraud dans la Revue des deux mondes, qui, en 1914, évoque un « philosophe méconnu : Maine de Biran », jusqu’à une (très) récente émission de France Culture à laquelle je participais, qui se demande : pourquoi faut-il lire Maine de Biran ? L’oubli de Biran ou son ignorance (relative quand même aujourd’hui !) est, pour ainsi dire, la chose du monde la mieux partagée, hélas…Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. Premièrement, de son vivant Biran n’a quasi rien publié sinon trois écrits : Influence de l’habitude sur la faculté de penser (1802), un Examen des Leçons de philosophie de M. Laromiguière (1817) et l’Exposition de la doctrine philosophique de Leibniz (1819). Par conséquent l’histoire de sa réception dépend étroitement de celle de ses éditions, biaisées, tronquées : l’édition Victor Cousin (1841), du genevois Ernest Naville (1857) et, avec la collaboration de Marc Debrit, des Œuvres inédites (1859). Celle d’Alexis Bertrand (1887), de Jean-Baptiste Mayjonade, (1896). Enfin l’édition de Pierre Tisserand (1920), presque complète, avant l’édition de référence de François Azouvi chez Vrin (1984-2001). Nous n’avons plus le droit aujourd’hui, par conséquent, d’ignorer la philosophie de Biran ! Deuxièmement, V. Cousin, qui, après la mort de Biran, a reçu de Lainé, exécuteur testamentaire de Biran, la mission d’examiner et de trier ses papiers, l’intronise en père fondateur du spiritualisme (ainsi ensuite de Ravaisson, qui, dans son Rapport, cite à l’envi son article sur Leibniz, sans sembler voir que le philosophe allemand est, pour Biran, le type vrai du spiritualisme, système contraire, comme son opposé, à une vraie science de l’homme, et jusqu’à Bergson). Au XX e siècle, quand la phénoménologie s’en empare, c’est pour l’introniser, cette fois (Michel Henry) comme l’un des fondateurs de la science phénoménologique (avec Descartes et Husserl) ou pour s’attacher quasi exclusivement à la question du corps propre, soit qu’elle identifie purement et simplement ego et corps (M. Henry toujours), soit qu’elle insiste sur la corrélation noético-noématique. Enfin la dernière raison, et non la moindre, tient au style de Biran (injustement décrié par H. Taine), à son écriture variée (outre les écrits « achevés », ses multiples notes de lecture, sa correspondance, et surtout son magnifique journal métaphysique dont il est, avec B. Constant, le fondateur du genre), et difficile : écriture de la redite, de la répétition (« Maine de Biran est l’auteur d’un seul lire, et ce livre il ne l’a jamais écrit », a pu écrire Henri Gouhier) : Biran ressasse, et cette répétition est partie prenante de sa pensée. Mais je ne peux m’appesantir ici sur ce point, pourtant fondamental.
Permettez-moi d’abord de vous remercier de commémorer à votre façon le bicentenaire de la mort de Maine de Biran (1766-1824). En effet la méconnaissance de Biran, déjà soulignée au XIXe et jusqu’au XX e siècle (cf. un article de Victor Giraud dans la Revue des deux mondes, qui, en 1914, évoque un « philosophe méconnu : Maine de Biran », jusqu’à une (très) récente émission de France Culture à laquelle je participais, qui se demande : pourquoi faut-il lire Maine de Biran ? L’oubli de Biran ou son ignorance (relative quand même aujourd’hui !) est, pour ainsi dire, la chose du monde la mieux partagée, hélas…Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. Premièrement, de son vivant Biran n’a quasi rien publié sinon trois écrits : Influence de l’habitude sur la faculté de penser (1802), un Examen des Leçons de philosophie de M. Laromiguière (1817) et l’Exposition de la doctrine philosophique de Leibniz (1819). Par conséquent l’histoire de sa réception dépend étroitement de celle de ses éditions, biaisées, tronquées : l’édition Victor Cousin (1841), du genevois Ernest Naville (1857) et, avec la collaboration de Marc Debrit, des Œuvres inédites (1859). Celle d’Alexis Bertrand (1887), de Jean-Baptiste Mayjonade, (1896). Enfin l’édition de Pierre Tisserand (1920), presque complète, avant l’édition de référence de François Azouvi chez Vrin (1984-2001). Nous n’avons plus le droit aujourd’hui, par conséquent, d’ignorer la philosophie de Biran ! Deuxièmement, V. Cousin, qui, après la mort de Biran, a reçu de Lainé, exécuteur testamentaire de Biran, la mission d’examiner et de trier ses papiers, l’intronise en père fondateur du spiritualisme (ainsi ensuite de Ravaisson, qui, dans son Rapport, cite à l’envi son article sur Leibniz, sans sembler voir que le philosophe allemand est, pour Biran, le type vrai du spiritualisme, système contraire, comme son opposé, à une vraie science de l’homme, et jusqu’à Bergson). Au XX e siècle, quand la phénoménologie s’en empare, c’est pour l’introniser, cette fois (Michel Henry) comme l’un des fondateurs de la science phénoménologique (avec Descartes et Husserl) ou pour s’attacher quasi exclusivement à la question du corps propre, soit qu’elle identifie purement et simplement ego et corps (M. Henry toujours), soit qu’elle insiste sur la corrélation noético-noématique. Enfin la dernière raison, et non la moindre, tient au style de Biran (injustement décrié par H. Taine), à son écriture variée (outre les écrits « achevés », ses multiples notes de lecture, sa correspondance, et surtout son magnifique journal métaphysique dont il est, avec B. Constant, le fondateur du genre), et difficile : écriture de la redite, de la répétition (« Maine de Biran est l’auteur d’un seul lire, et ce livre il ne l’a jamais écrit », a pu écrire Henri Gouhier) : Biran ressasse, et cette répétition est partie prenante de sa pensée. Mais je ne peux m’appesantir ici sur ce point, pourtant fondamental.
J’en viens à Descartes : on peut effectivement (et l’on doit !) commencer par lui, puisque « la philosophie de Descartes doit être considérée comme la véritable doctrine-mère en tant qu’elle tend à donner à la science des principes la seule base qu’elle puisse avoir dans le fait primitif de sens intime », écrit Biran dans l’Essai sur les fondements de la psychologie (1811-1812). Elle représente le vrai commencement, celui de la réflexion, la bonne méthode qui consiste à épouser le point de vue intérieur, sans prendre sur le sujet pensant une « vue du dehors » : la méthode réfléchie dans laquelle la réflexion, loin d’être spéculaire, désigne le repliement de l’individu sur ses propres actes, et sur leur principe : moi. On peut donc dire que le cogito est le seul vrai point de départ, car, en lui, l’exercice réel de la pensée et le sentiment d’existence individuel s’identifient. À ceci près que Biran lui substitue un volo. La « profondeur de cet énoncé » (le cogito), comme l’écrit Biran dans le même texte, tient à ce qu’il souligne qu’exister (pour soi), c’est s’apercevoir ou penser, immédiatement : pour être primitif, le fait de conscience ne se déduit de rien, mais il s’aperçoit intérieurement.
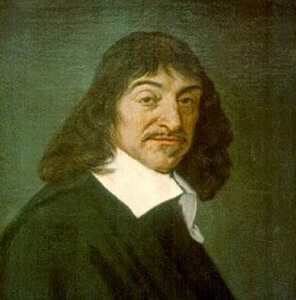 Quelle est alors l’erreur de Descartes ? sinon d’être passé du cogito, – je pense – à l’affirmation : je suis une res cogitans, (une chose pensante) en sortant du fait de conscience pour conclure sur la nature de l’âme comme substance, ou, comme dit Biran, comme réalité absolue. L’originalité de Biran est de congédier les discours sur ce que sont l’âme ou le corps séparément, comme substances séparées, abstraites : je n’ai pas le sentiment de mon âme. La relation primitive est relative, et ce relatif est le seul « absolu » dont les termes sont « distincts non séparés (Essai, 176). Biran le résumé très bien : « On m’a reproché que ma théorie tendait à pénétrer jusqu’au mode de l’union de l’âme et du corps, pendant qu’au contraire elle est la première qui ait établi nettement l’insolubilité du problème qui consisterait à déterminer ce mode d’union, puisqu’il faudrait d’abord concevoir séparément dans un point de vue objectif les deux termes du rapport primitif ou du fait de l’existence et voir du dehors comme objet ce qui ne peut être senti qu’intérieurement, comme sujet moi » (Discours lu dans une assemblée philosophique , t. X- 2).
Quelle est alors l’erreur de Descartes ? sinon d’être passé du cogito, – je pense – à l’affirmation : je suis une res cogitans, (une chose pensante) en sortant du fait de conscience pour conclure sur la nature de l’âme comme substance, ou, comme dit Biran, comme réalité absolue. L’originalité de Biran est de congédier les discours sur ce que sont l’âme ou le corps séparément, comme substances séparées, abstraites : je n’ai pas le sentiment de mon âme. La relation primitive est relative, et ce relatif est le seul « absolu » dont les termes sont « distincts non séparés (Essai, 176). Biran le résumé très bien : « On m’a reproché que ma théorie tendait à pénétrer jusqu’au mode de l’union de l’âme et du corps, pendant qu’au contraire elle est la première qui ait établi nettement l’insolubilité du problème qui consisterait à déterminer ce mode d’union, puisqu’il faudrait d’abord concevoir séparément dans un point de vue objectif les deux termes du rapport primitif ou du fait de l’existence et voir du dehors comme objet ce qui ne peut être senti qu’intérieurement, comme sujet moi » (Discours lu dans une assemblée philosophique , t. X- 2).
Le moi relève d’une relation sentie. L’âme n’est pas un objet de connaissance. Comme vous le voyez, le cogito biranien est un héritier du sentiment malebranchiste (de l’âme nous n’avons pas idée mais seulement sentiment intérieur), mais ce sentiment est parfaitement clair, évident : il est notre existence même. Enfin l’effort qui est la tension, le tonos de notre état de veille, va par degrés et le sommeil est une véritable éclipse de la conscience : le moi ne pense pas toujours (ceci dit contre le « dogme » cartésien, dit Biran, selon lequel que l’âme pense toujours) ! Une telle « égoïté substantielle », une telle pensée absolue serait en effet « sans terme, sans objet » (MDP, 74). C’est par ailleurs la critique que Biran adresse aux métaphysiciens allemands, et à Fichte en particulier, de transformer le sentiment relatif en un absolu : l’idéalisme est contenu dans la doctrine cartésienne, comme le ver dans le fruit…
Dans le Mémoire sur la décomposition de la pensée, dont la rédaction permit à Biran de devenir lui-même, de découvrir la dualité primitive, Descartes est déjà regardé comme « le créateur de la méthode pure de réflexion ». Le texte auquel vous vous référez est en effet une note du MDP (p.364) dans laquelle Biran, après avoir rappelé sa critique, souligne que Descartes n’a pas été assez attentif à l’action, à l’effort. Et Biran me semble avoir raison : la volonté est sans doute une faculté maitresse chez Descartes (cf. Article 17 des Passions de l’âme : « celles que je nomme ses actions sont toutes nos volontés, à cause que nous expérimentons qu’elles viennent directement de notre âme, et semblent ne dépendre que d’elle ») et désigne l’action ; mais Biran ici veut dire qu’il n’y a pas de sentiment de notre existence individuelle sans le sentiment de la résistance intérieure du corps propre, sans le « sentiment intérieur continu (je ne dis pas l’idée objective ou l’image) », souligne Biran, de cette co-existence du corps. Toute pensée, par conséquent, est un agir, comme toute action suppose un terme résistant : il n’aura donc manqué a Descartes que de lier la pensée à l’action alors qu’il a superbement, inauguralement, lié l’existence individuelle à la pensée.
2/ Venons-en, si vous le voulez bien, plus directement à la pensée de Maine de Biran lui-même. Dans son Commentaire aux Méditations métaphysiques, l’un des gestes les plus nets de l’auteur est de réintégrer le corps au sein de la sphère d’évidence, en tant que part essentielle de la certitude que je puis avoir de mon être. Et cette réintégration se fait sur le motif bien précis de la modification, ou plutôt du sentiment d’être modifié : « la certitude que j’ai de mon existence n’est pas celle d’un être abstrait, mais d’un individu qui se sent modifié dans un corps étendu, inerte, organisé, sur lequel il agit » (je souligne). Il me semble que nous avons là déjà, en quelques mots, implicite, l’une des premières difficultés de la pensée biranienne. Le moi apparaît en effet comme, si j’ose dire, un sentant senti – par lui-même. Le moi découvre en lui, ou bien plutôt se découvre lui-même être tout à la fois sujet et objet : mon corps est moi, mais il est aussi « cela » sur quoi j’agis, et ce par quoi j’agis. Le sentiment du moi est donc à la fois le sentiment d’une passivité et d’une activité spontanée. La force qui est ma volonté se manifeste ainsi dans ce que Maine de Biran, c’est bien connu, nomme « l’effort », c’est-à-dire précisément une force qui se prouve et qui s’éprouve dans sa rencontre avec un obstacle – hors et dans elle. Une première question, donc, peut-être un peu formelle, et méthodologique. : avec la découverte de ce que Maine de Biran nommera une « dualité primitive », dans l’Essai sur les fondements de la psychologie, où nous situons-nous ? Est-ce une découverte strictement psychologique, ou bien déjà ontologique ?
On est là, en effet, au cœur de la découverte biranienne, souligné par Ricœur, entre autres commentateurs : Biran est le premier à intégrer le corps résistant dans la définition du fait de conscience, à l’intérieur d’une région qui est celle d’une certitude non -représentative : le moi ne se représente pas, ne s’objective pas, ne se met point en images. À ce titre, – et je vous rectifie légèrement, le sentiment du moi ne se prouve pas, il s’éprouve, ne relève pas d’une évidence rationnelle mais de sentiment. Biran lève, nous venons de le voir, en ce sens la distinction (cartésienne) entre entendement et volonté : entendre c’est vouloir, s’il est vrai que la pensée ne s’exerce qu’avec le corps résistant. C’est ainsi qu’il faut lire les très fortes annotations de son commentaire aux Méditations métaphysiques, rédigées vers 1812.
À Descartes écrivant : « …s’il est vrai que je n’ai point de corps, il est vrai aussi que je ne puis ni marcher ni me nourrir », Biran rétorque : « Supposition impossible qu’ainsi je puisse exister et dire moi sans avoir la conscience du corps propre, et que je puisse avoir cette conscience de l’effort si le corps n’existe pas. Je puis bien rêver que je marche pendant que je suis dans le repos du sommeil, mais non pas que j’ai un corps sur lequel ma volonté agit, pendant que ce corps n’existe pas » (p. 36).
Autrement dit le doute qui entache le corps de la seconde Méditation (jusqu’à la sixième non incluse) est pour lui un doute absurde : fermer les yeux, boucher ses oreilles, etc. cela suppose un corps résistant ! « Je fermerai mes yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens. J’effacerai même de mes pensées toutes les images des choses corporelles, ou du moins puisqu’à peine cela se peut-il faire, je les réputerai comme vaines et fausses, et ainsi m’entretenant avec moi-même etc » (Méditation 3è) ». Biran répond : « Pendant qu’on ferme les yeux, qu’on détourne sa pensée des images etc. il est impossible de ne pas avoir la connaissance de son propre corps » (Ibid, p. 33). Si nous retrouvons le corps, celui de l’union, dans la VIème Méditation, seules deux facultés exigent une âme liée au corps (la sensation et l’imagination), et l’âme, comme le corps, sont des substances ! Un grand commentateur de Descartes a pu dire que le doute cartésien sur le corps n’était en réalité soutenu ici par aucune raison, et que Descartes anticiperait la continuité de résistance biranienne…Je suis sceptique ! La métaphysique eût pris une toute autre direction, ajoute Biran, si Descartes avait entrevu l’effort ! Mais il avait, selon lui, « quitté la partie » sur la question de l’union.
Dans la citation que vous donnez, c’est le terme « abstrait » qui importe : l’âme est une notion abstraite tandis que le moi est un sentiment relatif actif, qui nait de la rencontre entre une force et une résistance, soit dans l’action que j’effectue lorsque je veux. La certitude de l’existence de ce corps étendu fait donc la partie essentielle de celle que j’ai de mon être » (Ibid, p. 33)
Alors, faut-il dire, comme vous l’affirmez, que le moi « apparaît …comme, …, un sentant senti – par lui-même, qui se découvrirait « être tout à la fois sujet et objet », et qu’il serait « à la fois le sentiment d’une passivité et d’une activité spontanée » ? Un sentant-senti : la formule a le mérite de dire la corrélation ou l’inséparabilité des termes. Mais précisément on n’a pas affaire à une sensation (comme la sensation de mouvement de Destutt de Tracy) mais à un sentiment actif : celui de puissance, celui de causalité (et non pas une simple sensation musculaire qui pourrait être passivement reçue). Biran devient lui-même en commettant contre l’Idéologie (et le condillacisme qui l’inspire), dont il était d’abord l’adepte, le crime de parricide !
Exister pour soi, penser, c’est agir et trouver dans les organes résistants comme termes du vouloir, le point d’appui nécessaire pour réfléchir sa pensée. Rappelons que la distinction entre les deux termes signifie que la force n’est pas la résistance ; leur inséparabilité signifie qu’il n’y a pas de force sans résistance (celle, docile, du corps propre et celle, absolue, des corps étrangers) et inversement. L’actualisation de cette rencontre est le sentiment de soi. L’identité individuelle repose donc sur les deux termes, et s’il arrive à Biran de dire que le moi est cause, le moi n’est pas le premier terme de la relation.
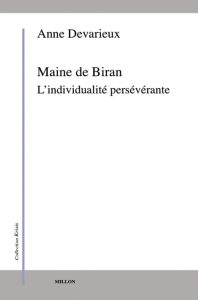 C’est pourquoi, – et je finis de répondre à votre question –, je ne suis pas un « objet pour moi-même » si l’on entend par objet un être extérieur à moi, devant moi : « le sens intime n’a pas d’objet », affirme Biran. Ou encore, son objet dit Biran est « immédiat » (oxymore qu’on trouve chez Malebranche ou Schopenhauer dans des contextes différents). Pour savoir ce que je suis objectivement, il faudrait que je cesse d’être moi ! En ce sens, je ne suis pas mon corps : Michel Henry identifiera ego et corps, ce que Biran ne fait pas, sauf quand il s’agit d’opposer le rapport entre moi et une machine étrangère, et celui entre moi et mon corps ; dans un texte de commentaire de Lelarge de Lignac, il écrit : « La machine étrangère et moi sommes des êtres séparés ; mon corps et moi ne faisons qu’un ; je ne puis le connaître comme objet en tant que j’agis immédiatement sur lui et par lui, comme je ne puis sentir immédiatement le pouvoir médiat que j’ai sur la machine, en tant que je la connais comme un objet différent de moi-même » (T.XI-2, « Notes sur quelques passages de l’Abbé de Lignac », p. 72-73).
C’est pourquoi, – et je finis de répondre à votre question –, je ne suis pas un « objet pour moi-même » si l’on entend par objet un être extérieur à moi, devant moi : « le sens intime n’a pas d’objet », affirme Biran. Ou encore, son objet dit Biran est « immédiat » (oxymore qu’on trouve chez Malebranche ou Schopenhauer dans des contextes différents). Pour savoir ce que je suis objectivement, il faudrait que je cesse d’être moi ! En ce sens, je ne suis pas mon corps : Michel Henry identifiera ego et corps, ce que Biran ne fait pas, sauf quand il s’agit d’opposer le rapport entre moi et une machine étrangère, et celui entre moi et mon corps ; dans un texte de commentaire de Lelarge de Lignac, il écrit : « La machine étrangère et moi sommes des êtres séparés ; mon corps et moi ne faisons qu’un ; je ne puis le connaître comme objet en tant que j’agis immédiatement sur lui et par lui, comme je ne puis sentir immédiatement le pouvoir médiat que j’ai sur la machine, en tant que je la connais comme un objet différent de moi-même » (T.XI-2, « Notes sur quelques passages de l’Abbé de Lignac », p. 72-73).
Agir sur soi n’est pas se représenter, s’imaginer, ou se concevoir objectivement. Enfin, oui mon corps résistant (qui n’est pas le tout de mon corps ! et Biran est très attentif aux conditions physiologiques du fait de l’effort) est ce par quoi j’agis et gagne avec le sentiment de moi, celui des existences étrangères, et ce sur quoi j’agis : en un sens j’agis sur moi et il n’est pas vrai, comme le souligne par ailleurs Biran dans le MDP, en rappelant les objections que Gassendi fait à Descartes, que « rien n’agit sur soi-même ». Je suis un individu, un sujet si vous voulez, et nulle passivité n’intervient ici : l’activité essentielle du moi est l’effort (« volonté » plutôt que spontanéité).
La dernière question que vous posez porte sur la genèse de l’effort qui peut être brièvement résumée comme suit : celui qui a fourni le « canevas » de ses méditations à Biran est Destutt de Tracy dont l’idéologie est, dans l’esprit de son inventeur, le terme qui a pour vocation de venir remplacer le vieux terme de métaphysique qui est une science ténébreuse et, pour tout dire imaginaire, à laquelle il faut substituer l’analyse ou la décomposition de nos idées. Dans son Mémoire sur la faculté de penser, c’est à la « sensation de mouvement », pense Tracy, que nous devons la connaissance de l’existence des corps étrangers. Il rectifie ainsi Condillac qui, dans le Traité des sensations, attribuait ce privilège au seul toucher. Or le même Tracy, peu après, dans les Éléments d’idéologie, rectifiera sa position et affirmera que la volonté doit précéder la sensation de mouvement de telle sorte que nous apprenons l’existence des corps étrangers quand ils font obstacle à notre désir de continuer notre mouvement. Ce qui pourrait, à première vue, satisfaire Biran ne le satisfait pas du tout : car Tracy identifie à tort volonté et désir et fait de la motilité une partie ou une dépendance de la sensibilité….
Biran découvre l’effort, dont il va ensuite formuler deux modalités : la tension générale du corps en masse qui correspond à la veille du moi (Bergson s’en souviendra !) qu’il dit « phénoménal », effort « immanent » ou « inintentionné », et qui nous découvre l’espace intérieur du corps résistant ; et l’effort actif, « exprès », « intentionné » propre à tel ou tel acte qui active les sens : regarder (et non pas voir passivement ), écouter ( et non pas entendre passivement) etc. qui sont des actes d’attention, et jusqu’à la plus haute intensité de l’effort qu’est la réflexion…
Enfin, et je termine ma réponse à votre question, une telle découverte n’est rien moins que celle du principe de la métaphysique, qui s’identifie, en effet, à la psychologie ou métaphysique de l’expérience intérieure. Le sentiment de soi n’est en rien une notion ontologique, si l’on entend par là qu’elle déterminerait ce qu’est l’âme, séparément du corps, « en soi » : le moi s’identifie à la force active car je ne peux douter des actes que je détermine comme moteur. C’est donc en nous qu’il faut puiser (cela dit contre Hume) le sentiment de causalité : nous ne pouvons refuser notre propre action là où elle est, véritablement car nous l’éprouvons ; la force motrice individuelle se réfléchit. Comme le dit Biran : « Nous ne supposons pas, mais nous apercevons immédiatement que notre individualité consiste dans une relation à deux termes qu’il est impossible de concevoir séparés, quoi qu’ils soient donnés distincts dans l’aperception même du moi. Et si de cette distinction réelle entre la force qui agit et le terme inerte qui résiste, nous concluons la possibilité d’une séparation absolue, nous fondons une conclusion hypothétique sur un principe de fait évident. (Ibid, p. 39).
Pour finir, – last but not least ! – la force dite « hyper-organique » relève, comme il le dit dans une précieuse lettre à Ampère, d’une « hypothèse explicative » : c’est dire qu’elle n’est pas spirituelle (de l’esprit séparé du corps nous ne savons rien), ni organique car, selon Biran, aucune hypothèse physiologique (comme métaphysique) ne parvient à dire le fait de conscience. Telle est la force du vouloir, irréductible à toute sensation.
3/ Je me permets ici, par manière d’incise, une question sur un point qui me paraît de première importance, à savoir la double résistance décrite par Maine de Biran, celle « docile » du corps, comme vous le dites, et celle « absolue » des corps étrangers. On voit bien la nécessité, bien sûr, de ce dédoublement : mon corps ne peut pas ne pas résister, en tant que corps, mais il ne peut pas ne pas résister docilement, en tant que mon corps. Mais précisément, comment Maine de Biran pense-t-il le rapport de ces deux cas de résistance ? Y a-t-il continuité, en ce sens que la résistance docile du corps propre serait de même nature que la résistance du monde extérieur mais amoindrie ? Ou bien au contraire y a-t-il rupture, en ce sens que la résistance que m’opposent les corps étrangers serait radicalement étrangère à celle de mon corps ?
Vous posez ici la question du « jugement d’extériorité » à l’occasion duquel Biran développe une position que l’on peut dire réaliste. En deux mots : indépendamment de la résistance intérieure du corps propre, il n’y a pas d’accès possible à celle des corps étrangers. La première est la condition sine qua non de la seconde. Mais, première différence, tandis que la première relève d’un espace intérieur ou d’« une sorte d’étendue », la seconde est livrée par le toucher mobile actif. La critique de Condillac aura joué ici un rôle déterminant. En l’absence de résistance invincible ou absolue des corps étrangers, le moi se prendrait pour l’âme du monde : “Mais s’il n’y avait point de résistance ou de sens musculaire, existerait-il pour nous un objet quelconque ?”. (t. XI-3, p. 214.). Seconde différence : la résistance du corps étranger est une résistance ponctuelle, discrète, celle du corps propre est continue, c’est-à-dire donne simultanément le tout. L’étendue du corps étranger, à l’inverse de celle du corps propre, exige, pour être connue, la succession de mouvements du toucher. Enfin, la résistance extérieure relève d’un jugement immédiat, car elle suppose la résistance intérieure, mais la première est perçue et non sentie. Malgré l’analogie entre les deux résistances, garantes de l’existence pour moi d’un monde, Biran souligne leur essentielle différence : « La différence, à la vérité très notable, qui existe entre ces deux modes d’étendue, c’est que le résistant organique continu est immédiatement perçu dans l’exercice unique du sens interne musculaire, tandis que la résistance étrangère perçue au moyen d’un sens composé (et à double fonction sensitive et motrice) tel que l’attouchement ne peut s’y séparer d’autres impressions qui la compliquent et se confondent avec elles » (MPP, 432). Le moi est non seulement distinct mais bien séparé du corps étranger, dont la résistance ne consent pas au moi ; et il se donne, à l’inverse du monde, dans l’effort seul, en dehors de toute complication sensible. Affirmer la résistance médiate et absolue du monde des corps extérieurs (par opposition à celle relative et docile du corps propre), c’est, pour Biran, identiquement refuser l’existence d’un monde représenté, « spectaculaire », dont seule la distance à moi mesurerait l’extériorité. Le monde en tant qu’il me résiste, n’est pas loin de moi, mais au contraire à portée de moi : Biran n’est le philosophe de la subjectivité que par refus de la posture idéaliste, celle qui ne contemple jamais dans le monde que sa propre pensée. L’existence du monde est aussi indubitable que celle de ma propre existence. Il nomme par conséquent les deux résistances aperception immédiate et aperception médiate, ou bien « aperception immédiate interne » et « aperception immédiate externe ».
Mon existence et les existences étrangères sont par conséquent d’égale certitude : « nous ne sommes, ni plus, ni moins certains de l’existence de notre moi comme sujet de l’effort, que de celle du corps ou du terme, soit organique, soit étranger, résistant au même effort et compris dans son aperception » (T.IV, 156).
4/ Je reviens à la question du moi. Dans le Mémoire sur la décomposition de la pensée, Maine de Biran distingue déjà le moi de l’âme, laquelle il identifie à une « substance ». Mais je voudrais citer un texte plus tardif, le Discours lu dans une société philosophique, où l’auteur articule ces deux notions de la façon suivante : « Ce moi qui n’existe pour lui-même qu’en tant qu’il s’aperçoit n’est point l’âme-substance dont nous croyons l’être absolu, mais bien un mode fondamental de cette substance, le seul sous lequel elle puisse s’apercevoir ou connaître qu’elle existe moi, mode essentiellement distinct de toutes les impressions de la sensibilité, puisque celles-ci se succèdent et varient sans cesse, pendant que le moi reste invariablement le même ». Le moi comme mode d’une substance, on ne peut s’empêcher de songer à Spinoza, quoique sans doute ici la réminiscence soit plus trompeuse qu’éclairante. Pourriez-vous précisément nous dire comment il convient d’entendre la distinction biranienne du moi et de l’âme, tout à la fois au plan de la connaissance (je me sais en tant que moi, mais je crois que je suis une substance), et au plan ontologique ?
Vous posez la question de la problématique évolution de la pensée de Biran, du fameux « tournant » de 1815. Biran développe en effet une théorie de la croyance comme faculté de l’absolu. Autour de 1815, en effet, sous l’influence de son ami Ampère (Correspondance, XIII-1) notamment, Biran s’achemine en effet vers une philosophie qui tente de fonder les existences dans l’absolu, et pose, en adoptant le vocabulaire kantien, des réalités « nouménales » ou êtres en soi (l’âme-substance, le corps-substance, Dieu), que le discours de la maturité nommait, pour les récuser, des « discours ontologiques ». La substance n’est plus synonyme de matière ou de res, mais désigne le substratum qui perdure malgré les changements, ou ce que nous appelons tel « dans l’intervalle de deux aperceptions » (VIII, p. 268). Tandis que l’hypothèse d’une « force virtuelle » comprise comme la force « dans l’attente d’acte » (t. III, p. 418) désignait une notion ontologique « indépendante de toute condition d’exercice » qui n’est pas le moi, la croyance à l’âme substance, irréductible à toute connaissance, est une forme de substantification de la force virtuelle. Alors que la notion de substance naissait d’une réflexion sur le terme passif, et la force d’une réflexion sur le terme actif de l’effort, – Leibniz ayant construit la nature avec la notion de force copiée sur celle du moi, et Descartes le moi avec une notion copiée sur la passivité du corps –, Biran n’oppose plus substance et force, et celle-ci est dite « substantielle ». Cependant, ne connaissant ni l’âme ni la matière, l’âme-substance est l’objet d’une croyance, induite du fait primitif (VIII, p. 85) qui reste premier.
Le texte que vous citez date probablement des années 1814-1815. Biran anime une société philosophique devant laquelle des textes sont lus et discutés. Il énonce, dans les lignes qui précèdent, une des deux difficultés capitales soulevées par les discussions. Il réaffirme qu’il n’est pas ou mal entendu, quand il affirme que le moi est « présent à lui-même comme personne actuelle et non pas comme âme ou comme un substratum extérieur, de qui l’on affirmerait des attributs ou modes conçus ou représentés sans être sentis ou intérieurement aperçus ». S’il emploie par conséquent, dans les lignes précédentes que vous citez, le terme de « mode », et cède en apparence au langage (de la substance) de ses adversaires, c’est pour mieux les contrer car il veut distinguer la permanence du moi (c’est cela le « mode fondamental ») par opposition aux impressions variables diverses de la sensibilité auxquelles on ne peut le réduire.
Il s’agit pour lui de montrer, contre certains (dont Royer Collard) que le moi n’est pas un objet de croyance, puisqu’il relève du sentiment immédiat : « Avant la notion de substance, d’être absolu, est le sentiment du moi individuel et relatif ». Le moi n’est pas l’âme substance avec ses attributs. Il écrit encore : « Je puis avoir le sentiment intime de mon existence et un mot pour exprimer le sujet actuel et permanent de tous les modes variables de ma sensibilité, de mon activité, sans avoir une notion de substance immatérielle, ni aucun mot, tel que celui d’âme, représentatif de cette notion ». Bref, le moi est distinct de ses modes. Et de conclure que toutes « les discussions du spiritualisme et du matérialisme roulent sur cette équivoque entre le moi et l’âme » !
5/ Une question encore sur le sujet de l’âme-substance et du moi : dans ses Quelques explications du magnétisme, Maine de Biran écrit : « il n’est pas impossible que ce soit la même substance, la même force qui agit alternativement, tantôt sur le système musculaire de la vie animale, avec la conscience de son effort, ce qui constitue le moi permanent de l’état de veille, et tantôt sur le système musculaire de la vie organique, ce qui constitue un autre moi ayant un autre système d’idées tout à fait différentes, et relatives à ce qui se passe dans l’intérieur du corps ». Faut-il bien lire, d’abord, que Maine de Biran identifie substance et force ? Comment ensuite comprendre cette hypothèse d’une âme-substance pouvant exister au sein du même individu selon plusieurs modes (plusieurs moi) différents ?
Cette dernière question se rattache, en un sens, à la précédente. Votre citation est extraite des réflexions de Biran sur J.P.F. Deleuze, élève de Puységur, partisan du magnétisme animal, que Biran connait et dont il discute les thèses. Il a lui-même assisté à des expériences magnétiques et le Docteur J.F. Delpit, secrétaire de la Société médicale de Bergerac, que Biran a fondée en 1806, lui donne aussi matière à penser le somnambulisme magnétique, et ses « phénomènes extraordinaires ». Biran est sur cette question très prudent : « Les mystiques, les magnétiseurs connaissent bien quelques moyens propres, en certains cas, à modifier ainsi l’âme ou l’organe, de manière à changer le mode de leur liaison, mais tout cela est encore obscur, sujet à une foule d’incertitudes et d’anomalies » (Journal, I, 120). Une telle obscurité est propre, en effet, à la vie organique, distinguée de la vie de conscience ou vie de relation : nous vivons en effet inconscients de cette vie animale et le moi est à ce titre une « seconde naissance ». L’homme est double, selon la formule que Biran reprend à Boerhaave : homo simplex in vitalitate, duplex in humanitate.
 Dans le cas du somnambulisme magnétique, qu’il s’agit d’expliquer, on pourrait donc, affirme Biran, pour rendre compte des mouvements inconscients du somnambule, supposer une double action de la force (ou de la substance, ou de l’âme ; ici les deux termes sont pris indifféremment au sens de force substantielle agissante) l’une sur le système musculaire de la vie consciente, l’autre sur le système musculaire de la vie organique, tandis que dans la veille, la latitude d’action de la force est le système musculaire de la vie animale consciente. Et à cela il faut ajouter l’influence du désir sympathique du magnétiseur. Une même force ou substance serait à l’œuvre, mais ceci est une hypothèse qui permettrait de rendre compte de l’étrangeté du moi de la veille et de celui du somnambule : l’absence de souvenir justifie, en effet, qu’il n’y a pas identité de personne, « quoi qu’il y ait identité de substance », dans l’hypothèse. On voit bien que Biran ne peut pas rendre compte de tels phénomènes par la seule force « hyperorganique » qui n’a pas d’action possible sur les organes intérieurs de la vie inconsciente, affective. Dans un tel cas de somnambulisme magnétique ici décrit, voilà deux personnes morales séparées et qui pourtant se connaissent et communiquent : Adélaïde et Petite, – le nom donné par la première dans sa « manie » – et la première s’adresse à la seconde comme à une étrangère : le moi de la veille juge l’autre comme il jugerait une personne étrangère, tandis que le moi de la veille n’a aucune idée de celui du somnambule. Bergson s’intéressera de près aux dédoublements de personnalité (Cf. le cas du révérend américain Anselme Bourne, cité par William James, qui ouvre une boutique de confiseries un beau jour, sans garder la souvenir de sa vie passée…mais je ne peux m’appesantir hélas sur ce parallèle). La question essentielle est pour Biran la suivante : dans le somnambulisme magnétique, le magnétisé conserve-t-il son moi ? Comment rendre compte d’un tel pouvoir de suggestion ? Devant le phénomène du magnétisme, Biran tente en effet de rendre compte de la division en faisant l’hypothèse que plusieurs sens internes, étrangers à l’action de l’âme dans la veille ordinaire, obéissent à cette action devenant ainsi des instruments de perceptions et d’ides dans l’état magnétique. Ce qui importe c’est l’analyse selon laquelle c’est au désir sympathique du magnétiseur et non pas à sa volonté que le somnambule se soumet. Enfin, ce qui est remarquable dans la suite du texte, et proprement stupéfiant, c’est qu’une telle réalité pourrait nous conduire directement à l’hypothèse spinoziste, car, en effet : « voilà bien les deux personnes qui se connaissent, se communiquent, savent réciproquement ce qu’elles pensent, n’en sont pas moins deux personnes séparées : et si l’on dit que c’est la même substance âme qui constitue les deux personnes, ou les réunit, je ne vois plus d’absurdité à dire comme Spinoza, qu’il n’y a qu’une seule substance pensante, dont toutes les pensées individuelles séparées ne sont que les modes ou attributs. » Or Biran, on le sait, ne peut faire véritablement sienne cette hypothèse : l’hypothèse d’une substance unique, la même partout, dont nos individualités seraient des modes relève d’un matérialisme de spéculation, ou d’un « système d’unité, gouffre dévorateur de toutes les existences individuelles » (X-2, 221) dont nous pouvons être sauvés, selon Biran, par le principe unitaire de la force. Car les forces sont plurielles.
Dans le cas du somnambulisme magnétique, qu’il s’agit d’expliquer, on pourrait donc, affirme Biran, pour rendre compte des mouvements inconscients du somnambule, supposer une double action de la force (ou de la substance, ou de l’âme ; ici les deux termes sont pris indifféremment au sens de force substantielle agissante) l’une sur le système musculaire de la vie consciente, l’autre sur le système musculaire de la vie organique, tandis que dans la veille, la latitude d’action de la force est le système musculaire de la vie animale consciente. Et à cela il faut ajouter l’influence du désir sympathique du magnétiseur. Une même force ou substance serait à l’œuvre, mais ceci est une hypothèse qui permettrait de rendre compte de l’étrangeté du moi de la veille et de celui du somnambule : l’absence de souvenir justifie, en effet, qu’il n’y a pas identité de personne, « quoi qu’il y ait identité de substance », dans l’hypothèse. On voit bien que Biran ne peut pas rendre compte de tels phénomènes par la seule force « hyperorganique » qui n’a pas d’action possible sur les organes intérieurs de la vie inconsciente, affective. Dans un tel cas de somnambulisme magnétique ici décrit, voilà deux personnes morales séparées et qui pourtant se connaissent et communiquent : Adélaïde et Petite, – le nom donné par la première dans sa « manie » – et la première s’adresse à la seconde comme à une étrangère : le moi de la veille juge l’autre comme il jugerait une personne étrangère, tandis que le moi de la veille n’a aucune idée de celui du somnambule. Bergson s’intéressera de près aux dédoublements de personnalité (Cf. le cas du révérend américain Anselme Bourne, cité par William James, qui ouvre une boutique de confiseries un beau jour, sans garder la souvenir de sa vie passée…mais je ne peux m’appesantir hélas sur ce parallèle). La question essentielle est pour Biran la suivante : dans le somnambulisme magnétique, le magnétisé conserve-t-il son moi ? Comment rendre compte d’un tel pouvoir de suggestion ? Devant le phénomène du magnétisme, Biran tente en effet de rendre compte de la division en faisant l’hypothèse que plusieurs sens internes, étrangers à l’action de l’âme dans la veille ordinaire, obéissent à cette action devenant ainsi des instruments de perceptions et d’ides dans l’état magnétique. Ce qui importe c’est l’analyse selon laquelle c’est au désir sympathique du magnétiseur et non pas à sa volonté que le somnambule se soumet. Enfin, ce qui est remarquable dans la suite du texte, et proprement stupéfiant, c’est qu’une telle réalité pourrait nous conduire directement à l’hypothèse spinoziste, car, en effet : « voilà bien les deux personnes qui se connaissent, se communiquent, savent réciproquement ce qu’elles pensent, n’en sont pas moins deux personnes séparées : et si l’on dit que c’est la même substance âme qui constitue les deux personnes, ou les réunit, je ne vois plus d’absurdité à dire comme Spinoza, qu’il n’y a qu’une seule substance pensante, dont toutes les pensées individuelles séparées ne sont que les modes ou attributs. » Or Biran, on le sait, ne peut faire véritablement sienne cette hypothèse : l’hypothèse d’une substance unique, la même partout, dont nos individualités seraient des modes relève d’un matérialisme de spéculation, ou d’un « système d’unité, gouffre dévorateur de toutes les existences individuelles » (X-2, 221) dont nous pouvons être sauvés, selon Biran, par le principe unitaire de la force. Car les forces sont plurielles.
6/ Il faut en effet poser la question de l’évolution de la pensée de Maine de Biran, et j’aimerais pour terminer rappeler très rapidement les trois étapes que Henri Gouhier distinguait dans son itinéraire philosophique. Je cite Les conversions de Maine de Biran, paru en 1947 : « Trois étapes divisent l’itinéraire de Maine de Biran après la crise du printemps 1804 : 1) la psychologie de l’effort […] ; 2) la théorie de la croyance […] ; 3) la vie de l’esprit sous l’action de la grâce ». La première de ces « conversions » a lieu aux alentours de 1804, la seconde aux alentours de 1813, la dernière aux alentours de 1815. Ces vues de Gouhier vous semblent-elles rendre bien compte de la vie intellectuelle de Maine de Biran ? Et pour conclure, je me permets de citer une question que Gouhier, précisément, se posait à lui-même dans le livre cité, en la posant à son lecteur : « Biran est-il allé plus loin que le biranisme ? » Pourriez-vous en quelques mots essayer d’éclairer d’abord le sens de cette interrogation, et peut-être nous donner votre réponse ?
 Le livre d’Henri Gouhier demeure incontournable, parce qu’indépendamment de ses qualités bien connues d’historien de la philosophie, Gouhier est un des rares commentateurs à vouloir rendre compte de l’évolution de la pensée de Biran qu’il interprète en termes de « conversions ». Il n’y a donc rien, me semble-t-il, à modifier à sa périodisation, mais on peut, peut-être, discuter de ses conversions plurielles. Une autre grande interprétation est celle de Michel Henry, quoi qu’on en pense, qui voit dans cette évolution un approfondissement de la structure de la subjectivité. Ces deux interprétations n’étant par ailleurs pas forcément concurrentes. Personnellement, mais cela n’engage évidemment que moi, c’est la découverte du Biran de la maturité qui a retenu et retient toujours mon attention ; découverte, pour le dire en passant, qui est double : non seulement celle de la dualité primitive interne et de son couple dont les termes sont « distincts non séparés », mais de ce qu’il nomme, après Rousseau notamment, le « sentiment de l’existence » formé par le consensus des affections pures, « illocalisables » hors effort : c’est l’Eurydice de notre vie réfléchie, à nous, Orphées de l’effort ! Notre existence humaine est double, et l’homme, peut-être, scindé, entre deux (sinon trois !) vies. La dernière philosophie de Biran, avec ses étapes, dont la genèse est très passionnante (cf. notamment la correspondance avec Ampère), me semble entachée d’un doute, d’une hésitation fondamentale, qui fait écho à cette dualité humaine qu’on assimile faussement à la dualité primitive. Biran, dans cette dernière étape, ne remet jamais en cause le fait primitif dont il faut, selon lui, toujours partir : l’énigme ou la « difficulté formidable » (Gabriel Tarde) d’être soi, intuition décisive dont il ne cesse de dire qu’elle lui échappe et dont il renouvelle perpétuellement l’étonnement. C’est pourquoi j’aurais tendance à dire que Biran ne s’est jamais converti qu’à lui-même. Une philosophie est toujours plus riche que ses thèses. La phrase, remarquable, de Gouhier adressée sous la forme d’une question, résonne avec les doutes biraniens : Biran est-il allé plus loin que le biranisme ? Cela me semble vouloir dire deux choses. La première est que l’intuition biranienne outrepasse le biranisme mis en thèses, le biranisme « constitué », y compris par Biran lui-même (Biran n’aime guère les « ismes » et ce n’est pas un hasard s’il n’a pas fait école). Les commentaires passés (Barbillion, Paliard, La Valette-Montbrun, Tisserand…), que cite Gouhier, juste avant ce passage, à propos de la dernière conversion, ont trait à l’expérience religieuse, et soulignent l’essentiel inachèvement de sa pensée. On peut par conséquent se demander s’il n’appartient pas à Biran seul de conclure. Mais ce que la question, magnifique, de Gouhier accentue, c’est précisément l’impossibilité de conclure. Nous n’avons par conséquent pas fini d’interroger la pensée de Maine de Biran.
Le livre d’Henri Gouhier demeure incontournable, parce qu’indépendamment de ses qualités bien connues d’historien de la philosophie, Gouhier est un des rares commentateurs à vouloir rendre compte de l’évolution de la pensée de Biran qu’il interprète en termes de « conversions ». Il n’y a donc rien, me semble-t-il, à modifier à sa périodisation, mais on peut, peut-être, discuter de ses conversions plurielles. Une autre grande interprétation est celle de Michel Henry, quoi qu’on en pense, qui voit dans cette évolution un approfondissement de la structure de la subjectivité. Ces deux interprétations n’étant par ailleurs pas forcément concurrentes. Personnellement, mais cela n’engage évidemment que moi, c’est la découverte du Biran de la maturité qui a retenu et retient toujours mon attention ; découverte, pour le dire en passant, qui est double : non seulement celle de la dualité primitive interne et de son couple dont les termes sont « distincts non séparés », mais de ce qu’il nomme, après Rousseau notamment, le « sentiment de l’existence » formé par le consensus des affections pures, « illocalisables » hors effort : c’est l’Eurydice de notre vie réfléchie, à nous, Orphées de l’effort ! Notre existence humaine est double, et l’homme, peut-être, scindé, entre deux (sinon trois !) vies. La dernière philosophie de Biran, avec ses étapes, dont la genèse est très passionnante (cf. notamment la correspondance avec Ampère), me semble entachée d’un doute, d’une hésitation fondamentale, qui fait écho à cette dualité humaine qu’on assimile faussement à la dualité primitive. Biran, dans cette dernière étape, ne remet jamais en cause le fait primitif dont il faut, selon lui, toujours partir : l’énigme ou la « difficulté formidable » (Gabriel Tarde) d’être soi, intuition décisive dont il ne cesse de dire qu’elle lui échappe et dont il renouvelle perpétuellement l’étonnement. C’est pourquoi j’aurais tendance à dire que Biran ne s’est jamais converti qu’à lui-même. Une philosophie est toujours plus riche que ses thèses. La phrase, remarquable, de Gouhier adressée sous la forme d’une question, résonne avec les doutes biraniens : Biran est-il allé plus loin que le biranisme ? Cela me semble vouloir dire deux choses. La première est que l’intuition biranienne outrepasse le biranisme mis en thèses, le biranisme « constitué », y compris par Biran lui-même (Biran n’aime guère les « ismes » et ce n’est pas un hasard s’il n’a pas fait école). Les commentaires passés (Barbillion, Paliard, La Valette-Montbrun, Tisserand…), que cite Gouhier, juste avant ce passage, à propos de la dernière conversion, ont trait à l’expérience religieuse, et soulignent l’essentiel inachèvement de sa pensée. On peut par conséquent se demander s’il n’appartient pas à Biran seul de conclure. Mais ce que la question, magnifique, de Gouhier accentue, c’est précisément l’impossibilité de conclure. Nous n’avons par conséquent pas fini d’interroger la pensée de Maine de Biran.









