Introduction : Question, sens et mathesis (par Jean-Baptiste Fournier)
Il peut ne pas paraître évident, pour le lecteur de Philosophie et demande[1] se prenant au jeu de la construction des différentes dimensions de la nouvelle mathesis dont ce livre ambitieux se met en quête, de saisir le rôle qu’y joue la phénoménologie de la question. Plus généralement, on peut s’étonner que la méthode phénoménologique puisse s’élever au traitement d’objets métaphilosophiques, et redouter, non sans raison, qu’à ce jeu, elle finisse par se perdre. Telles ont été mes premières réactions lorsque j’ai préparé cet entretien : si l’idée même d’une phénoménologie de la question ne me paraissait pas aller de soi, je n’avais pas non plus compris qu’il s’agissait là, en réalité, de la voie d’accès la plus directe aux développements de Philosophie et demande.
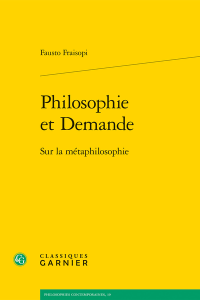 Une des difficultés que pose l’entreprise de Fausto Fraisopi est en effet de comprendre pourquoi la reprise du projet d’une mathesis (encore universalis?) s’impose – et cela d’autant plus que la description du réel que donne l’auteur semble particulièrement peu compatible avec un tel projet, ce que suggère d’ailleurs l’expression hautement paradoxale de « mathesis des instabilités ». C’est précisément pour comprendre la nécessité de la mathesis que le passage par la phénoménologie de la question s’impose et prend tout son sens. La nécessité de la mathesis s’inscrit dans la demande de sens qui surgit dans le sujet confronté à la complexité radicale et inassimilable du réel – la nécessité de la métaphilosophie prend donc sa source dans la très concrète et très existentielle question : « qui/que suis-je ? ». Mais précisément, aborder directement cette question du point de vue métaphilosophique, ce serait risquer de la perdre dans une analyse d’emblée abstraite. Au contraire, la phénoménologie ouvre ici un champ de phénomènes dans lequel se fait jour un certain niveau de sens : non pas le sens déjà constitué, ni même le « sens-se-faisant », mais le sens seulement demandé ou exigé. La sphère du sens non encore fait constitue l’objet propre de la phénoménologie de la question et le fonds phénoménal de la métaphilosophie.
Une des difficultés que pose l’entreprise de Fausto Fraisopi est en effet de comprendre pourquoi la reprise du projet d’une mathesis (encore universalis?) s’impose – et cela d’autant plus que la description du réel que donne l’auteur semble particulièrement peu compatible avec un tel projet, ce que suggère d’ailleurs l’expression hautement paradoxale de « mathesis des instabilités ». C’est précisément pour comprendre la nécessité de la mathesis que le passage par la phénoménologie de la question s’impose et prend tout son sens. La nécessité de la mathesis s’inscrit dans la demande de sens qui surgit dans le sujet confronté à la complexité radicale et inassimilable du réel – la nécessité de la métaphilosophie prend donc sa source dans la très concrète et très existentielle question : « qui/que suis-je ? ». Mais précisément, aborder directement cette question du point de vue métaphilosophique, ce serait risquer de la perdre dans une analyse d’emblée abstraite. Au contraire, la phénoménologie ouvre ici un champ de phénomènes dans lequel se fait jour un certain niveau de sens : non pas le sens déjà constitué, ni même le « sens-se-faisant », mais le sens seulement demandé ou exigé. La sphère du sens non encore fait constitue l’objet propre de la phénoménologie de la question et le fonds phénoménal de la métaphilosophie.
Il est donc particulièrement éclairant d’aborder Philosophie et demande à partir de cette sphère de phénomènes nouvelle, inextricablement liée à la conception du réel comme irréductiblement complexe, et où la nécessité de la mathesis viendra ultimement prendre sens. Or, entre les notions en jeu ici se nouent des relations complexes, et c’est pour dénouer ce nœud que j’ai proposé à Fausto Fraisopi de tirer quelques fils et de l’inviter, à l’occasion de mes questions, à développer quelques points qui me paraissaient essentiels. Dans les pages qui suivent, nous commençons ainsi par aborder de manière très générale l’idée d’une phénoménologie de la question, en prenant ancrage dans le phénomène le plus simple du questionnement : question enfantine, question socratique… J’interroge ensuite Fausto Fraisopi sur le rôle que joue la méthode phénoménologique dans Philosophie et demande, avant d’aborder plus frontalement les problèmes que pose son livre et auxquels la phénoménologie de la question offre une voie d’accès. Nous tâchons ensuite de déterminer la structure du champ ainsi ouvert en nous interrogeant sur le statut insigne de la question première : « qui/que suis-je ? ».
Jean-Baptiste Fournier : Un des apports majeurs de Philosophie et demande est de mettre la question en question – entendons par là, de poser à nouveaux frais et à la lumière de la science et de la philosophie contemporaines la question socratique : de quoi s’enquiert-on lorsqu’on pose une question ? La philosophie doit en un sens commencer par poser la question de la question. Or pour vous, poser une question, ce n’est pas tant interroger l’essence d’une chose ; ce n’est pas tant expliciter ce qui est déjà là en déployant la triade « Gefragte »/« Befragte »/« Erfragte »[2] ; une question se définit plutôt chez vous par rapport à une demande de sens.
Il me semble qu’il y ait là une définition forte de ce qu’est une question, et cela bien au-delà du cadre théorétique dans lequel se déploient vos analyses. Ainsi, si on s’intéresse aux questions enfantines – à la genèse, donc, des questions –, on ne peut que constater le caractère prégnant de la demande de sens qui s’y fait jour. Parce que donner sens, pour l’enfant, c’est se rassurer, se raccrocher à quelque chose, tout comme le bébé qui, à la naissance, demande un regard à sa mère pour s’accrocher à quelque chose, se repérer. Plus tard, l’enfant demande très explicitement du sens en constituant son langage et interrogeant les adultes autour de lui : derrière le « ça s’appelle comment ? » émerge la demande de sens. Ensuite encore, le « pourquoi » remplace les simples questions de dénomination, mais fait toujours fond sur la même exigence de sens, et l’adulte est requis pour y répondre.
Ma première question porte donc sur ce rapport intime entre question et demande de sens, qui me semble être une porte d’entrée très importante dans Philosophie et demande. Ainsi, quel lien voyez-vous exactement entre question, demande, sens et, pourrait-on dire, assurance ? En outre, comment votre propos se situe-t-il par rapport au schéma heideggérien, et plus généralement à ce que pourrait être une phénoménologie de la question ? Enfin, le modèle de la question enfantine vous paraît-il apte à saisir ce qu’il y a d’essentiel dans une question ou faut-il adopter un autre point de vue pour rendre compte du rapport entre question et demande de sens ?
Fausto Fraisopi: Avant de répondre à votre question, il me faudrait davantage développer quelques considérations par rapport
- à la question socratique;
- au fait lui-même de mettre en question la question;
- au cas, peut-être métonymique, de la demande enfantine.
Par rapport au premier point, je voudrais répondre résolument par une réponse négative. Tout simplement parce que je ne sais point quelle est la “question socratique”. Par le fait d’être constamment en confrontation avec, plongé dirais-je dans la culture antique, je ne saurais identifier la question socratique ni l’élever à une sorte de paradigme d’une pensée philosophique en tant que telle. Je pense très modestement que pour arriver à caractériser une telle figure, bien avant d’en faire quoi que ce soit, il faudrait composer – si cela est possible – le Socrate de Platon, de Xénophon et d’Aristophanes, pour ensuite arriver à réduire cette figure multiforme à levier d’une philosophie.
Je serais bien plus intéressé par la saisie de l’évolution de la figure socratique au sein de la philosophie platonicienne, à savoir son rôle modulaire et absolument plastique dans la toute première fondation d’une protè epistème. Mais cela nous amènerait trop loin, mais certainement loin aussi de ce que j’appelle dans le livre un “socratisme vide”[3] qui se fonde sur un motto assez fastidieux: si la métaphysique a procédé aux réponses, il faut occulter la métaphysique pour redécouvrir les questions. C’est trop simple, trop immédiat, une recette finalement rhétorique.
Par rapport au deuxième point, et sans retomber dans un regressus in infinitum, il faudrait sincèrement demander, au point où nous en sommes, c’est-à-dire sur la base de notre culture (aussi philosophique) ce que “mettre en question la question” veut effectivement dire, et le faire en soulignant justement “des nos jours et philosophiquement”. Peut-être va-t-on discuter ensuite d’une telle nécessité et de la nécessité de le faire à partir de la phénoménologie.
Car, en effet, on pourrait tout simplement répéter, ou renouer avec la problématologie de Michel Meyer, qui se définit une science de la question[4]. Mais ce n’est pas le cas ni le but. Pour arriver tout simplement à saisir philosophiquement la question, en tant que telle – car autrement la linguistique nous en donne une définition épistémique bien plus claire – tout d’abord et davantage en tant qu’acte d’un individu orienté à savoir, il fallait, il faudrait la ramener “sur terre”. Cela équivaut à dire qu’il faudrait la soustraire à la fausse abstraction, à l’abstraction essentiellement factice, d’un questionner purement théorique, ou d’un questionnement lequel, pour être tel, n’est que purement théorique, orienté uniquement aux objets célestes que la philosophie de fois en fois reconnaît.
Or, déjà un tel acte de saisie suffirait à relativiser ou à révoquer l’isolement (prétendu sur la base d’une sorte de supériorité ou de dignité) des questions philosophiques ou scientifiques plus abstraites et/ou plus fondamentales. Cela arriverait à re-inscrire l’acte de questionner (en toute sorte) au sein d’une histoire, d’une genèse et d’une concrétion de sens des orientations problématiques qui mènent aux questions. L’inscription du questionnement philosophique au sein d’une praxis implique, tout d’abord, d’inscrire, ou de savoir reconnaître le questionnement comme praxis et, du point de vue philosophique, de tirer la leçon tout d’abord de Wittgenstein et ensuite de Dewey par rapport au questionnement.
Cela nous ramène – en quelque sorte – au troisième point, à savoir le caractère épigénétique des questions clairement théoriques, un caractère épigénétique qui peut être entendu aussi bien du point de vue onto- que phylo-génétique. En considérant que l’on n’a que des morceaux de phylogénése d’un questionner – dans les textes des grandes religions par exemple, ou dans l’épos ou encore dans la tragédie – ces morceaux, il faudrait les interpréter. Une telle interprétation est largement acceptée: elle dit, en bref, que bien loin d’y avoir une sorte de kairos, d’événement de la theôria (Burnet) et, donc du questionnement proprement théorique qui est celui de l’épistème grecque, il y a bel et bien une genèse (Cornford, Vernant et d’autres) qui conduit de l’interrogation sur ce que, avec Scheler, on peut définir “die Stellung des Menschen im Kosmos” (une interrogation propre à toutes les grandes religions de l’antiquité, de la Chine à Gilgamesh à Homère, en passant par le Bhagavadgita, les Upanishad et toutes les traditions initiatiques) au questionnement théorique, à la theôria et à l’épistème grecques. Cette interrogation est demande de sens, dans la mesure où on n’a pas de “theoretische Einstellung” qui soit (encore) définie, ou du moins explicite et codée dans une praxis.
Cela rend d’autant plus intéressant de retracer ces morceaux de phylogenèse au niveau onto-génétique, à savoir – justement comme vous le faites remarquer – dans la question enfantine. Cela ne signifie pas que les schémas (onto-génétique et phylo-génétique) soient parfaitement superposables, ni que l’on n’arrive pas à commettre un grand erreur en les superposant. Cela démontre au moins que tout de même il y a une correspondance singulière – et rarement interrogée – entre l’émergence de la theôria et son questionnement du point de vue phylogénétique et l’instauration d’un régime d’intérrogativité théorique chez l’enfant: tous les deux sont relativement tardifs, à savoir qu’il y a bien avant une phase dans laquelle questionner c’est demander. La réponse n’est pas nécessairement, pour l’enfant qui questionne, saillante du point de vue de son contenu strictement théorique, mais saillante en vertu d’une assurance, d’une donation de stabilité (phonétique, verbale, nominative etc.) et, comme vous l’affirmez, on pourrait même se pousser à affirmer qu’au niveau anté-prédicatif il y a une ouverture vers un milieu incertain. Au sein de ce milieu flou, incertain, le sens est donné par la croisée du regard maternel ou paternel sans qu’il y ait réponse du tout. Le questionnement définitionnel (“qu’est-ce que cela?” proféré ou tout simplement induit par une indication déictique) et le questionnement explicatif-causal sont – du moins du point de vue ontogénétique – tardifs, en retard par rapport à l’origine, tout comme au sens phylogénétique. Il ne faut pas en faire un absolu, donc un commencement absolu, comme si – en dehors de toute Lebensform, en dehors et indépendamment de toute praxis – il arrive, de façon miraculeuse, presque divine, le questionner théorique.
A ce point je pourrais être en mesure de répondre à votre question, à savoir la question du rapport intime entre question et demande de sens via le demander – ce qui n’est pas à négliger. Car après ces considérations liminaires, qui n’épuisent point la complexité et la difficulté du thème, il est quand-même légitime d’envisager un lien plus profond de la question théorique avec une activité plus basale, plus enracinée dans la praxis de plusieurs formes de vie, qui consiste à vouloir obtenir quelque chose par une demande. Ce demander se trouve dans le questionner, mais il est parfois occulté par la nature technique de la question, par sa consistance, par sa texture conceptuelle hyper-fine, hyper-abstraite. Il demeure tout de même actif, opératif, en acte. Et cela dans la mesure où la “simple” question est un acte pratique, ou si l’on veut, praxiologique, par lequel on fait quelque chose. Qu’est-ce l’on fait au juste? On ouvre un champ de saisie, où la saisie de ce qui est en question devient plus claire, plus définie. Par cette ouverture on déploie une dynamique de “prise” plus précise, plus fine, ou plus vaste.
Cette dimension sous-jacente de la question permet de réconfigurer également l’approche du schéma heidéggerien et nous permet, par ce schéma, de rejoindre une phénoménologie de la questio. Par rapport à ce schéma, et au § 2 d’Être et temps[5] il y aurait beaucoup (beaucoup trop) à dire. Tout d’abord, ce que l’on passe souvent sous silence, est le fait :
- que la structure formelle de la question n’est qu’un vide qui, pour Heidegger, s’applique à toute question – en tant précisément que structure formelle –
- et que, pour la comprendre de façon adéquate en relation au sens de l’être il faut parcourir tout l’analytique du Dasein pour qu’elle nous dise quelque chose.
Tout de même, des problèmes demeurent, car ici question (Frage) – comme modalité du “chercher” [Suchen] – trouve sa direction préalable dans le “cherché”. Or, pour la question du Sens (de l’être), si le cherché théorétiquement est le Sens (de l’être) et non pas l’être, car cela n’aurait aucun sens, le Sens n’est pas nécessairement un cherché théorétiquement, ou ne l’est pas à titre ultime (tout comme le cosmotheoros de Le visible et l’invisible de Merleau-Ponty ne l’est en pas à titre ultime[6]). Y a-t-il vraiment un Sens de l’être, ou un Sens tout court, que l’on peut chercher (éventuellement, par la Seinsfrage)? N’est-elle cette situation déjà une idéalisation philosophique, sinon métaphysique, par laquelle la pensée (qui se croit dépositaire d’un tel questionner) rate l’essentiel tout en prétendant le saisir (à savoir LE SENS, ou l’unique)?
On pourrait de façon philosophiquement plus lucide et plus pertinente affirmer que, si le question (même comme chercher) est un acte par lequel on cherche…à combler un vide, car tout d’abord et premièrement demande, ce vide n’est pas un unique, ou il ne se laisse pas ramener nécessairement à un pròs hèn comme les significations de l’étant à un Sens de l’être (au sein de la tradition métaphysique, notamment à partir de Suarez). Le fait d’être en demande de sens, par plusieurs modalités d’approches au réel, n’est pas, n’est plus un idole métaphysique caché sous les dépouilles d’une interrogation existentielle. Il est en revanche le signe d’une situation privative constitutive sans possibilité d’unité pléromatique. Il s’agit de la condition humaine, si l’on veut, dans et par laquelle le vide d’un Sens se manifeste par nos attitudes de demande de rémplissement. Cela renforce l’actualité et la radicalité de l’approche phénoménologique à la question développée premièrement dans les Leçons sur la synthèse passive – dont Heidegger était certainement informé – qui se placent en amont de la radicalisation heideggerienne et pour cette raison développent une radicalité d’interrogation immanente aux formes d’expérience sans être affectés par le besoin d’un Unique, soit-il le Sens, soit-il le Sens de l’être. Tout comme la question enfantine, la question théorique – même celle qui fait semblant d’être “fondamentale” – est constitutivement ramenée au champ de l’immanence de notre expérience du réel et de notre vie en commerce avec ce réel sans que l’indication d’un Sens unique soit donnée.
Jean-Baptiste Fournier : On comprend bien à vos réponses que poser la question de la question, c’est en un sens poser la question du sens telle que la pose la phénoménologie – à savoir l’extension du sens au-delà de la pure sphère de l’expression linguistique, vers un niveau, justement, plus « fondamental ». Et aborder votre livre au prisme de la phénoménologie de la question est en effet une manière de faire ressortir l’originalité de ce mode de saisie du sens, non pas en tant que « sens-se-faisant », mais au moment où, justement, il ne se fait pas encore, mais où apparaît l’attente ou la demande de sens.
Cela m’amène à une double question : tout d’abord, comme vous le remarquiez, que veut dire pour vous « mettre en question la question » et surtout quelle est la pertinence de poser cette question dans un cadre phénoménologique ?
En outre, cela m’amène à me demander de manière plus générale quel est votre rapport à la phénoménologie ? La redéfinition phénoménologique du sens vous semble-t-elle particulièrement apte à mettre au jour cette demande de sens dont vous soulignez le caractère prégnant ?
Cette question se pose en fait à plusieurs niveaux :
- en particulier, il me paraît utile à la compréhension de votre projet de vous interroger sur l’évolution de votre rapport à la phénoménologie ? Je suis en effet frappé par l’évolution que semble marquer la traduction de « Philosophie und Frage» par « Philosophie et demande » : je vois dans cet écart entre les deux titres le signe d’une insistance plus marquée vers la dimension phénoménologique, une orientation plus thématique sur le concept phénoménologique de sens. Cette évolution vous paraît-elle significative et va-t-elle dans le sens d’une prise de conscience plus aiguë de la pertinence de la méthode phénoménologique pour aborder les problèmes qui vous occupent et pour poser la question, non seulement de la question, mais aussi de votre objet plus direct, la mathesis ?
- Et à l’inverse, quel est, du point de vue de votre relation à la phénoménologie, le rapport entre les analyses méta-philosophiques que vous menez dans ce premier tome de Philosophie et demande et les analyses qui occuperont dans le second tome ?
Fausto Fraisopi: Le rapport de Philosophie et demande avec la phénoménologie (tout comme avec Kant et l’Idéalisme Allemand) aussi bien dans sa version Française qu’Allemande est en effet prédominant et, si l’on veut, constituant, même en laissant de côté le glissement sémantique entre le titre en Français et en Allemand. En effet, “Philosophie und Frage” (comme titre!) exprimait de façon plus vague ce que le titre Français exprime de façon plus claire, c’est-à-dire, cela peut paraitre paradoxal, équivoque. Car “demande” en Allemand peut-être exprimé aussi bien comme “Anfrage”, “Nachfrage” que comme “Forderung”, tandis que “demande” fixe cette équivocité dans un seul terme. L’expression “Philosophie und Frage”, au lieu de “Philosophie und Anfrage” (ou Nachfrage ou Forderung) correspond tout simplement à une nécessité d’ordre “esthétique” et il ne trahit aucune instance plus marquée vers la dimension phénoménologique dans l’édition Française. Certes, au fil des années nécessaires de travail (extrêmement dense) dont j’ai eu besoin pour amener le premier volume à une forme “acceptable” du point de vue spéculatif – je me réfère notamment à la seconde partie du premier volume en Français – et surtout grâce à mes Vorlesungen et séminaires de recherches à Freiburg, la relation à la phénoménologie s’est définie de façon encore plus marquée. Et cette relation consiste, notamment par rapport aux enjeux philosophiques de notre temps, sur lesquels je reviendrai, à considérer la phénoménologie – pour citer un article remarquable et remarquablement clair de Julien Farges récemment paru – comme “philosophie du sens”[7].
A cette thèse il faudrait tout de même ajouter un long éclaircissement théorique, sur lequel je travaille en duo actuellement (pour un livre sur les structures fondamentales de l’expérience: Topoi der Erfahrung. Noema, Horizont, Eidos aus der gegenwartigen Perspektive). Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que la phénoménologie, notamment chez Husserl mais on pourrait très bien étendre la thèse à toute la tradition successive, n’interroge premièrement ni des structures ontologiques ou gnoséologiques mais le Sens de l’expérience au sein de laquelle peuvent s’esquisser des structures ontologiques et/ou gnoséologiques. Ces dernières ne sont donc jamais un primum. Le plus fondamental pour la phénoménologie est le plus horizontal et visible, notre expérience du monde: la nôtre justement, pas celle d’une entité cognitive anonyme (aussi bien du point de vue de l’individu que de la communauté, aussi bien du point de vue ontogénétique que phylogénétique).
Si l’on prend par exemple les concepts que je viens de mentionner, il “suffit” de se concentrer sur le couple conceptuel “noema-horizon” qui n’a aucun équivalent ailleurs, et notamment dans la philosophie analytique (qui était) hégémonique : le noème c’est ni tout simplement le Sinn ni tout simplement la Bedeutung d’héritage frégéen, ni une synthèse qui vienne aprés. La coappartenance entre ce qui peut être conçu de façon abstractive comme la Bedeutung (objectale) et ce qui peut être conçu de façon abstractive comme le Sinn est décisive et change toute l’approche aussi bien à une ontologie qu’à une épistémologie. Et surtout l’ouverture thématique à l’intérieur de laquelle on en fait expérience de ce “ceci dans son comment”, n’est ni une compléxion simplement sémantique ni un référence simplement ontologique. Elle n’est pas un simple “contexte” sémantique du parlant, ni un espace ontologiquement individué mais l’expression la plus claire d’une situationnalité plus riche, plus complexe du point de vue de la description qui pourrait se définir uniquement de façon topologico-structurale.
Cette richesse se traduit – sans abandonner la rigueur, tout au contraire!!! – dans une orientation de travail tout simplement différente. Sans vouloir affirmer que, par là, on est exceptés des apories fondamentales qui affectent cette orientation de pensée, il faut tout simplement avouer que le choix de s’inscrire dans cette perspective de questionnement est clairement “méta-philosophique” ou “extra-philosophique” et ce “méta-” ou cet “extra-” se laissent très clairement caractériser par le “ni-ni”. Si l’on veut aboutir ou bien à une théorie de la connaissance et rien d’autre ou à déterminer, comme dans l’ontologie métaphysique analytique, l’inventaire du monde, la phénoménologie ne sert tout simplement à rien: elle est trop fine, vibratile, en soi (si vous me le permettez) dialectique, en vertu de ses équilibres instables, précaires, qu’elle ne laisse pas aboutir à des annonces triomphalistes (car justement encore de bout en bout métaphysiques). Marc Richir, phénoménologue avec lequel je n’ai ni j’ai jamais eu trop d’affinité – mais dont il faut reconnaître tout de même la puissance et la radicalité – formule cela avec une clarté foudroyante:
dans ses profondeurs les plus révolutionnaires, la phénoménologie n’a rien d’une ontologie et rien d’une métaphysique. Peut-être, énigmatiquement, a-t-elle encore quelque chose à voir avec la philosophie puisqu’elle est, dans notre tradition, le prolongement de la praxis du penser. Et peut-être, non moins énigmatiquement, peut-on préciser, en ce sens, qu’elle n’est pas une mathesis universalis, mais une mathesis, qui s’apprend et se change à mesure qu’elle avance, de l’instabilité et des mouvements inextricablement complexes de cette praxis.[8]
Or, laissons pour un instant de côté la question – il faudrait toutefois la poser, et de façon radicale, systématique – de savoir dans quelle mesure, et selon quels développements nécessaires, une telle mathesis des instabilités peut et doit regagner la dimension du savoir contemporain, tout fait d’instabilités ou de stabilités non figées dans une ontologie définitive. Si je ne suis pas ou je n’arrive pas à être sympathisant avec la façon de Richir de radicaliser la phénoménologie, je le suis beaucoup avec la reprise de thèmes richiriens faite par Alexander Schnell, et, notamment pour le premier, avec la tentative de ramener l’approche phénoménologique en rapport constructif avec la tradition de l’Idéalisme Allemand. Cela nous ramène bien évidemment, après le ni-ni (ontologique et épistémologique) au “rien d’écart”[9] formulé par Schnell justement par rapport au “Sens se faisant” et au fait d’aborder le problème du Sens par le prisme de la question (abordée phénoménologiquement).
De ce point de vue, si l’on veut, je n’essaye point de saisir le sens mais de montrer comment, bien loin de la perspective d’un Sens se faisant, il n’y a pas UN Sens qui se fait mais DES SENS qui se font et que nous ramenons, de façon inavertie, à la notion, tributaire encore d’une métaphysique du fondement unique, au singulier, au Sens. Or, le fait de définir une mathesis des instabilités, ou pour mieux dire des transformations (qui sont des transformations structurelles) de notre expérience épistémique et pré-épistémique du monde, implique de se placer justement là où ce qui est fait du Sens (ou des Senses) se faisant ne fait justement plus sens, c’est-à-dire là où nous place la question fondamentale, et fondamentalement pré-philosophique “Que/qui suis-je?” “Qui sommes nous? “Que sommes-nous devenus? »[10] comme première cristallisation, encore libre de présupposés philosophiques, de la demande de Sens.
Car s’il y a une demande de Sens, dans toutes ses formes possibles, cela signifie que ce qui est phénoménologiquement, existentiellement et épistémologiquement premier n’est pas le Sens se faisant comme Sinnbildung, mais des concrétions de Sens, Sinnbildungen (ici le pluriel est nécessaire et décisif) à partir desquelles l’existence fait expérience d’un défaut (apparemment) indépassable d’unité. C’est à partir de cette expérience d’éparpillement que ressort la theôria – justement comme projet et comme ouverture thématique sur un horizon dans lequel les parties n’ont qu’une unité justement horizontale. Je n’affirmerais pas qu’à ce moment, le moment onto- et philogénétique de l’émergence de la theôria, le sens ne se fait pas encore: ce qui ne se fait pas encore c’est justement la présupposition que ces unités éparpillées soient susceptibles d’être ramenées à l’unité. Ce qui ne se fait pas encore à ce point, ou qui demeure (encore) inhibé, c’est le geste métaphysique (soit-il un geste métaphysique classique, ontologique, ou bien phénoménologique).
Pour cette raison je me demande toujours et avec plus d’insistance si une métaphysique phénoménologique (laquelle bien évidemment ne peut pas être ontologique en premier chef mais qui doit regagner l’ontologie), et si le fait de se déclarer comme appartenant à la phénoménologie sont finalement nécessaires. Cela ne l’est pas tout d’abord pour éloigner les apories ou pour poursuivre un projet qui la dépasse.
Je dirais que la grandeur de la phénoménologie husserlienne se laisse saisir à mesure qu’on s’en éloigne (critiquement), à mesure que l’on prend conscience du fait que le projet de raison dont nous avons besoin aujourd’hui la dépasse largement.
Ce projet ne la dépasse pas – comme ils aimeraient faire croire un prétendu “réalisme spéculatif” – en vertu de la centralité de la corrélation au sein de la phénoménologie transcendantale. Cette corrélation est en revanche essentielle, fondamentale, pour interroger le savoir tel qu’il se fait aujourd’hui. Ce projet la dépasse car, si l’on veut en faire une prôte épistème, il faut prendre conscience des seuils que le savoir, le monde et leurs structurations entremêlées ont franchi depuis la formulation de son projet initial. Ce dépassement n’est pas aisément négligeable – mais cela appartient à un autre ordre de considération – même s’il ne révoque pas la puissance et la plasticité du projet phénoménologique comme projet de rationalité, et d’interrogation du réel. Tout comme pour la philosophie analytique (de Frege-Russell à Carnap), un projet qui a été défini entre le dix-neuvième et le vingtième siècle, la phénoménologie doit inévitablement passer par une révision massive et radicale de ses textures conceptuelles théoriques fondamentales, plutôt qu’être faite l’objet d’un histoire récapitulative. Et, compte-tenu du fait que je suis encore convaincu – à la suite de Kant – que les systèmes philosophiques aient leur origine par generatio aequivoca[11], je pense qu’à l’époque actuelle la phénoménologie, son approche et sa méthode doivent être ré-fusionnés dans quelque chose d’autre pour arriver à redonner expression au projet radicalement rationaliste des origines. Peut-être, et c’est ainsi que je la conçois, la radicalisation de la phénoménologie est-elle justement une radicalisation de son rationalisme[12] plutôt qu’une radicalisation en direction d’une figure fondamentale, toujours plus fondamentale.
 Pour revenir à votre dernière question, dans le second tome il arrive précisément cela, un matériau qui appartient très clairement aux structures (à certaines structures) définies par la phénoménologie est fusionné à nouveaux frais – de façon déductive et non simplement introductive comme dans le premier, qui assume la forme d’une “spekulative Darstellung” – dans une forme de mathesis structurelle des transformations. Cette dernière garde, comme matrice fondamentale, l’ouverture de l’existentiel à l’épistémique. Cette ouverture est le questionnement sur le sens du connaitre, un sens théorique (dans l’exposition aux phénomènes qui se sont avérés être “autre chose”, un multiversum) mais aussi un sens éthico-politique (dans l’exposition de l’homme à un monde qui a perdu la physionomie du monde Euro-centré et, cataclysme après cataclysme, s’est façonné dans le monde actuel). Cette matrice se traduit dans l’impératif, politique, que la mathesis doit avoir comme fin la paideia.
Pour revenir à votre dernière question, dans le second tome il arrive précisément cela, un matériau qui appartient très clairement aux structures (à certaines structures) définies par la phénoménologie est fusionné à nouveaux frais – de façon déductive et non simplement introductive comme dans le premier, qui assume la forme d’une “spekulative Darstellung” – dans une forme de mathesis structurelle des transformations. Cette dernière garde, comme matrice fondamentale, l’ouverture de l’existentiel à l’épistémique. Cette ouverture est le questionnement sur le sens du connaitre, un sens théorique (dans l’exposition aux phénomènes qui se sont avérés être “autre chose”, un multiversum) mais aussi un sens éthico-politique (dans l’exposition de l’homme à un monde qui a perdu la physionomie du monde Euro-centré et, cataclysme après cataclysme, s’est façonné dans le monde actuel). Cette matrice se traduit dans l’impératif, politique, que la mathesis doit avoir comme fin la paideia.
Jean-Baptiste Fournier : Votre réponse indique bien ce qui me paraît être le problème fondamental de Philosophie et demande, à la fois son coeur et la difficulté qui ne manque pas de se poser lorsqu’on le lit : l’articulation de la mathesis avec la conception du réel qui est inextricablement liée à la mise au jour d’un niveau phénoménologique fondamental où le sens ne se fait pas encore mais est simplement demandé ou exigé (au triple sens de la Frage, de l’Anfrage et de la Forderung). Vous évoquez d’ailleurs vous-même dans votre réponse la nécessité de poser cette question frontalement et radicalement. Je vous la pose donc. Tout d’abord, pourriez-vous éclaircir le sens que vous prêtez à l’instabilité, la complexité du réel ?
Il me semble que c’est là pour vous la définition même du réel – ce qui ne se laisse pas saisir, ce qui est toujours en excès par rapport à la theôria : le diffus, le complexe. Ce qui est passionnant dans votre analyse, c’est que cette définition de la réalité (ou ce niveau de réalité) est strictement corrélée à la “phénoménologie de la question”, parce que précisément il s’agit d’un niveau où le réel ne se laisse pas saisir sous la forme de jugements mais seulement de questions qui sont nécessairement des questions fondamentales, pré-théoriques, celles que se pose nécessairement le sujet confronté à la complexité grandissante du réel : “que/qui suis-je ?”, en particulier. Il est intéressant que votre analyse, dans Philosophie et demande, commence par cette question orientée subjectivement alors que ce qui est en jeu, c’est la notion même de réel. Doit-on y voir le constat d’échec d’un certain cartésianisme ? La perte de repère du sujet dans le réel et son besoin de se ressaisir, ou plutôt de ressaisir son sens dans un réel qui, fondamentalement, n’en a pas ? L’échec d’une mathesis et la nécessité d’en élaborer une autre ? Mais quoi qu’il en soit, la complexité du réel, la Forderung de sens, l’exigence ou la demande qu’en fait le sujet, et enfin, sur le plan métaphilosophique, la phénoménologie de la question, tout cela semble inextricablement lié.
Mais la question est alors : pourquoi donc introduire ici le concept de mathesis ? Reconnaître la complexité inhérente à la notion de réel, et la reconnaître de façon radicale comme vous le faites, reconnaître le caractère non-encore-sensé de l’expérience primordiale du monde dans lequel le sujet semble de prime abord se perdre et qu’il ne peut qu’interroger et non saisir théoriquement, n’est-ce pas mettre au jour quelque chose qui, par principe, échappe à toute mathesis ? En d’autres termes, comment articulez-vous le réalisme très particulier qui est le vôtre, dans sa dimension non spéculative justement, avec l’émergence d’une mathesis des instabilités ?
Il ne me semble pas en effet qu’il y ait dans cette articulation de la mathesis au réel instable une simple reprise d’une théorie carnapienne qui ferait de la theôria une simple Nachkonstruktion logique, ne serait-ce que parce que l’Aufbau carnapien suppose l’unité fondamentale du monde, ce qui ne me paraît pas être un présupposé de votre analyse. En d’autres termes, comment articulez-vous l’instabilité du réel et la mathesis, et corrélativement la phénoménologie de la question et la mise au jour des structures que vous résumez très clairement à la fin de l’ouvrage ? Et si cette mathesis est bien une mathesis de l’instabilité, et pas une reconstruction ou post-construction logique qui ramènerait cette instabilité à une stabilité rassurante et constituerait la réduction de la complexité du réel à des éléments simples, alors quelle est sa source ? Et comment les différentes branches de cet arbre que vous substituez à celui des Principes de Descartes tiennent-elles les unes avec les autres ? Qu’est-ce qui structure la mathesis dans un monde dont le caractère essentiellement et radicalement complexe a été reconnu ?
Fausto Fraisopi : Merci pour cette série de questions fondamentales, auxquelles je vais essayer de répondre. Tout d’abord, je voudrais – de façon très bienveillante mais autant radicale – rejeter la thèse selon laquelle quoi que ce soit, dans ma perspective, indique « le constat d’un échec d’un certain cartésianisme ». Mais pour que ce rejet soit conceptuellement clair, la réponse aux autres questions est nécessaire, et j’espère, à la fin, d’arriver à une clarté conceptuelle suffisante.
1) Tout d’abord, pourriez-vous éclaircir le sens que vous prêtez à l’instabilité, la complexité du réel?
Venons tout d’abord à des remarques préliminaires. Tout d’abord, au sujet de ce que vous définissez comme « l’articulation de la mathesis avec la conception du réel », en y ajoutant une demande d’éclaircissement, plus précisément du sens que je prête à l’instabilité, la complexité du réel.
Or, il y a ici strictement rien de subjectif ou qui relève de quelque chose d’arbitraire. C’est justement une prise en compte, absolument lucide et détachée, des seuils franchis par le savoir depuis un siècle et demi: tant pour le définir par des extrêmes de Riemann (1854 ca.) au Nobel pour la Physique assigné en 2021 en passant par le problème des trois corps de Poincaré, la mécanique quantique, la crise du Weltbild mise en avant par Bohr et Heisenberg, les systèmes hors équilibre etc. Comme l’affirme Cliff Hooker, bien que les choses aient changé un peu depuis 2011 (en philosophie des sciences):
The impact of complex systems on science is a recent, ongoing and deep revolution. But a few honorable exceptions, it has largely been ignored by scientists and philosophers alike as an object of a rejective study[13].
C’est cela qu’on a tendance à oublier aujourd’hui, c’est-à-dire le travail, long, difficile, du point de vue de la philosophie théorique, sur une révolution ou plusieurs révolutions dans la science. Ces révolutions ont radicalement métamorphosé le paysage de notre savoir et de notre existence, de notre être au monde. Il s’agit de changements dont l’école phénoménologique mainstream d’un côté, ou les réverbères spéculatifs des dernières années de l’autre n’ont pas voulu entendre parler, pour donner lieu à des formes de “métaphysique”, phénoménologique et/ou réaliste qui ne peuvent ni ne veulent se heurter aux savoirs positifs. Elles ne veulent pas surtout se heurter aux problèmes que ces savoirs posent aussi seulement à l’élaboration, à la formulation claire d’une idée de mathesis aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une sympathie personnelle envers la “pensée complexe” (à l’égard de laquelle je suis et j’ai toujours été très critique). Il s’agit d’une prise de conscience, d’un prendre acte de seuils franchis.
Il n’y a pas donc aucun sens à prêter aux résultats scientifiques provenants des sciences qui abordent les systèmes complexes. Le sens est clair: la notion de monde lui-même – comme còsmos, ordre – a été entièrement révoquée. Non parce qu’il n’y aurait plus aucun ordre ou aucune mesure possible – comme si on retombait dans l’affirmation d’un chaos originaire. Ce que nous disent les savoirs positifs à ce sujet, par des dispositifs bien rigoureux, est que l’ordre est dépourvu de toute caractéristique ontologico-fondamentale et holistique (en d’autre mots: l’ordre n’est plus le chiffre du réel ni la notion paradigmatique du savoir du réel). Le désordre n’est plus bruit de fond, noise, perturbation mais incubateur local de l’émergence d’un ordre localisé. Des îlots d’ordre et de stabilité sont spatialement relatifs (là où par “spatialement” on conçoive le seul espace dans lequel l’ordre est saisissable, l’espace des phases d’un système dynamique) et émergents, c’est-à-dire temporellement relatifs. Si l’on considère que la notion de monde vient de celle de còsmos et que còsmos signifie premièrement ordre, quelque question philosophique fondamentale faudrait bien se la poser, un jour ou l’autre.
Cela a un correspondant épistémologique [erkenntnistheoretisch] et ontologique bien radical, génialement résumé par Jocelyn Benoist (comme est de son usage) dans la Préface à La complexité et les phénomènes:
- le complexe se modélise, c’est-à-dire qu’il “apparait” uniquement dans le contexte d’une certaine pratique épistémique de “mise-en-image” [Abbildung]. Cette pratique n’est pas un milieu neutre ou illusoire, trompeur, parmi deux dimensions veritatives (la pensée, le réel) mais la matrice à partir de laquelle l’expérience (aussi épistémique) du monde trouve forme et saillance: le complexe ne se représente pas, il se modélise. C’est que, contrairement à ce qui se passe dans le cas du « représenté » classique, la façon que le complexe a d’être « représenté » est partie intégrante de sa constitution et donc il ne peut jamais être représenté sans reste.
- Le complexe ne se laisse pas ramener, ou à réduire à l’ontologie:“l’objet n’est pas le format adéquat à la complexité. Il ne sert à rien, de ce point de vue, de compliquer à l’envi les formes d’ Un objet compliqué reste un objet, et comme tel, épistémologiquement simple : possible corrélat d’un acte de l’esprit, si abstrait et stratifié puisse s’avérer celui-ci. […. Il est impossible de faire rentrer le réellement complexe dans un tel lit de Procuste, non pas parce qu’il serait intrinsèquement trop petit ou trop grand pour cela – l’ontologie sait étendre ou amputer adéquatement ce qu’elle veut mesurer – mais tout simplement parce que cela n’a pas de sens. Situer quelque chose dans le cadastre de l’ontologie, c’est en effet, essentiellement, le mettre à plat. Or le complexe, définitionnellement, est ce qui ne peut se mettre à plat”[14].
 Si l’on veut, le seul sens que je me suis permis de prêter à l’instabilité (N.B.: telle qu’elle est fixée par les savoirs par des dispositifs rigoureux!) est de la reconnaître comme un défi énorme (s’il ne s’agit pas d’une catastrophe) pour notre idée de connaissance du monde (justement “mathesis”) et de être. Car toute l’histoire de l’ontologie (peut-être exception faite pour Hegel) est fondée sur la caractérisation d’une stabilité ontologique sous-jacente aux processus physiques. Pour confirmer cela, on pourrait poser un simple défi à ceux qui, aujourd’hui prétendent faire de la métaphysique en toute forme. Et la métaphysique, si l’on se tient à la rigueur de l’histoire de la philosophie (voir en France Courtine, Marion, Brague) est toujours une métaphysique ontologique (!). Pour parler en termes analytiques: “no metaphysics without ontological commitment”. Comme le disait de façon extrêmement claire J.-L. Marion dans un entretien, donné à KTOTV: “Quand vous êtes un philosophe métaphysique votre intérêt c’est d’expliquer les choses qui sont. C’est-à-dire c’est de poser très vite la question […]: “est-ce ce que je sais, ce que je pense savoir, est-ce c’est ou est-ce ça n’est pas?” […] Et évidemment il tranche, il est là pour ça: il dit “ça n’est pas ou mieux cela ne peut pas être. […] On se bat pour fixer une frontière et pour faire le tri selon le critère de l’être“[15]
Si l’on veut, le seul sens que je me suis permis de prêter à l’instabilité (N.B.: telle qu’elle est fixée par les savoirs par des dispositifs rigoureux!) est de la reconnaître comme un défi énorme (s’il ne s’agit pas d’une catastrophe) pour notre idée de connaissance du monde (justement “mathesis”) et de être. Car toute l’histoire de l’ontologie (peut-être exception faite pour Hegel) est fondée sur la caractérisation d’une stabilité ontologique sous-jacente aux processus physiques. Pour confirmer cela, on pourrait poser un simple défi à ceux qui, aujourd’hui prétendent faire de la métaphysique en toute forme. Et la métaphysique, si l’on se tient à la rigueur de l’histoire de la philosophie (voir en France Courtine, Marion, Brague) est toujours une métaphysique ontologique (!). Pour parler en termes analytiques: “no metaphysics without ontological commitment”. Comme le disait de façon extrêmement claire J.-L. Marion dans un entretien, donné à KTOTV: “Quand vous êtes un philosophe métaphysique votre intérêt c’est d’expliquer les choses qui sont. C’est-à-dire c’est de poser très vite la question […]: “est-ce ce que je sais, ce que je pense savoir, est-ce c’est ou est-ce ça n’est pas?” […] Et évidemment il tranche, il est là pour ça: il dit “ça n’est pas ou mieux cela ne peut pas être. […] On se bat pour fixer une frontière et pour faire le tri selon le critère de l’être“[15]
La question/défi à poser au métaphysicien est la suivante: “Essayez de caractériser un écosystème ou une crise économique ou même l’agrégation de l’espace dans la gravité quantique du point de vue ontologique”! Il n’y a aucune métaphysique phénoménologique, ni analytique qui peuvent le faire, car justement c’est la possibilité de caractérisation selon une ontologie de base (ou fondamentale) qui fait défaut.
Je me rends bien compte que cela paraisse bien difficile et fasse presque objet d’un refus. C’est difficile non seulement à saisir dans sa forme conceptuelle mais à accepter tout d’abord au niveau archétypal. Ce dernier est le niveau qui dépasse a parte ante la métaphysique occidentale et un grand nombre de formes de cosmogonies (et de religions) qui font de la mise à l’écart du chaotique l’acte premier d’émergence de l’ordre du monde (par quoi et/ou par qui cette émergence est opérée s’avère être ici secondaire). Au stade de notre savoir, il n’y a pas un chaos holiste qui est écarté ou ordonné ni un chaos (autant holiste, donc autant métaphysique) qui régit le réel. Ce qui se manifeste est un réel hybride, subsistant entre des états chaotiques et des états ordonnés par des bifurcations.
C’est cette situation que j’ai essayé de résumer en forme de récit (ou de généalogie) dans deux paragraphes de Philosophie et demande[16]. Et un des facteurs essentiels de cette généalogie est la libération finale de la phénoménalité de la métaphysique qui la subjuguait en en faisant nécessairement (et donc préjudiciellement) un ordre cosmique de nature strictement et inéluctablement ontologique.
Il est alors évident que la mathesis est inextricablement liée à la mise au jour d’un niveau phénoménologique fondamental, mais, encore une fois, pas de façon arbitraire, comme pour un plaisir à traiter la chose selon un penchant pour une philosophie plutôt que pour une autre.
Le niveau phénoménologique émerge là où l’ouverture de la vision, de la theôria, est libérée de l’emprise de la métaphysique, et donc d’une ontologie (nécessairement holiste). Pour avancer un parallélisme, dans le domaine anglo-saxon ce niveau phénoménologique se manifeste au sein du pragmatisme (notamment Dewey). Tout au plus, le choix d’assumer ce niveau phénoménologico-existentiel – spéculaire et correspondant au niveau épistémique, car tous les deux subsistent au-delà d’un effondrement – et de l’analyser avec des catégories qui proviennent de la philosophie husserlienne, cela relève d’un choix, que je revendique. Ce choix a affaire à la rigueur des descriptions structurelles que la grammaire husserlienne nous met en mesure d’accomplir et, de l’autre, comme pour la réponse précédente, à la pertinence de nombreux concepts clé.
Ce qui est – à mon avis – extrêmement passionnant est justement la dialectique entre la demande de sens (qui demeure encore demande de stabilité) des individus et des formes du “collectifs” (groupes religieux, confessions, sociétés) et la dissolution de ce même sens prétendu et supposé comme possible de la part de l’épistémè: il s’agit là d’une dialectique fondamentale, récurrente, qui a fait de l’histoire du savoir une histoire positive, et constructive, d’émancipation.
Cette dialectique – vous avez raison – se cristallise et émerge toujours à nouveau dans la question pré-théorique (ou en tout cas pré-philosophique) “que/qui sujs-je?”, question nécessairement et pour cause équivoque, justement en tant que cristallisation d’une dialectique fondamentale.
Ce n’est pas étonnant alors si, dans le double mouvement subsistant entre le premier et le second volume, cette question se représente a fortiori une fois esquissées les formes de mathesis et une fois fournie une structure du réel complexe an-ontologique et méta-métaphysique.
2) N’est-ce pas mettre au jour quelque chose qui, par principe, échappe à toute mathesis?
Toutefois, lorsque vous affirmez que deux “reconnaissances” ont lieu, celle “de la complexité du réel” et celle du caractère “non-encore-sensé de l’expérience primordiale du monde”, et que cela échappe à toute mathesis, je rencontre de sérieux problèmes.
Le premier est dans la définition ou tout simplement dans la nomination d’une “expérience primordiale”. Très franchement je ne trouve pas qu’ici on ait affaire à quelque chose de primordial, comme à un Abgrund. L’absence d’un sens unitaire de notre expérience du monde, surtout et d’autant plus lorsque on en fait expérience dans toute sa complexité, n’indique pas un primordial, indique tout simplement une résistance du réel à se laisser enfermer dans le Sens que nous prétendrions lui attribuer en vertu de notre besoin de stabilité. Cela est encore trop métaphysique. Rien de primordial, juste la dialectique, le conflit – peut-être irrésolu au-delà des dogmes ou des systèmes métaphysiques – d’une demande qui persiste en vertu de notre situation dans l’existence, notre exposition au monde, et les structures de compréhension épistémique de ce monde. Elles font que ce prétendu Sens – unitaire, englobant, rassurant – soit un Non-Sens du point de vue du savoir. Mais qui a dit qu’une mathesis, ou que des formes de mathesis sont possibles uniquement lorsqu’elles absorbent dans les mathèmata toute sorte d’aspect du réel?
C’est le préjugé métaphysique par excellence! Il s’agit d’un point à l’apparence très fort (de la métaphysique) qui s’avère enfin être son point le plus faible, le Trieb de devoir à tout prix faire de la connaissance humaine quelque chose qui dispose absolument tout dans l’espace de la theôria. En revanche il n’est pas ainsi, car le savoir n’est pas un système religieux qui doit englober le còsmos pour donner sens à l’existence du croyant ou de l’adepte, ni un panlogisme architectonique, ni un produit tout fait délivré par une ousine…ou un inventaire. Il y a savoir – et donc mathesis et donc aussi paideia – aussi là où, par une démarche spéculative, on sait qu’il y a des irréductibilités aux formes d’épistème, et que les formes d’épistème s’enracinent sur un terrain qui ne se laisse pas absorber entièrement dans les démarches mises en places par les structures qui décrivent les invariants de la phénoménalité. Ceci est le sens de la citation aristotélicienne qui se trouve au debout et qui revient à la conclusion du premier volume[17]
Pour cette raison une mathesis s’articulant selon des formes dont chacune, comme dans Philosophie et demande (ou dans la perspective qu’il introduit), admet nécessairement un “blind spot”, un point aveugle, n’est point la réfutation d’une mathesis, mais peut-être uniquement la tentative de penser la mathesis en dehors de la métaphysique, en dehors d’un holisme ou des holismes. Car ce holisme ou bien est une idole – c’est à dire un simple postulat métaphysique – ou bien est incomplet, donc ex definitione contradictoire.
3) En d’autres termes, comment articulez-vous le réalisme très particulier qui est le tien, dans sa dimension non spéculative justement, avec l’émergence d’une mathesis des instabilités ?
Tout d’abord laissez-moi dire que quelqu’un aurait une certaine difficulté, à la lecture de certains passages de Philosophie et demande, qui se trouvent vers la fin de la longue construction des formes de mathesis, à caractériser mon “réalisme”, et à le caractériser comme “non-spéculatif”. Je ne suis pas tout simplement le porteur d’un “Réalisme” en philosophie, un réalisme non spéculatif ou spéculatif. Je cite les passages:
“Une telle « texture du réel » ne se dévoile pas à l’œil nu. Cette texture peut se laisser saisir, peut se laisser toucher du doigt uniquement à partir de la consistance de ces images spéculaires, à partir de leur épaisseur spéculative. Toute tentative de ramener le réel à un cadre, de l’enfermer dans une catégorie, échoue. Cet échec du «concept» de la métaphysique à capturer sa nature protéiforme, représente, du point de vue spéculatif, une telle consistance, une telle épaisseur”[18].
“L’épaisseur de la singularité « réelle » est une épaisseur spéculative ou n’est pas. L’épaisseur de cette singularité laisse découvrir, comme profondeur, les dimensions à l’intérieur desquelles, et les dynamiques par lesquelles elle peut se laisser comprendre, voir, toucher du doigt. En dépit de ce que voudrait faire le réductionnisme, la singularité n’est pas annulée – ex-pliquée, donc aplatie – par sa réduction méréologique”[19]
Pour trancher, je n’arrive point à comprendre – philosophiquement – ce que réalisme, spéculatif ou pas, veut dire lorsqu’on le ramène à l’épreuve des structures par lequel il prétend d’atteindre le réel. J’arrive bien à comprendre l’instance réaliste avancée par Jocelyn Benoist, une instance qu’il venait de construire patiemment bien avant que cette “bulle spéculative” du réalisme explose. Car cette instance, que j’ai intégrée pendant des années (des décennies dirais-je) est une instance qui vise le réel – comme vous les disiez avant par rapport à ma perspective – par contraste, dans la résistance à une forme de prise conceptuelle. Toutes les autres formes de “nouveau réalisme”, de retour aux choses en soi, m’échappent. Tout comme m’échappent les critiques formulées par ces nouveaux réalismes aux auteurs qui sont censés être, pour ses auteurs, les porte-feux d’un anti-réalisme corrélationiste. Pour y être depuis trente ans désormais, quand je lis les descriptions de Descartes, de Kant, d’Hegel, d’Husserl fournies par ces approches néo-réalistes, je ne les reconnais pas, tout simplement. Je n’arrive pas à comprendre, plus en particulier, comme la corrélation modélisante représente une condition négative à la saisie du réel (Michel Bitbol non plus d’ailleurs[20]); je n’arrive pas à comprendre comment le fait de développer des cadres toujours théoriquement plus fins de saisie (épistémique donc aussi philosophique) de la phénoménalité représente un anti-réalisme, même si ces cadres appartiennent à une dimension modélisante, donc intérieure à et présupposant la corrélation.
Pour revenir à votre question, je me sentirais d’affirmer – en dehors de toute prise de position pro ou contra le réalisme – qu’uniquement là où on a développé (et, pour le lecteur on a parcouru) le chemin de construction et d’agencement des formes de mathesis, on peut arriver à saisir l’instabilité constitutive qui caractérise la phénoménalité à laquelle nous sommes irrémédiablement exposés: comme individus, comme sociétés et, à l’époque de l’Anthropocène, comme humanité. Car dans cette perspective – laquelle, je le répète, intègre l’étude et l’assimilation des savoirs tels qu’ils se font aujourd’hui – l’instabilité du monde phénoménal, sa non-stabilité ontologique (ou dislocation constante par rapport à une ontologie de référence) – est saisie par des structures, qui relèvent des formes de mathesis. Ce n’est pas affirmée en vertu d’un sentiment personnel, ou d’un seul agencement de thèses à l’intérieur d’une démarche doxographique. C’est cela qui est difficile et indigeste.
La mathesis des instabilités – une mathesis qui se place au-delà de la métaphysique, (méta-métaphysique) et qui pense nécessairement au-delà de l’ontologie fondamentale[21] ou d’une ontologie singulière élevé à paradigme de saisie du réel (donc aussi méta-ontologique) – émerge dans et par sa construction. Le savoir est construction, pas entièrement peut-être mais en grande partie. C’est uniquement en ayant suivi avec un oeil critique la construction que l’on peut arriver à y voir en transparence une forme de réalisme (et, si on en a tellement besoin, tirer d’une démarche, l’indication consolatrice d’une réalité). Toutefois, compte-tenu du fait que justement la méta-métaphysique se développe à partir de l’équivocité constitutive de la question réaliste, la question sur le réel (Chap. V et IX), je ne pense pas que le lecteur à la recherche d’UN réel ou DU réel (ou des deux à la fois) soit réellement satisfait. Il devrait, avant de rechercher de telles réponses, prendre conscience – s’il lui est possible – de l’équivocité de sa demande de sens transformée en demande/question réaliste.
Venons aux dernières questions, avant de revenir à l’échec mentionné d’un cartésianisme.
4) Il ne me semble pas en effet qu’il y ait dans cette articulation de la mathesis au réel instable une simple reprise d’une théorie carnapienne qui ferait de la théoria une simple Nachkonstruktion logique, ne serait-ce que parce que l’Aufbau carnapien suppose l’unité fondamentale du monde, ce qui ne me paraît pas être un présupposé de votre analyse.
Oui, en effet il y a une prise de distance essentielle, épistémologiquement décisive, de Carnap pour la raison que vous mentionnez, à savoir le présupposé carnapien de l’unité fondamentale du monde. Ce présupposé s’est affaibli jusqu’à l’inconsistance aussi bien par le travail interne au sillage carnapien (je me réfère notamment à Quine et Goodman) et par le travail externe, celui, bien plus massif, des savoirs. Par rapport au premier, par des raisons théoriques à mon avis difficilement contestables, cette unité fondamentale demeure chez Quine encore possible en vertu de son naturalisme, mais elle est affaiblie à partir du moment où on prend conscience d’une relativité ontologique constitutive. Chez Goodman ce présupposé n’a plus lieu d’exister justement en vertu de l’inconsistance théorique du naturalisme lui-même, qui se voit attribuer une fonction non plus fondatrice comme chez Quine.
Quelle est alors, ou sur quoi devrait reposer cette unité fondamentale du monde? Sur la perception sensorielle ou plus généralement expérimentale? En ce cas, ce serait une unité bien restreinte et limitée. L’unité du “Monde” ne peut donc être qu’une unité horizontale, qui n’en est une que si l’on prend en compte la façon par laquelle nous la projetons – juste pour revenir à ce méchants philosophes, Descartes, Kant, Husserl dont on se soucie de mettre en lumière l’anti-réalisme. Par cela je ne veut pas dire que l’unité du monde est factice, mais uniquement qu’elle se laisse saisir dans le jeu extrêmement fin de notre exposition aux phénomènes et de nos pratiques épistémiques qui réalisent des formes d’unité, des correspondances dont la robustesse n’est point liée à un présupposé de type métaphysique ou ontologique. Car si l’expression “l’unité fondamentale du monde” ne cache pas un présupposé ontologique ou métaphysique, il faudrait m’expliquer comment elle est aussi seulement possible.
Du point de vue de la science, la chose est encore plus éclatante. Car l’essor du savoir à partir de la fin du XIX siècle ne fait qu’épuiser ce présupposé fondamental, sans pour autant affaiblir le savoir lui-même, mais en le renforçant ! Plutôt que s’interroger sur l’unité fondamentale du monde et de persister dans le deuil de sa perte, il faudrait poser la question suivante: sommes-nous en mesure d’ouvrir une perspective pour le savoir (mais aussi pour l’émancipation humaine) à l’intérieur duquel l’unité du monde est l’unité – jamais définitive, jamais conclue, toujours horizontale et plastique – qui subsiste entre notre expérience des phénomènes et les formes de mathesis qui leurs fournissent des formes de stabilité (c’est-à-dire d’intelligibilité) théorique? Cette specularité, comme forme d’unité, exclut la possibilité que la mathesis soit tout simplement [bloß] une post-construction, en l’inscrivant dans une démarche plutôt transcendantaliste (mais reformée!) et en inscrit le projet dans une dimension qui n’est plus débitrice d’une forme de métaphysique.
Comment cela se fait, pourrait peut-être émerger dans la suite de notre dialogue. Il est tout de même certain que pour se faire, elle devra garder la plasticité et l’horizontalité ouverte qui est la marque constitutive aussi bien de l’existence que du savoir.
Cela nous ramène, avec des simplifications nécessaires, inévitables hélas, à un de ces méchants philosophes dont on veut à chaque pas suspendu marquer l’échec, Descartes. Je me permet de composer les deux questions que vous posez :
5) “Il est intéressant que votre analyse, dans Philosophie et demande, commence par cette question orientée subjectivement alors que ce qui est en jeu, c’est la notion même de réel. Doit-on y voir le constat d’échec d’un certain cartésianisme?”
6) “Et comment les différentes branches de cet arbre que vous substituez à celui des Principes de Descartes tiennent-elles les unes avec les autres ?”
Or, une petite prémisse est nécessaire: j’ai été formé aux études d’histoire de la philosophie “ancienne école”, la plus dure, apparemment ennuyeuse, acribique, presque claustrophobique. Notamment, dans le cas des études cartésiennes, par des fréquentations directes qui s’étalent sur 25 ans (T. Gregory tout d’abord, M.E. Scribano, M. Fichant, J.-L. Marion, F. De Buzon) et par un intérêt toujours croissant, sans solution de continuité (et plein d’admiration) par les études cartésiennes notamment en France (au-delà des fréquentations personnelles, Gueroult, Alquié, Beyssade, Kambouschner, Mehl et beaucoup d’autres). En vertu de ma formation en histoire de la philosophie – et pas pour la sympathie pour telle ou telle autre figure de l’histoire de la philosophie – je suis presque physiologiquement incapable de prononcer de formules comme: “échec du cartésianisme”, “pour en finir avec Descartes”, “goodbye Kant” et choses de telle sorte. Au-delà de la dimension pathologique actuelle du slogan pour se donner un certain air de radicalité, je n’arrive pas à les comprendre, tout comme je trouve un peu comique, ou pathétique, cet acharnement des prétendus “penseurs du complexe” à la suite de Morin (volens nolens) contra Descartes (j’en fait aussi mention, ironique, dans Philosophie et demande[22]).
Si en revanche on a les outils, les moyens et le courage pour se plonger dans ce processus extrêmement complexe et majestueux qui est la sédimentation de la Modernité jusqu’à (mais surtout et principalement grâce à) Descartes, ces thèses apparaissent pour ce qu’elles sont, des slogans, rien de plus. Donc aucune intention de mise en échec du cartésianisme, ou d’un cartésianisme, tout simplement parce que sans ces méchants rationalistes (Galilée, Kepler, Descartes) corrélationistes, idéalistes on serait encore à s’interroger sur quel monde il fallait construire et si la science devait encore suivre Aristote. Mais pour revenir à votre question, ce qui m’interroge est la prémisse:
7) “Philosophie et demande, commence par cette question orientée subjectivement alors que ce qui est en jeu, c’est la notion même de réel”.
Pourquoi, en est-il autrement chez Descartes, non seulement dans les Méditations mais dans toute son oeuvre? On arrive vraiment à penser, pas vous bien évidemment mais plusieurs le font, que le maître d’armes, le voyageur, le scientifique, celui qui rédige les Méditations l’année de la mort de son père et de sa fille bien-aimés (de surcroît sur un parchemin bien connu, celui des Exercices spirituels de Loyola) épuise toute dimension existentielle et toute question orientée vers l’humanité et vers les hommes que nous sommes, pour présenter un corpus de thèses simplement théoriques? Le savoir ressort d’une question, d’une demande de sens orientée vers nous-même et vers notre exposition à un monde dont la forme (se métamorphosant) nous échappe et qu’il faut redessiner par le savoir (et l’action). En fait Descartes, par sa grandeur philosophique et spirituelle immense, à mon avis le seul (avec Platon et Marx) à pouvoir être considéré comme un philosophe “welthistorische” [à la Hegel], enterre toujours ses fossoyeurs.
Mais venons aux raisons plus strictement théoriques. Bien évidemment la science que l’on vient de mentionner à fait un pas au-delà de Descartes, un pas au-delà de la science de l’ordre et de la mesure, un pas au-delà du mécanisme universel, mais aurait-elle pu le faire sans le codage galiléen-cartésien de la science? C’est impensable! Juste un exemple: sans le fameux passage des Regulae selon lequel “tout est modélisable par des dimensions” on n’aurait même pas l’idée de pouvoir modéliser un système dynamique, donc on n’aurait pas l’idée d’attracteur, donc pas non plus l’idée d’attracteur étrange, donc pas de butterfly effect (qui est – il faut le savoir – à l’image de l’attracteur étrange de Lorenz, pas du gentil papillon en chair et en os!) et aucune idée de multiversum.
De façon correspondante mais cette fois relative à Philosophie et demande:
- bien évidemment le cogito anti-métaphysique que je formule et ensuite j’explique se place au-delà de Descartes, simplement dans la mesure qu’il énonce l’identité du Je et de l’horizon (“Je suis un horizon – nous sommes des horizons”[23]) c’est-à-dire de deux figures qui échappent à l’ontologie en échappant à toute substantialisation. Ce qui est le plus important, est que sur la base de ce “cogito anti-métaphysique” on peut construire une mathesis méta-égologique qui modélise et affirme la référence à soi-même comme la concrétion génétique d’une multi-dimensionalité. Cette dernière est plastique et évolutive, dans des formes singulières, duales, communautaires[24].
- Bien évidemment la mathesis méta-théorique développe une idée plutôt rhizomique qu’arborescente du savoir, en pensant (et modélisant!!!) les théories comme réseaux évolutifs et plastiques, s’entremêlant[25], donc encore une fois au-delà de Descartes et de toute forme d’architectonique d’inspiration kantienne[26].
- Bien évidemment au-delà de Descartes, et des toutes les ontologies “monistes”, la mathesis méta-ontologique applique la modélisation algébrique non plus à l’étant mais aux ontologies elles-mêmes[27] dans une dimension de relativité ontologique indépassable[28].
- Bien évidemment, pour conclure, la mathesis méta-métaphysique – qui résulte de la spécularité et de l’articulation modulaire des autres[29] – prend les trois formes de mathesis pour en faire une mathesis des instabilités et des transformations (grâce aux mathématiques – catégoriales – qui ont été développées entretemps[30]).
Cela marque-t-il l’échec du cartésianisme ou d’un certain cartésianisme? A mon avis marque le triomphe de l’esprit plus profond de Descartes, de son rationalisme, qui persiste même au-delà de la mise en écart, épistémique ou philosophique, donc toujours a fortiori rationnelle, des thèses locales.
Ensuite vous demandez:
8) Et comment les différentes branches de cet arbre que tu substitues à celui des Principes de Descartes tiennent-elles les unes avec les autres ?
Tenons-nous dans le cadre métaphorique: mon intention n’est pas de procéder à des implants d’ordre botanique, pour ainsi dire. Donc je n’arrive même pas à concevoir une telle substitution. Dirais-je, toujours dans le même cadre métaphorique, qu’il faudrait considérer cet arbre, et la vie de cet arbre, de façon systémique, c’est-à-dire eco-systémique. En d’autre mots: pas d’implants botaniques, pas d’ingénierie végétale transgénique, mais une vision élargie qui ne considère pas l’arbre comme isolé d’un écosystème mais comme le lieu ou l’attracteur d’un éco-système et qui considère la dynamique complexe de cet écosystème, toujours robuste et précaire à la fois, sensible aux variation de l’environnement, symbiotique.
Donc la mathesis, pour revenir à une autre de vos questions, ne peut que structurer des dimensions. Tout d’abord, de façon nucléaire, la dimension existentielle et expérientielle de notre exposition aux phénomènes et la dimension épistémique de stabilisation de l’intelligibilité de ces phénomènes. Ensuite, à l’intérieur de cette spécularité ou dans l’horizon décrit par cette spécularité, les quatre formes de mathesis qu’il faut développer pour penser l’entremêlement pluriel de ces dimensions.
Jean-Baptiste Fournier : Je rebondis sur cette question des formes de mathesis et des dimensions qu’elles structurent, et il me semble essentiel d’insister sur la dimension “existentielle” de ce que vous appelez “l’exposition aux phénomènes”. En effet, à lire Philosophie et demande, on ne peut qu’être frappé par le fait que l’ouverture de la mathesis s’effectue à partir du sujet qui se découvre dans la question “qui/que suis-je ?” ; et à lire votre livre comme nous le faisons à partir du point de vue d’une phénoménologie de la question, on ne peut laisser ininterrogé le fait que cette question, précisément, soit la première.
Évidemment, il y a toujours dans un livre des contraintes extérieures diverses qui poussent à adopter un certain ordre d’exposition et je me méfie toujours de la tendance à surinterpréter l’ordre dans lequel les choses sont présentées. Mais il n’y a rien à mes yeux d’anodin dans le fait que la question “qui/que suis-je ?” et la découverte du sujet comme celui qui est fondamentalement exposé aux phénomènes soient premières – je dirais même qu’il y a là, une fois encore, la preuve d’une inscription très forte de votre propos dans une forme de post- ou de néo-cartésianisme. D’où une question très simple, pour finir par le commencement : quelle est la spécificité, quel est le statut de la question “qui/que suis-je ?” dans l’économie de votre livre, dans la mathesis dont vous ouvrez les principales dimensions, et dans la phénoménologie de la question en général ?
Fausto Fraisopi: La question me parait bien fondamentale, et cruciale. Deux remarques préliminaires sont nécessaires. Tout d’abord sur la primauté (du moins dans l’ordre d’exposition) de la question “que/qui suis-je?”.
Je conviens avec vous sur le fait que des livres sont soumis à “des contraintes extérieures diverses qui poussent à adopter un certain ordre d’exposition” et que, en bon lecteur, il faut se méfier “toujours de la tendance à sur-interpréter l’ordre dans lequel les choses sont présentées”. Bien heureusement, toutefois, cela n’est pas le cas dans cette démarche, au sens que ce que je mentionnais comme “structuration des dimensions de la mathesis” obéit, et ne peut qu’obéir, à une logique constructive, dont les premiers passages sont essentiels. En d’autres mots: cette introduction (bien que longue) à une nouvelle dimension, en tant que forme de Besinnung, notamment dans les premiers cinq chapitres, ne se soumet pas à de contraintes extérieures. Pourrait-on demander: extérieures à quoi? Justement à la “chose même”, à la “Sache”. Peut-être c’est la hybris à laquelle s’expose cette entreprise – c’est-à-dire de ne s’en tenir qu’à la Sache et à sa morphologie. Et étant donné qu’il s’agit d’une dimension, ou de l’ouverture de dimensionnalités qui se croisent et s’entremêlent, le point de départ est essentiel, crucial.
Le point de départ toutefois n’est pas la question “que/qui suis-je” mais le chemin (progressif et régressif) à la fois qui mène à individuer – ou à reconnaitre – cette question comme “première”. Et en ce sens, au sens du chemin progressif et régressif qui s’ouvre au premier chapitre – et qui a été déployé de façon plus analytique dans les premier deux chapitres de Philosophie und Frage II[31] – deux affirmations de votre question se rejoignent:
- qu’il “rien à mes yeux d’anodin dans le fait que la question “qui/que suis-je ?” et la découverte du sujet comme celui qui est fondamentalement exposé aux phénomènes soient premières”;
- et qu’il s’agit bien une indication – je n’utiliserais pas le mot “preuve” – de l’inscription très forte de ce propos dans une forme de post- ou de néo-cartésianisme.
Pour fournir clarté au premier point, je vais essayer tout d’abord d’éclaircir ce dernier.
Tout comme pour la réponse précédente, je suis à des années lumière d’inscrire mon propos dans une forme ou une autre de néo- ou post-cartésianisme mais vous avez saisi exactement le point dont il s’agit. Dans la figure du “Je-horizon”- difficile à saisir de premier abord, car pour cela il faut déjà l’acheminement – saisissable uniquement par la question et son auto-suspension, il y a, aussi bien du point de vue de la saisie conceptuelle directe, que du point de vue des recherches qui y ont amené, une référence essentielle à quelque chose que l’on pourrait indiquer comme subjectivité.
Mais la situation est encore plus “stratifiée” (pour ne pas utiliser le mot “complexe”) de ce qu’il parait. Cela dans la mesure où ils convergent ici cinq figures, l’étude – pluridécennale – sur lesquelles est condensée dans ce mouvement progréssif-regréssif: la theôria grecque et St. Augustin comme son dépassement historique, Descartes, Kant, Husserl (ou plus précisément l’opposition entre la libre décision de l’epoché husserlienne et l’évènement de la totalité du monde dans son détachement du sens par l’angoisse chez Heidegger[32]).
Or, malheureusement, je ne peux démêler ici toute l’intrication conceptuelle – bien que cela soit par ailleurs nécessaire. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de reprendre le cogito cartésien tel quel (qu’est-ce que vraiment?) mais de le faire passer à travers au moins deux stations fondamentales. La première est la saisie de l’horizon phénoménal qui se donne à partir de l’expérience du sublime chez Kant – et qui est strictement liée à la dynamique de l’auto-affection des §§ 24-26 de la Deduction B (de 1787)[33]: encore une fois saisie de soi-même comme être rationnel, affectant de l’intérieur la sensibilité, par le biais de (la phénoménalisation de) l’idée d’infini. La seconde est la figure phénoménologique de l’auto-affection, lue au sein de son évolution à partir d’Husserl jusqu’à Michel Henry. Toutefois, ce qu’il faut – il faudrait – retenir est un chiasme, un switch de Gestalt qu’Husserl remarque avec clarté remarquable dans les études du volume XV d’Husserliana: “Le dedans intentionnel [das intentionnale Innen] est en même temps le dehors [Aussen]”[34].
La dynamique de cette équivalence m’a occupé pour longtemps, et notamment par rapport à ce que je mentionnais auparavant, à savoir la question d’où et comment nous arrivons à la saisir. De surcroit, s’il s’agit d’une équivalence structurale: quand, dans quelle forme d’expérience pouvons-nous la voir à l’œuvre? Heidegger mais aussi Hegel affirment une sorte d’émergence de la conscience de cette identité – qui est d’ailleurs l’identité, mystérieuse (pôs…) déjà affirmé par Aristote[35] . Il s’agit (il s’agirait) d’un arriver du sujet à saisir et à se saisir (pour Hegel comme “Raison”[36]): à partir d’un parcours chez Hegel ou à partir de l’événement d’une situation émotive chez Heidegger. Dans les deux cas, il s’agit de la saisie indépendante de la volonté d’un sujet singulier déjà orienté de façon épistémique et/ou philosophique. Le sujet philosophique ne peut que cristalliser l’émergence de cette conscience d’identité dans une décision au savoir (à la theôria). Il s’agit très clairement de la situation germinale à partir de laquelle on peut remonter, de la situation du “magna quaestio mihi factus sum”[37] à une situation plus sauvage, plus barbare, phénoménologiquement et transcendalement pure[38], plus précisément celle de l’émergence de la theôria.
Toutefois toute cette stratification problématique, se laisse ramener – peut-être de façon (trop) esthétique – à une situation “anthropologique” bien particulière, que Karl Jaspers synthétise de façon magistrale dans une entretien (et que nous pouvons retrouver ensuite aussi dans l’abécédaire de Deleuze[39]): la contemplation de la mer. La mer, l’horizon sont : “cet au-delà, le miroir de ce dont nous avons besoin quand nous dépassons la finitude de notre condition. Cette expérience élémentaire, pour ainsi dire barbare…”[40].
Ce passage, peut-être brutal, choquant, de l’hyper-stratification conceptuelle à la situation élémentaire de l’exposition de chacun à l’horizon des phénomènes, à la situation elle-même, esthétiquement (et émotivement) déterminée, nous indique néanmoins la Sache et la structure qu’il faut y chercher. Car, au fond et au-delà de l’érudition philosophique (pourtant nécessaire et inéludible pour donner forme, voix, structure à cette situation) il y a une Sache pré-philosophique et nécessairement experiencielle.
L’esthétisation expériencielle d’une telle situation – qui peut se retrouver aussi dans les peintures du mouvement romantique allemand (Friedrich, Böcklin) ou magistralement formulé chez Leopardi (L’infini) – correspond à une Sache, porte à expression cette Sache mais ne peut pas en être la source (comme le disait très bien Kant par rapport au sublime mais aussi Heidegger par rapport au sentiment d’angoisse): le sublime et l’angoisse ne sont que des points de manifestation. Et cette Sache est justement le fait qu’il y a une structure fondamentale qui fait de l’Innen et de l’Aussen une identité, une identité sui generis….de quelque façon (pôs, pour reprendre Aristote). De cette identité on fait expérience, avant tout partage entre idéalisme et réalisme, empeiria et epistème.
La question était, encore une fois, comment arriver à fixer cette Sache, en travaillant sur les structures. Ce travail, originairement orienté à saisir la structure d’horizon, a trouvé sa convergence vers la question “que/qui suis-je?” tout simplement en se posant une autre question – à l’apparence dépourvue de sens – par rapport à deux thèmes fondamentaux (de la phénoménologie mais, par translation, de la philosophie transcendantale en tant que telle):
- la dynamique du remplissement dans la réécriture de la sixième recherche logique (qui donne lieu à la formulation cohérente de la structure d’horizon) et
- la topique du phénomène fournie dans Etant donné, qui “ordonne” les phénomènes selon leur caractère de remplissement jusqu’à la forme du phénomène saturé.
La question était la suivante: et si on allait chercher le chiffre de l’expérience non tant vers la saturation mais dans la direction inverse?[41]
Qu’y aurait-il à l’opposé de la saturation du point de vue phénoménologique et épistémique de l’évidence?
N’y aurait-t-il l’extrême détresse intuitive d’un quelque chose d’expériencé selon une modalité bien particulière d’expérience, en défaut presque absolu d’évidence (et de remplissement intuitif)?
En fait, tous ces éléments ont convergé vers la question “que/qui suis-je?”, c’est-à-dire, pour caricaturer brutalement, vers quelque chose qu’on a toujours eu sous les yeux – du moins philosophiquement, à partir de la toute première configuration de la theôria Grecque, en passant par la Gnose et le “quaestio mihi factus sum” d’Augustin – sans y prêter attention.
Elle est quelque chose qui a été philosophiquement toujours sous nos yeux.
On n’y a pas prêté attention lorsque on a lu les passages sur l’angoisse dans Sein und Zeit ou des passages du tome XV de Husserliana[42], en se focalisant uniquement sur ce qui nous avait été mis sous les yeux, sans interroger la situation fondamentale qui le rendait possible, que ce soit dans la forme du sujet transcendantal (Husserl) ou dans la forme du Dasein (Heidegger). On n’y a pas prêté attention lorsqu’on a considéré le passage mentionné de la raison dans la Phénoménologie de l’esprit, car on se concentrait sur le principe de l’idéalisme et non pas sur l’état neutre, pré-philosophique qui pouvait le rendre éventuellement possible.
On n’y a pas prêté attention lorsqu’on a considéré la quatrième des questions kantiennes qui structurent architectoniquement l’entreprise critique. On n’y a pas prêté attention lorsque on a lu et relu, commenté et recommenté (et souvent aussi misinterpreté) le “je suis, j’existe” de Descartes.
En-déca de toutes ces figures réside la question, la question qui les organise autour de la réflexion philosophique sur la subjectivité mais laquelle, en tant que situation plus originaire, est tellement familière qu’on n’y prête pas attention. Elle indique une Sache et une structure nécessaire à toute prise de position philosophique sur le sujet, soit elle celle de l’empirisme radical de James (“all that!”[43]) ou de l’idéalisme hégélien.
Et cette Sache, j’ai fait des recherche à ce sujet, n’est pas non plus dépendante de la structure interrogative des langues indo-européennes[44], comme l’ontologie et l’hypostase de l’òn à partir de la copule. Cette Sache indique que il y a un “se tenir ensemble (de l’expérience)” déterminé, comme “se-tenir-ensemble”, ouverture thématique et synoptique, par la suspension du sens de validité de cette unité. Et cette suspension – donc aussi ce qu’elle détermine, c’est-à-dire l’ouverture thématique et synoptique – se manifeste dans la question elle-même, ou dans le moment où l’on persiste dans cette question, on (se) regarde dans le miroir de cette question, on fait expérience par cette question.
La question a toujours été là, à la base de nos existences, de nos cultures, dans plusieurs formes[45], il fallait uniquement la considérer comme forme d’expérience dans et par laquelle on a accès à une Sache. Une fois fait cela, il n’était pas difficile la mettre en relation avec quelque chose d’autre, une structure, qui demeure occultée par les formes “responsives” de caractérisation de l’homme et du sujet, toujours explicitement ou implicitement métaphysiques.
Cette structure est le “Je-horizon” – pas le Je qui a un horizon mais le Je qui est un horizon – une structure qui réside en-déca de toute prise de position philosophique sur le sujet. Et si on l’appelle “field of consciousness” à l’anglo-saxonne, la chose ne change pas, on appauvrit uniquement les potentialités d’interprétation philosophique de la chose elle-même. Le problème ce n’est pas le nom, mais le fait qu’il y ait une unité à l’intérieur de laquelle se placent des lambeaux, des unités de sens.
Le fait de faire expérience de la question révèle en fait un plenum d’expérience (au-sens du “all that” de l’empirisme radical jamesien) tenu ensemble par quelque chose, et ce quelque chose est l’orientation thématique de la question sur ce quoi ou qui je suis. Ce n’est pas le Moi (Ich) qui est saisi, ce n’est pas le (plenum du) Monde qui est saisi – tous les deux des termes métaphysiques bien postérieurs. Dans la visée du “Je” suspendu dans la question neutralisée “que/qui suis-je?”, ce qui est saisi est l’unité synoptique et thématique de toute ouverture à quelque chose. Cette Sache, comme intentionnellement dedans et dehors, est l’horizon que nous sommes.
La question “que/qui suis-je?” est donc première? Certainement elle n’est ni première au sens ontogénétique ni au sens phylogénétique: au sein de toutes nos existences et au sein de toutes nos cultures on a du passer pour une infinité de questions avant d’arriver tout simplement à les formuler.
La question n’est pas non plus originaire, ou n’est pas originaire au sens ontologique ou en quelque sorte sotériologique. En quel sens elle est donc première? Elle est première peut-être au sens de l’Urphänomen de Goethe, un phénomène marginal, auquel on ne prête pas forcement attention mais qui recèle en lui-même une structure fondamentale (donc transcendantale) de l’expérience[46]. La question est donc première tout d’abord au sens métonymique, car comme Urphänomen ou (dans sa modification de neutralité, dans sa suspension), phénomène transcendantal originaire[47], montre en-deçà de toute prise de position philosophique (donc ontologique, donc métaphysique) la Sache. Elle montre le “fait” – pour s’exprimer avec Heidegger le “phänomenologischer Tatbestand”[48] – que, en tant que pure situation, je suis infiniment plus étendu, au sens que je suis projeté en profondeur thématique, que moi-même comme point. Et cet être projeté comme horizon n’est que la structure fondamentale (je-horizon), expérienciée de façon auto-affective par la question, la structure qui tient ensemble ce qui se montre au sein de toute ouverture thématique possible. Autrement dit: je suis déjà assigné à moi-même sous la figure d’horizon, ce qui résiste à la puissance extreme, à la ruse et à la malice qui ne sont pas celles du malin génie mais du réel lui-même qui se transforme et se soustrait à l’uni(ci)té de notre compréhension épistémique[49].
D’un autre coté la question est première car elle est la souche germinale d’une crise épistémique profonde. Et cela me ramène à une autre question que vous avez posé, celle de la présence d’une question qui pourrait être vulgairement prise comme (uniquement) existentielle pour une démarche qui conduit à la définition de formes de mathesis.
Or, ce fait est étrange si l’on ne considère pas deux facteurs, l’un général (externe, dirais-je, à la démarche en question), l’autre particulier (ou interne à la démarche de Philosophie et demande).
Le premier est le fait que toute connaissance demeure toujours et constitutivement une science faite par l’homme, sans que cela représente la dérive dans une sorte de relativisme ou de négation de l’objectivité des sciences. Toutefois – au-delà des fausses interprétations dans la direction heideggerienne et vulgairement herméneutique de la révolution anti-copernicienne en phénoménologie[50], ou aussi de certaines naïvetés (un peu réactionnaires dirais-je) d’Husserl sur la relativité einsteinienne ou pire sur la mécanique quantique – le savoir demeure un fait “humain”, que l’on ne peut pas déléguer à un ordinateur (car l’ordinateur justement n’est pas en demande de sens) ni l’on peut dérubriquer à simple activité formelle-computationnelle (les recettes de cousine comme prétendait Croce). Cela équivaut à affirmer que si, à bon droit, l’épistémologie peut devenir épistémologie de telle ou telle autre science – sur l’arrière-plan d’une épistémologie générale, cela n’est pas permis à une prôte epistème. Cela ne doit point représenter l’apologie de l’ignorance d’une telle démarche à l’égard du savoir qui se fait et qui s’est fait, mais ne peut pas non plus faire comme si le savoir ne prenne point départ d’une demande radicalement humaine (de savoir, de sens) et qu’elle ne revienne pas à structurer, transformer, révolutionner cette Lebenswelt à partir de laquelle trouve et a toujours trouvé son essor.
Or, il est clair que ce “trouver essor” et ce “revenir” du savoir, de l’épistème à la Lebenswelt ne doit à tout jamais signifier une réduction de l’évidence au subjectif. Elle ne doit toutefois non plus signifier une mise à l’écart de l’étude (soigneuse) sur les positivité comme formes qui ont une teneur de stabilité radicalement indépendante de la subjectivité singulière ou duale ou plurielle qui les saisit ou les amène à la lumière du jour. Mais la tache d’une telle prôte épistème spéculative (mais non métaphysique telle que je la définis) a le grand problème, qu’elle excède la “simple” interprétation de la demande de sens de l’existence telle que peut se déployer au niveau strictement basal, horizontal, de l’ouverture de la Lebenswelt.
Cette ouverture de la Lebenswelt comme multidimensionnalité qui se montre par la demande “que/qui suis-je?” peut être lue bien évidemment comme le point de départ mais ne peut pas être lue comme seule et exclusive dimension de Philosophie et demande. Si l’on veut, la question “que/qui suis-je?”, par sa dynamique interne, fournit la toute première ouverture intuitive à cette dimensionnalité plurielle et intriquée, de cette multi-dimensionnalité plastique. La saisie de la teneur épistemiquement “informe” (ou non clairement structurée) de la Lebenswelt du point de vue de la mathesis (d’une prôte épistème non-métaphysique), telle qu’elle s’annonce au stade de la question, ne dois pas être tenue par exclusive. Tout au contraire! Elle est fonctionnelle à une construction dans et par laquelle on s’éloigne progressivement de cette saisie informe pour donner forme et structure à des formes d’expérience et de mathesis nouvelles. Ces formes, tout en émergeant de cette dimension, ne peuvent qu’en s’éloigner pour la retrouver ensuite dans la forme, transfigurée, de “chora épistémique”[51]. Cette dernière est celle qui rend possible toute méta-ontologie constructive, dans la mesure où – sans vouloir rentrer dans des détails épistémiques fort ennuyeux – aujourd’hui et notamment pour la modélisation des phénomènes complexes, les dichotomies comme “nature-esprit”, “physique-social” etc. ne sont pas seulement dépassées mais posent des obstacles à la saisie épistémique. La Lebenswelt abandonnée mais surtout retrouvée aussi comme “chora épistémique” nous laisse aussi comprendre comment la dimension essentiellement complexe de cette ouverture expériencielle peut être portée à intelligibilité de façon toujours épistémiquement plus pertinente sans pourtant y être épuisée.
L’éloignement progressif des formes de mathesis se fait toutefois par des formes de questionnement – qui résident, par leur dynamique interne, à la base des autres formes de mathesis – et qui gardent en elles une trace de la demande originaire. Cela dans la mesure où elles représentent le résultat d’un processus spéculatif qui relève de la même demande et la pose à l’intérieur d’un horizon qui a changé, s’est métamorphosé (tout comme la vision qui doit l’explorer).
Or, pour expliquer ce processus il faudra beaucoup plus de pages qu’il a fallu pour éclaircir a minima ce premier passage. Il suffit toutefois de remarquer, comme il est fait dans Philosophie et demande, que la demande de sens du savoir – qui réside à la base de et ouvre la dimension de la mathesis métathéorique – garde en elle-même, comme relevée, la question “que/qui suis-je?” . Elle se laisse comprendre à partir d’un moment critique, de rupture, de perte de sens d’une forme de vie laquelle, à son tour, se laissera comprendre uniquement à partir de la mathesis méta-égologique. De même pour la question “ti tò òn;” laquelle transfigure la demande de sens au niveau d’un horizon théorique à l’intérieur duquel l’être du théorique arrive au questionnement nécessaire de l’être de la theôria elle-même. La question “que/qui suis-je?” se retrouve enfin retraduite, relevée donc et transfigurée au début de la mathesis méta-métaphysique dans la mesure où la question “qu’est-ce que (le) réel?” pose, en régime de relativité ontologique, la demande de sens d’une rationalité à l’intérieur d’un horizon qui n’est plus structuré par un présupposé/primat ontologique.
Il ne s’agit pas d’un mouvement linéaire, uni-dimensionnel, prototype auquel notre idée de démonstration demeure illusoirement attachée. En étant l’ouverture constructive de dimensions du savoir, l’enchainement de ces questions doit être pensé, à chaque fois, comme ouverture d’un espace nouveau à l’intérieur de cette dimension par le point aveugle, par l’incomplétude qui l’affecte, un point aveugle, une béance, un Umschlag à partir desquels s’ouvre un autre espace thématique et se définit cette forme de mathesis qui lui est appropriée. Ce qui tient ensemble, et qui laisse croiser ces dimensions est un fait, essentiel: l’impossibilité structurelle que cette première question – expression nue de la demande de Sens – même dans ses sublimations épistémiques, ne peut pas trouver, théorétiquement, réponse.
Cela nous fais revenir à mon avis, avec un regard plus pertinent, à vos questions précédentes concernant la mathesis.
D’un coté vous affirmiez, à bonne raison, que
- “Philosophie et demande, commence par cette question orientée subjectivement alors que ce qui est en jeu, c’est la notion même de réel”.
- “Il me semble que c’est là pour vous la définition même du réel – ce qui ne se laisse pas saisir, ce qui est toujours en excès par rapport à la theôria: le diffus, le complexe”.
Pour enfin demander:
et si cette mathesis est bien une mathesis de l’instabilité […] alors quelle est sa source ?
Je voudrais revenir sur le premier point, car on pourrait penser que la question orientée subjectivement et la notion même de réel soient ou bien aux antipodes ou bien incompatibles. Or, cela dépend de l’horizon de pensée à l’intérieur duquel l’on pense cette relation, et de la texture intime de la démarche de pensée qui les mets en relation et/ou en opposition. Bien évidemment on peut penser l’opposition comme un choix nécessaire à prendre pour developper ou bien une pensée d’orientation existentielle ou bien la construction ou la définition d’une construction épistémique du réel tel qu’il est saisi par les savoirs positifs.
Sauf que c’est à mon avis l’opposition elle-même qui est fallacieuse et le fait de penser en régime de suspension de la notion de “philosophie” suspend aussi cette dichotomie et nous fait retrouver une corréspondance perdue en vertu d’une simple prise de position arbitraire. Car la compléxité du réel se manifeste oui, de façon “structurée”, au niveau épistémique mais elle apparait aussi et simplement, de façon germinale, sur l’arrière-plan de la question que plus de toutes énonce l’impossibilité de se retrouver dans la compléxité de ce réel. Cette question, sur laquelle nous avons déjà dit beaucoup – par rapport à son rôle au sein de “Philosophie et demande” – est et ne peut qu’être la question “que/qui suis-je?”.
Donc plutôt que la penser comme une opposition, je concevrais la relation entre “notion du réel” et la “question orientée subjectivement” comme un rapport de spécularité. En fait, dans une telle spécularité, ce que vous définissez comme “question orientée subjectivement” ne s’avère qu’une ouverture thématique, interrogative vers un horizon du monde, du réel auquel nous n’arrivons pas à prêter une physionomie fixe, lequel ne se manifeste selon l’unité de Sens à partir duquel pouvoir y penser notre existence.
De même, la “notion du réel” – que je ne définirais point comme le point d’arrivée d’un tel parcours – fait “sens” uniquement pour un individu, pour une communauté, pour notre humanité. Une telle notion est vraiment ce qui fait constitutivement défaut dans Philosophie et demande car elle serait, comme notion, statique. En revanche la façon par laquelle la phénoménalité complexe à la quelle nous sommes tous exposés peut se fixer dans sa réalité (ou dans ses réalités), et uniquement par là faire sens, est ce qui motive seulement Philosophie et demande.
Le but de Philosophie et demande – mais, on pourrait aussi dire de La complexité et les phénomènes, dans la mesure où il en représente l’approche propédeutique nécessaire – est d’arriver à définir un cadre à l’intérieur duquel la pensée puisse faire expérience de la métamorphose de sa vision. Une telle métamorphose n’est pas optionnelle, elle est demandée pour comprendre la complexité de l’ouverture phénoménale à la quelle toute forme d’existence est nécessairement exposée. Cela équivaut à déployer non seulement une multiplicité de concepts nouveaux ou d’individuer des structures ou de cadres relativement nouveaux (qui se cristallisent dans les thèses sur les formes de mathesis aux Chapp. VI-IX). Cela équivaut aussi et surtout à les inscrire au sein d’une expérience (de pensée). C’est pour cette raison que l’expression “mathesis des instabilités” par elle-même ne représente pas grand chose. Pour mieux dire elle est équivoque, dans la mesure où on la peut prendre:
- aussi bien comme l’expérience des instabilités du sens de notre expérience singulière du réel;
- que comme connaissance des instabilités qui se montrent dans des approches épistémiques au complexe (bifurcations, théorie des catastrophes, systèmes chaotiques etc.).
Le premier problème est ici que, si on prend la relation dont on a fait mention auparavant comme une opposition, à savoir comme un choix philosophique indépassable, on aboutira toujours à une mathesis amputée (ou bien de sa consistance épistémique ou bien de sa signification “humaine”, pour les hommes et pour la communauté humaine que nous sommes). Un second problème est que c’est uniquement dans la transition d’une dimension (l’existentiel) à l’autre (l’épistémique), du particulier (de l’expérience de chacun) à l’universel de la structure (épistémique) que peuvent faire face des dimensions qui structurent une telle spécularité. Ce qui se métamorphose dans cette transition, et dans/par les construction qu’elle demande en vertu d’une logique et d’une cogence interne point arbitraire, est la theôria elle-même. Que la transition nécessaire pour instituer cette spécularité soit difficile, même douloureuse dirais-je, est le prix à payer pour une pensée dans laquelle le singulier se reflète dans l’universel et l’universel (d’un savoir, mais plus généralement d’un sens de l’être-au-monde) se reflète au sein de la singularité dans sa capacité de transformation.
En ce sens, une “phénoménologie” de la question n’est jamais fondamentalement une “phénoménologie” de la curiosité mais arrive à toucher, de façon peut-être inattendue, par les développements et les transformations qu’elle exige, la nature même de la raison.
***
[1] F. Fraisopi, Philosophie et demande. Sur la métaphilosophie, Paris, Classiques Garnier, 2021. Cfr. également Id., Philosophie und Frage, vol. II, Untersuchungen über die Formen der mathesis, Freiburg i.B. – München, 2016.
[2] M. Heidegger, Sein und Zeit, HGA 2, Frankfurt a. M., Klostermann, 1977, § 2, pp. 6-12.
[4] M. Meyer, De la problématologie, Paris, PUF, 2008.
[5] Loc. cit.
[6] Cfr. M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 150.
[7] J. Farges, Husserl: la phénoménologie comme philosophie du sens. In: Philosophie,155, 2022, p. 18-37.
[8] M. Richir, Métaphysique et phénoménologie. In: E. Escoubas – B. Waldenfels (Hrsg.): Deutsche und französische Phänomenologie, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 127.
[9] A. Schnell, Le clignotement de l’être, Paris, Hermann, 2021, p. 169.
[10] Clement d’Alexandrie, Excerpta ex Theodoto, 78.2, tr. Fr. Extraits de Théodote, Paris, Cerf, 1976 ad. loc.
[11] Cette question, absente dans la Critique de la raison pure [B 832 – A 804] s’ajoute dans la lettre de Kant à Stäudlin du 4 Mai 1793 [Ak. IX, p. 429]. Et la considération explicite de sa fonction architectonique se trouve uniquement dans la Logik Jäsche, Ak. IX, p. 25.
[12] Cf. F. Fraisopi, Die Idee einer spekulativen Phänomenologie (als Mathesis), in F. Fraisopi (Hg.), Radicalizing Phenomenology. Neue Perspektiven – Nouvelles perspectives, Phänomenologische Forschungen, 2021/2, p. 183-216, p. 186/7.
[13] C. Hooker, Introduction to „Philosophy of Complex Systems“, North-Holland, Elsevier, 2011, 3.
[14] J. Benoist, Que le complexe n’est pas du simple plus compliqué, in F. Fraisopi, La complexité et les phénomènes. Nouvelles ouvertures entre science et philosophie, Paris, Hermann, 2012, p. 10.
[15] https://www.youtube.com/watch?v=N-Bq6Ioji28&t=1558s (min. 17 ff.)
[16] Cf. Kôsmos et theôria: génealogie(s), in: Philosophie et demande, op. cit., Chap. 6, pp. 125-130; Les plans des dialectiques, Chap. 7, pp. 140-147.
[17] Aristote, Métaphysique, IV, 1006 a.
[18] Ibid., p. 205.
[19] Ibid., p. 207.
[20] M. Bitbol, Maintenant la finitude. Peut-on penser l’absolu?, Paris, Flammarion, 2019.
[21] Cf. Philosophie et demande, op. cit., p. 178-186. Cette thématique est développée de manière analytique dans Untersuchungen über die Formen der Mathesis, op. cit., §§ 85-86, 459-470.
[22] Philosophie et demande, op. cit., p. 222.
[23] Ibid., p. 59.
[24] Cf. à ce sujet, Chap. VI, pp. 112-130 et notamment “Thèses sur la mathesis méta-égologique”, pp. 120-122.
[25] Et, je voudrais le souligner sur la base d’acquis scientifiques bien concrets qui se sédimentent depuis vingt ans et qui sont largement acceptés et discutés. La pertinence de cette méthode a été confirmée, récemment, par une publication dans la Physical Review Letters du janvier 2018 (cfr. I. Iacopini, S. Milojevic, V. Latora, Network Dynamics of Innovation Processes, in Physical Review Letters, 120, 2018).
[26] Cf. à ce sujet, Chap. VII, pp. 131-168 et notamment “Thèses sur la mathesis méta-théorique”, pp. 120-122 et notamment “Thèses sur la mathesis méta-théorique”, pp. 158-161.
[27] Et encore une fois, sur la base d’acquis scientifiques bien concrets qui se sédimentent cette fois depuis trente ans ou plus: M. Mahfoudh – G. Forestier – L. Thiry – M. Hassenforder, Algebraic graph transformation for formalizing ontology changes and evolving ontologies. In: Knowledge-Based Systems, Volume 73, 2015, p. 212-226. Cf. également G. Taentzer – F. Mantz – Y. Lamo, Co-transformation of Graphs and Type Graphs with Application to Model Co-evolution. In: Ehrig, H., Engels, G., Kreowski, HJ., Rozenberg, G. (eds) Graph Transformations. ICGT 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7562. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
[28] Cf. à ce sujet, Chap. VIII, pp. 169-194 et notamment “Thèses sur la mathesis méta-ontologique”, pp. 192-194.
[29] Cf. à ce sujet, Chap. IX, pp. 195-218 et notamment “Thèses sur la mathesis méta-métaphysique”, pp. 213-218.
[30] Cf. à ce sujet, mais uniquement par rapport à la modélisation de la complexité du vivant F. Bailly – G. Longo, Mathématiques et sciences de la nature. La singularité physique du vivant, Paris, Hermann, 2007, p. 217-20. A partir dette forme de modélisation de formes “complexes” d’objectité [Gegenständlichkeit], analysée dans La complexité et les phénomènes [op. cit., 92 passim] on avait esquissé une première forme de modélisation méta-ontologique (ibid., p. 463-488).
[31] Untersuchungen über die Formen der Mathesis, op. cit., §§ 1-15, pp. 139-190.
[32] Cette alternative, et précisément par rapport à l’émergence de la theôria chez les premiers penseurs grecs, a été récemment analysée par Klaus Held, Die Geburt der Philosophie bei den Griechen. Eine phänomenologische Vergegenwärtigung, Alber Verlag, Baden-Baden, 2022, p. 128-149.
[33] Cfr. par exemple F. Fraisopi, L’ouverture de la vision. Kant et la “phénoménologie implicite” de la Darstellung, G. Olms, Hildesheim – Zürick – New York, 2009, pp. 275-301, 407-425; A. Schnell, Zeit, Einbildung, Ich. Phänomenologische Interpretation von Kants “Transzendentaler Kategorien-Deduktion”, V. Klostermann, Frankfurt a.M., 2022, p. 118-129.
[34] E. Husserl, Intentionnalité et être-au-monde, Hua. XV, p. 549-556 (§ 8), tr. fr. in D. Janicaud (éd.), L’intentionnalité en question entre phénoménologie et recherches cognitives, Paris, Vrin, p. 145.
[35] Aristotelis De anima, 431b 20.
[36] Vgl. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in Hegels Werke, Frankfurt a/M, Suhrkamp, Bd. 3, S. 179 : “Die Vernunft ist die Gewißheit des Bewußtseins, alle Realität zu sein; so spricht der Idealismus ihren Begriff aus. Wie das Bewußtsein, das als Vernunft auftritt, unmittelbar jene Gewißheit an sich hat, so spricht auch der Idealismus sie unmittelbar aus: Ich bin Ich, in dem Sinne, daß Ich, welches mir Gegenstand ist, nicht wie im Selbstbewußtsein überhaupt, noch auch wie im freien Selbstbewußtsein, dort nur leerer Gegenstand überhaupt, hier nur Gegenstand, der sich von den anderen zurückzieht, welche neben ihm noch gelten, sondern Gegenstand mit dem Bewußtsein des Nichtseins irgendeines anderen, einziger Gegenstand, alle Realität und Gegenwart ist. Das Selbstbewußtsein ist aber nicht nur für sich, sondern auch an sich alle Realität erst dadurch, daß es diese Realität wird oder vielmehr sich als solche erweist”.
[37] Cfr. par exemple Augustinus, Confessiones, X, 6 : « et direxi me ad me et dixi mihi, « tu qui es ? » et respondi « homo », et ecce corpus et anima in mihi praesto sunt, unum exterius et alterum interius. Quid homo est, inde quaerere debui deum meum, quem iam quaesiveram per corpus a terra usque ad coelum, quousque potui mittere nutais radias ocularum meum ? ».
[38] Ce mouvement régressif s’est cristallisé tout d’abord dans une étude plus courte, déjà publiée et ensuite dans une étude plus longue qui va être intégrée dans la version Française des Recherches sur la forme de la mathesis. (Die Schau und das Spekulativ Der Verlust der griechischen Idee der « theôria » und das Spekulativ bei Augustinus [De Trinitate XV]). Cf. à ce sujet une version abrégée dans Horizon and Vision. The Phenomenological Idea of Experience versus the Metaphysics of Sight. In: Horizon. Studies in Phenomenology, 4 (1) 2015, p. 124-145.
[39] Je me réfère à l’anecdote de la fillette du Limousin face à la mer, contenu dans l’abécédaire de Deleuze, E comme Enfance.
[40] Karl Jaspers, Ein Selbstportät, Disponible sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PQmR4nxk0AA
[41] Philosophie et demande, op. cit., pp. 49-53.
[42] Cfr. par exemple E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, in Husserliana, Bd. XV, Den Haag, M. Nijoff, 1973, p. 153: “Die Frage, was bin ich, was ist der Mensch, die Menschheit, beantwortet die Transzendentalphilosophie durch ihre tiefste Auslegung der Subjektivität als sich selbst und Welt konstituierender”.
[43] W. James, A World of pure experience. In Essays in Radical Empiricism, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1976, p. 21-44, S. 36: “The instant field of the present is always experienced in its pure state, plain unqualified actuality, a simple that, as yet undifferentiated into thing and thought, and only virtually classifiable as objective fact or as some one’s opinion about fact”.
[44] En Chinois, par exemple les deux questions, c’est-à-dire “qui suis-je?” Et “qu’est-ce que je suis?” peuvent être formulées comme 我是誰?(wo shi shui?) et comme 我是什么?(Wo shi shen me?)
[45] Y compris le bouddhisme, la pratique zen japonaise et beaucoup d’autres formes qui n’appartiennent pas au code de la pensée occidentale.
[46] J. W. Goethe, Farbenlehre. In Werke, Bd. 13. X [Dioptrische Farben], § 175, S. 376, tr. fr. Paris, Triades, 1980, p. 138/9: “ Les phénomènes que nous percevons par nos sens ne sont le plus souvent que des cas qui, avec quelque attention, peuvent être rattachés à des rubriques générales connues empiriquement. Celles-ci, à leur tour, se classent sous des rubriques scientifiques qui elles-mêmes renvoient à un niveau supérieur et ainsi portent à notre connaissance certaines conditions indispensable du phénomène. C’est à partir de là que, peu à peu, tous les phénomènes apparaissent soumis à des règles et à des lois supérieurs qui se révèlent non par des mots et des hypothèses à notre entendement, mais par des phénomènes à notre vue intuitive. Nous nommons ceux-ci phénomènes primordiaux [Urphänomene], car rien dans ce qui se manifeste visiblement n’est au-dessus d’eux, et par contre ils sont parfaitement aptes à nous faire revenir par degrés le long de la voie par laquelle nous nous étions élevés jusqu’au cas le plus commun de l’expérience quotidienne”.
[47] Untersuchungen über die Formen der Mathesis, cit., § 16, p. 191-194.
[48] M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Frankfurt a. M., Klostermann, GA 24, 1997, p. 227.
[49] Je cite et je paraphrase ici, pro domo mea, des considérations que J.-L. Marion développe à propos de la seconde Méditation dans une émission de France Culture dont le titre est: “Qui suis-je?” de 2017. C’est une convergence inconsciente (Philosophie und Frage est parue dans sa version allemande en 2016) qui m’intrigue profondément.
[50] Contre ces fausses interprétations on ne peut bien évidemment que conseiller le livre et plus en général la démarche de Dominique Pradelle. Cf. à ce sujet D. Pradelle, Généalogie de la raison. Essai sur l’historicité du sujet transcendantal de Kant à Heidegger, Paris, PUF, 2013.
[51] Cf. Untersuchungen über die Formen der Mathesis, cit. § 115: Erfahrungsboden als epistemische Chora, p. 588-590.








