Entretien avec Bernard Suzanne : Autour de la traduction de Platon (partie 1)
B : La supposée théorie des Idées
AP : Un de vos articles, intitulé « De quoi parlons-nous ? Pour en finir avec la théorie des formes / idées attribuée à Platon[1] », au demeurant passionnant, cherche à rendre compte de l’écart manifeste dont témoigne l’Etranger du Sophiste à l’endroit d’une « théorie des Idées ». L’essentiel de l’argumentation, très serrée, concerne le rapport de Platon aux eidè qui, selon vous, ne serait pas exactement un « ami des eidè » comme l’évoque l’Etranger. Avant toutes choses, comment traduisez-vous eidos, et quel rapport établissez-vous entre l’eidos et l’idea[2]?
BS : La raison pour laquelle Platon n’est pas un ami des eidè au sens que l’Étranger du Sophiste donne à cette appellation est qu’il les place en opposition avec les fils de la terre (les « matérialistes »), dans un « combat de géants » (gigantomachia, 246a4) à propos de ce qui est ou pas ousia (étance »), donc dans une logique d’exclusion. Or je viens de dire que justement Platon n’était pas dans cette logique d’exclusion, quoi que puissent en penser les tenants d’un « théorie des idées » qu’aurait avancée Platon, mais dans une logique d’inclusion. Pour Platon bien compris, tout ce dont on parle « est » par le simple fait qu’on en parle et qu’on peut donc dire à son propos « c’est… ». La question n’est alors pas de savoir si « c’est » ou « ça n’est pas », mais ce que c’est, quelle est son « étance », son ousia. Ce peut n’être qu’un mot, comme schmilblick, sans contrepartie hors de lui, mais dans ce cas, « c’est » au moins un mot ! C’est en ce sens que Platon, qui fait parler l’Étranger, est au-dessus de la mêlée et pas plus fils de la terre qu’amis des eidè, si cela veut dire refuser à une partie des « étants » (onta), les « étants » matériels ou les « étants » purement intelligibles, le statut d’« étants » (onta) en leur refusant toute « étance » (ousia), alors même que, pour ce faire, on en parle, ne serait-ce que pour nier qu’ils « sont », ce qui en fait au moins des mots.
Concernant eidos, vous ne serez pas surpris après tout ce que j’ai dit auparavant, si je vous dis que sa traduction (ou non traduction) dépend du contexte et surtout que le plus important n’est pas de traduire, mais de comprendre ! D’autre part, les mots que je n’utilise pas pour traduire eidos peuvent être aussi significatifs que celui que je finis par utiliser quand je traduis. Ne pas traduire eidos par « forme » ou par « idée » là où tout le monde attendrait l’une ou l’autre traduction dit quelque chose autant, sinon plus, que le mot que je pourrais choisir pour le traduire, au moins pour ceux qui sont déjà un peu familiers avec Platon et ses commentateurs.
Ceci étant dit, dans la version d’octobre 2012 de ma traduction de l’analogie de la ligne, au contraire de ce que j’avais fait dans la première version remontant à 2001, j’avais décidé de traduire toutes les occurrences d’eidos dans l’analogie par le même mot, pour permettre au lecteur de voir au moins que c’était le même mot en grec, ce qui me semblait plus important que de choisir dans chaque cas une traduction, au besoin différente de celle utilisée pour d’autres occurrences, supposée par le traducteur mieux adaptée à chaque contexte spécifique, et j’avais choisi de revenir au sens premier du mot, qui est « apparence (visuelle) », comme c’est d’ailleurs aussi le cas pour idea. Et la suite m’a prouvé que ce choix était des plus éclairants sur les propos de Platon.
AP : Diriez-vous alors que la notion d’apparence, contrairement à un cliché péniblement répandu, n’est pas combattue par Platon, ni mise en opposition à ce qui serait une sorte de réalité authentique ?
BS : Il faut prendre ici « apparence » dans le sens A du TLFI[3], « Manière dont quelque chose apparaît, se manifeste », soit aux sens (sens A1), soit à l’esprit (sens A2), et non pas dans le sens B, « Aspect seulement superficiel, souvent trompeur d’une chose, par opposition à sa réalité ». Ce que ce choix de traduction, éclairé entre autres par l’allégorie de la caverne bien comprise et le mythe de l’âme du Phèdre, m’a finalement permis de comprendre, c’est que ce sur quoi veut insister Platon à travers ce choix de mot, c’est sur le fait que, dans le sensible comme dans l’intelligible, c’est-à-dire par le biais des sens, et de la vue en premier, aussi bien que par le biais direct de l’esprit/intelligence (noûs), ce que nous appréhendons par ces « organes », noûs compris, est conditionné par le pouvoir, les spécificités et les limites de chacun d’eux. Nous n’avons pas de mal à admettre que l’ouïe ne nous donne accès qu’à des sons, l’odorat qu’à des odeurs, le goût qu’à des saveurs, le toucher qu’à des sensations purement tactiles, nous avons déjà un peu plus de mal à admettre que la vue ne nous donne accès qu’à des couleurs dans un « espace » bidimensionnel et pas même à des « formes », qui résultent de l’analyse qu’en fait l’esprit, et donc à admettre que chacun de ces sens ne nous donne qu’une appréhension partielle de ce qui les active, mais le plus souvent, nous ne nous posons même pas la question de savoir si notre esprit nous donne, ou peut nous donner, une appréhension complète et exhaustive de ce qu’il considère. Pour Platon, notre noûs (« esprit/intelligence ») est un moyen supplémentaire d’appréhender ce qui agit sur nous, les pragmata (« choses/faits »), qu’ils agissent aussi sur nos sens ou seulement sur lui sans la médiation des sens. Et il n’y a pas plus de raisons de penser que cette appréhension nous donne une « vue » exhaustive et parfaitement adéquate de ce qui l’active, qu’il n’y en a de penser que c’est le cas pour la vue sensible, où nous savons justement, si nous prenons le temps d’y réfléchir, que ça ne l’est pas. Et d’ailleurs, nous n’avons aucun moyen de savoir si c’est le cas puisque nous ne disposons pas d’autres « organes » d’appréhension que les cinq sens et l’intelligence (noûs) : si, en tant qu’êtres humains, nous n’avions pas le sens de l’odorat, rien ne nous permettrait de savoir que certains pragmata émettent quelque chose qui pourrait activer des récepteurs spécialisés d’une manière qui pourrait être analysée par notre esprit comme des odeurs. Dit dans le langage du mythe de l’âme du Phèdre, les âmes humaines ne peuvent passer de l’autre côté du ciel, dans le lieu supra-céleste (ton huperouranion topon, Phèdre, 247c3), auquel seuls les dieux ont accès, et où l’on peut accéder aux « ça-même » (ta auta).
Dans l’allégorie de la caverne, dans laquelle le mot anthrôpos, toujours employé au pluriel, fait référence aux âmes humaines, Socrate nous montre ces âmes à la fois comme sujets susceptibles d’apprendre sous la forme des prisonniers enchaînés (anthrôpous en République VII, 514a3) et, dans la ligne du gnôthi sauton (« apprends à te connaître toi-même »), comme objets de connaissance pour ces sujets apprenants sous la forme des porteurs cachés par le mur dans la caverne (anthrôpous en République VII, 514b8), qui figurent ces âmes en tant qu’invisible aux yeux et ne devenant « visibles », c’est-à-dire intelligibles, individuellement qu’une fois le prisonnier sorti de la caverne (anthrôpôn en 516a7), en même temps que tout le reste de ce qui était visible dans la caverne (kai tôn allôn, id.). Et il nous montre ces objets de connaissance à travers quatre « représentations » correspondant aux quatre segments de la ligne : dans la caverne (c’est-à-dire dans le visible), comme ombres de statues d’hommes sexués (andriantas, 514c1, construit sur la racine anèr, qui signifie « homme » par rapport à « femme »), figurant l’« image » que nous donne la vue de tout ce qu’elle appréhende et correspondant au segment de l’eikasia ; comme ces statues d’hommes portées et « animées » par les anthrôpoi/âmes cachés par le mur, figurant les corps matériels et correspondant au segment de la pistis ; puis, hors de la caverne (dans l’intelligible), d’abord, le temps de s’habituer à la lumière du soleil/bon, comme ombres et reflets des anthrôpoi/âmes redoublés hors de la caverne, c’est-à-dire comme logoi tenus par (ombres) et sur (reflets) eux dans ce qui correspond au segment de la dianoia ; enfin ces anthrôpoi/âmes eux-mêmes (auta, 516a8) dans ce qui correspond au segment de la noèsis, si tant est qu’on puisse accéder à ce stade, par une appréhension qui ne peut être qu’incommunicable, puisque la communiquer ne pourrait se faire que par des logoi et nous ferait donc retomber au niveau précédent (les astres, découverts dans l’étape suivante, d’abord à travers leurs reflets, puis directement, ce sont les ideai purement intelligibles aussi bien du bon (le soleil) ou du juste, que de l’homme (la lune ?), ou du lit ou de la table, ideai qui ne sont pas visibles dans la caverne, ce qui explique que le découpage de la ligne se fasse en deux segments inégaux, avec le segment de l’intelligible plus grand que le segment du visible, sans qu’il soit besoin de connaître la proportion (logos au sens mathématique de « rapport ») entre les deux segment à respecter dans ce découpage). Mais ce qui distingue dans le visible l’eikasia (les ombres) de la pistis (les statues d’hommes), le logos (justification logique) n’est pas le fait que nous voyons des images dans le premier cas et les originaux de ces images dans le second, mais le fait que, dans le premier cas, nous ne sommes pas conscient de ce que nous ne voyons que des images (« ceux-là ne pourraient tenir pour le vrai autre chose que les ombres des objets fabriqués », 515c1-2), alors que, dans le second, nous avons compris que la vue ne nous donne qu’une image partielle de ce qui l’active. Transposant dans le découpage du segment de l’intelligible, que Socrate nous invite à faire ana ton auton logon (« selon le même logos », VI, 509d7-8), qui, contrairement à ce que pensent tous les commentateurs, n’est pas celui qui a servi à découper la ligne une première fois en deux segments inégaux, sans que Socrate nous en dise plus à ce sujet, mais seulement le même que celui qui a servi à découper le segment du visible, ce qui fait passer du segment de la dianoia au segment de la noèsis, c’est le fait d’avoir pris conscience de ce que les mots et les logoi ne nous donnent que des « images/représentations » de ce dont ils parlent, « images/représentations » qui sont d’ailleurs sans aucune ressemblance avec ce qu’elles prétendent représenter, et ne peuvent donc tout au plus que nous donner accès à des relations, pas au « ça-même » de ce que les mots désignent, pour autant que les relations que nous établissons entre mots dans nos logoi correspondent à celles qui existent entre les « étants » que prétendent désigner ces mots. Et ce sont précisément de telles relations qui nous servent à poser les eidè que nous associons à ces mots (une trapeza, c’est quelque chose qui a quatre pieds ; une klinè, c’est quelque chose sur lequel on peut se coucher ; etc.). Mais ces eidè ne sont pas les auta, les ça-même (autè hè trapeza, « la table elle-même » ; autè hè klinè, « le lit lui-même » ; etc.), ce qui ne veut pas dire qu’ils sont parfaitement arbitraires et subjectifs puisqu’ils sont « contraints » justement par les auta dont ils sont les eidè et par le fait que la nature de nos organes des sens et de notre intelligence est déterminée par notre nature commune d’êtres humains. Et le fait que, dans de nombreux cas au moins, en particulier la plupart de ceux impliquant des sensibles, nous parvenions à nous comprendre et à pouvoir interagir entre nous de manière productive, prouve qu’ils ont une certaine « objectivité ».
L’eidos qu’une personne donnée associe à un nom donné dépend de son âge et de son expérience, et s’enrichit au fil de sa vie, commençant avec des critères exclusivement sensibles : dans l’allégorie de la caverne, ce sont les prisonniers encore enchaînés qui donnent des noms aux ombres qu’ils voient puisque c’est la seule chose à laquelle ils ont accès,[4] mais pour les prisonniers libérés, même si les noms ne changent pas, le contenu des eidè qui y sont associés s’enrichit jusqu’à ne plus inclure que des critère d’intelligibilité, ou en tout cas à ne plus se limiter à des critères exclusivement sensibles. Et c’est là que, dans certains contextes au moins, se fait selon moi la différence entre eidos et idea : l’idea est une « catégorie » d’eidos limitée à des critères d’intelligibilité et sans référence à des critères sensibles. Si Platon a choisi, dans la discussion sur les différentes sortes (eidè, République X, 597b14) de lits/couches, de prendre des exemples parmi des objets fabriqués par les hommes, c’est précisément pour rendre plus facile à comprendre cette distinction puisque, pour de tels objets, nous savons quelle est leur finalité. Et, dans cette perspective, il est déterminant, pour comprendre ses propos, de bien voir où il emploie le mot eidos et où il emploie le mot idea, ce qui est pratiquement impossible dans la plupart des traductions disponibles. Sans entrer dans une analyse exhaustive de ce texte, notons seulement qu’il dit que c’est en fixant les yeux sur l’idea, et non pas sur l’eidos, de lit que le fabriquant de lit travaille. Ce qu’il veut dire par là, c’est que ce n’est pas en se limitant à revoir dans sa mémoire tous les lits qu’il a eu l’occasion de voir dans sa vie, c’est-à-dire en se limitant à un eidos purement visible/sensible, qu’il travaille, mais en cherchant à comprendre ce à quoi sert un lit, sans s’occuper, dans un premier temps au moins, de l’aspect visible que peut prendre un tel meuble. C’est pourquoi il peut innover et faire un lit qui ne ressemblera à aucun des lits qu’il a vus dans sa vie, et qui sera pourtant un lit, peut-être même meilleur que tous ceux qui ont été fabriqués jusqu’alors.
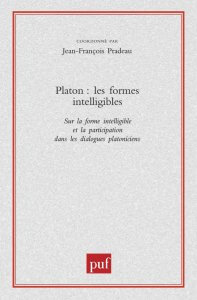
Un indice encore en faveur de cette distinction : Platon parle de hè tou agathou idea (« l’idea du bon »), jamais de to tou agathou eidos (« l’eidos du bon »). Mais attention ! cette distinction n’est valable que dans certains contextes spécifiques et Platon peut employer aussi bien le mot eidos que le mot idea dans des sens plus usuels, en particulier quand il les met dans la bouche d’interlocuteurs de Socrate dont il expose les idées en utilisant leur propre vocabulaire, comme c’est par exemple le cas dans le Parménide, dans la discussion entre Socrate et Parménide, où celui-ci utilise alternativement eidos et idea, voire genos, sans sembler faire de différence entre ces mots..
AP : Quel(s) gain(s) interprétatif(s) votre lecture de l’eidos et l’idea vous permet-elle d’obtenir ?
BS : Mes précédentes réponses ont dû vous en donner une idée ! Cela m’a permis de passer d’une compréhension des propos de Platon « pervertis » par la supposée « théorie des formes/idées » à laquelle personne n’adhère et dont on ne voit plus trop la portée pour nous aujourd’hui, mais qu’on regarde, comme un objet de musée, avec un pseudo-respect condescendant puisque Platon, son auteur supposé, est considéré par tous comme l’un des plus grands penseurs de tous les temps (malgré ça !) à une compréhension parfaitement compréhensible et pertinente encore aujourd’hui. Mais ça a été dur et je ne suis pas sûr que ce soit fini tant il est difficile de secouer vingt-cinq siècles de traditions, surtout quand on est un nouveau venu sans formation initiale ni au grec, ni à la philosophie, et qu’on marche sur des œufs de peur de se planter et de devenir la risée des spécialistes…
AP : Oui, j’entends cette réponse mais justement, il y a quelque chose de déroutant dans cette manière de voir quand on a à enseigner les textes de Platon. D’un côté, il est entièrement vrai qu’il est impossible, pour un professeur, d’expliquer à ses étudiants en quoi consistent exactement les idées, et à ce titre il y a toujours une déception quant à l’exposition de ce que sont les idées ou les formes. Mais d’un autre côté, si l’on suit votre lecture, il n’y a plus véritablement de doctrine platonicienne, et je crois qu’il ne faut pas sous-estimer, notamment dans le cadre de l’enseignement, l’importance de disposer d’une doctrine à expliquer, et il est vrai que l’identification d’un cadre doctrinal qui pourrait être assumé par la supposée théorie des Idées est à ce titre un « soutien » presque nécessaire pour transmettre les textes.
BS : Il y a deux parties dans votre question : la question de l’enseignement de Platon et la question de la « théorie des idées », qui nécessite des réponses sur deux points : « théorie » et « idées ». Je vais répondre successivement sur ces différents points.
La question de l’enseignement de la philosophie, et de celle de Platon en particulier, est une vaste question, que je ne puis aborder ici qu’à la marge. Tels que je les lis, les dialogues de Platon visent à la formation de philosophes (au sens que Platon donne à ce mot, dont il s’explique en particulier dans le livre VI de la République) destinés à gouverner une cité. Il ne s’agit donc pas dans son esprit d’un enseignement visant tout le monde. Si l’on regarde le programme qu’il esquisse dans le livre VII de la République, et en particulier la partie en décrivant le déploiement dans le temps et la cible, à partie de 535a3, on constate qu’il s’agit d’un programme long, puisqu’il va jusqu’à la cinquantième année au moins (cf. 540a4), et qui est en même temps un processus de sélection avec alternance entre des périodes d’études et des périodes d’implication dans les affaires de la cité, et l’on peut facilement, en lisant ces pages, pressentir qu’il y aura des pertes en cours de route et que celles et ceux qui parviendront au terme seront une infime minorité. Je ne pense pas que cela soit de l’élitisme de la part de Platon, mais simplement du réalisme. Et contrairement à ce que pourraient penser les pareils de Karl Popper, Platon n’est pas un totalitariste (c’est ce qu’il appelle la tyrannie). Pour lui, les hommes ne sont pas au service de la cité (polis) et de ses dirigeants, mais au contraire la cité et ses dirigeants sont au service des citoyens (politai). La cité n’est pas pour lui une « réalité » au-dessus de ses citoyens (alors qu’il parle d’une « âme du monde », il ne parle jamais d’une « âme de la cité »), mais une création des hommes (ce qui explique qu’elle n’ait pas d’« âme ») pour organiser leur vie sociale pour le meilleur, puisque c’est leur nature d’être des animaux destinés à vivre en société, des animaux « politique » (dont le cadre de vie est la polis, non pas au sens de « ville », mais au sens de « cité-état »). Le rôle des dirigeants est donc de faire en sorte que le plus grand nombre possible des habitantes et des habitants de la cité puissent être le plus heureux possible, en faisant en sorte que chacune et chacun mette au mieux au service de tous les capacités dont la nature l’a pourvu. Or l’expérience prouve que les aptitudes pour cette fonction sont extrêmement rares et qu’en plus le risque qu’elles soient gâchées par une éducation inappropriée ou tout simplement une absence d’éducation est important (cf. République VI, 490e2, sq.). Au contraire d’un « élitiste » au sens qu’on donne souvent à ce terme, Platon, sachant qu’il ne peut pas changer les dispositions naturelles des individus, propose un système où tout est fait pour maximiser les changes d’identifier ces oiseaux rares et de leur donner la meilleure éducation possible pour la tâche qui les attend. La première disposition en ce sens est de faire de ce travail la responsabilité principale des dirigeants en place (cf. République III, 415b3-6). La seconde est pour eux de le faire, non pas dans un esprit de caste en privilégiant leurs propres enfants dans le cadre d’une « aristocratie » héréditaire, mais en « draguant » aussi large que possible dans les trois classes (cf. République III, 415b6-c6), et aussi en ne prenant pas en considération pour cela le sexe, qui n’a rien à voir là-dedans, pour ne pas réduire de 50 % les chances de dénicher ces oiseaux rares (la « première vague » sur l’égalité hommes-femmes affrontée par Socrate au début du livre V de la Réûblique). Et la seconde vague, bien comprise, celle de la communauté des hommes, des femmes et des enfants (parler de communauté des femmes et des enfants, comme on le fait en général, est une vision « machiste » de ce que propose Socrate, qui n’est pas celle de Platon !), va dans le même sens, en visant à ne pas faire dépendre l’éducation des enfants des hasards de leur milieu de naissance et de la fortune plus ou moins grande de leurs parents (cf. République V, 465b12-c7), puisqu’ils sont pris en charge par la cité dès l’instant de leur naissance (le caractère réaliste d’une telle mesure est une autre affaire, mais, avant de la rejeter, il faut d’abord comprendre sa finalité pour pouvoir ensuite chercher d’autres moyens d’atteindre cette finalité si elle est jugée bonne). Platon est parfaitement conscient du fait qu’une telle éducation/sélection risque de former des personnes qui n’auront pas envie de mettre les mains dans le cambouis ensuite, mais il sait aussi qu’il ne faut surtout pas confier le pouvoir à ceux qui le recherchent (cf. République VII, 520d1-4 ; 521b4-5) et que celles et ceux qui auront franchi toutes les étapes de cette éducation/sélection auront compris qu’il est meilleur pour eux d’accepter de consacrer une part de leur temps à gouverner plutôt que d’être gouvernés par des personnes moins aptes qu’eux à cette tâche (cf. République I, 347b5-d2).
Pour Platon, l’éducation, quand il ne s’agit pas d’apprendre aux « élèves » des techniques spécifiques, ne consiste pas à faire passer du maître à l’élève des « thèses/théories » toute faites, mais à développer son sens critique et à l’amener progressivement à découvrir par lui-même les réponses aux questions qu’il se pose ou qu’on l’amène à se poser, en cohérence avec les réponses déjà acceptées pour d’autres questions dont il doit prendre conscience qu’elles sont liées. Dans cette perspective, Platon ne développe pas dans ses dialogues des « théories » et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a écrit des dialogues dans lesquels il ne se met jamais en scène et non pas des traités dogmatiques. Est-ce que cette manière de faire est adaptée à tous les publics, c’est une autre histoire, qui rejoint la question précédente et qui nous conduirait trop loin. Mais cela veut dire, pour en revenir à notre sujet, que toute « théorie », des idées, de la réminiscence, ou de n’importe quoi d’autre, qu’on prétend attribuer à Platon n’est pas de lui, mais d’interprètes de ses dialogues, présents ou passés.
Ceci étant dit, concernant les « idées », c’est-à-dire l’emploi des mots eidos et idea par Platon, il ne fait aucun doute qu’il les emploie et qu’on peut donc chercher à comprendre comment il les utilise et ce qu’il dit à leur propos et avec eux. Et que des textes comme l’analogie de la ligne, l’allégorie de la caverne et la discussion sur les différentes sortes de lits, à condition de bien les comprendre, ce qui n’est justement pas le cas pour la plupart des commentateurs, soient des lieux privilégiés pour ce faire, c’est évident. Encore faut-il prendre la peine de lire ce qu’écrit Platon et de ne pas arriver avec des idées préconçues ! Et dans cette perspective, un cas qui me laisse rêveur est celui du célèbre platonicien américain du début du XXème siècle Paul Shorey, qui a traduit la République pour la collection Loeb, l’équivalent anglo-saxon des Budé : dans une note sur sa traduction de l’allégorie de la caverne, il écrit « It is probably a mistake to look for a definite symbolism in all the details of this description. There are more stages of progress than the proportion of four things calls for. All that Plato’s thought requires is the general contrast between an unreal and a real world, and the goal of the rise from one to the other in the contemplation of the sun, or the idea of good ».[5] Traduit, non seulement de l’anglais au français, mais des mots à la pensée, ce qu’il dit en substance, c’est : « Je n’ai pas réussi à trouver une explication du symbolisme de l’allégorie de la caverne qui cadre avec ma compréhension de l’analogie de la ligne qui a précédé où il est question de quatre sortes de « choses », mais ce n’est pas grave car je peux au moins la faire cadrer avec ma compréhension de Platon et de la « théorie des idées » que, comme l’immense majorité de mes collègues présents et passés, je lui prête, et voilà comment ça marche : il suffit d’opposer un monde irréel à un monde réel et d’y voir l’élévation de l’un à l’autre dans la contemplation du soleil, c’est-à-dire l’idée du bon ». Tout est dit !… Ce sont pourtant mes efforts pour trouver une signification acceptable aux détails de l’allégorie et de l’analogie qui l’a précédée qui en donne une compréhension cohérente qui m’ont permis d’y voir plus clair sur, non pas une autre version d’une « théorie des eidè » qui serait de Platon, mais ce que cherche à nous faire comprendre Platon quand il parle d’eidè et d’ideai. Et, ce faisant, j’ai pu constater à quel point, au contraire de ce que suggère Shorey, Platon est attentif aux moindres détails de ces images et combien il est fructueux de passer du temps à chercher à les « décoder », sans en rester à de grandes idées générales, comme le font nombre de commentateurs. J’ai déjà mentionné dans une précédente réponse les grandes lignes de mon interprétation de l’allégorie, parfaitement cohérente avec l’analogie de la ligne, elle aussi bien comprise, et elle fait un sort à la « théorie » des deux mondes de Shorey et de beaucoup d’autres. Et ça marche tellement bien que je suis maintenant convaincu que c’est LA manière de la comprendre voulue par Platon (je ne suis par contre pas encore sûr d’avoir complètement « décodé » l’analogie de la ligne, qui est plus abstraite et moins imagée, mais je progresse sur le sujet et je prépare justement une nouvelle version de la page de mon site qui en propose ma traduction, surtout pour reprendre les notes, avec certaines desquelles je ne suis plus en accord : dans la version actuellement en ligne, bien qu’ayant vu qu’il y avait deux manières de comprendre ana ton auton logon, je n’avais pas encore remis en cause la compréhension unanimement acceptée que c’était le rapport utilisé pour couper la ligne une première fois qui était aussi utilisé pour couper chaque segment ainsi obtenu en deux). Pour la petite histoire, la clé de compréhension de l’allégorie de la caverne m’a été fournie, bien involontairement, par Monique Dixsaut à travers une émission des Chemins de la philosophie où elle intervenait sur France Culture sur le thème du philosophe roi,[6] écoutée bien après sa diffusion à partir des archives de l‘émission, dans laquelle elle faisait référence à une instance du mot anthrôpos dans l’allégorie en disant que c’était la seule occurrence de ce mot dans toute l’allégorie. Or, ayant déjà à cette époque traduit l’allégorie pour mon site, j’étais à peu près sûr que le mot y apparaissait plusieurs fois et c’est en allant vérifier que c’était bien le cas que, retrouvant dans un même mouvement qui les rapprochait les quatre occurrences de ce mot, toujours au pluriel et utilisé à la fois dans la caverne et hors de la caverne, j’ai cherché à mieux comprendre ce que cela signifiait et en suis arrivé à l’interprétation que j’ai résumée auparavant.

AP : Comment expliquez-vous dans ces conditions les raisons pour lesquelles, depuis si longtemps, une « théorie des idées » aurait excessivement été attribuée à Platon ?
BS : Aristote, que Platon avait infiniment mieux compris que lui n’avait compris Platon, et qui n’a jamais digéré que Platon n’en fasse pas son successeur à la tête de l’Académie, justement parce qu’il avait anticipé ce qui serait arrivé s’il l’avait fait, porte une lourde responsabilité dans cette affaire.
Le fait que Platon était tellement au-dessus du lot et en avance sur son temps a sans doute joué aussi. L’influence du christianisme, qui a conduit, par réaction des milieux intellectuels d’alors, aux interprétations « mystiques » de sa pensée par les néo-platoniciens, et l’adoption par les penseurs chrétiens des premiers siècles (Justin, Origène, Augustin, pour ne citer que ceux-là) du platonisme comme cadre de leurs tentatives de « rationaliser » le dogme chrétien, où il était tentant de faire des ideai platoniciennes les « idées » de Dieu, ont pris le relai. Le Moyen-Âge classique, en remettant à l’honneur Aristote, a remis au centre du débat ses incompréhensions de Platon et la Renaissance a retrouvé Platon au filtre des néoplatoniciens.
Plus récemment, Darwin porte aussi sa part de responsabilité, dans la mesure où il est à l’origine de la notion d’évolution, qui s’est ensuite répandue dans tous les domaines et qui, dans le domaine de la pensée et dans le cas particulier de Platon, à accrédité l’idée, non seulement que, puisqu’Aristote était postérieur à Platon il devait constituer un progrès sur lui, mais aussi que Platon lui-même avait pu « évoluer » au fil de sa vie, ce qui n’est pas contestable mais a fourni un argument facile à ceux qui ne parvenaient pas à voir la cohérence de ses propos pour expliquer de supposées « discordances » entre les dialogues dès lors qu’on posait en axiome qu’il avait écrit ses dialogues comme des œuvres le plus souvent indépendantes les unes des autres sur une période d’une cinquantaine d’année sans en avoir la moindre preuve, et permettait de mettre les bizarreries de cette « théorie » promue par son successeur Aristote sur le compte d’erreurs de jeunesse plutôt que d’incompréhension de son élève. Et pour finir, les méthodes modernes de formation et de travail des philosophes professionnels, qui contraignent à passer plus de temps à lire tout ce qui a été écrit sur le sujet auquel on s’intéresse, une littérature secondaire qui est de plus en plus considérable dans le cas de Platon, qu’à lire Platon lui-même, et qui favorisent l’étude au microscope de petits bouts de texte des dialogues plutôt que les grandes vues d’ensemble, n’encouragent pas les nouveaux venus à des remises en cause globales de la pensée dominante et du cadre interprétatif « officiel » (dialogues de jeunesse, dialogues de maturité, dialogues tardifs).
AP : Autant je partage votre analyse quant au rapport entre Aristote et Platon, autant je suis réservé quant au rôle de Darwin dans cette affaire qui a toujours pris soin de faire le départ entre l’évolution et le progrès, soulignant même de manière systématique leur absence de rapport. L’évolution darwinienne n’a rien à voir avec un progrès.
BS : Je suis d’accord avec vous sur ce point. Mais quand je parle de Darwin dans ce contexte, ce n’est pas tant pour faire référence à ses propres écrits que pour en faire le père d’une « révolution » dans tous les domaines de la pensée qui, en amalgamant effectivement les notions d’évolution et de progrès que Darwin ne confondait pas, a modifié en profondeur notre manière de voir et de comprendre le monde qui nous entoure et, dans le cas de Platon, a induit les effets que j’évoque dans ma précédente réponse. Et puis c’est aussi pour produire un petit effet de surprise sur le lecteur, qui ne s’attend sans doute pas à ce qu’on parle de Darwin dans une étude sur Platon !
AP : Une question encore sur ce sujet. Jean-Joël Duhot avait publié un long ouvrage[7], fort stimulant, montrant que la supposée « théorie des Idées » était très difficilement trouvable chez Platon, thèse qu’il avait reprise dans ses Leçons sur Platon[8]. Nous avions d’ailleurs mené un entretien avec lui, ici et là. Puis-je vous demander sur quel point vous vous retrouvez dans les analyses de Duhot, et sur quel point vous vous en écartez ?
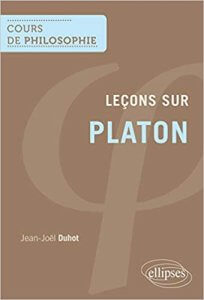
BS : Le rejet de la « théorie des idées », que je rejette aussi sur des bases différentes, n’est qu’un élément annexe des thèses de Jean-Joël Duhot, qui, comme beaucoup d’autres, n’a pas jugé utile de prendre le temps de chercher à « décoder » l’allégorie de la caverne, dans laquelle il croit voir « la grande présentation de l’expérience socratique – et peut-être aussi un peu platonicienne – de l’extase, que le Banquet avait montrée de l’extérieur »,[9] et dans laquelle surtout, il ne veut pas chercher une des sources d’une potentielle « théorie des idées » de Platon, puisque sa thèse pour la rejeter est de ne la trouver que dans l’exposition qu’en fait Parménide dans le dialogue éponyme, dans sa discussion avec Socrate, ce qui rend plus facile de la rejeter comme théorie de Platon.
Il défend aussi l’existence de ce qu’il appelle le « cycle éléatique », constitué du Parménide et de la trilogie clairement identifiée par des références croisées Théétète, Sophiste, Politique, qui constitue la sixième tétralogie du plan d’ensemble dont je suggère qu’il est celui des dialogues, mais il lui donne un sens complètement différent qui, selon moi, ne correspond pas aux intentions de Platon. D’autre part il reste dans le cadre interprétatif « officiel » (dialogues de jeunesse, dialogues de maturité, dialogues tardifs) et fait de Platon un mâtiné de Pythagoricien et de « néo-Éléate », ce que je récuse absolument. Mais surtout, toute son interprétation de Platon découle d’une lecture de quelques passages du Timée (dont il fait le dernier mot de Platon sur la plupart des sujets) dans lesquels, en tant que musicien, il voit Platon appliquer le modèle mathématique de la gamme pythagoricienne, seul phénomène physique à avoir été modélisé mathématiquement en son temps selon lui, à la « création » de l’Univers et de l’âme du monde, le « même » entrant dans sa composition correspondant pour lui à l’octave et l’« autre » à la quinte, et il fait pour cela de lui le précurseur des savants qui, à partir des Kepler et autres Galilée et jusqu’à nos jours, ont cherché à modéliser mathématiquement le Monde, ce en quoi, à mon avis, il se trompe. Outre le fait que je ne vois pas Platon choisir le nom de Timaios pour un personnage (très probablement fictif, de l’avis même de Duhot) qui livrerait en son nom son dernier mot sur les problèmes auxquels il a consacré sa vie, ce qui reviendrait, dans le domaine politique, à mettre la timocratie avant l’aristocratie (au sens platonicien du gouvernement par les meilleurs), c’est-à-dire la quête des honneurs avant l’excellence, Platon indique clairement dans la République (VII, 533c7-d7) que les mathématiques, comme toutes les autres disciplines qu’il a passées en revue pour la formation des philosophes rois, sont de l’ordre de la dianoia, intermédiaires entre l’opinion et le savoir (epistèmè), et ne sont que des aides à la formation à la dialektikè (la maîtrise du logos à travers le dialegesthai), qui reste pour lui le faîte des études sans rien au-dessus d’elle (République VII, 534e2-535a1, dans lequel mathèmata signifie non pas « mathématiques » au sens moderne, mais « objets d’études »). S’il est certain que l’harmonie, au sens le plus général et pas seulement musical, joue un rôle majeur pour Platon, entre autre dans la conception qu’il se fait de la justice, idée/idéal de l’homme incarné, telle que présentée par Socrate dans la République (harmonie intérieure d’une âme composite comme préalable à l’harmonie sociale entre citoyens de la cité), et que les rapports numériques qu’il mentionne dans sa description de la création du kosmos par le démiurge dans le Timée lui ont effectivement très probablement été inspirés par la gamme pythagoricienne, ce n’est pas à l’octave et à la quinte que font référence les mentions du « même » et de l’« autre » dans la composition de l’âme du monde et de l’homme, mais au fait que ces deux « notions » sont à la racine du logos par le rôle qu’elles jouent dans la création des noms et leur association à des eidè (voir plus haut la citation de République X, 596a6-8) sur la base de ressemblances (« même », tauton, 596a7) et de différences (« autre », thateron), une fois éliminés les éléments de position dans le temps et l’espace pour rendre la comparaison possible, ce qui en fait des « étants », non pas éternels, ce qui suppose encore le temps infiniment continué, mais atemporels, c’est-à-dire sans liens avec le temps, et sans position dans l’espace.
Pour Platon, comme pour les Grecs de son temps, il y a une différence de nature entre les nombres servant à compter des entités discrètes, qui ne peuvent donc être que des nombres entiers, et les mesures de grandeurs continues, qu’on peut au mieux chercher à représenter par des rapports de nombres entiers. Or, il constate que justement, même dans des figures géométriques « harmonieuses » comme le triangle équilatéral, le carré ou le cercle, il n’est pas toujours possible de trouver de tels rapports et que certains d’entre eux sont alogoi (« irrationnels »), comme c’est le cas pour le rapport de la diagonale d’un carré à son côté (√2) ou de la circonférence d’un cercle à son diamètre (π). Nous avons tourné la difficulté en inventant ce que nous appelons des nombres « réels », qui permettent d’associer une représentation à base de chiffres à n’importe quel point d’une droite continue ou à n’importe quelle mesure d’une grandeur quelconque évoluant de manière supposée continue, et même des nombres dits « complexes », qui permettent de le faire pour n’importe quel point d’un plan, mais c’est au prix de la perversion du concept de « nombre » au sens où l’entendait Platon, même si cela nous a permis des avancées extraordinaires. Pour Platon, ce que cette « irrationalité » signifie, c’est qu’il y a dans toute création une part d’« irrationnel » (alogos), quelque chose qui ne peut être réduit à des rapports numériques d’entiers, qui s’impose (anagkè) même au créateur et interdit l’« harmonie » parfaite (voir le rôle assigné par Timée à anagkè, la « nécessité », dans l’œuvre du démiurge). C’est ce qu’il cherche à faire comprendre en choisissant comme composants élémentaires de son « modèle » de la matière deux triangles rectangles dont un des côtés est dans un rapport « irrationnel » avec les deux autres (√3 pour le demi-triangle équilatéral et √2 pour le demi-carré[10]), alors même qu’il est parti de figures parmi les plus régulières qu’on puisse imaginer, le triangle équilatéral et le carré. Et on peut y voir une autre « instanciation » du « même » et de l’« autre », le côté étant dans un rapport irrationnel avec les deux autres figurant l’« autre » là où les deux côtés commensurables l’un à l’autre figurent le « même ».
Certes, Platon, dans le Timée, est le premier à proposer un modèle « mathématique » de la matière, mais, ce faisant, son objectif n’est pas de permettre aux hommes de dominer la matière, mais de leur proposer un modèle pour le travail qui les attend, construire leur univers, celui de la cité dont ils sont, ou devraient être, les « démiurges » en prenant modèle sur le kosmos qui les entoure et en acceptant et « apprivoisant », ce faisant, la part d’« irrationnel » qu’il est impossible d’éviter. Enfin, une bonne compréhension du Théétète et de l’« échec » de celui qui donne son nom au dialogue à définir le savoir (epistèmè) faute d’avoir commencé par s’interroger sur le logos par lequel nous y avons accès, confirme l’opinion de Platon sur les mathématiques : Théétète est peut-être devenu un brillant mathématicien, mais justement, il en est resté là et n’est pas devenu philosophe, et l’on peut penser que, comme son maître Théodore, il a pris pour argent comptant la caricature de philosophe que Socrate leur sert au milieu du dialogue, celle du philosophe vu par des « scientifiques » (la seule fois où Socrate utilise le mot « philosophe » dans ce portrait est vers la fin dans l’expression « celui que tu nommes philosophe » (hon dè philosophon kaleis, 175e1) adressée à Théodore). Comme quoi il ne suffit pas de ressembler physiquement à Socrate (cf. Théétète, 143e8-9) pour devenir philosophe, il faut lui ressembler par le logos, comme son jeune homonyme qui prendra la place de Théétète dans le Politique.
[1] https://www.plato-dialogues.org/fr/pdf/De_quoi_parlons-nous_long.pdf
[2] Nous renvoyons le lecteur à l’article célèbre de Monique Dixsaut, « Ousia, eidos et idea dans le Phédon », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 181 :4, 1991, p. 479-500, repris dans Monique Dixsaut, Platon et la question de la pensée. Etudes platoniciennes I, Paris, Vrin, 2000, ainsi qu’aux collectifs suivants : André Motte, Christian Rutten et Pierre Somville (éds.), Philosophie de la forme: eidos, idea, morphé dans la philosophie grecque des origines à Aristote, Louvain, Peeters, 2003 et Jean-François Pradeau (dir.), Platon : les formes intelligibles, PUF, Paris, 2001.
[3] Thesaurus de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=1604349840;r=1;nat=;sol=2;
[4] « S’ils étaient capables de dialoguer entre eux, les [choses] présentes étant les mêmes, ne crois-tu pas qu’ils prendraient l’habitude de donner des noms à ces [choses] mêmes qu’ils voient ? » (République VII, 515b4-5 selon la leçon du manuscrit A).
[5] Plato, Republic II, translated by Paul Shorey, Loeb Classica Library, Harvard University Press, Cambridge, 1935 (reprint 1987), p. 126, note a.
[6] https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/lectures-de-la-republique-de-platon-34-le
[7] Jean-Joël Duhot, L’énigme platonicienne, Paris, Kimé, 2017.
[8] Jean-Joël Duhot, Leçons sur Platon, Paris, Ellipses, 2019.
[9] Jean-Joël Duhot, Leçons sur Platon, Paris, Ellipses, 2019, p. 174.
[10] Les trois côtés d’un demi triangle équilatéral de côté a mesurent respectivement a (l’hypothénuse), a/2 et a√3 /2 ; les trois côté d’un demi carré de côté a mesurent respectivement a, a et a√2 (l’hypothénuse).








