La dialectique serait-elle l’opium du philosophe ?
On a toutes les raisons de le croire, à la lecture du cours magistral de Gérard Lebrun, publié par deux de ses étudiants, sous le titre L’envers de la dialectique. Hegel à la lumière de Nietzsche1 qui propose une lecture fascinante du système hégélien comme théodicée d’un type inédit, mais pas moins délirant que les autres. Il y aurait bel et bien un envers de la dialectique, si étonnant que cela puisse paraître. Étonnant, puisque la dialectique se voulait le régime de discours qui ne laisse rien au-dehors de lui, aucun envers, aucune détermination conceptuelle. Or, Lebrun montre, à la lumière de Nietzsche, qu’il y a bel et bien un revers non élucidé par la dialectique, et que celle-ci constitue donc une « stratégie philosophique inavouée ».
Cours magistral, à tous les sens du terme, où éclate à chaque page le talent de pédagogue et d’interprète d’un auteur qui a élevé le commentaire au rang d’œuvre, et l’enseignement au rang d’art2
Au cinéma, il arrive qu’on tourne la suite d’un film, et (rarement il est vrai), il arrive que la suite soit meilleure que le premier. Je pencherais pour dire, mutatis mutandis, que c’est le cas ici, et que le grand professeur de Sao Paolo, a surpassé son étude précédente sur Hegel, La patience du concept.
Un éclairage nietzschéen sur Hegel
S’agirait-il donc d’une sorte de second tome de La Patience du concept, qui prolongerait l’exploration du langage hégélien ? Oui, mais dans une direction entièrement opposée – et c’est la principale surprise qui attend le lecteur, dès les premières pages.
En effet, à la fin de la Patience, le lecteur était resté sur l’image d’un Hegel d’un type inédit : non pas le panlogiste dogmatique, le théologien masqué qui aurait mis le point d’orgue à la métaphysique en la rendant totalement systématique –mais au contraire un parfait sceptique qui aurait entrepris de dissoudre une à une nos certitudes de langage et nos évidences les mieux assurées, à la façon d’un Wittgenstein. Ne resterait alors, après la dialectique hégélienne, qu’une pensée entièrement « fluidifiée », se mouvant à l’infini en elle-même –la philosophie n’étant plus alors un de ces systèmes sur lesquels les impatients décident de leur vie et bâtissent une morale, mais la mise en question, par le langage même, des moyens par lesquels notre langage se constitue, « rien qu’un flot montant qui ne constitue que lui-même ».
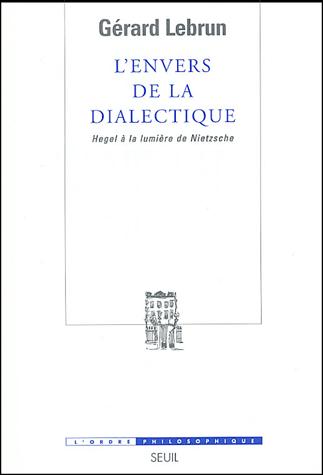
C’est pourquoi le changement de perspective dans L’envers de la dialectique est si spectaculaire. Alors qu’au début de la Patience, Hegel était rapproché de Nietzsche comme critique de la superstition, ici Nietzsche est convoqué pour mettre au jour les choix profonds et inavoués sur lesquels repose le langage dialectique.
C’est en effet d’abord d’un problème de langage dont il s’agit : « voit-on de quelle façon il s’agit de parler ? » Gérard Lebrun, ayant patiemment établi les règles du langage de Hegel –ayant appris à parler hégélien, comme on parle français ou anglais3 – il travaille ici à dire le ressentiment qui anime secrètement la dialectique.
Déjà, le premier mérite de la Patience du concept était de déchiffrer le hégélien sans jamais le parler directement : décoder une langue mais sans reprendre tel quel le style de Hegel, au contraire de plusieurs commentateurs qui s’installent dans ce langage et le parlent sans en interroger les règles… comme si, par la seule imprégnation, la lumière allait finir par se faire dans la tête du lecteur !
Avec l’Envers, le style de Lebrun a gagné en force, en concision, et en humour. Plus libre, plus personnel, plus drôle, ce livre nous montre un Lebrun qui a abandonné ce style rigoureux jusqu’à la rigidité de la Patience du concept, sans rien perdre de sa parfaite maîtrise. Sur le fond, Lebrun se rapproche de Foucault et Deleuze (du premier pour le thème de l’archéologie du sens, du second pour la conception de la différence). Dans l’ensemble, le livre semble parcouru d’un éclat de rire secret, comme celui qui anime les meilleurs chapitres de Nietzsche : un rire serein et libérateur.
Mais, au juste, en quoi consiste le ressentiment hégélien ? Pourquoi Nietzsche nous aide-t-il à le découvrir ? Et, en supposant qu’on puisse comprendre les règles de la dialectique, la philosophie peut-elle y échapper ? Voilà les questionnements que ce livre met en place.
Nous passerons en vue quelques thèmes de l’enquête menée par Gérard Lebrun, en regrettant que, pour chaque citation qui sera faite, trois ou quatre autres passages seront laissés de côté. Un peu à la façon de la dialectique hégélienne, qui est sans doute impossible à résumer, il serait vain de vouloir rendre de façon satisfaisante, autrement qu’en citant tout le livre, le travail d’exploration entrepris par Lebrun. Ce compte-rendu, du fait de ses insuffisances inévitables, sera plus que jamais une invitation à lire le livre.
Les illusions de la dialectique
L’auteur commence par contester les résultats de son livre précédent : est-il si certain que l’exercice de la dialectique nous délivre pour de bon des illusions de l’Entendement, entendue comme la « raison » des classiques, cette faculté de « découverte et de possession des principes »4 ? Cette certitude de pouvoir se délivrer des naïvetés de la philosophie par un discours qui s’inscrirait dans l’Absolu, n’est-ce pas là une naïveté plus grande encore ? « Cette quête exclusive de la « vérité » nous dispense de toute réflexion préalable sur le sens usuel des mots. Pourquoi ce concept est-il ainsi marqué ? Pourquoi l’usage de ce mot l’a-t-il emporté ? Ces questions indignes de la philosophie, Hegel les abandonne au philologue, à l’historien du fortuit. […] Ainsi naît un dogmatisme plus insinuant que celui qui procède par axiomes et théorèmes et qui, mieux que celui-là, nous donne l’assurance qu’il ne tient qu’à nous de faire se déployer le discours de la Vérité. Havre inespéré pour la théologie. »5
Lebrun se propose de parcourir le déploiement de l’ontologie de Hegel, c’est-à-dire précisément « un indicateur sémantique, un méta-discours qui a pris toutes précautions pour que le sens de certains mots […] demeure inflexiblement marqué »6. « Parcourir cette dimension, c’est découvrir qu’il y a un point de vue d’où la raison hégélienne est exposée au même type de critique qu’elle-même adresse incessamment à l’« Entendement ». C’est commencer à dévoiler l’envers de la dialectique. Elle aussi est partiale. Elle aussi occulte ses présupposés. Elle n’est pas le méta-discours qu’elle prétendait être relativement aux philosophies d’« entendement ». »7 On n’étudiera donc pas le système à l’aune d’un autre système de repérage, au nom d’un discours plus vrai : on se contentera de prendre cette ontologie pour ce qu’elle est, un texte, avec ses articulations, son mode de construction, et pour y retrouver –c’est là l’intérêt de l’éclairage nietzschéen – des orientations vitales inavouables, car morbides…
Le premier chapitre est consacré à la définition de la « véritable théodicée » telle que l’entend Hegel. En quel sens précis son œuvre est-elle une justification de l’ordre du monde au nom de Dieu ? Ce que rejette Hegel, c’est aussi bien la compréhension de l’histoire en termes de pure causalité d’un côté, ou d’intervention d’une Providence divine de l’autre. Aussi Hegel ne fait-il pas l’apologie du fait accompli ni du meilleur des mondes possibles. Il y a une profonde originalité de la Providence hégélienne : quelle est-elle ? Elle ne dit pas qu’un Dieu dirige le monde, mais elle affirme plus « modestement » que tous les évènements, si hasardeux soient-ils, finiront par former du sens, que du hasard surgira la nécessité, que l’ordre sortira du désordre de l’histoire. C’est cette « modestie » de la rationalité de l’histoire hégélienne que Lebrun repère en fait comme une exigence théologique maximale : à savoir que l’histoire devrait finir par former un récit, que le rationnel et le sens finiraient par émerger de l’irrationnel et du non-sens. Une raison doit finir par ressortir de cette histoire pleine de bruit et de fureur.
Le monde sensible, le monde du fini, qui n’est rien face au Concept, finit par céder entièrement à cet infini auquel il est incapable de résister. La religion ayant fait son œuvre, c’est à l’Etat de recueillir tout le passé, et le bon chrétien doit vivre pleinement en lui, dans « un monde luthérien, morne et sobre, où la présence sensible a perdu son prestige, où l’art appartient au passé. »8.
Le nihilisme hégélien
C’est autour du thème de l’Etat que vont se concentrer, dans les chapitres suivants, les analyses –qui m’ont semblé, je me permets d’insister, tout simplement éblouissantes – du nihilisme hégélien. Je ne reprendrai pas, ni en détail ni en résumé, ces analyses, car je crois vraiment que c’est les dénaturer que d’essayer de les condenser. Voici juste quelques indications : une fois établi cette philosophie de la soumission à l’Etat, Lebrun montre comment cela se combine avec une conception de la puissance qui aurait des comptes à rendre au droit ; comment se construit à partir de là un discours de soumission inconditionnelle de l’homme au règne de l’Etat. Comment cette soumission passe par une épreuve de dressage tyrannique de l’homme, qui le déprendra à jamais de l’idée même de s’arracher à cette vie morbide et diminuée. Puis, comment Nietzsche permet de penser une rupture avec ce dressage du « troupeau humain » par le prêtre, et comment l’analyse du devenir, au crible de la volonté de puissance et de l’éternel retour, entreprend de saper toute philosophie de l’Histoire.
C’est donc un récit nietzschéen de la domestication de l’homme par l’État moderne que Lebrun reconstitue en filigrane du texte de Hegel. Le concept central de ses analyses serait celui de peur, dont Gérard Lebrun montre l’importance dans la pensée de Hegel : la peur qui tue en l’homme toute velléité de jamais vouloir vivre en-dehors de l’État.
C’est le dernier chapitre, étudiant le thème du « Cercle des cercles » qui montrera en quoi la subversion hégélienne de la dialectique s’avère finalement inoffensive : si l’Esprit produit une infinité de moments et de figures toujours différents en lesquels il se retrouve en tant qu’il les engendre (l’Un n’existant que pour autant qu’il est partout dans le Multiple), alors l’Histoire n’est bien qu’une vaste théodicée.9
La différence et l’histoire
Sur la notion de différence, Lebrun croise une seconde fois la critique deleuzienne. Une note de la Patience du concept mentionne déjà que Lebrun n’avait lu Différence et répétition qu’après avoir écrit son livre. A Deleuze qui reprochait à Hegel de soumettre encore la différence à l’identité, Lebrun demandait si, Hegel, posant l’Identité de l’Identité et de la Différence, en restait bien à la différence au sens de l’entendement. Ici, Lebrun paraît bien plus proche de Deleuze, qui affirmait que la dialectique ne pouvait supporter la différence qu’en la faisant aller jusqu’à l’altérité, de manière à exiger une réconciliation, un apaisement après le déchirement. La philosophie de la différence, telle qu’elle se trouve exposée notamment au centre de Différence et répétition, dans le chapitre « La pensée sans image » n’aiderait-elle pas à rompre ce cercle dialectique, à penser hors de l’image chrétienne du monde ? Lebrun accorde à Deleuze ce thème de la circularité du même dans la dialectique, tout en notant que l’Esprit ne se retrouve lui-même que dans le dissemblable, pas l’identique. Le sens, la raison, ressurgissent à chaque fois sous une formation historique différente. « Il n’y a plus rien d’étrange, plus rien à redouter, sous le soleil de l’Esprit. Et du même coup nous comprenons ce que signifie cette novation sans relâche, qui vaudra à la dialectique son aura « critique et révolutionnaire » : elle n’est que l’index d’une sécurité ontologique maximale. […] Comment imaginer subversion plus bénigne, et « délire bachique » plus rassurant ? »10
Le coup de force de cette étude est de prendre au sérieux les critiques adressées par Nietzsche à Hegel, d’utiliser les « analyseurs nietzschéens » pour relire Hegel, Kant et la métaphysique, et déceler la résignation et la déprime vitales qui minent secrètement ces pensées. Par exemple, ne plus penser les étapes de l’histoire et ses peuples selon les degrés de maturité (intellectuelle, technologique, donc idéologique) des peuples, mais selon leur degré de vitalité, voilà ce que serait une analyse historique dans le sillage de Nietzsche. On ne pourra plus dire avec Marx que la pensée des Grecs était victime d’un développement technique insuffisant et qu’ils resteraient donc par rapport à nous des enfants.
Le passage suivant, entre autres, est un bon exemple de la sûreté, de la précision et de l’humour ravageur des propos de Lebrun : « On sait à quelle prouesses moliéresques put donner lieu, après Hegel, ce type d’analyse [sur la maturité des peuples] (après Hegel seulement, car lorsque le « développement de l’Esprit » joue le rôle d’infrastructure, l’explication est plus abstraite, donc moins drôle), mais on se rend peut-être moins compte que c’est par principe qu’une analyse idéologique ainsi menée manque la spécificité de son objet, quel qu’il soit, puisqu’il s’agit toujours de rapporter la constitution d’un concept ou d’une croyance à un niveau de connaissances, à un degré de maturité intellectuelle ou de maîtrise technique […] Il en va tout autrement quand nous nous demandons de quel type de rendement vital, de quelle figure d’équilibration des pulsions est symptomatique tel système de croyances ou de concepts : ici, en tout cas, on se débarrasse de la grille pédagogique, on envoie promener tout axe de repérage téléologique. Brisant toute ligne de « développement » dialectique, on n’a plus affaire qu’à une histoire des mentalités – ou, mieux, des vitalités »11.
Au bout du compte, que gagnerions-nous, à supposer que Lebrun ait « raison » ? Est-ce que nous aurons prouvé, avec une certaine jubilation vengeresse, que Hegel avait tort de A à Z ?… Est-ce que nous serons persuadés qu’il est inutile et dangereux de continuer à le lire (parce qu’en parlant de règne de l’Esprit sur terre et de réalisation de l’Absolu, il nous contaminerait insidieusement de son ressentiment…) ?
« Le regard curieux de l’ethnographe »
Mais au-delà du cas de Hegel, c’est la philosophie qui est concernée : « Sous une apparence inévitablement technique, ce travail, qui est, en fin de compte, polémique, pourrait conduire à l’abordage de thèmes socio-politiques plus concrets et surtout plus actuels qu’on ne pourrait croire en suivant cette promenade archéologique. » Resterait, en somme, à suivre l’entreprise de Foucault pour renouveler la philosophie de l’histoire. Mais c’est la figure de la philosophie comme Savoir Absolu qui se trouve alors congédiée.
Quel changement impliquait déjà la Patience du concept par rapport à l’histoire de la philosophie ? Il s’agissait de se libérer d’une certaine forme de pratique de la philosophie, qui aurait à porter sur quelque chose, à représenter une chose : Hegel aurait ainsi dépassé la conception de la philosophie comme simple représentation du monde, pour la constituer en discours qui explore à l’infini ses fragiles capacités à tenir. Aussi étions-nous en quelque sorte libérés de la tradition, qui n’avait plus rien à nous apprendre sur un absolu qui resterait hors du discours. Voilà maintenant qu’avec L’envers de la dialectique, nous découvrons que la dialectique ne peut que dissimuler ses orientations vitales, et qu’ainsi, c’est l’idée de clôture du discours sur lui-même qui saute, à coup de dynamite « nietzschéenne ». Le philosophe ne peut plus disparaître derrière sa philosophie, ses opinions ne sont plus valables universellement, c’est-à-dire impersonnelles. En cela consiste le conseil de Lebrun : « Gardons-nous seulement d’oublier, en les lisant, que la « raison », le « Concept », l’« Idée » sont des mots qui indiquent, aussi certaines acceptions et certains refus. Oui, gardons-nous de les lire comme si ces mots n’avaient pas une face cachée. »12
Peut-être pour lire un philosophe, faut-il déjà ne plus croire à ce qu’il dit. Il faut avoir commencé par l’aimer, par l’admirer, puis avoir pris congé de lui. Mais comment, après s’être dépris de la croyance en un auteur, ne pas forger une croyance de remplacement ? Se libérer d’un auteur, très bien. Mais qui nous libérera de cette libération ? Du moins Nietzsche ne demandait-il pas à son lecteur de croire à ce qu’il affirme, mais de lui résister et de se montrer à la hauteur des défis qu’il lui lance. Faute de cette éthique du maître qui convie ses disciples non à un apprentissage mais à une joute, le penseur voudra propager un message, il délivrera la vérité, il se fera prêcheur – chrétien ou marxiste : « En nous montrant à l’œuvre l’« Absolu » – dont le Dieu créateur ne fut jamais qu’une des plus prestigieuses figures –, Hegel focalise des thèmes (le telos, l’infinité) qui, depuis les Grecs –notamment chez Aristote et chez Plotin –, rendirent possible la formation de ce que nous entendons par « théologie », depuis que naquit une dogmatique chrétienne. Ces thèmes, Hegel les infléchit et les renoue à sa façon […] Pour avoir l’idée de reparcourir ces formes, encore faut-il être convaincu que l’entreprise théologique était sans objet, et que l’« Absolu » est un concept vide. C’est alors seulement (très exactement à partir de Schopenhauer et à sa suite) qu’il est possible de jeter sur l’autre versant de la dialectique le regard neutre et curieux de l’ethnographe. Penser, au contraire, que la dialectique – corrigée, réajustée, redressée – nous permet encore de mieux comprendre l’histoire des hommes, des classes et des nations, c’est forcément se laisser prendre au mirage de l’« Absolu ». C’est demeurer obstinément fidèle à la vieille espérance qui créa les religions, les eschatologies et, aussi, la plupart des philosophies en faveur dans l’Université. »13
L’incurable dialectique
C’est donc à une critique non marxiste de Hegel que s’essaie Gérard Lebrun : le décryptage que Marx effectue en termes de réduction du discours à une idéologie s’avère insuffisant. On aura encore rien dit quand on aura repéré chez Hegel une théorie « réactionnaire » de l’Etat ou une soumission à une vision théologique du monde. Ce qu’il faut détecter patiemment, ce sont les choix lexicaux originaux, les options et inflexions de sens donnés aux mots, qui renvoient eux-mêmes à un ensemble de choix vitaux, qui sont des choix paradoxaux, au sens (nietzschéen) où celui qui les fait ne peut pas du tout éviter de les faire. On aura alors cerné une ontologie : une certaine perspective vitale qui devra être évaluée en termes de santé et de maladie.
Aussi est-il vain de vouloir « réfuter » Hegel au nom de l’exactitude historique ou d’une vision plus « progressiste » du devenir humain. On resterait encore littéralement empêtré dans les filets de la dialectique. Il n’y a donc pas en tant que tel d’impensé du texte qu’il faudrait mettre au jour, ni de préjugés sociaux inaperçus et qu’il faudrait dissiper. Pas non plus d’insuffisances logiques, épistémologiques ou empiriques.
La dialectique est tout entière en son développement discursif : elle ne masque pas de non-dit –ce en quoi d’une part, elle n’est pas une idéologie et d’autre part, elle est incurable. « On ne réfute pas une maladie des yeux » : ajoutons qu’on n’en guérit pas avec des verres correcteurs ; on peut en revanche en détecter les symptômes… et se faire une idée de l’étendue des dégâts.
C’est là le résultat du travail « archéologique » entrepris par Lebrun –et qui a pour conséquence une redéfinition de l’activité du philosophe : « Mais par quel entêtement lexical devrions-nous lier le sort de la philosophie à la croyance en l’existence d’un logos qu’il reviendrait à une méthode de déterminer en dernière instance ? Pourquoi la philosophie devrait-elle, pour mériter son crédit, prendre la place, désormais vacante, de la théologie ? Philosopher pourrait aussi bien consister à interroger l’expérience que nous avons des mots, et à rendre à leurs diverses provenances les significations dont le « discours sérieux » des « philosophes » entendait retrouver la vérité. Non plus expliciter le sens (qui, depuis toujours, attendrait d’être énoncé), mais enquêter sur les hasards de sa formation. »14
Livre de rupture, donc, et d’abord pour Gérard Lebrun, qui se reproche un peu d’avoir délaissé trop longtemps Berkeley, Schopenhauer ou Bergson, et d’avoir passé trop de temps avec des auteurs – Kant et Hegel – qui, décidément, « n’étaient pas [son] genre »15.
- Gérard Lebrun, L’envers de la dialectique. Hegel à la lumière de Nietzsche, Seuil, 2004
- « L’acte d’enseigner, dont il faisait son œuvre la plus chère, acte sans œuvre et travail d’acteur dont il préparait (et répétait) avec soin chaque mot, chaque geste, chaque intonation, chaque incise ou aparté, avec un talent consommé d’homme de scène qui déclencha plus d’une fois les applaudissements de ses auditoires… » Avant-propos, page 9
- Pour une tentative similaire, voir le livre de François Zourabichvili, Spinoza : Une physique de la pensée (PUF, 2002), qui se place explicitement sous l’égide de Lebrun ; en particulier le chapitre V : « comment parler le spinozien ».
- page 21
- page 20
- page 72
- page 21
- page 61
- On ne manquera pas de noter que Lebrun a ainsi construit sa démonstration sur un modèle circulaire, puisque cette explication finale, la plus élaborée, la plus riche, rejoint le premier moment, celui de la détermination de la théodicée en sa vérité la plus simple. Ultime hommage au Maître de la part du disciple impertinent ?
- page 314
- page 224
- page 24
- page 315
- page 21
- page 24








