La liberté intérieure de Claude Romano, paru en 2020 chez Hermann (collection « Le Bel Aujourd’hui »), est un essai consacré à la remise en question de la conception traditionnelle de l’autonomie. Le sous-titre modeste, « une esquisse », rappelle la vocation phénoménologique de l’ouvrage, ainsi évoquée à travers la notion husserlienne d’Abschattung. Par un propos clair et concis, l’auteur met en évidence les limites et les présupposés de la conception hiérarchique qui situe l’autonomie dans la soumission des états ou des mouvements psychiques inférieurs, attribués à l’animalité, aux états supérieurs, jugés propres de l’homme (raison, intellect). L’ouvrage se propose ainsi de renouer avec la signification grecque de la liberté, comme parachèvement de la nature propre.
L’introduction présente les principaux reproches adressés à la conception hiérarchique de l’autonomie, reproches ensuite développés dans le reste de l’ouvrage. La première partie expose le débat entre compatibilisme et libertarianisme. La suivante détaille et critique la solution à cette difficulté apportée par Harry Frankfurt, qui adhère au modèle hiérarchique. La troisième partie s’attache à la spontanéité préréflexive de nos tendances ou inclinations. Romano répond ensuite à diverses objections et précise les conditions de réalisation de l’autonomie. La dernière partie illustre ce qui précède par l’exemple de la résolution de Mme de Clèves à la fin du maître-ouvrage de Mme de Lafayette, La princesse de Clèves. Ce qui est en jeu est d’abord le choix entre atomisme et holisme, selon que nous concevons la liberté comme acte fondamental, atome d’initiative absolue, ou bien comme volonté en accord avec l’ensemble de nos attitudes. Il en va également de la nature de l’homme, qui se révèle irréductible à une faculté particulière (raison, intellect, volonté, etc.). Surtout, la marque de la liberté ne se trouve pas dans le pouvoir sur soi, mais dans une paix intérieure qui un état spontané. Enfin ce sont la distinction et la séparation entre autonomie et éthique qui est en jeu, dans la mesure où les exigences de l’une ne sont pas celle de l’autre. Mais nos principes éthiques font partie de nos motivations, au centre desquels se replace l’individu autonome.
Romano envisage la liberté comme capacité de vouloir et de choisir par soi-même, autonomie qui est expression de soi et manifestation de l’accord avec soi-même. La liberté intérieure réside dans le choix qui tient compte de toutes les motivations qui apparaissent dans notre situation et dans nos réactions affectives à celle-ci (p. 17). Cette liberté n’est pas la hiérarchisation des états ou des mouvements psychiques, mais l’accord avec soi dans les volontés et les désirs, éliminant toute source de conflit. Holiste, le gouvernement de soi est « une fidélité à la totalité des mouvements qui nous guident ».[1] L’accord avec soi est un état spontané, c’est-à-dire « réfractaire à toute tentative pour l’amener à se produire directement », « soustrait à tout contrôle direct » (p. 19). C’est « un effet essentiellement secondaire », un by-product au sens de Jon Elster : on ne peut pas « l’amener à se produire comme un effet de notre vouloir ».
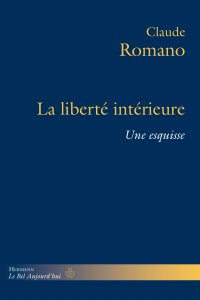
Face au problème de l’autonomie (volonté ou désir sont-ils affranchis de toute coercition ou contrainte ?), Romano renvoie dos à dos les compatibilites et les incompatiblistes. La volonté apparaît alors conditionnée par des raisons, mais nous nous reconnaissons dans certaines volontés ou nous voulons les avoir, alors que d’autres volontés s’imposent à nous. Cette reconnaissance fait notre autonomie : nous agissons ainsi comme nous voulons sans division, sans conflit entre des désirs actuels et des désirs que nous voudrions avoir. Romano reprend ici les thèses d’Harry Frankfurt, avant de les amender : la liberté consiste à faire « ce qu’on veut vraiment », en se reconnaissant dans cette volonté ou en la reconnaissant comme sienne.[2] L’autonomie résiderait dans la possession des volontés et des désirs que l’on veut avoir, ce qui implique une hiérarchie entre les attitudes ou les états d’esprit. L’agent évaluerait réflexivement ses désirs et volitions, pour s’en distancier et les rejeter, ou les endosser et « s’identifier sans réserve aux désirs qui sont les siens, en désirant avoir de tels désirs ». Le problème est que ce modèle implique une régression à l’infini : l’identification serait le désir d’éprouver tel désir, donc elle constituerait un désir de degré supérieur.
Être autonome, explique la troisième partie, c’est « vouloir en plein accord avec soi-même, c’est-à-dire avec l’ensemble de ses attitudes […] vouloir sans division intérieure » (p. 49). L’autonomie implique une « vérité à l’égard de soi-même » : un accord avec nos inclinations, tendances, dispositions véritables, dans leur totalité, donc une unité intérieure ou une adéquation à soi, dont les critères se trouvent dans notre vie affective autant que dans notre volonté. L’autonomie réside d’abord dans l’intégration de « nos désirs de différents ordres, réfléchis et irréfléchis, à une totalité harmonieuse » (p. 50) et cet accord est un effet essentiellement secondaire.[3] Nos désirs et inclinations sont spontanés et nos réactions affectives expriment ce que nous sommes parce qu’elles « se déploient en-deçà de notre contrôle » (p. 51). L’autonomie est à la fois gouvernement de soi et adéquation à soi, « capacité d’évaluation réflexive de nos propres attitudes » et authenticité se traduisant dans nos choix et conduites (p. 53), le double produit d’une réflexion objective fondée sur des normes impersonnelles et d’une réflexion subjective sur les tendances durables et fondamentales de notre vie affective. Cette réflexion subjective révèle à l’agent ce à quoi il aspire en vérité.
Malgré sa labilité, notre vie affective peut nous orienter dans l’existence, car les humeurs sont plus stables que les sentiments, qui sont plus stables que les émotions. La vie affective est ordonnée, soumise à des lois a priori. Après avoir répondu à d’autres objections et critiqué l’idée d’autoconstitution du sujet moral, Romano souligne que chacun des deux versants de la liberté intérieure (évaluation réflexive et spontanéité sensible), indépendant de l’autre, « doit être envisagé à la lumière de l’autre » (p. 66), afin d’unifier, d’une part, les attitudes soumises à un contrôle direct en fonction de normes objectives et, d’autre part, celles qui apparaissent spontanément en fonction de normes subjectives enracinées dans la sensibilité. L’autonomie naît de « l’accord des inclinations entre elles, tel qu’il se manifeste à travers des configurations relativement stables de notre vie affective ». Elle suppose de se replacer au centre de toutes nos aspirations ou motivations, sans chercher à les contrôler, ni à en écarter certaines.
L’autonomie, des Repères éblouissants à La liberté intérieure
LI aborde de façon simple et accessible des questions essentielles, auxquelles l’ouvrage propose des réponses novatrices, en évitant aussi bien les simplifications hâtives que la pure érudition sclérosante. L’ouvrage s’inscrit dans le prolongement d’Etre soi-même (2019) et des Repères éblouissants (2019), quoique les références à ces publications soient rares dans les notes de bas de page. Romano reprend ainsi dans la quatrième partie la distinction entre émotions, sentiments et humeurs, ainsi que l’idée d’une légalité a priori de la vie affective, déjà présentées dans les RE (ch. VIII). Juste avant d’aborder « l’intentionnalité des émotions », les RE définissaient la liberté d’autrui comme « sa capacité à se dérober à nous de mille manières, à se soustraire à l’échange, à se déguiser » (RE, ch. VII, p. 235). Cette liberté s’accompagnait d’une « singularité radicale », conférant à autrui une imprévisibilité radicale. Le huitième chapitre décrivait en détail les caractères phénoménologiques des émotions, déjà considérées comme expressions de nos tendances, donc de nous-mêmes (p. 272). Les réactions corporelles concomitantes aux émotions se signalaient par une spontanéité qui ne dépend pas entièrement de nous, sans être purement involontaire. Les contrôler, c’était leur ôter leur caractère spontané, donc authentique, et la spontanéité ne pouvait par définition être obtenue sur commande,[4] ce que LI rappelle en soulignant que la spontanéité, sans être totalement incontrôlable, « est impossible à contrôler sans perdre son caractère de spontanéité » (p. 51).
Dans les RE, il était déjà question de se reconnaître dans les expressions émotionnelles conformes à nos tendances et de les considérer comme nôtres. La spontanéité des réactions était le critère permettant d’affirmer qu’on éprouve une émotion. L’émotion se présentait comme une expression primordiale de celui qui l’éprouve, une manifestation de ses tendances et une révélation de son être.[5] C’est à ce moment-là que Romano soulignait la stabilité de notre affectivité, la constance relative des tendances, besoins, rejets, vulnérabilités qui s’expriment dans notre vie affective, ce que LI rappelle au début de la quatrième partie.
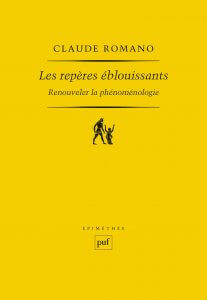
Dans les RE, c’est le neuvième chapitre qui livrait les précisions les plus importantes concernant la liberté, alors associée à la faculté de choisir, faculté exclue par l’habitude-routine, qui rétrécit le champ des possibles. La liberté caractérisait la conduite que l’aptitude a rendue intégrée, maîtrisée, conforme à notre volonté. Romano insistait alors sur le caractère temporel et progressif ou graduel de la liberté, comme « aptitude sui generis obtenue et développée au fil du temps », à travers l’éducation et l’expérience personnelle (ch. IX). Dans LI, il souligne que l’autonomie (dans son versant subjectif) se fonde sur des tendances générales de notre vie affective dégagées sur un temps long : l’adéquation à soi suppose de prendre en compte les tropismes affectifs stables (p. 62). Si la sensibilité n’est pas d’emblée en accord avec la réflexion pratique sur les raisons présidant au choix, il faut faire un effort pour « progresser vers un plus grand accord entre nos différentes attitudes », en considérant les motifs qui apparaissent dans la situation et les normes subjectives que nous révèle notre sensibilité.[6] C’est ce caractère linéaire ou horizontal de la liberté qui nous paraît être un contresens, puisqu’il ne semble pas y avoir de liberté intérieure tant que nous sommes asservis au temps, sous la forme du passé, du connu, c’est-à-dire de la pensée. Il faut dire que la liberté est initiale ou immédiate, qu’elle n’est pas une chose à atteindre ou à gagner, un idéal, un état d’esprit qui devrait être progressivement atteint au cours du temps, grâce à diverses pratiques : « la liberté n’est pas le choix […] la liberté ne se trouve pas au terme de l’évolution de l’homme, souligne Jiddu Krishnamurti, mais réside dans le premier pas de son existence ».[7]
Dans les RE, Romano proposait une « définition minimale » de la liberté qui pointait déjà vers le concept d’autonomie : la liberté se donnait comme « la capacité à décider par soi-même à l’encontre d’un conditionnement par la société » (en particulier par la « voix publique » : on), « une appropriation de son choix et une aptitude à décider par soi-même ». Les réflexions objectives et subjectives, décrites aux chapitre III et IV de LI, étaient déjà présentes sous la forme d’une « délibération », décrite comme une aptitude acquise (RE, ch. IX, « « Habitude » et liberté »). La spontanéité justifiait le caractère horizontal ou linéaire de la liberté : notre spontanéité de vivants « autolocomoteurs », était-il expliqué, nous permet d’acquérir une capacité à soumettre nos raisons d’agir à une évaluation, à délibérer sur nos fins et par-là à décider par nous-mêmes en nous soustrayant (en partie) aux pressions et conditionnements environnants. On s’approprie ainsi l’aptitude à l’autonomie, qui admet des degrés, de sorte qu’il y a une éducation à la liberté.
De l’ipséité à la liberté
Dans le prolongement d’Etre soi-même, LI tente de préciser les rapports entre liberté et ipséité, en faisant de l’autonomie l’expression de soi et la manifestation de l’accord avec soi-même. La notion de liberté était déjà au cœur d’Etre soi-même, où elle accompagnait le naturel, la spontanéité et l’irréflexion. Comme dans LI (I, p. 24-25), l’étude de la liberté stoïcienne conduisait à évoquer le compatibilisme (Être soi-même, ch. III), mais au lieu de pointer la conception hiérarchique de l’autonomie, Romano soulignait alors le monisme psychologique des stoïciens, qui refusent d’opposer raison et passions. L’auteur envisageait l’ipséité comme naturel, c’est-à-dire comme diminution du « contrôle ordinaire sur nous-même » et « expression de ce que nous pensons et ressentons vraiment » (p. 601). La spontanéité, déjà irréductible à la volonté comme au jugement, était définie comme inclinations et aspirations qui apparaissent « en nous sua sponte, antérieurement à toutes nos prises de position (volonté et jugement) à leur égard ». La condition de l’accord avec soi et de la liberté était le naturel, par la suppression de toute dualité entre notre nature sensible et notre volonté rationnelle. La maîtrise de soi impliquait un contrôle procédant d’un laisser-aller supérieur, l’accord intérieur naissait d’un souci de soi prenant la forme d’une négligence et d’un « insouci de soi ». La liberté était envisagée non pas comme libre-arbitre, mais comme accomplissement de soi, ce qui n’est pas sans rappeler le parachèvement de la nature propre évoqué par l’introduction de LI.[8]
Alors que LI fait de l’accord avec soi-même un by-product au sens de Jon Elster, « un effet essentiellement secondaire », Être soi-même reprochait à Elster de confondre l’attitude de nonchalance, le fait de se placer volontairement dans un état ou une disposition propices à la nonchalance, avec le fait de « se placer dans une attitude consistant à vouloir être nonchalant », d’être volontairement nonchalant ou d’être tel par un effet direct de sa volonté (p. 623). Là où l’auteur du Laboureur et ses enfants soutenait qu’on ne peut pas se donner pour but d’être naturel, que le naturel n’est pas un idéal et qu’il est comparable au sommeil, Être soi-même objectait que la comparaison n’est pas légitime, que le sommeil n’est pas une conduite et qu’il peut s’obtenir par des procédés indirects. Romano soulignait le caractère volontaire des attitudes consistant à « se placer dans un état propice au sommeil ».[9] Elster se voyait reprocher de croire à tort que l’impossibilité de s’appliquer à être naturel est causale ou empirique, alors qu’elle est conceptuelle.
Au terme de l’ouvrage de Romano, le lecteur peut rester désireux de savoir comment concrètement parvenir, dans nos choix, à ne plus chercher à contrôler ou écarter certaines de nos aspirations ou motivations. Mais cette difficulté tient plus à la frustration que provoque un bref développement bien mené plutôt qu’à une insuffisance de l’ouvrage. Un doute peut néanmoins s’élever concernant la distinction entre actes et volontés, ou désirs, proposée dès le début de la première partie. Romano insiste certes sur l’irréductibilité de l’autonomie à la volonté et sur son rapport nécessaire à des tendances ou des inclinations spontanées et infra-volontaires. Mais nulle part l’auteur ne remet en question l’idée que la liberté serait intrinsèquement liée à la volonté, au choix et aux désirs : l’autonomie est d’abord et prioritairement « une question d’intégration de nos désirs ».[10] Lors même que la troisième partie se présente comme un éloge de la spontanéité de nos réactions affectives, cette spontanéité est toujours rapportée à l’autonomie comme capacité de vouloir et de choisir par soi-même, ou comme fait de « vouloir sans division intérieure » (49). En ce sens, l’ouvrage ne rejette pas tout volontarisme moral, mais surtout l’une de ses formes particulières : celle qui soutient que l’accord intérieur peut être produit « de manière volontariste » (p. 65), que je peux « me constituer comme un sujet dont la volonté serait unifiée par une action réflexive directe sur moi-même ».
Une liberté prisonnière de la volonté ?
Etre soi-même soutenait déjà qu’on peut vouloir et obtenir indirectement la survenue du naturel, de la nonchalance et de la spontanéité, comme un « effet secondaire », « une conséquence indirecte », en se plaçant dans un état qui leur est propice (p. 633-634). Romano concevait cette démarche en un sens technico-pratique, ou artisanal, sur le modèle partiellement volontariste d’une aptitude, ainsi que nous avions eu l’occasion de le souligner. Dans LI, nos réactions affectives, pourtant spontanées, peuvent là aussi être « suscitées comme des effets indirects de certaines stratégies » (p. 51). Plus généralement, il ne s’agit pas seulement dans LI de découvrir nos inclinations ou tendances spontanées, mais aussi de vouloir en plein accord avec elles. L’autonomie n’est pas seulement adéquation à soi, elle est aussi gouvernement de soi, contrôle direct de notre jugement et de notre volonté (p. 56). Mais la liberté intérieure est-elle vraiment une question de volonté ? Y a-t-il réellement un rapport entre liberté et volonté ? Il n’y a peut-être de choix qu’en cas d’hésitation, et d’hésitation qu’en cas de confusion. « Quand on voit les choses très, très clairement, explique par exemple Krishnamurti, il n’y a pas de choix ».[11] Pour reprendre un exemple cher à Romano, en cas d’amour authentique l’entreprise de se marier peut apparaître comme une évidence davantage que comme le produit d’une décision et d’un choix réfléchi ! Il y a liberté quand « l’esprit est assez clair pour ne pas avoir à demander, à décider quoi que ce soit ».[12] Au lieu de situer la liberté dans la volonté en accord avec soi, il faut souligner que « fondamentalement, nous ne sommes pas libres du tout. Nous sommes conditionnés, et il faut une compréhension énorme de ce conditionnement pour être libre ».[13] De ce point de vue, rien n’indique chez Mme de Clèves une compréhension profonde de la nature, de l’origine et des limites de la volonté en général.
Romano lui-même semble admettre que la liberté qui est celle de la volonté n’est pas absolue ou totale, qu’elle est partielle et limitée, puisque nous ne pouvons pas toujours vouloir selon notre bon vouloir ou « façonner » nos propres volontés à notre guise.[14] Autant dire que la liberté de s’affirmer soi-même n’est pas la liberté absolue.[15] Romano évite à juste titre la condamnation de l’attachement, la promotion du renoncement et de l’abdication, mais il rejette ces attitudes au motif que le choix n’y tient pas compte de toutes nos motivations, que sa décision ne reflète pas tout ce qu’il est. Or s’il faut rejeter ces attitudes, n’est-ce pas plutôt parce qu’elles sont volontaires et qu’il n’y a aucune liberté dans « un acte de volonté accompli par la pensée »[16] ? « La liberté est totale », semble-t-il, si nous percevons clairement qu’elle est nulle dans ces actes volontaires.
Paix et volonté
La définition romanienne de la liberté intérieure semble contradictoire, dans la mesure où la volonté paraît exclure la paix, l’absence de toute division et de tout conflit, pourtant considérée comme « le sceau de la liberté pleine et entière » (p. 18). L’accord avec soi dans les volontés et désirs consiste en effet à vouloir en accord avec l’ensemble de nos attitudes (inclinations, tendances, dispositions), à intégrer « nos désirs de différents ordres, réfléchis et irréfléchis, à une totalité harmonieuse »,[17] par exemple reconnaître et accepter nos pulsions comme un aspect de nous-même, pour réussir à les domestiquer (p. 43). Mais la volonté et le désir ne sont-ils pas eux-mêmes à l’origine du conflit ? Il faut préciser que le conflit réside dans le fait d’« être tiraillé entre des désirs que l’on a et les désirs que l’on voudrait avoir ».[18] Or la volonté et le désir semblent être dans une situation de conditionnement réciproque vis-à-vis de la pensée et de sa tendance inhérente à opposer ce qui est et ce qui devrait être.[19]
« La volonté elle-même est le conflit, explique ainsi Krishnamurti, elle est la conséquence du conflit […] l’action en vue d’un but enferme le moi en lui-même, elle sépare, elle isole. […] C’est la volonté qui engendre le conflit, le désir de devenir ou d’atteindre le suprême ».[20]
Dès lors qu’il y a volonté ou désir, il y a division entre ce qui est et ce qui devrait être, entre observateur et observé, ou bien entre des motivations divergentes. Or cette division n’est-elle pas l’origine du conflit ? Pour les êtres conditionnés que nous sommes, choisir et décider en tenant compte de notre sensibilité et de notre vie affective, au lieu de les exclure, rester fidèle « à notre propre complexité intérieure » (p. 17), n’est-ce pas laisser notre conditionnement s’exprimer et s’aggraver, au lieu de le comprendre et ainsi de le neutraliser ?
Nos réactions affectives ne sont spontanées selon Romano qu’au sens où elles se produisent en nous de leur propre initiative, se déploient en-deçà de notre contrôle : il est impossible de les susciter ou de les modifier à notre guise, par un effort direct de volonté. Mais elles restent des réactions, qui peuvent être acquises[21] et lorsqu’elles sont innées chez l’individu, elles sont vraisemblablement a posteriori du point de vue de l’espèce et de son évolution. Certes, pour Romano la vie affective et sa motivation obéissent à des lois a priori, dont les RE (ch. VIII) expliquaient déjà la possibilité ; mais cette thèse est inséparable d’un ensemble de spéculations sur la nécessité et sur les structures immanentes de l’expérience. Elle doit être rejetée si les motifs qui éveillent les émotions se révèlent projetés sur le monde par le sujet émotif, conférés aux choses par nos états affectifs, situés dans nos croyances à propos des choses plutôt qu’enracinés dans des aspects du monde. Les normes vitales auxquelles nos émotions seraient liées et qui sont censées être relativement stables d’un individu à l’autre n’ont-elles pas en réalité subi au cours de notre évolution, en particulier depuis notre auto-domestication, une altération significative, en forme de dégénérescence ? C’est ce que soutiennent les partisans d’une perturbation de nos instincts influencés par de « fausses loi »,[22] c’est-à-dire un développement artificiel, produit par les conditions extérieures créées par l’homme, à savoir notre société artificielle, incomprise et soumise au règne de l’inauthenticité et de l’alinéation, sous la forme de l’opinion, de l’imitation, de la convention, de l’hypocrisie, du mensonge et du conformisme, décrits en détail par Être soi-même (ch. XIV).
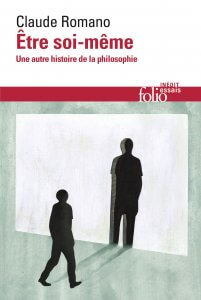
La distinction romanienne entre émotion, sentiment et humeur permet difficilement de faire la différence entre d’une part les affects – intentionnels ou non –, qui sont enracinés uniquement dans le corps, dans des instincts intacts et dans la perception de directe ce qui est (par exemple la peur face à un danger réel, ou la joie gratuite, supplémentaire, sans motif ni raison) et d’autre part les affects conditionnés par l’esprit, la pensée ou par des instincts qu’ils ont perturbés (comme la peur de paraître ridicule aux yeux d’autrui). Si l’on ne confond pas l’affectivité normale ou saine avec l’affectivité commune et habituelle, beaucoup des émotions que Romano juge justifiées, parce qu’intentionnelles et rationnelles, motivées par de bonnes raisons – pourront paraître inappropriées à la situation, voire pathologiques. La manière dont le monde m’apparaît me dévoile mon appartenance au monde non seulement en tant que corps, mais tout autant comme esprit pensant. L’émotion exprime des tendances dont la nature ne dépend pas seulement de ce qui est, mais aussi de la pensée, du connu ; elle nous éloigne en partie de ce qui est. Les émotions sont vécues dans les limites du moi comme individualité empirique ; elles semblent conditionnées par la pensée et son activité interprétative, ou réductibles au connu. Les prétendues raisons qui motivent nos émotions dépendent peut-être de ces émotions et de ce qu’on croit sur le monde ou juge à son sujet.[23] Il ne semble en aller autrement que dans le cas inhabituels, qui ne méritent pas d’être appelés « émotions » parce qu’ils ne sont pas nécessairement intentionnels ni motivés par des raisons, mais qui ne sont pas non plus des « humeurs », parce qu’ils ont une portée cognitive et ne sont pas une projection sur la situation de nos états transitoires.[24] Il nous semble, en somme, que les relations mutuelles entre les motifs sont contingentes, qu’il n’y a pas de lois a priori de la motivation qui régiraient la sphère émotionnelle, qui détermineraient des relations nécessaires des émotions. Les émotions sont des réactions subjectives contingentes à des situations contingentes. Notre vie affective ordinaire n’a pas seulement une dimension contextuelle : elle est elle-même le contexte, dirait Krishnamurti, au sens où sa contextualité est intrinsèque. Notre vie affective ordinaire est en outre relative aux circonstances et cette relativité n’est peut-être pas un principe objectif, mais un principe subjectif appartenant aux régularités de la motivation des affects communs et habituels.
Une liberté compromise ?
Pour Romano, la décision autonome est « l’expression de notre propre complexité intérieure, peut-être même un difficile compromis » (p. 69). Mais comment faire le lien entre cette complexité et la simplicité, l’absence de souci réflexif, qui définit le naturel selon Être soi-même ? Si être soi-même, c’est être naturel, donc faire preuve d’une réelle simplicité, qui ne peut être recherchée pour elle-même et qui exclut la conscience réflexive, reste-t-il encore une complexité intérieure à laquelle il s’agirait d’être fidèle, ou dont témoigneraient les exigences intégrées – toujours imparfaitement – dans la décision ? La difficulté s’aggrave si la simplicité s’avère indispensable à la liberté intérieure, ainsi qu’il est permis de le supposer, en accord pourtant avec Être soi-même. Elle devient radicale si nous ne réduisons pas la simplicité à l’absence de retour réflexif sur soi-même, comme le fait la conclusion de l’ouvrage de 2019, mais si nous redonnons à la simplicité toute sa richesse de signification, en reconnaissant par exemple que « ce qui est simple est infiniment subtil, […] extrêmement délicat », et que « vivre simplement est l’art le plus grand ».[25]
La liberté intérieure semble radicalement éloignée du compromis qu’évoque Romano. Ce dernier soutient que la décision finale de Mme de Clèves est un compromis difficile et courageux, la « nécessité d’une intégration, toujours imparfaite, entre des exigences qui témoignent de sa propre complexité intérieure » (p. 77). La justesse d’une décision existentielle singulière dépendrait d’un « va-et-vient entre les deux faces de l’autonomie », évaluation réflexive et spontanéité sensible (p. 78). En réalité, quand nous discernons intelligemment quels sont nos besoins essentiels, « nous ne sommes plus avides de possessions » et nous ne faisons « plus de compromis entre ces besoins essentiels et les conditions du monde qui reposent sur la soif des possessions », nous pouvons nous libérer de l’attitude de possessivité.[26] Il n’y a pas de compromis dans la vie quotidienne lorsque nous n’avons plus le sens de l’acquisition – même si nous vivons dans une société qui cultive la possessivité –, de même qu’il n’y a pas de « possibilité de compromis entre la guerre et la paix ». Si nous croyons réellement qu’une action (par exemple tuer) est mauvaise, nous n’acceptons aucun compromis (par exemple « dans la provocation d’une guerre, ou dans la participation au conflit »). Il ne peut pas non plus y avoir « un compromis entre l’acquisition et la non-acquisition. Il n’y a de compromis que si, à un certain moment, nous voulons acquérir quelque chose et qu’à un autre moment nous ne voulons pas l’acquérir », lorsque nous avons l’instinct de possession et que nous laissons « aux circonstances, aux idées, aux idéaux le soin de [nous] pousser à perdre ce sens de la possession ». Nous comptons alors sur le temps pour établir ces compromis, qui sont inévitables lorsque nous avons l’instinct d’acquisition et qu’en même temps nous voulons ne pas l’avoir.[27]
Une autonomie abstraite ?
La liberté intérieure dont parle Romano est moins une réalité que – au mieux – « une idée régulatrice ; il est peu probable qu’on puisse l’atteindre sous une forme achevée – encore moins de manière définitive. Une intégration parfaite entre les deux versants, objectif et subjectif, de l’autonomie est un idéal dont on peut chercher au mieux à se rapprocher » (p. 70). Cette situation, qui explique en partie pourquoi l’exemple topique d’autonomie donné dans la cinquième partie est issu de la fiction – rappelle la rareté et la fugacité du naturel, considéré par Être soi-même comme « une situation-limite dans laquelle nul ne peut se tenir en permanence. Pour les animaux réfléchissants que nous sommes, cette attitude ne constitue probablement pas le cas le plus courant » (p. 622). Pour notre part, nous avons préféré mettre ces limites au compte du caractère volontaire de la pratique censée favoriser la survenue de la spontanéité, et de l’enracinement de cette pratique dans la tendance inhérente de la pensée à forger le sentiment illusoire d’un moi permanent. Le caractère idéel, régulateur, incomplet et fugace de l’autonomie semble fragiliser le discours de Romano, voire en saper directement les fondements, puisque l’auteur se proposait au départ « de revenir en-deçà » de la compréhension de la liberté à partir de son concept simplement formel (p. 6), pour atteindre la « liberté pleine et entière », achevée (p. 7), le parachèvement même de l’homme, sous la forme d’une volonté et d’une décision qui « expriment l’être que nous sommes ». L’attachement à l’idéal, sous quelque forme que ce soit, n’est-il pas un des obstacles majeurs à l’éclosion de la liberté intérieure ? Difficile de comprendre comment l’autonomie pourrait rester spontanée, s’il s’agit de l’envisager comme un idéal – celui d’une intégration entre le gouvernement de soi et l’adéquation à soi – dont nous cherchons à nous rapprocher.
[1] Une décision autonome reflète tout ce qu’on est », émotions comprises (p. 18).
[2] p. 32. Ou encore : « on n’est véritablement libre que si l’on agit comme on veut sans être divisé intérieurement, c’est-à-dire sans être tiraillé entre des désirs que l’on a et les désirs qu’on voudrait avoir ».
[3] On ne peut pas décider de cette intégration, ni atteindre cet état « comme le produit d’une tentative directe pour l’engendrer ». Cet accord est « un état réfractaire au vouloir à propos duquel tout effort pour l’amener directement à se produire échoue » (p. 50).
[4] Lors de notre lecture d’Etre soi-même, nous ignorions encore les raisons précises, tenant à des structures a priori et détaillées dans les RE, pour lesquelles « la spontanéité se définit comme ce qui ne peut s’obtenir sur commande » (Être soi-même, p. 633).
[5] RE, p. 276-277.
[6] p. 69. C’est nous qui soulignons.
[7] Jiddu Krishnamurti, in Mary Lutyens, Les années d’accomplissement, vol. II, éd. Arista, 1984.
[8] La représentation de la liberté qui était combattue n’était pas la conception hiérarchique de l’autonomie, mais la réduction de la liberté « à un pouvoir de façonnement de soi quasi illimité ne reposant que sur lui-même » (Être soi-même, p. 610). Le naturel résidait dans des déterminations (grâce et simplicité) spontanées ou infra-volontaires et préréflexives. Le naturel était d’abord ce qu’on ne peut pas « amener à se produire comme un simple effet du vouloir » (ibid., p. 625).
[9] Être soi-même, p. 632. On peut volontairement chercher à agir, expliquait Romano, pour « favoriser la survenue d’un état de nonchalance », lequel peut rendre nos conduites spontanées.
[10] p. 50 (c’est nous qui soulignons). Krishnamurti pointe souvent ce présupposé : « Nous pensons qu’il [le choix] nous donne la liberté. Nous aimons cette liberté de choisir ; nous pensons que la liberté est nécessaire pour ce choix — ou plutôt que le choix nous donne une sensation de liberté » (Krishnamurti, Krishnamurti to himself, Mercredi 20 avril 1983, cf. Dernier Journal, Ed. du Seuil, Coll. « Points Sagesses », p. 86-87).
[11] Ibidem. « Quand il choisit, il [l’homme] est déjà dans la confusion. Quand vous voyez quelque chose vraiment clairement, vous ne faites pas de choix. […] Quand vous voyez quelque chose très clairement, où est la nécessité de choisir ? Il n’y a pas de choix. C’est seulement un esprit confus qui choisit […] pas un esprit clair et précis qui voit directement les choses. Pour un tel esprit il n’est pas de choix. » (Collected works, Vol. XVII – 270, https://www.krishnamurti-france.org/Fondamentalement-nous-ne-sommes-pas-libres).
[12] Krishnamurti, causerie publique du 23 juillet 1972 à Saanen (Suisse), cf. Vivre dans un Monde en Crise, Pocket Spiritualité, 2008, I, ch. 5, p. 114.
[13] Krishnamurti, Collected works, Vol. XVII – 270.
[14] Seule la « liberté partielle » naît « de la volonté de se libérer de quelque chose », alors que la liberté « totale, absolue » n’en naît pas. (Krishnamurti, causerie publique du 1er septembre 1985 à Brockwood Park [Grande-Bretagne], Vivre dans un Monde en Crise, Pocket Spiritualité, 2008, ch. 13, p. 246).
[15] « La liberté absolue […] n’est pas celle de faire ce qui vous plaît, vous affirmer ou convertir autrui. Tout cela n’est que sottise » (Krishnamurti, causerie publique du 29 août 1985 à Brockwood Park [Grande-Bretagne], ibid., II, ch. 11, p. 241).
[16] Krishnamurti, causerie publique du 23 juillet 1972 à Saanen (Suisse), ibid., I, ch. 5, p. 131.
[17] p. 50. C’est nous qui soulignons.
[18] Romano, LI, p. 32. Le conflit provient de « volontés qui s’imposent à nous, parce que nous échouons à nous reconnaître en elles », des « volontés que nous ne voulons pas avoir » et qui ne sont donc « pas vraiment « les nôtres » au sens fort » (p. 31), « une volonté compulsive s’imposant à nous contre notre gré » (p. 32).
[19] « Dès lors qu’on a le choix, la contradiction est là. Le choix existe lorsqu’on est dans la confusion », quand on ne sait pas quoi faire, parce qu’on n’accepte pas la réalité telle qu’elle est : « vous essayer de changer ce qui est en quelque chose d’autre et, dès lors que vous faites cela, un conflit apparaît, et ce conflit est source de confusion » (Krishnamurti, Vers la révolution intérieure).
[20] Krishnamurti, Commentaires sur la vie, t. I, ch. 78.
[21] « Beaucoup de nos inclinations, goûts, prédilections, sont en nous le produit d’une éducation, d’une culture, ou la conséquence des événements qui ont façonné nos vies » (p. 52).
[22] Krishnamurti, le 2 avril 1934, Auckland (Australie).
[23] Selon cette perspective, c’est souvent la croyance, et non le fait, qui motive l’action. Une raison dépend de ce qu’on croit sur elle et nous avons des raisons d’éprouver, croire et faire quelque chose dans la mesure où nous ne comprenons pas ce qui est et où nous nous en éloignons. Les motifs des émotions seraient donc des projections sur le monde de notre vie émotionnelle. Les émotions ne seraient pas motivées par des faits du monde. Les vecteurs émotionnels dépendraient des émotions.
[24] Tel est le cas de ce que Krishnamurti appelle la « passion ». Sans motif, mobile, ni cause, la passion est un état de notre intimité la plus profonde, qui n’est pas la réponse à une stimulation. Elle naît de l’attention, de l’affrontement de la souffrance, de l’abandon de soi ou du don de soi-même, et elle ne contient nulle exigence, ni recherche d’assouvissement ou de stimulation, seulement une sensibilité extrême étendue à tous les phénomènes de façon égale, ainsi qu’une forme d’« austérité », liée à l’absence de moi et de dualité entre l’observateur et l’observé.
[25] Krishnamurti, huitième Causeries à Ojai (Californie), dimanche 24 Mai 1936.
[26] Krishnamurti, 1ère Causerie dans les Jardins de L’École Vasanta, le 30 mars 1934, Auckland (Australie), CW, vol. 2 « Qu’est-ce que l’action juste ? » (1934-1935), Éditions de Kendall/Hunt Dubuque (Iowa), 1991-1992 (c’est nous qui soulignons).
[27] Ibidem. Krishnamurti donne l’exemple de Gandhi, dont la « pensée était celle d’un révolutionnaire », mais qui s’est révélé ensuite n’être qu’un réformateur : « une fois engagé dans le jeu politique, Gandhiji a dû recourir aux compromis et ses tendances révolutionnaires ont été étouffées ». Krishnamurti, cité in Pupul Jayakar, Krishnamurti une vie, Presses du Châtelet, 2010, p. 166 (c’est nous qui soulignons). L’action n’est pas un compromis et elle est harmonieuse lorsqu’elle n’est pas engendrée par des impulsions momentanées et que nous agissons à partir de notre « plénitude », lorsque nous faisons preuve d’« une grande ardeur, une grande recherche dans la profondeur de l’action » (Italie, 2ème Causerie, Stresa, le 8 juillet 1933).







