Pierre Caye est philosophe et directeur de recherche au CNRS. Il vient de publier Durer[1] aux Belles Lettres, ouvrage qui fait suite à la Critique de la destruction créatrice (2015) ainsi qu’à Comme un nouvel Atlas (2017) édités par la même maison. Deux livres importants ont précédé cette trilogie : Morale et Chaos paru aux Éditions du Cerf en 2008, et Empire et décor sorti en 1999 chez Vrin. Cette actualité est une opportunité pour revenir sur l’ensemble de son œuvre et exposer le cheminement de sa pensée.
Actu-Philosophia : Pierre Caye, je vous remercie chaleureusement d’avoir accepté cet entretien. Si j’ai pris attache avec vous, c’est que j’ai trouvé votre pensée particulièrement stimulante : architecture et urbanisme, droit, néoplatonisme, économie et travail, technique, philosophie politique, …, pléthore sont les thèmes que vous abordez et mettez en relation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de découvrir sous quelle pensée directrice se subsument tous ces objets et de dénouer les fils que vous avez tressés entre eux, j’aimerais que nous prenions le temps de comprendre ce qu’est la philosophie pour vous. Vous écrivez dans le premier chapitre de Comme un nouvel Atlas[2] (p. 11-12) :
« Je propose pour ma part une autre approche, car il n’est pas de philosophie qui me semble digne d’être pensée et exercée aujourd’hui si celle-ci se montre incapable de se confronter à la puissance de la mondialisation et, par cette confrontation, de se constituer en tant que métaphysique dans sa double fonction de compréhension du réel et de libération par rapport à son inertie ».
Alors voici mes premières questions : la philosophie a-t-elle pour seule vocation, ou pour vocation essentielle, de se confronter à la mondialisation ? Son destin, même après les entreprises de destruction (Heidegger) puis de déconstruction (Derrida en particulier et les penseurs dits « postmodernes » de façon plus générale), est-il encore de se faire métaphysique ? Pourquoi ? Dans quel but ?
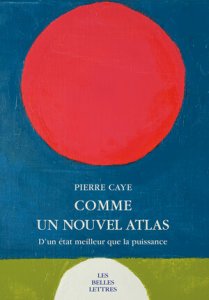
Pierre Caye : La mondialisation ne se limite évidemment pas à l’internationalisation des échanges et à la levée des barrières douanières. Elle est au service de la marchandisation généralisée de la société, c’est-à-dire au fait que tout acte, même dénué de finalité patrimoniale (jouer du piano, aller à l’école, partir en vacances, etc.), a des effets économiques et est appelé à se trouver monétisé et inclus dans la comptabilité nationale. Les Anglo-saxons appellent la mondialisation « globalization ». Ce terme me semble plus juste parce qu’il signale une approche globale des actions humaines, des actions interchangeables à travers le marché. Bref, la mondialisation est au service de l’instauration du règne de l’économie. Et par instauration j’entends deux choses : 1) l’économie forme un ordre, je dirais même, en reprenant un terme nietzschéen, une formation de souveraineté (herrschafgebilde), ou plus exactement une formation de domination, puisque l’économie et sa mondialisation témoignent d’un système politique post-souverain capable de faire ordre et de produire ainsi de la domination non moins que les vieux dispositifs de souveraineté ; 2) l’économie dispense ses principes et sa loi à l’ensemble des pratiques sociales ; elle diffuse pour reprendre la formule de Mark Fisher (Le Réalisme Capitaliste, N’y a-t-il aucune alternative ?) une atmosphère généralisée qui détermine non seulement nos conditions de travail, mais aussi les savoirs qu’on nous enseigne, voire les arts et la culture. Cette domination globale du marché donne l’impression pour reprendre une expression célèbre de Margaret Thatcher, qu’ « il n’y a pas d’alternative », absence d’altérité et d’issue, qui caractérise bien la formation de domination, en scellant précisément son effectivité. Dans ce cadre, l’essentiel des débats intellectuels ou politiques contemporains ne sont en fait que des arbitrages, des régulations au sein de la formation de domination.
Il n’y aucune raison pour que la philosophie échappe à cette domination, et il est maints exemples où celle-ci finit par se dissoudre dans le grand régime de narrativité générale qui accompagne toute formation de domination. Je ne suis pas sûr que les courants philosophiques que vous citez – la destruction de la métaphysique en tant que celle-ci serait l’oubli de l’Etre, la déconstruction, le post-moderne ou la French Theory, et on pourrait y ajouter l’Ecole de Francfort ou la philosophie analytique–, aient pris toute la mesure de la mondialisation et de la révolution néolibérale de notre temps qui n’est ni la continuation du Gestell, du règne de la technique et de la planification telle que Heidegger le décrit au début des années 50, ni un retour au capitalisme du XIXe siècle. Toutes ces philosophies, sans exception, voulaient solder la séquence tragique des totalitarismes européens du XXème siècle où, il est vrai, l’ontologie a joué un rôle non négligeable, sans prendre la mesure des nouvelles formes de domination en voie d’émergence. Adorno et Horkheimer dénonçaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale la pulsion totalitaire des Lumières. Les Lumières ont disparu aujourd’hui, mais la domination est restée. La domination c’est ce qui reste toujours : à la fin, c’est toujours elle qui gagne. Je suis sensible à l’ambition critique de la philosophie contemporaine et mes ouvrages en témoignent, mais il n’est pas, à mes yeux, de critique philosophique digne de ce nom si elle ne prend pas en compte non seulement le récent passé européen mais aussi les nouvelles dominations qui s’annoncent.
La métaphysique est un vieux savoir, un très vieux savoir qui se compte en millénaires, j’oserais même dire, comme Joseph Delteil, un savoir « paléolithique », qui se sert des mots simples de la langue pour renvoyer aux expériences communes de la vie : être, un, multiple, le même, l’autre, etc. Le terme d’essence, d’ousia, par exemple signifie d’abord en grec la terre, le fond, le patrimoine foncier. Rien de plus évident pour les Grecs. C’est en quoi l’ousia signifie essentiellement la stabilité du réel d’où les Grecs tirent leur idée d’essence. Deleuze aimait dire qu’il faisait une métaphysique naïve, en utilisant lui aussi des mots simples. J’ajouterais que toute grande métaphysique est appelée à jouer de sa naïveté. C’est la meilleure façon de déjouer la complexité des formations de domination, d’y introduire de l’étrangeté, de l’uncanny disent les Anglo-saxons. Dans Durer, je procède à une opération extrêmement simple qui consiste à prendre l’expression « développement durable » au pied de la lettre, en me demandant ce que la durée fait à la production et à son économie. Cette simple question, proprement philosophique, remet en cause les postulats de l’économie contemporaine, qui est un savoir acosmique, sans feu ni lieu, et qui à ce titre se prête au plus haut point à la mondialisation.
J’ajouterai enfin que la métaphysique est un savoir de la différence, comme au demeurant les autres grands savoirs « paléolithiques » : le droit ou l’architecture, auxquels je me suis aussi fortement intéressé comme vous le rappelez. Le droit repose sur la différence du fait et du droit, l’architecture sur celle du chantier et du projet, la métaphysique sur celle du principe et de ses principiés. Même si ces savoirs « paléolithiques » sont aujourd’hui souvent malmenés, même si la globalisation tend à réduire leur différence constitutive, ils sont omniprésents ; il en va de même de la métaphysique.
Il y a un grand malentendu entre Heidegger et la plupart de ses interprètes. Heidegger est le dernier grand penseur de la différence, celui qui a montré mieux que tous ses prédécesseurs que la différence anthropologique, la différence entre l’homme et l’animal qu’il a thématisée sous le terme de Dasein, repose sur la différence métaphysique, en l’occurrence ontologique entre l’être et les étants. La philosophie contemporaine a plutôt tendance, comme le reste de la société globalisée, à réduire la différence, à lui en donner une version minimaliste (la différance derridienne ou Différence et répétition de Deleuze). Minimiser la différence ne signifie pas au demeurant sa négation ; il y a sans doute un bon usage de la minimalité de la différence, mais cela dépasse notre propos d’aujourd’hui. Oui sans doute un bon usage, mais aussi un risque, celui de la dissémination et de la dissolution de la philosophie dans la narrativité générale de la formation de domination. Or, et c’est l’idée que je défends, seule la différence peut failler, fissurer ce qui se donne dans l’absolue immanence que lui procure la clôture propre à l’absence de toute alternative. Naïveté, étrangeté, différence sont les seuls instruments capables de remettre en cause le processus de reproduction de la formation et d’intensification de la domination.
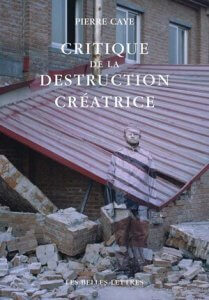
J’ai fait appel pour ma part, dans Critique de la destruction créatrice[3], à une différence plus radicale encore, non pas à la différence ontologique (entre l’Être et les étants, entre la puissance et l’acte), mais à la différence hénologique néoplatonicienne (la différence entre l’Un et l’être, entre le principe de cohérence et celui de l’existence), pour rendre raison de la situation contemporaine du système productif et de sa responsabilité à l’égard de l’environnement et des générations futures. Ce faisant, j’ai à la fois radicalisé la différence pour la rendre indissoluble dans la culture contemporaine liée organiquement à la formation de domination, mais je l’ai aussi, d’une certaine façon, minimisée pour la rendre opératoire au sein de cette même formation, selon une véritable dialectique du maximum et du minimum. Vous me demandez alors : mais la philosophie ne peut-elle servir qu’à fissurer les dispositifs de domination ? Si on considère que la philosophie est un exercice libre de la pensée, un affranchissement de la pensée par rapport à tout ce qui la code, et non pas une simple consolation, alors, sans être la seule fin de la philosophie, celle-ci en est sans doute la fin première … pour une philosophie première.
PREMIÈRE PARTIE : LA MOBILISATION TOTALE
AP : Merci, cher Pierre Caye, pour cette longue réponse qui annonce la marche que nous allons suivre dans cet entretien : je vous propose en effet de partir du monde d’aujourd’hui tel qu’il est, tel qu’il se donne, tel qu’il va, et que vous caractérisez plus précisément par le phénomène de « destruction créatrice », puis d’en sonder les racines et les principes métaphysiques ; nous serons alors en mesure de comprendre comment votre interprétation du néoplatonisme permet de réintroduire de la différence – terme clef de vos propos précédents et catégorie directrice de vos ouvrages – à rebours du projet de totalité porté par l’ontologie. Il nous restera alors à examiner comment cette restauration de l’hénologie peut conduire à un développement durable qui ne soit pas au service du développement, mais de la durée. Débutons donc par cette « destruction créatrice », une expression par laquelle l’économiste autrichien Joseph Schumpeter tenta de rendre compte de la croissance dans le système capitaliste. Pourriez-vous tout d’abord préciser ce que Schumpeter entendait exactement par-là ?
PC : La théorie économique classique ou néo-classique du XIXe siècle est d’abord une théorie de l’équilibre ou encore de l’état stationnaire. Une économie à l’état stationnaire se doit d’atteindre un niveau optimal, un niveau d’équilibre entre la production, la consommation et la démographie, et ce niveau d’équilibre n’appelle ni innovation ni croissance. Quand Walter Benjamin assimile dans sa Critique de la violence (1921) l’économie à la violence conservatrice, il pense évidemment à cette conception de l’économie. Comment pourrait-on assimiler aujourd’hui le marché à une force conservatrice alors qu’elle se présente comme destruction créatrice ? S’il fallait à tout prix utiliser une catégorie benjaminienne pour définir la violence de l’économie, la notion de violence divine lui serait bien plus adaptée. De fait, le XXe siècle a profondément révolutionné la science économique en mettant en avant ce que les théories précédentes écartaient par principe de leur champ d’investigation, l’innovation et la croissance, passant ainsi d’une approche statique de la production et des échanges à une approche dynamique fondée sur le déséquilibre. Il est un théoricien qui symbolise plus que tout autre cette transformation fondamentale de l’économie au XXe siècle dépassant par ses effets sa seule dimension épistémologique : il s’agit de Joseph Schumpeter. Au départ, sa théorie de l’innovation a deux objectifs : mettre en valeur la figure de l’entrepreneur, et il faudrait sur ce point noter sa convergence avec Spengler et Le Déclin de l’Occident (1919), mais aussi rendre raison du profit. Ce n’est que dans Capitalisme, Socialisme, Démocratie, un texte de 1942, écrit au cœur de la Seconde Guerre mondiale – et le contexte n’est pas anodin – que Schumpeter formule la fameuse expression de « destruction créatrice » qui permet de relier, sous une forme certes paradoxale, innovation et croissance. À ses yeux, le capitalisme n’est pas seulement un processus d’évolution, mais cette évolution procède en réalité moins par transformation que par destruction et par révolution, « comme un processus de mutation industrielle […] qui révolutionne incessamment de l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant perpétuellement des éléments neufs », écrit-il. Ce qu’il compare à « une singulière tempête » (a particular storm). Et il précise à la suite : « Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c’est en elle que consiste en dernière analyse le capitalisme, et toute entreprise capitaliste doit bon gré mal gré s’y adapter. » Il importe cependant de noter qu’il s’agit d’un hapax, d’une expression que Schumpeter n’utilise qu’une seule fois et qu’il ne cherche pas à théoriser, laissant aux commentateurs postérieurs le soin de faire le lien entre sa théorie de l’innovation et la destruction créatrice. Plus dignes d’être notées encore, un certain nombre d’analyses de ce même livre – Capitalisme, Socialisme, Démocratie – constituent en réalité une critique de la destruction créatrice ou son remède, tant le paradoxe ainsi soulevé apparaît odieux à celui-là même qui l’a forgé. J’y reviendrai.
AP : Ne pourrait-on pas également dire que Schumpeter inscrit sa pensée dans le sillon tracé par Marx qui considérait que la révolution permanente des moyens de production était le propre du capitalisme ?
PC : Vous avez raison de citer Marx sur ce point. Schumpeter est un grand lecteur de Marx. Il lui consacre ainsi, en introduction de Capitalisme, Socialisme, Démocratie[4], une longue étude. Je dirai non sans une certaine provocation que Schumpeter est un marxiste de droite, courant idéologique que des auteurs comme Jacques Attali ou Alain Minc représentent bien aujourd’hui en France. Que signifie en l’occurrence qu’être un marxiste de droite ? Schumpeter utilise l’opposition marxiste entre les forces de production créatrices de richesses et les rapports de production qui les entravent et les spolient : il l’utilise cependant au profit non de l’ouvrier mais de l’entrepreneur. C’est Schumpeter qui, à travers précisément l’innovation, fait de l’entrepreneur et non de l’ouvrier syndiqué, la force productive majeure capable de renverser les rapports de production existants. Schumpeter sert donc de matrice au discours sur l’entreprise qui, de l’Entreprise France des années 80, à la Startup Nation d’aujourd’hui, obsède la classe politique. Il est vrai que, comme vous le notez à juste titre, Marx lui-même en son temps, à contrecourant de la doxa économique en faveur de l’état stationnaire, avait déjà défendu une conception croissantiste, dynamique de la production économique, essayant mieux encore de conjurer l’entropie du capitalisme et sa loi des rendements décroissants. C’est la voie qu’empruntera à son tour Schumpeter. L’interprétation croissantiste de la production que propose Marx s’inspire à son tour de la dialectique hégélienne, de sa négativité et de sa relève, dialectique qui elle-même sous-tend la logique de la destruction créatrice. Apparaît ainsi au jour le lien étroit qu’économie et métaphysique entretiennent en tant que toutes deux sont des pensées qui prétendent rendre raison de la totalité du réel.
Mais, avant d’en venir à cette étroite intrication entre économie et métaphysique, j’aimerais revenir sur le fait que Schumpeter non seulement ne va pas jusqu’au bout de sa théorie, mais finit même par procurer des armes pour en faire la critique. Il importe en effet de noter combien sa sociologie est en opposition frontale avec sa théorie de l’innovation et de la croissance. Même si la bourgeoisie entrepreneuriale est à la pointe des forces productives, Schumpeter hésite à lui confier les rênes de l’Etat qu’elle menace de détruire, car la vie de l’Etat ne relève pas de la destruction créatrice. La bourgeoisie, à ses yeux, doit être politiquement bordée et contrôlée par l’aristocratie considérée comme une force de conservation garante de la durée de la société et de ses institutions. Car la société doit être protégée de sa mobilisation totale par le système productif. Simplement, aujourd’hui, cette force de conservation et de protection de la société est assumée moins par l’aristocratie, trop proche désormais de la classe bourgeoise, que par les « premiers de corvée », dont la récente épidémie a mis en valeur l’action, et par tous ceux et toutes celles qui assurent des tâches de soin, de protection, de reproduction, dont la très grande majorité appartient aux classes populaires voire au prolétariat. Nous voyons en revanche que les élites politiques échouent de leur côté à remplir cette mission de défense et de protection de la société qui leur revient pourtant au premier chef. Nous assistons à un renversement radical de la sociologie marxiste. La légitimité du peuple provient aujourd’hui de sa force non plus productive mais conservatrice et protectrice. C’est le peuple qui assure les conditions de reproduction de la société et non plus les élites.
AP : Par ailleurs, votre intérêt pour la destruction créatrice ne se limite pas à la description positive de la globalisation : vous affirmez en effet, dans la Critique de la destruction créatrice, que « la destruction créatrice apparaît comme la métaphysique de l’économie, ce par quoi l’économie accède au point de vue métaphysique, mais qui, à partir de ce nouveau point de vue, menace en retour d’affecter et d’inquiéter la métaphysique » (p. 18). Quels sont plus précisément ces liens entre métaphysique et économie ? Et quelle est cette menace que fait planer l’économie sur la métaphysique ?
PC : Les XXe et XXIe siècles ouvrent le temps de la mobilisation totale. On peut avoir une double lecture de la mobilisation totale : par la technique ou par le marché. La mobilisation totale par la technique, c’est ce que Heidegger appelle le Gestell, la planification absolue des forces productives, indistinctement humaines et matérielles, et leur computation universelle, qui transforment l’homme en machine et la société en usine. Or, Heidegger note à juste titre que ce Gestell ou règne de la technique ne relève en rien d’une approche empirique, positiviste, pragmatique du réel, mais de l’histoire de la métaphysique et du devenir de son ontologie : de l’ousia platonicienne comme mise en présence et disponibilité de l’essence jusqu’à l’exposition universelle des étants en passant par l’objectivisme cartésien, le subjectivisme kantien et la volonté de puissance nietzschéenne. Empirisme, positivisme, pragmatisme n’étant ici que les instruments du Gestell et non son principe.
On peut certes considérer que la révolution néolibérale, la marchandisation générale de la société et les nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui marquent la fin du XXe siècle et le début de notre siècle, ne font que s’inscrire dans la continuité du Gestell décrit par Heidegger. Je ne partage pas cette interprétation. On remarque en effet que le marché ne fonctionne pas comme le Gestell de la technique : la logique de l’ingénieur n’est pas celle du financier ou du publicitaire. Le Gestell est le résultat d’une accumulation de subjectivité appuyée par des processus de rationalisation du réel au risque de sa pétrification et de son blocage. La mobilisation par le marché cherche au contraire à fluidifier le réel pour multiplier de façon spontanée, non planifiée, les interactions sociales sources de la croissance et du profit. Elle engage à cette fin des processus de désubjectivation dans un monde de plus en plus chaotique requérant, pour s’y adapter, des rationalités beaucoup plus souples et aléatoires. Elle repose moins sur la subjectivité, trop éclatée pour être accumulée, que sur l’intensification de l’énergie cinétique que cet éclatement paradoxalement favorise. On passe, comme le note Peter Sloterdijk, de la mobilisation totale proprement dite à la « mobilisation infinie ». Cette nouvelle modalité de la mobilisation n’est pas elle non plus étrangère à l’histoire de la métaphysique. Mais cette histoire raconte le déploiement de l’ontologie non plus comme présence, mais comme puissance : de la toute-puissance de la théologie nominaliste médiévale au champ d’immanence deleuzien en passant par l’Urgrund schellingien, l’élan vital bergsonien, mais aussi la violence divine benjaminienne, sans oublier toutes les philosophies de la multiplicité qui jalonnent notre siècle. C’est à cette généalogie qu’appartient la destruction créatrice. Cette histoire-là repose sur le déni de l’entropie de la puissance, pire encore de sa pulsion de mort. Le devenir de l’ontologie, vu sous le prisme du marché, se caractérise par l’oubli non plus de l’Etre, mais de l’Un, l’oubli de la différence hénologique, si bien thématisée par le néoplatonisme, entre l’un et l’être, ou plus précisément entre le principe de cohérence et le principe d’existence. On retrouve ici la sociologie schumpétérienne et sa différence politique fonctionnelle entre aristocratie et bourgeoisie, entre force de tenue et de maintien (l’Un) et force de production et de procession (la substance, l’Être).
AP : Venons-en alors justement à cette généalogie de l’ontologie que vous proposez. Vous opérez un déplacement, lourd de conséquences, qui réside dans un changement de la catégorie directrice de l’ontologie : non plus la présence, mais la puissance, ainsi que vous le signalez ci-dessus. Vous écrivez ainsi dans Morale et Chaos[5] (page 36) :
« À mesure que l’être se déploie dans l’histoire de la métaphysique, la question de sa force s’impose de plus en plus jusqu’au point où la puissance et l’être se convertissent parfaitement, sans reste ni différence, dans les systèmes du chaos ».
Pourriez-vous retracer synthétiquement les grandes lignes de cette histoire et nous expliquer pourquoi les métaphysiques antique et médiévale, en dépit de leur appartenance à l’ontologie, ont bridé ou limité l’expression de la puissance ? Et pourquoi l’histoire de l’être s’accomplit-elle, si je puis dire, dans la cybernétique, la complexité, la théorie des systèmes, toutes sciences que vous regroupez sous le seul terme de « chaos » ?

PC : Je ferai d’abord une remarque méthodologique sur la question de la généalogie. Il n’y a pas en philosophie de vraie ou de fausse généalogie. Les concepts fraient tous azimuts et ne font pas spontanément des lignages aisément repérables. Toute généalogie est d’abord une reconstruction qui a sa part d’artificiel, que maints contre-exemples peuvent venir remettre en cause, mais qui néanmoins restent intéressante à partir du moment où elle permet de comprendre quelque chose d’un certain état contemporain de la pensée, d’une certaine situation de la praxis et de sa force dans la société. Il n’y a rien d’hégélien dans une généalogie. Elle ne rend pas raison du développement de l’histoire de la métaphysique vers son achèvement. Elle est simplement un outil qui sert à sonder à coup de marteau les formations de domination de notre temps. C’est pourquoi, à partir du moment où l’on se rend compte que la mobilisation infinie n’est pas simplement le prolongement de la mobilisation totale ou du Gestell, de la planification, mais qu’elle en est d’une certaine façon le renversement, il importe de retracer une autre généalogie de l’être. Je ne vais pas revenir sur les quelques auteurs que je viens de citer dans ma réponse précédente ni sur leurs thèmes. Je me contenterai de quelques sondages que je juge particulièrement significatifs et utiles pour comprendre la généalogie de la puissance qui travaille notre temps. Heidegger, dans son commentaire aux 3 premiers chapitres du livre Théta de la Métaphysique d’Aristote, que l’éditeur français a sous-titré non sans pertinence De l’essence et de la réalité de la force, affirme à juste titre que le couple de l’acte et de la puissance constitue le couple directeur de l’ontologie. Il importe donc de retracer la généalogie de l’énergeia et de la dynamis aristotélicienne autant que de l’ousia platonicienne. Chez Aristote, l’acte et la puissance s’entre-limitent : la puissance conditionne l’acte qui ne saurait transgresser sa condition, tandis que l’acte parachève la puissance, et ce faisant la circonscrit, la stabilise et la fixe. L’histoire de la métaphysique postérieure a eu tendance à dissocier l’acte et la puissance l’un de l’autre, et à absolutiser l’un ou l’autre : on pense à l’Esprit acte pur de Giovanni Gentile qui fait de l’acte une auto-fondation ex nihilo, l’impossible enfin là, hic et nunc, qui définit chez Bataille la souveraineté. En tant que l’acte accomplit l’impossible il s’est affranchi de la puissance comme condition limitative de son actualisation en vue de libérer à son tour un surcroît de force par rapport à la potentialité du réel, une surpuissance, à la fois un au-delà de la puissance et un plus de puissance, ce qui justifie précisément qu’on puisse parler ici de souveraineté. À l’inverse, non pour l’acte affranchi de la puissance, mais pour la puissance affranchie de l’acte, on pense aux philosophies du virtuel dont on a trace au moins depuis Nicolas de Cues : « Le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais seulement à l’actuel » dit Deleuze. Il est la réalité même de la possibilité. Il définit les conditions de toute actualité sans être déterminée par l’actualisation. Le virtuel est une matrice infinie qui ne se nourrit que d’elle-même. Ces processus de dissociation et de radicalisation au sein de l’ontologie sont au service d’un déchaînement de la dispensation de l’être, d’une intensification de la force en jeu dans l’articulation du principe, de l’homme et du monde. Et d’une certaine façon la différence ontologique heideggérienne entre l’Être et les Étants, ou l’Ereignis, font partie de cette histoire.
Ce que j’appelle les ontologies sauvages de la souveraineté absolue ou de la virtualité infinie ont toutes deux fortement marqué de leur empreinte l’histoire politique, économique et technique de notre temps. On pourrait résumer l’histoire du XXe siècle par le passage ou la substitution d’une absoluité ontologique à l’autre, de celle de l’acte à celle de la puissance : de la souveraineté hypertrophiée des révolutions russe, italienne et allemande aux virtualités de l’économie de marché et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il existe, d’un point de vue strictement métaphysique (mais la métaphysique suffit-elle ici ?), deux voies pour contenir ces ontologies sauvages. La voie aristotélicienne qui repose, nous l’avons vu, sur l’articulation et l’entre-limitation de l’acte et de la puissance, et qui constitue en quelque sorte une régulation interne à l’ontologie, ce qui l’empêche de verser dans l’absolu. Et la voie néoplatonicienne qui régule l’être, sa dispensation et sa procession par l’extérieur, par le tout autre que celui-ci : l’Un, en tant que l’Un représente le principe de cohérence du monde appelé à limiter la procession de la substance et à structurer le déploiement de son existence. Proclus affirme clairement que l’un n’est ni acte ni puissance en tant précisément qu’il ne se dispense pas, qu’il est imparticipable et incoordonné. Et c’est précisément en quoi il est le tout autre de l’être
Il faudrait aussi revenir sur la question de la Volonté de Puissance et peu importe qu’il faille attribuer cette notion à Nietzsche ou au contraire la juger étrangère à celui-ci comme le défend Mazzino Montinari, l’éditeur scientifique de Nietzsche, pour qui « la volonté de puissance n’existe pas » chez le philosophe de l’Eternel Retour, interprétation que je partage. Quoi qu’il en soit, la volonté de puissance, aussi anonyme soit-elle, reflète bien un certain état de la praxis humaine ; davantage encore, elle est une notion fondamentale pour notre propos, une notion pivot qui nous permet de passer de la généalogie de la présence à celle de la puissance. Lorsque Heidegger critique la volonté de puissance dans le cadre de sa généalogie de la présence, il critique moins la puissance que le fait que celle-ci puisse faire l’objet de la volonté humaine. Il identifie alors la volonté de puissance à la volonté de la volonté, comme si la volonté de l’homme absorbait la puissance de l’être. Et c’est bien ainsi qu’Heidegger comprend le Gestell, le règne de la technique. La tâche de Heidegger consiste à renverser la Volonté de puissance, c’est-à-dire à faire que la puissance de l’être absorbe la volonté humaine de sorte que la volonté de puissance ne soit plus la volonté de la volonté, mais la puissance de la puissance. La puissance pure atteint alors au sommet de son absoluité. Assurément, le fait que la puissance échappe à la volonté de l’homme en change la nature et l’essence. La cybernétique, les systèmes complexes, la théorie du chaos participent à mes yeux de cette radicalisation de la puissance et de sa virtualité. Ce sont des savoirs qui ont parfaitement pris la mesure de la critique heideggérienne du Gestell, de son excès d’actualisation, de rationalisation et d’identité, pour promouvoir une conception du système plus souple et aléatoire, plus libre, plus ouverte au multiple, au service d’une mobilisation du réel intensifiée, mais aussi au prix de l’affolement de notre système productif et de l’augmentation de sa capacité de destruction.
Grand entretien avec Pierre Caye : Autour de durer. Eléments pour la transformation du système productif (partie II)
[1] Pierre Caye, Durer. Eléments pout la transformation du système productif, Paris, Les Belles Lettres, 2020.
[2] Pierre Caye, Comme un nouvel Atlas. D’un état meilleur que la puissance, Paris, Les Belles Lettres, 2017.
[3] Pierre Caye, Critique de la destruction créatrice. Production et humanisme, Paris, Les Belles Lettres, 2015.
[4] Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme, démocratie, Paris, Payot, 1990.
[5] Pierre Caye, Morale et chaos. Principes d’un agir sans fondement, Paris, Cerf, 2008.








