Nous vous présentons une œuvre philosophique contemporaine, grosse de presque six mille pages, entièrement gratuite et publiée uniquement sur Internet.
Jacques Darriulat, professeur de philosophie esthétique à Paris-IV, a ouvert il y a trois ans un site Web : http://www.jdarriulat.net/ ; il y publie aussi bien des cours que des essais plus personnels. A l’heure où nous publions, le compteur affiche 5900 pages et le site s’enrichit chaque mois d’une nouvelle publication.
Entrer dans ce site, sobre dans sa présentation, c’est entrer dans une immense caverne d’Ali Baba, qui regorge de trésors tous plus somptueux les uns que les autres : explications sur la théorie du Beau chez Platon, commentaire des carnets de Léonard de Vinci, cours sur les Essais de Montaigne, réflexions sur le tableau médiéval comme miroir, essais sur la caricature et le grotesque ou encore méditation sur la sentence « deviens ce que tu es »… Ce ne sont là que quelques exemples parmi des dizaines d’autres textes proposés sur le site.
Nous avons voulu rencontrer l’auteur pour qu’il nous parle de ses textes et qu’il revienne avec nous sur quelques aspects de sa grande passion : l’art. Comme le philosophe du Neveu de Rameau au café, il nous entretient de politique, d’amour, de goût ou de philosophie. Il abandonne son esprit à tout son libertinage et se laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente.
Nous remercions vivement Jacques Darriulat de nous avoir guidés dans l’écritoire de son musée imaginaire.
Entretien : Timothée Coyras et Nicolas Rousseau.
Illustrations et commentaires : Nicolas Rousseau
(Nous présenterons cet entretien en deux fois. Dans cette première partie, Jacques Darriulat parle de la conception de son site Internet ; il décrit ensuite la place de la philosophie esthétique en France et les fondements de la vision moderne de l’art. Lire la seconde partie. )

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Oedipe et le Sphinx (1808), musée du Louvre. Pour le regard esthétique, la beauté est un sphinx qui nous adresse une énigme.
Jacques Darriulat commence par nous poser quelques questions sur Actu-philosophia, sur sa structure, les contributeurs, la fréquentation, pour les comparer avec son propre site et, plus largement, pour réfléchir sur ce qu’est un site Internet, sujets sur lesquels il souhaite débuter cet entretien.
Nicolas Rousseau : Comment avez-vous eu l’idée de faire votre site ?
Jacques Darriulat : Avant d’enseigner à la Sorbonne, j’enseignais en classe préparatoire à Henri-IV. J’ai publié quelques livres à ce moment-là, après mon doctorat d’Etat. Ces livres étaient orientés vers la philosophie de l’art. Quand j’ai été nommé à la Sorbonne, j’ai eu pour moi davantage de temps, et je me suis étonné moi-même de ne plus rien publier. Je me suis rendu compte que j’enseignais vraiment ce qui m’intéressait, c’est-à-dire la philosophie de l’art. Je ne pouvais pas l’enseigner à plein temps en classe préparatoire : il fallait préparer au concours de la rue d’Ulm. Je ne pouvais pas, par exemple, passer toute l’année sur la notion de baroque en hypokhâgne.
Arrivé à l’université, j’ai pu enseigner à loisir la philosophie de l’art. Mon écriture est alors passée dans mes cours, car j’ai depuis longtemps l’habitude de les rédiger pour eux-mêmes tout autant que pour l’exposé oral. Comme cela correspondait à peu près au moment où j’ai eu un ordinateur (1995), ces cours se sont accumulés sur disque dur. J’ai pris plaisir à les écrire. Le traitement de texte permet de construire un texte comme une marquèterie, on arrive vraiment à polir la phrase pour qu’elle épouse au plus près les inflexions de la pensée.
Ces cours ont pris un volume assez important. Qu’en faire ? Les publier ? Il aurait fallu les revoir, et c’eût été un travail considérable, et un peu stérile… On me disait que je ne publiais plus rien. J’étais moi-même interdit par cette question. J’ai alors réalisé l’importance du travail effectué pour mes étudiants. Si aujourd’hui je publiais intégralement les cours qui se trouvent sur mon site, cela ferait vingt volumes de trois cents pages ! J’accumulais ce gisement de textes, et je pensais qu’il était dommage de les laisser sommeiller dans la crypte de mon disque dur. Mon site actuel n’est qu’une partie de cet ensemble, je garde par devers moi un nombre non négligeable de textes non encore publiés sur le site. Et chaque mois, pour l’enseignement ou pour mon plaisir, j’en écris de nouveaux.
Il faut bien dire qu’il y a aussi un problème du côté des éditeurs. Pour le premier livre que j’ai publié 1, il a fallu de l’audace, car nous n’avions aucune certitude de trouver des lecteurs, et mon éditeur a accepté de courir un risque véritable. Je lui en sais encore gré. C’était un livre cher, avec des illustrations. José Alvarez, aux éditions du Regard (elles ont pris le nom d’Editions de la Lagune pour cette collection), a eu le culot de le lancer. Le livre s’est bien vendu, en partie à cause d’une émission de TV. Il y a eu pourtant des petits frottements. Par exemple, l’ouvrage s’intitulait Les métaphores du regard ; il a fallu, pour la disposition typographique de la couverture, que j’enlève le « Les ». Le titre est donc devenu Métaphores du regard. C’est un détail, mais c’est tout de même désagréable. Quand vous faites un livre, il n’y a pas une virgule que vous n’avez pas pesée et pensée. L’auteur est le seul au monde (avant Dieu !) à pouvoir juger de son texte. Or les éditeurs sont souvent des écrivains qui n’ont pas écrit, mais qui voudraient écrire, et qui se rattrapent en réécrivant les textes qu’on leur propose. Ce n’a pas été le cas de José Alvarez, qui ne s’est pas permis, et je l’en remercie, de modifier quoi que ce soit au texte de l’ouvrage. Tous les éditeurs ne sont pas aussi respectueux du texte qu’on leur confie. Certains exigent de changer l’ordre des chapitres, exigent un autre titre ou demandent la réécriture de tel ou tel passage. Ce n’est pas acceptable !
En outre, la part qui revient à l’auteur dans les contrats d’éditions oscille entre 3 et 8%, un peu plus quand vous commencez à vous faire connaître. Tout le reste revient à l’éditeur, qui a certes pris des risques et engagé des capitaux. Il n’en reste pas moins que le livre est la création exclusive de l’auteur, et de nul autre. Le tapuscrit de mon premier livre a été corrigé et composé par un professionnel, mais pour les autres livres, j’ai dû apporter le texte entièrement composé sur disquette, puis sur CD. Pour le petit livre sur Jérôme Bosch 2, j’ai non seulement écrit le livre, mais je l’ai composé moi-même. Les auteurs se sont mis ainsi peu à peu à faire le travail des typographes, qui se sont retrouvés en conséquence au chômage. C’est regrettable. C’était un fort beau métier, de véritables artisans, une corporation pleine de noblesse, et qui a une belle histoire. Aujourd’hui, c’est à l’écrivain de faire ce travail, qui suppose pourtant une science réelle. Et le comble, c’est qu’on se permet parfois de corriger le texte ainsi présenté, pour des raisons que l’auteur ne connaît ni ne reconnaît. Maintenant, nous avons tous appris à travailler sur traitement de texte. Nous sommes devenus des typographes, amateurs sans doute, mais typographes quand même. Nous avons assimilé quantité de règles de composition, qui nous étaient inconnues auparavant. Mais il est bien évident que ce travail est approximatif, et qu’un véritable typographe y trouverait beaucoup à redire !
Ainsi, l’écrivain fait tout, mais ne touche que 5% du fruit de son travail, et doit accepter en outre les modifications qu’on lui suggère. Il n’est pas interdit de s’en irriter. Par ailleurs, une fois signé le contrat, le texte ne vous appartient plus, il devient la propriété de l’éditeur, et de lui seul. Si le texte ne se vend pas, et si vous avez l’opportunité de le publier d’une autre façon, pour lui donner la chance d’une nouvelle vie, vous ne le pouvez pas sans l’autorisation de l’éditeur, qui répugne alors à vous la donner, même s’il ne vend au plus qu’une dizaine d’exemplaires par an. C’est ainsi que j’ai rédigé certains petits essais qui trouveraient un véritable lectorat sur mon site, mais que je ne peux mettre en ligne parce que l’éditeur qui en est le propriétaire me refuse le droit de le faire. C’est très regrettable. Un auteur veut surtout que son texte vive, c’est-à-dire qu’il soit lu, qu’il donne à penser à de nombreux lecteurs, et qu’il engendre ainsi d’autres livres, et d’autres réflexions. Il est triste de penser qu’il est des livres qui meurent doucement sur des étagères poussiéreuses, oubliés de tous. La Toile donne à l’auteur cette chance de rencontrer un vaste lectorat. C’est ainsi que mon site est en train de dépasser le seuil des 10.000 visites mensuelles, alors que l’ouvrage que j’ai le plus vendu n’a jamais dépassé les 2000 exemplaires !
La Toile est une extraordinaire invention : non seulement l’outil de recherche, qui dépasse largement en puissance tout ce qu’on a connu auparavant, mais aussi la possibilité de diffusion des textes. Sur la Toile, j’ai la possibilité de publier ce que je veux, quand je veux, sous la forme que je veux. Ce n’est certes pas le cas avec les éditeurs. Sur ce site, je compte sortir un cours sur Cézanne le mois prochain. Je suis absolument libre. Dix jours avant, je revois un peu mon texte, je l’illustre et je le lance sur Internet. Je suis totalement maître de ce que je choisis de publier.
Sur ce chapitre, il y a encore beaucoup de choses à dire. Quand vous publiez un livre chez un éditeur, vous le faites généralement avant Noël, à la rentrée universitaire de septembre-octobre ou pour le Salon du livre en avril. Rarement en dehors de ces deux périodes. A ce moment-là, on fait une campagne avec le service après-vente. Il faut donner des arguments aux professionnels de la distribution, qui vont essayer de persuader les libraires. Vous pouvez être invité à la radio ou à la TV. Si la promotion fonctionne, vous vendez 90% des livres imprimés en six mois. Vous vendez encore 3% en un an et après, entre cinq et dix exemplaires par an, puis plus rien. Au bout d’un an, en général, l’électroencéphalogramme est plat, ou à peu près. Les livres sont des objets de consommation qui se détruisent très vite. Combien demeurent ?
Tandis que quand vous mettez un texte sur un site, il ne cesse de compter un nombre croissant de lecteurs. Je dépasse maintenant les 10.000 visites par mois, et je n’ai fait pourtant aucune publicité. J’ai d’abord mis sur le site, lors de son ouverture, il y a trois ans, en novembre 2007, une grande quantité de textes, et je publie un texte nouveau tous les mois, car il faut que le site soit vivant, qu’il ne cesse de croître, et non qu’il se contente d’être sans se renouveler. Je reçois des mails de lecteurs qui me remercie de cette initiative, il est émouvant de les lire : « Je suis à la retraite, grâce à vous j’ai enfin compris que j’aurais dû passer ma vie à faire de la philo… ». Avec un éditeur, vous n’avez pas de contact, vous recevez peu de lettres, il faut écrire à l’adresse de l’éditeur, qui transmet le courrier à l’auteur. Peu de lecteurs prennent cette peine. Il est bien plus simple d’envoyer un courriel. Un site commence doucement, ensuite ça « prend », la fréquentation se multiplie, vous le voyez vivre. Je ne sais pas jusqu’où cela peut aller, la croissance est exponentielle ! Quand vous en êtes à dix mille, vous allez beaucoup plus vite vers vingt mille que vous n’êtes passé de cinq à dix mille ! Croissance géométrique et non arithmétique. Sans doute grâce au bouche à oreille. Il doit y avoir beaucoup d’étudiants de classe prépa, et je vois bien que la fréquentation baisse pendant les vacances universitaires. Certains textes sont des essais, d’autres des commentaires, de Platon par exemple, en ce cas il s’agissait de cours composés pour les hypokhâgnes, ou les Terminales d’Henri-IV… Mes textes donnent des grilles de lecture et des réponses (quelques réponses seulement, car Platon est un auteur fort difficile). Je trouve cela enthousiasmant.
Le site Internet comme œuvre
Il y a encore beaucoup à dire car c’est un sujet d’une grande richesse. Un site est un autre type d’œuvre. Quand on publie un livre sur papier – tous ceux qui l’ont fait l’ont éprouvé – et que le texte vous paraît digne d’être publié, vous signez le bon à tirer, parfois il est vrai pressé par les délais que l’éditeur s’est engagé à respecter. Quelques heures après, je crois que c’est une expérience que tous les écrivains ont connue, vous découvrez subitement une note essentielle, une addition cruciale, qui aurait tout changé, et donné une dimension tout autre à votre livre ! C’est évidemment une illusion, mais on ne peut s’empêcher de tomber dans ce panneau. Il y a toujours quelque chose qu’on a oublié, et qui paraît évidemment d’autant plus important qu’on l’a oublié. Sur la Toile, ce problème n’existe pas, on peut corriger ou préciser chaque fois qu’on le désire. Le papier fige, la Toile est une perpétuelle recréation. Work in progress… La Toile un réseau fluide où la pensée est sans cesse en train de se cristalliser et de se transformer, aux carrefours sémantiques où prennent forme les idées… Le texte ne cesse d’évoluer, selon l’intensité des échanges.
On ne peut pas dire toutefois que le texte évolue collectivement, par le seul métabolisme de l’échange des signes. Ce serait sans doute beau, mais c’est une utopie : l’auteur reste l’unique responsable de son texte, et les textes nouveaux – je veux dire ceux qui valent quelque chose – que le texte engendre, ne sont nullement des répétitions, de respectueux pastiches, mais au contraire des dépassements, parfois violemment critiques. Je veux dire que les lecteurs qui vous ont le mieux compris sont aussi ceux qui vous attaquent avec la plus grande pertinence. Il n’y a de vrais disciples que ceux qui sont insolents. Peu importe : il reste qu’un texte a donné l’impulsion de son propre dépassement, de sa propre négation. Le texte reste ainsi le texte d’un auteur. L’idée qu’il puisse y avoir un produit collectif du fonctionnement structural de la pensée, par simple conglomération du sens, par le simple jeu des échanges, est une illusion. La Toile ne crée pas de sens, la pure communication ne produit pas de la pensée, seul l’enseignement peut le faire… Un texte qui naîtrait spontanément de l’entrelacement des textes serait un mythe peut-être, mais non un texte.
Je reste le maître du texte. C’est pourtant un peu ambitieux de parler de work in progress. En vérité, je peux ajouter des notes, préciser des références, c’est à peu près tout… Et je ne m’en prive pas, par exemple pour préciser le sens d’un mot, en chercher la première apparition, qui a valeur de symptôme, le mot « modernité » par exemple…
Le texte est donc malléable. Ce n’est pas une œuvre figée, telle qu’en elle-même l’éternité – ou l’oubli – la change… Quand sait-on d’ailleurs qu’un texte est achevé ? La critique génétique a bien montré que cela ne voulait rien dire. Les Essais de Montaigne en sont un magnifique exemple. Tous les textes sont ainsi. Il n’y a pas de version définitive. C’est une illusion que l’édition papier suscite. Valéry a bien mis le doigt sur cette difficulté.
Le site laisse entièrement libre d’ajouter, de revoir. Par exemple, il y a sur mon site un texte sur les religions du Livre. Je me demandais quelle était l’unité de l’islam, du judaïsme et du christianisme, ce qu’on nomme « les religions du Livre ». Je n’avais compris qu’une seule dimension de l’islam, la dimension horizontale (civile, juridique), qui contracte une société sur elle-même, « l’assemblée des croyants ». Alors qu’il y a aussi une dimension verticale, mystique : la poésie soufie, qui est d’une grande beauté. J’ai ajouté quatre pages, ce que je n’aurais jamais pu faire sur l’édition papier.
Ce sont des questions que vous connaissez bien puisque vous travaillez pour un site. On dit que la lecture sur écran est moins confortable que la lecture sur papier. Ce n’est pas faux, question d’habitude peut-être… L’idéal serait de pouvoir lire sur papier les textes que la Toile vous a fait connaître, et qui vous ont semblé dignes d’intérêt. Sur mon site, la moyenne du temps de visite est de quatre minutes. Certains ne restent que trente secondes (mais d’autres restent des heures) parce qu’ils copient et collent juste le texte, et l’impriment sur papier. D’autres, sans doute, se contentent de jeter un coup d’œil, et passent à autre chose. Visiteurs de passage… Mais quand vous vendez un livre, combien de fois les acquéreurs regardent trois pages, et le referment ? Certains l’achètent, le posent sur l’étagère, et ne le lisent jamais. Il ne faut pas croire que si le texte est sur papier, il sera lu avec dans un recueillement plus profond que s’il est lu sur la Toile. Il y a des gens qui ne lisent pas sur écran. Il m’est arrivé de faire des conférences et de rencontrer des lecteurs de mon site qui tenaient à la main, pour m’en parler, les textes qu’ils avaient eux-mêmes imprimés. Ils ressentaient le besoin, pour les lire, de les transcrire sur papier.
NR : C’est ce que j’ai fait. J’ai imprimé après avoir copié–collé sur traitement de texte. Lire à l’écran un texte long est assez pénible.
JD : Oui, je comprends…
En fait, je le crains, les éditeurs n’aiment pas ce que je fais. J’avais eu quelques propositions. Un éditeur était intéressé. J’étais d’accord mais je souhaitais que les textes restent sur le site. Là, les éditeurs ne sont plus d’accord, ou du moins hésitent. Ils pensent que la Toile leur fait concurrence. Je crois qu’ils ont tort. Les lecteurs qui apprécient un texte qui se trouve sur un site, l’impriment. Ils ont alors des feuilles volantes, qui se dispersent aisément … Vous savez que le gramme d’encre, dans une cartouche, a la valeur du gramme d’or ! Ces cartouches sont extraordinairement chères. Si vous voulez imprimer trois cents pages, il faudra sans doute deux cartouches : 16€, plus le papier, et vous obtenez un paquet informe, et non un livre relié. Je pense que si les lecteurs trouvaient sur le marché, pour 15 à 20€ environ, ces mêmes textes, ils l’achèteraient volontiers, même s’ils peuvent les consulter sur la Toile. Les éditeurs français ne le comprennent pas. Je crois qu’aux Etats-Unis la relation est moins conflictuelle. La Toile n’est pas une concurrence pour le livre, mais plutôt un accompagnement. Il y a quelques années, les éditeurs ont cru que la photocopie, le « photocopillage », tuerait l’édition. Il n’en a rien été. Bien au contraire, on a constaté que les prétendus « photocopilleurs » étaient aussi de grands consommateurs de livres, qu’ils achetaient en grand nombre. Loin d’être une concurrence, un site électronique fait connaître un auteur, et fonctionne comme une publicité. Il favorise l’achat de l’équivalent papier, il ne lui fait pas obstacle.
Il y a encore autre chose : quand vous publiez sur papier, vous figez une trame textuelle. Il y a une suite de chapitres, qui se succèdent selon un ordre invariable, vous ne pouvez plus jouer avec cette disposition. Le site est en revanche une constellation de textes en laquelle le lecteur peut voyager comme il le souhaite. C’est une autre façon de lire. Le site propose un paysage textuel : chaque lecteur trace lui-même son chemin. C’est beaucoup mieux qu’un livre en somme. A condition de concevoir le site comme un jeu de textes, une sorte de jeu d’échecs textuel, à l’infini, quelque chose comme la bibliothèque de Jorge Luis Borges. Telles sont les raisons pour lesquelles je pense qu’un site électronique permet d’inventer une œuvre d’un type nouveau. J’imagine que Joyce ou Borges auraient été passionnés par la souplesse de l’outil, ils auraient sans doute créé des sites géniaux, extraordinairement compliqués, labyrinthiques, et absolument originaux. Ils auraient inventé un nouvel espace littéraire, une combinatoire textuelle qui fait pleinement jouer le système des correspondances, « dans une ténébreuse et profonde unité »… Je crois que la Toile va donner naissance à un genre d’œuvres nouvelles, qui va s’affirmer et se développer.
Cela pour vous dire que je ne conçois pas le site que comme un simple recueil de leçons… Il y a une œuvre–site qui reste à inventer, et que je n’ai pas encore trouvée parmi les textes qui hantent la Toile. Très souvent les sites sont faits de contributeurs divers, chacun travaillant de son côté. Je ne connais aucun site où un auteur unique compose un grand ensemble de textes qui se réfèrent les uns aux autres. Mon site n’est pas une œuvre, il serait bien prétentieux de l’affirmer, il y a encore des choses bien universitaires, mais pourtant je souhaiterais qu’il le devienne. Je crois qu’une œuvre-site est possible, qu’elle est sur le point de naître, et qu’elle aura des propriétés spécifiques, qui ne sont pas celles du livre traditionnel. Telles sont les raisons qui m’ont conduit à créer ce site.
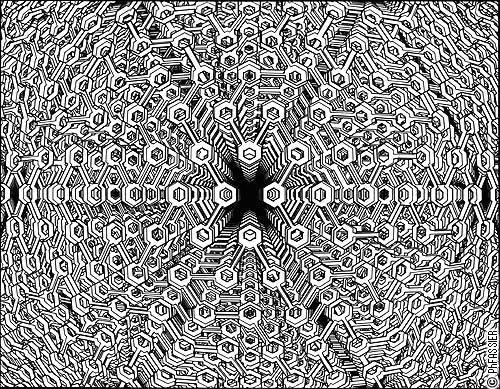
« L’univers (que d’autres appellent la Bibliothèque) se compose d’un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales… Letizia Alvarez de Toledo a observé que cette vaste Bibliothèque était inutile : il suffirait en dernier ressort d’un seul volume … comprenant un nombre infini de feuilles infiniment minces… Le maniement de ce soyeux vade-mecum ne serait pas aisé : chaque feuille apponte se dédoublerait en d’autres ; l’inconcevable page centrale n’aurait pas d’envers. » (Jorge Louis Borgès, « La bibliothèque de Babel », in Fictions)
NR : Vous pensez qu’il y a une création spécifique qui est possible sur Internet, par l’architecture du site, les liens entre les pages…
JD : Je ne suis pas du tout technicien, j’aurais d’ailleurs grand besoin du concours d’un expert en la matière. C’est un étudiant, qui est aussi un ami, qui m’a initié au logiciel qui permet de composer les pages du site. Tout ce que je sais faire, c’est jouer sur les références du site, tisser la trame de la Toile. C’est assez rudimentaire. J’ai défini l’architecture du site dès le début. Quand j’ai commencé, je ne me rendais pas compte du nombre de textes que j’allais mettre sur le site. Je pensais que cela ne ferait pas même un millier de pages. Je me suis dit un jour qu’il fallait que je calcule et j’ai été effaré de découvrir que j’approchais des cinq mille pages ! J’arrive maintenant bientôt à six mille…
J’ai jugé que trois parties suffiraient : il y a une partie intitulée Initiation à la philosophie esthétique, c’est un cours que j’avais rédigé en grande partie lors de ma première année d’université. Une deuxième partie est composée d’études sur des Auteurs divers, il y a là un grand nombre de textes. C’est de loin la partie la plus copieuse. La troisième partie est faite d’Essais plus personnels, ou d’études thématiques. Avec ces trois parties, je crois que je peux tout classer. Je n’ai jamais eu l’idée d’un texte, aussi différent soit-il de tout ce que j’avais publié auparavant, qui ne puisse entrer dans une de ces trois catégories. Parfois, je suis tenté de me dire que, lorsque j’aurai un certain lectorat, je pourrai publier des textes politiques : ils entreront sans peine dans la partie consacrée aux « Essais ».
Cette architecture est très simple, très sobre. Le lecteur s’y retrouve. On me propose parfois des publicités, je dis toujours non. Je tiens à cette austérité, à cette simplicité… Comme je tiens à la gratuité de la consultation des textes. C’est un gisement que je confie à ceux qui voudront bien l’exploiter. Il faudrait ici parler des « droits d’auteur », ou du moins de ce qu’on nomme ainsi. Mais ce serait un trop vaste problème. Je crois qu’un texte appartient à son auteur, quoi qu’on fasse, car on ne peut se l’approprier qu’à la condition de le recréer, de l’intérieur, et donc de devenir une sorte de double de l’auteur lui-même, ce qui n’est guère possible. Cela dit, un texte n’est pas fait pour être respecté comme un dogme sacré, il est fait pour produire du sens, et engendrer des textes nouveaux. Certains craignent le copié/collé. Ils se trompent. C’est toujours par emprunt et assimilation que le savoir a progressé. C’est avec des livres qu’on fait des livres, et un écrivain est d’abord un grand lecteur. Sur mon site, il y a bien des thèmes et des auteurs que je souhaiterais encore ajouter. Je veux faire une grande leçon sur Dante, par exemple. J’ai encore un long cours sur Bergson à publier. Il manquera toujours quelque chose. Ce travail est infini.
Il est merveilleux de maintenir un œuvre dans le bonheur de l’inachèvement. Pas de bon à tirer. Elle est infinie, cette œuvre… Elle finira quand je ne serai plus capable d’écrire un mot – ou quand j’en aurai assez, ce qui revient au même.
L’esthétique en France
NR : Au départ, comment en êtes-vous venu à vous spécialiser dans la philosophie de l’art ? Par goût personnel ?
JD : La métaphysique est le fondement de la pensée, la racine de l’arbre de la philosophie. Or il me semble que l’esthétique est la métaphysique de la modernité. Dans un monde voué à l’immanence, l’esthétique pense ce qu’il peut encore y avoir d’absolu, qui vaut par soi-même et non relativement à autre chose.
Depuis mon enfance, je m’intéressais à l’art. Mes parents étaient un peu connaisseurs. J’aimais dessiner et peindre. J’avais, je crois, le culte des images. J’aimais rêver dans les musées, devant les tableaux. J’adorais la peinture. Je l’adorais, même si ce goût s’est un peu effacé, à partir d’un certain âge, au profit de la musique. Avec l’âge, sans doute, notre sensibilité au temps se fait plus vive.
J’avais le sentiment que penser, c’était d’abord penser l’énigme des œuvres d’art. L’art était vraiment l’énigme la plus intense, qui incitait à penser, dont on ne pouvait esquiver la muette question. Je suis entré à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud en 1966. Dès l’année de l’agrégation, j’ai voulu faire de la philosophie esthétique. Ensuite, je me suis un peu détourné de l’université. A l’époque, en 1968, l’université était quelque chose qui devait s’effondrer dans les six mois. Le monde entier, du reste, était sur le point de s’effondrer… Dans ce contexte d’apocalypse imminente, les idées de carrière paraissaient méprisables, et ceux qui ne les méprisaient pas étaient à nos yeux les plus méprisables…
J’ai alors fait du journalisme, de la critique d’art, semaine après semaine, d’abord à Combat, où je tenais une rubrique hebdomadaire, au Point ensuite, qui venait de se lancer. Jusqu’au jour où j’en ai vraiment eu assez. C’était une aliénation extrêmement contraignante à l’actualité. Les galeries s’efforçaient de faire passer des articles, il fallait rendre compte de l’art au jour le jour, et disserter sur des œuvres dont nous savions pertinemment que plus personne n’en parlerait quelques années plus tard. On ne peut éviter de ressentir, assez vite, la vanité de ce travail de Sisyphe. Pourtant, cet exercice n’était pas vain. A force de rédiger des critiques sur telle ou telle exposition, sur des artistes singuliers, me sont apparues des idées générales sur l’essence de la peinture, ce qu’est un tableau, ce que nous nommons tel. C’est ce qui m’a décidé à arrêter le journalisme : je voulais composer une réflexion générale sur la peinture, et ne pas simplement rendre compte, semaine après semaine, des expositions temporaires. Le tableau est le mode par lequel, depuis la renaissance, nous célébrons les images. Il a ses propriétés spécifiques, qui ne sont pas celle de l’icône, par exemple, moins encore celles du lavis chinois. J’ai d’abord imaginé un livre, tant je m’étais éloigné de l’université. Mais le projet était très ambitieux, et la solitude pesante. J’ai alors donné à mon travail la forme d’un doctorat. Je pouvais ainsi en parler avec un directeur compétent, n’être plus livré à moi-même, discipliner mon travail, m’assigner à en rendre compte à intervalles réguliers.
En esthétique, la philosophie se penche sur l’éclat très pénétrant du sensible. Ce qui doit être saisi par la pensée, ce n’est pas une essence qui a valeur universelle, ou du moins générale, c’est inversement un singulier sensible, qui fait signe, un hiéroglyphe qui me met au défi de le déchiffrer. Ce défi fait tout le poids de la question esthétique. Rien n’est plus grave que la beauté. Il faut répondre au Sphinx.
Il y a tout un continent de la philosophie qui est totalement étranger à cette inquiétude, tout ce qui tombe sous l’autorité de ce que Kant nomme le « jugement déterminant », la théorie de la connaissance, par exemple, ce qu’on appelle l’épistémologie. Quand je faisais mes études, Bachelard était à la mode, c’était un étrange épistémologue, il proposait une sorte d’esthétique de la connaissance, et la logique de son œuvre l’a conduit de l’étude de l’esprit scientifique à l’élaboration d’une véritable poétique fondée sur la rêverie qu’inspirent à l’imagination et à l’entendement les quatre éléments de la matière, ou plutôt de ce qu’un esprit préscientifique croit être la matière… Il y a eu tout un courant de la philosophie française qui était franchement hostile à l’orientation esthétique. Dans notre pays, la philosophie universitaire a été profondément marquée par le positivisme. Elle considérait volontiers que l’esthétique était de la dentelle pour jeunes filles, de l’aquarelle pour demoiselles… Il n’y a encore aujourd’hui en France que peu de départements de philosophie qui possèdent un véritable enseignement d’esthétique, ou de philosophie de l’art.
De plus, j’avais une connaissance assez précise de la peinture, par l’exercice de la critique d’art, et parce que depuis longtemps je fréquentais les images. Je m’étonnais de l’ignorance des philosophes en ce domaine. C’était l’époque où Mikel Dufrenne écrivait sur l’expérience esthétique. Ce sont de grandes généralités, souvent pertinentes, intéressantes, mais des généralités tout de même. Il ne dit rien de bien précis sur les œuvres de l’art. C’est pourtant, je l’ai dit, le plus singulier qui doit être l’objet de l’esthétique. Pour le regard esthétique, le détail vaut toujours plus que le général. « Cette rose que je vois » comme l’écrit Kant, mais non « toutes les roses ». Les travaux d’iconologie de Panofsky ont été traduits autour des années 1970. Ce fut pour moi un émerveillement. Une érudition prodigieuse, extrêmement précise, qui arrive à rendre compte avec une extrême délicatesse de la qualité du choc esthétique. J’éprouvais le besoin de cette érudition. Aujourd’hui encore, je tiens Les Primitifs flamands (traduction malheureuse de Early Netherlandish Painting) pour l’un des plus grands livres d’art qu’il m’ait été donné de lire. A l’inverse de ce que beaucoup pensent, l’érudition, quand elle est conduite avec talent, n’est pas simple accumulation d’informations. La véritable érudition est créatrice, elle sait même être puissamment poétique, à condition d’être portée par une intuition éclairante, ce qui est toujours le cas des travaux de Panofsky. L’érudition réussit à reconstituer la genèse de l’œuvre, elle tisse le réseau dont l’œuvre n’est certes pas la résultante, mais en lequel l’œuvre a trouvé du moins l’occasion de son événement. L’érudition vivante retrouve le véritable sentier de la création, elle nous fait partager la joie intense de l’œuvre en train de se faire. C’est à cette condition seulement que nous pourrons tourner vers l’œuvre un regard qui est digne d’elle. A côté des vagues dissertations qui tenaient lieu de savoir en philosophie esthétique, les analyses extraordinairement pertinentes de Panofsky me semblaient seules montrer la voie. J’ai pensé que c’était ainsi qu’il fallait chercher la vérité des œuvres.
Le drame de la France, c’est que, depuis la révolution française, et la naissance du musée, il y a deux lignes parallèles, et qui ne se rejoignent pas : d’une part les historiens d’art, qui s’en tiennent, ou du moins le prétendent, à la définition des faits. Les historiens d’art n’aiment pas toujours les philosophes, qu’ils considèrent, parfois il est vrai non sans raison, comme des bavards. Cette fierté pour la connaissance positive conduit même parfois à une sorte de haine pour la théorie. Identifier, dater, classer, gérer le patrimoine : il faut s’en tenir là, et tout le reste est littérature…. Et de l’autre côté, sur l’autre ligne, il y a une philosophie qui disserte avec brillant de l’art en général mais semble ne connaître aucune œuvre en particulier. Je connais des œuvres de philosophie analytique qui prétendent traiter de l’art, et ne connaissent en tout et pour tout que les tournesols de Van Gogh et l’urinoir de Duchamp. C’est un peu maigre. C’est surtout bien désinvolte, et ne témoigne pas d’un grand amour pour les œuvres. Cette ignorance superbe des philosophes de l’art est insupportable aux historiens d’art. Et il faut bien reconnaître qu’ils n’ont pas tout à fait tort.
J’apprécie le travail de Daniel Arasse, l’homme était fort sympathique, sa mort prématurée a été d’une grande tristesse, il savait s’intéresser au détail des œuvres, il savait les aimer dans ce qu’elles ont de plus singulier, et c’est au détail dans l’art qu’il a consacré précisément le premier livre qui l’a fait connaître du grand public. Il était historien de formation, non philosophe. Mais il savait considérer l’œuvre en philosophe, et n’avait pas peur de penser, ni de risquer des thèses, des interprétations. Les historiens d’art ne l’apprécient pas toujours, les philosophes ne se sont guère intéressés à ses travaux. Ils étaient pourtant assez originaux pour réconcilier les uns et les autres. La chose ne s’est pas faite. Je le regrette.
Malgré le peu d’intérêt que nous avions, au lendemain de 68, pour la carrière universitaire, j’ai toutefois pensé un moment m’inscrire en doctorat, tout de suite après l’agrégation. Cette expérience a été édifiante. J’avais en tête un grand nombre de sujets, ce qui signifie simplement que j’avais des idées encore bien floues, même si je songeais travailler surtout sur le futurisme, alors bien méprisé au profit du cubisme, qu’une vulgate bien française voulait considérer comme le seul initiateur de la modernité des avant-gardes au XXe siècle. Peu importe… Quand je me suis mis en peine de chercher un directeur de thèse, je me suis trouvé pris entre la corporation des historiens de l’art d’une part, et le cercle des philosophes de l’art de l’autre. André Chastel, qui enseignait au Collège de France, et qui ne pouvait donc diriger une thèse, avait alors donné à l’histoire de l’art en France, dans le sillage des travaux de ce très grand historien d’art que fut Henri Focillon, une orientation remarquable. Il inspirait tout particulièrement les premiers numéros de La Revue de l’Art, qui était alors tout à fait passionnante, qui savait être savante sans refouler pour autant les exigences de la pensée ni les questions de pure théorie. Cela a bien changé…
Je suis donc allé voir Jacques Thuillier, un élève de Chastel, grand spécialiste de Nicolas Poussin. Je me souviens fort bien de cet épisode un peu comique, mais qui demeure à mes yeux emblématique. Thuillier était un homme charmant, fort savant en son domaine, et nous avons parlé longuement peinture avec une commune passion. Cette conversation fut pour moi, qui n’étais qu’un débutant, fort enrichissante. Toutefois, Thuillier refusait systématiquement les sujets de thèse que je lui proposais, à tel point que cela est devenu une sorte de jeu entre nous, et que je suis allé jusqu’à lui proposer vingt sujet de thèse ! Quelque temps après, il me téléphonait pour me proposer de consacrer dix ans de ma vie à un obscur peintre hollandais du siècle d’or, qui l’intéressait dans le cadre de ses recherches, mais qui n’entrait nullement dans mes perspectives de recherche. Je me souviens avoir raccroché assez sèchement, et nous ne nous sommes plus jamais revus. Je me suis alors tourné vers la philosophie de l’art, et les travaux de Jean Laude correspondant à l’esprit de ce que je souhaitais faire, je me suis fait connaître auprès de cet universitaire. Toujours charmant bien entendu, mais d’une telle négligence, perdant les manuscrits que je lui confiais, que je me suis bientôt éloigné de lui. Sans doute avais-je du mal à me plier à la soumission assez féodale qui règne dans les relations universitaires…
Plus tard, alors que la critique d’art m’avait permis de définir avec plus de précision l’orientation de ma recherche, j’ai rencontré Olivier Revault d’Allonnes qui a accepté de diriger mon doctorat. Ce fut un excellent directeur de thèse, surtout en ce sens qu’il me laissait faire à peu près tout ce que je souhaitais faire. Revault d’Allonnes est devenu un ami. Il n’en reste pas moins que l’orientation que j’avais choisie restait, dans l’université française, relativement solitaire.
J’ai cherché à établir par la suite des liens qui conjugueraient la positivité de l’historien de l’art avec l’exigence théorique de la philosophie de l’art. Par exemple, j’ai organisé un colloque à la Sorbonne sur « L’invention de l’esthétique », auquel j’ai souhaité inviter, non seulement des philosophes, mais aussi des conservateurs et des historiens de l’art. Edouard Pommier, de l’Ecole du Louvre, dont j’ai ainsi pu apprécier à la fois la grande science et l’extrême bonté, a accepté, ainsi que Jean Clair, alors directeur du musée Picasso, et qui a toujours lui-même été un électron libre dans le monde du patrimoine. Mais c’est tout, tous les autres auxquels j’ai adressé la même demande ont repoussé l’occasion de venir parler avec des philosophes. En vérité, il n’y a pas eu de dialogue, chacun a parlé selon son école et ses habitudes, la rencontre fut fort chaleureuse, et les uns et les autres sont retournés chez eux, sans que cette tentative de liaison n’ait pas la suite d’autres effets. Il est vrai que j’étais moi-même trop sceptique sur l’avenir de ce projet, pour avoir l’énergie et le désir de continuer seul dans cette direction.
Vraiment, je trouve que cette mutuelle surdité est quelque chose de très dommageable, de très stérilisant pour la recherche, et aussi de très français… Il y a presque quarante ans que j’ai choisi de me tourner vers la philosophie de l’art, et que je me suis heurté à cet obstacle. Je dois bien constater qu’aujourd’hui nous n’avons pas progressé d’un pas dans cette direction, il me semble parfois, quand je pense aux travaux inspirés par Chastel, que nous avons même régressé !
Il y a en Allemagne une très riche tradition de la philosophie de l’art qui est parfaitement capable de concilier ces deux inconciliables, en Angleterre l’Institut Courtauld a su conserver l’esprit des recherches d’Aby Warburg, et la richesse du classique de Gombrich, L’Art et l’illusion, en témoigne, aux Etats-Unis Panofsky a su communiquer son immense culture à ses étudiants, en Italie la connaissance de l’art a toujours été d’une extrême richesse, sans comparaison possible avec la France, dont les cycles d’enseignement n’ont jamais inscrit l’histoire de l’art aux programmes. Arasse avait pourtant entrouvert cette voie, mais il est mort avant d’avoir pu l’affirmer avec une autorité suffisante. J’aurais voulu faire cela, mais l’inertie des institutions s’y est opposée. D’autres sans doute le feront. Ce n’est plus vraiment mon affaire. Il est bien plus important à mes yeux que je prenne maintenant le temps d’écrire ce que je crois devoir écrire…
Naissance du patrimoine et de l’histoire de l’art
Timothée Coyras : D’où vient, selon vous, cette ignorance des philosophes pour l’art ? Est-ce d’une tradition philosophique qui mépriserait le sensible, qui privilégierait le concept ? Par exemple, chez Kant, il y a une esthétique et en fait, une ignorance totale de l’art.
JD : J’ai pour la troisième Critique, et pour Kant en général, une grande admiration et un immense respect. Ce texte a établi, avec une profondeur que je crois sans précédent, les principes sur lesquels se fonde toute appréciation esthétique de l’art ou de la nature, même si la beauté de la nature reste pour Kant, mais je crois que c’est précisément là une des idées fortes de l’esthétique, supérieure à la beauté de l’art. Pourtant, vous avez raison de le souligner, Kant est un véritable analphabète de l’art. Il évoque en passant, dans l’Anthropologie, un tableau qui représente des Stoïciens et qui serait du Corrège, alors qu’il s’agit d’une fresque qui rassemble tous les sages de l’antiquité dans une Ecole d’Athènes idéale, et dont l’auteur est Raphaël : trois fautes en trois mots, on ne peut guère faire mieux. Pourtant la troisième Critique définit un art qui n’existait pas encore quand elle a été composée : comment Kant aurait-il pu trouver des exemples à l’appui de ce qu’il pensait ? L’esthétique kantienne annonce un avenir encore indéterminé, cet avenir qui prend conscience du regard qu’il dirige sur le monde avec le texte magnifique que Baudelaire publie en 1863 : Le Peintre de la vie moderne. Les véritables connaissances, remarquables pour son temps, dont fait preuve Hegel dans ses leçons d’esthétique (si bien mal nommées, puisqu’elles sont au contraire très hostile aux postulats de l’esthétique…), font le bilan d’un passé plusieurs fois millénaire, et c’est la raison pour laquelle Hegel peut dérouler sous nos yeux le musée du passé. Mais à l’époque de Kant, il n’est pas d’œuvres encore qui réalisent pleinement le programme esthétique, et il faut se résigner à ne voir paraître que le chant du rossignol, les plumages du colibri ou de l’oiseau de paradis, les dessins à la grecque et les cadres en rinceaux.
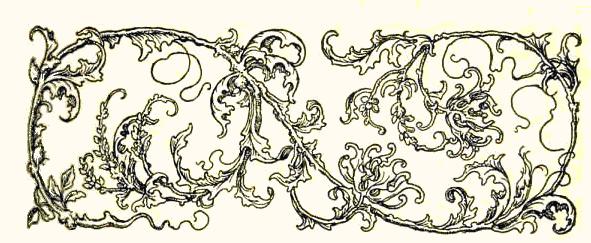
Le rinceau est un ornement sculpté, peint ou en mosaïque, représentant des motifs de plantes s’enroulant et s’enlaçant, jouant sur les symétries et les imprévus. Ces décorations suggèrent le sentiment d’une beauté libre, qui se déploie pour elle-même, sans raison. La rencontre esthétique réveille ainsi en nous le sentiment d’une vivacité jaillissante.
Comme vous le savez, l’idée de l’esthétique est venue en France par l’ouvrage de Baumgarten, Aesthetica, dont les deux premiers volumes sont publiés en Allemagne en 1750. A ma connaissance, le premier français qui utilise ce substantif est un illustre inconnu, Louis de Beausobre, un de ces « philosophes » français qui avaient été appelés à l’Académie des sciences de Berlin par Frédéric II. Il publie en français en 1753 des Dissertations philosophiques parmi lesquelles il consacre un article à la définition de « l’Esthétique ». Ce qu’on entendait alors par là était encore très proche de la tradition rhétorique. Les exemples que choisit Baumgarten sont significatifs de ce point de vue : Cicéron, Horace, Virgile… Peu, ou pas d’exemples empruntés aux arts plastiques. Il y avait pourtant depuis longtemps ce qu’on appelle une « littérature d’art », celle des connaisseurs, ou bien encore les textes écrits par les artistes eux-mêmes, mais elle n’était pas parvenu à la connaissance des philosophes. C’est la révolution qui crée le corps des conservateurs, et qui institutionnalise par là même l’élaboration d’une histoire des arts. La Convention décide que la République française doit rassembler toutes les œuvres de l’esprit dans un vaste Museum pour l’éducation du genre humain. Le musée prétend alors être une phénoménologie de l’esprit illustrée. Chacun sait que Hegel écrit, dans les dernières lignes de la Phénoménologie, que le parcours accompli par l’esprit a été comme la visite d’une « galerie de tableaux », « galerie » signifiant ici musée, comme on parle de la « Galerie des Offices ».
Pour réaliser ce grandiose projet, on n’a pas hésité à recourir à la violence pure et simple : les campagnes de Napoléon ont organisé une véritable razzia sur tous les musées d’Europe, une opération internationale de brigandage artistique. Tous les chefs-d’œuvre du monde devaient être à Paris, puisque c’est à Paris qu’est née la grande révolution, et que l’idée des droits de l’homme est devenue effective sur la terre. Paris doit devenir la capitale du genre humain. Le musée du Louvre est alors pendant quelques années – la Restauration restituera les œuvres à leurs propriétaires légitimes – d’une richesse fabuleuse : on pouvait y admirer l’Apollon du Belvédère, le Laocoon, les Raphaël, les chefs-d’œuvre du musée du Vatican, ceux des Offices, des musées de Munich, de Vienne… Pour conserver ces trésors, il a fallu nommer des gardiens du patrimoine. Il fallait étiqueter les œuvres, les authentifier, les dater. C’était un travail extrêmement précis, qui n’avait pas à se poser la question de savoir ce qu’était une œuvre d’art, ni comment il convenait d’en parler : la question était résolue d’avance, une œuvre d’art est un objet qui appartient aux collections du patrimoine, et la science qui est requise à son égard est celle, purement descriptive, de la rédaction et de l’entretien du catalogue.
Il est même possible de remonter plus haut. On peut dire d’une certaine façon que l’indifférence réciproque, sinon l’hostilité, des philosophes de l’art et des historiens d’art vient de plus loin.
C’est ainsi que le « connaisseur » – le mot vient de l’anglais « connoisseur » – prétendait au XVIIIe siècle être le spécialiste qui a seul autorité en matière d’art, à l’instar de « l’antiquaire », qui revendiquait le monopole de la connaissance de l’art antique. Diderot, dont la sensibilité est extraordinairement esthétique, même s’il ignore le substantif, tenait sur l’art un autre langage. Il critiquait très durement la myopie des antiquaires, l’étroitesse de leur point de vue, et tout particulièrement le plus célèbre d’entre eux, le comte de Caylus, qui était sa tête de turc ! Diderot se méfiait de la prétendue science de l’art, il prétendait que l’excès de l’érudition émoussait la pointe du goût, et qu’il faut une certaine fraîcheur, ou naïveté, pour ressentir pleinement l’émotion de la beauté. Je me garderai bien de le suivre sur cette voie, et je crois au contraire, comme nous l’avons dit tout à l’heure, que l’érudition, quand elle est véritablement éclairée, peut seule pleinement apprécier l’originalité de l’œuvre d’art.

Horace Vernet, Clair de lune (1771), musée du Louvre.
Diderot passe devant un tel clair de lune de Vernet, il trouve le tableau banal. Il continue son chemin, voit soudain par la fenêtre la lune dans le ciel et s’aperçoit alors combien Vernet a peint exactement le clair de lune. L’esthétique suppose toujours une rencontre brusque, inattendue avec le beau.
Ainsi naquit le patrimoine. Les administrateurs qui en avaient la charge avaient une tâche qui leur était propre. Rien ne les incitait à dialoguer avec les philosophes, qu’ils ignoraient, et qui les ignoraient. Ce qui est regrettable, c’est que les philosophes ne soient pas allés vers les conservateurs, et non que les conservateurs ne soient pas allés vers les philosophes : ils n’avaient aucune raison de le faire, ils faisaient leur travail, et cela suffisait. Pas tout à fait cependant… Il fallait bien organiser le musée, disposer les œuvres selon la succession des salles. Il fallait donc classer. Or, il n’y a guère de classification sans une philosophie implicite qui lui donne raison. Comment disposer les œuvres ? Par école ? Par chronologie ? Par style ? Par pays ? Toute exposition de suppose une philosophie, elle accomplit sans le savoir l’idée même d’une phénoménologie, de façon rudimentaire sans doute, mais sans qu’il soit possible d’en faire tout à fait l’économie cependant.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’histoire de l’art a fait des progrès très impressionnants. Il est vraiment dommage que les philosophes n’aient pas su profiter de ces recherches ! Si l’institution n’avait pas fait obstacle à ce dialogue, je pense que les remarquables travaux d’un Henri Focillon, par exemple, auraient été d’une bien plus grande fécondité.
Naissance de l’esthétique
NR : Quand vous parlez de la rencontre avec une œuvre d’art, vous en parlez comme d’une rencontre avec le Sphinx, l’Enigme. Toute beauté est-elle énigmatique ? Ou bien certaines beautés seulement font-elles sens pour la réflexion ?
JD : C’est le regard que l’esthétique pose sur la beauté qui fait de la beauté un sphinx. Thoré-Burger, le grand critique qui redécouvrit au XIXe siècle l’œuvre oubliée de Vermeer, avait l’habitude de nommer ce peintre « le Sphinx ». La qualité du regard esthétique précède le mot qui le qualifie : il y a par exemple une grande sensibilité esthétique dans le très remarquable ouvrage que Jean-Baptiste Dubos publie dès 1719, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Et Diderot, qui n’avait jamais entendu parler de Baumgarten, tourne vers les œuvres un regard qu’on peut bien dire pleinement « esthétique ». Je crois que l’esthétique est le parti pris qui définit le mieux l’essence de ce que nous avons nommé « modernité ». L’art « moderne » n’est que le développement historique des possibilités contenues dans l’idée de l’esthétique. Baudelaire l’a admirablement démontré dans un texte fondamental, Le Peintre de la vie moderne. L’esthétique prend conscience d’elle-même au XVIIIe siècle, et cette inspiration me semble féconde jusqu’à la naissance de ce qu’on nomme, assez énigmatiquement, « l’art contemporain », qui n’est certes plus un art « esthétique », et que je crois même fondamentalement hostile à l’orientation esthétique du travail de l’artiste. La rupture s’accomplit à mon sens vers 1960, avec le Pop Art, ce qui est également fort énigmatique. La rupture historique est évidemment 1945 ; pourquoi les années soixante ont-elles été déterminantes pour la révolution qui s’est accomplie dans le domaine de l’art ? Sans doute sommes-nous encore trop proches de cette rupture pour bien la comprendre…
Le regard esthétique appréhende la beauté comme un sphinx qu’on rencontre. Pour la tradition académique et classique, le beau correspondait à un canon rigoureux, à un jeu de proportions objectives, que le concept était en mesure de déterminer. Le beau plaisait par concept. Il y avait des lois de l’harmonie, de la composition, il y avait même une arithmétique de la beauté, fondée par exemple sur le nombre d’or, ou sur la concordance des phases acoustiques dans l’accord parfait. Il appartenait à l’Académie, c’est-à-dire à l’assemblée des doctes, d’énoncer les règles de l’art. L’esthétique fait au contraire de la beauté une rencontre renversante, un éblouissement fécond qui suscite en nous le désir de créer. De la forme objective, on ne peut alors plus rien dire, sinon qu’elle est le motif de l’œuvre, le motif et non le modèle. Avec l’esthétique, le beau cesse d’être un objet de savoir, et ceux qui se prétendent doctes en ce domaine ne le font que par abus de pouvoir. Nul ne sait plus ce qui est beau. Tel est en effet le grand paradoxe de la troisième Critique : il ne sera question que du sentiment de la beauté, quant au beau lui-même, il se dissout dans l’informel, dans les flammes du feu ou dans les volutes du torrent, pour reprendre les images chères à Kant.
Dès cet instant, la beauté est un sphinx, l’inconnu qui est à la source d’un travail créateur, à la façon de Cézanne, qui disait toujours travailler sur le motif, qui le mettait en demeure de peindre, et non sur le modèle, que l’on copie avec application. Cette interprétation de la beauté m’a toujours semblé d’une grande richesse. C’est la raison pour laquelle j’ai longtemps opposé une grande résistance à ce qu’on nomme « l’art contemporain », il y a en lui une véritable haine de l’esthétique, qu’on trouve également dans l’esprit qui inspire la philosophie analytique. Bien entendu, cela reste trop général, et il faudrait nuancer selon les cas…
En outre, il faut bien reconnaître que l’art contemporain n’est pas sans raisons, légitimes et fortes. L’inspiration esthétique semble en effet s’être épuisée dans les années soixante du siècle dernier. A mon sens l’œuvre de Rothko est la dernière dont on puisse dire qu’elle soit pleinement esthétique, et il s’agit précisément d’une œuvre limite, au-delà de laquelle il n’est guère possible de porter ses pas. Comme si la perspective ouverte par le regard esthétique rencontrait là sa limite. C’est alors qu’est apparu le « contemporain », et qu’il n’a cessé de prendre de l’autorité. L’art conceptuel a été déterminant dans cette rupture.
Tant que l’œuvre d’art a été interprétée dans l’axe de la perspective esthétique, alors oui, le beau était un sphinx incompréhensible, que nul ne peut connaître par concept, mais qui a le pouvoir de motiver la création poétique. Création qui n’est pas du tout inconsciente, qui est intelligente au contraire car l’entendement y participe, il invente des règles selon le jeu de formes que l’imagination fait naître. Le beau n’est un sphinx que pour l’interprétation esthétique. Ce serait par exemple un contresens de parler d’une esthétique platonicienne. Il n’y a pas davantage d’esthétique pythagoricienne, ni médiévale, contrairement à ce que suggère Edgar de Bruyne par le titre de son magnifique ouvrage : L’esthétique du moyen âge. L’art est encore lié à l’époque médiévale à l’idée d’un canon de la beauté, qui apparaît de façon évidente par exemple dans les carnets de l’architecte Villard de Honnecourt. Il n’y a pas d’esthétique médiévale, il n’y a pas davantage d’esthétique classique. Watteau, par ses dessins tout autant que par les tableaux, fait déjà preuve en revanche d’une sensibilité pleinement esthétique. Fragonard plus encore, Fragonard dont les impressionnistes se réclameront. Nous sommes au XVIIIe siècle. C’est alors que le beau devient un sphinx.

Antoine Watteau, Pèlerinage à l’île de Cythère (1717), musée du Louvre. La scène est saisie dans l’instant, dans le mouvement de ces voyageurs de l’île du plaisir. Il est impossible de dire si les personnages arrivent ou bien s’en vont déjà. L’œuvre garde ainsi un caractère énigmatique.
Platonisme et néo-platonisme
NR : L’idée que le beau n’est pas de ce monde, qu’il est au-delà du sensible, apparaît avec Platon.
JD : Oui, un Platon toutefois très scolaire… Platon lui-même est tellement profond ! Je n’ai jamais clairement lu chez Platon qu’il y aurait deux mondes, l’un sensible et l’autre intelligible. On peut à la limite soutenir cette thèse, mais il faut reconnaître que Platon est bien éloigné de l’idéalisme dogmatique dans lequel se sont empressé de le caser les manuels. J’incline plutôt à croire que Platon est le plus grand des philosophes sceptiques. A partir du Sophiste, tous les dialogues platoniciens sont sceptiques. D’un scepticisme heuristique, comme dirait Sextus Empiricus…
Et le beau est chez Platon un thème tellement riche qu’on ne peut pas régler lui son compte si facilement. Le beau chez Platon n’est-il pas aussi un choc sensible ? Comme le dit Diotime, la beauté est d’abord celle de ce beau corps. Kant ne dit pas autre chose : ce ne sont pas toutes les roses qui sont belles, c’est cette rose-ci que je vois, ici et maintenant. Le phénomène de la beauté est pleinement sensible, et charnel. Il survient ici-bas, non au-delà. Le beau platonicien est un appât que les Immortels utilisent pour arracher les mortels à la caverne où ils croupissent dans l’inconscience. Même le pire des imbéciles est intelligent au moins une fois dans sa vie, quand il est amoureux, et l’amour est le désir que fait naître en nous la rencontre de la beauté. La beauté nous sauve de la bêtise…
Le beau intelligible, au-delà du sensible, est une idée néoplatonicienne plutôt que platonicienne. Le néoplatonisme auquel je pense ici, c’est celui de Marsile Ficin, et dans une moindre mesure de Pic de la Mirandole, dans le dernier quart du 15e siècle, à Florence, avec l’Académie platonicienne sous Côme, puis Laurent le Magnifique. Le néoplatonisme était dominant quand peignait Botticelli, ce qui n’est pas rien. L’art à la cour des Médicis constitue alors un des moments les plus grandioses de l’histoire de l’art. Michel-Ange lui-même, ce qui n’est pas rien non plus, dans les sonnets, ou quand il peint la voûte de la Sixtine (Le Jugement dernier est d’une inspiration bien différente), et plus généralement dans la plus grande partie de son œuvre, est inspiré par les idées néoplatoniciennes. C’est une philosophie qui parle à l’imagination, et qui reste assez simple. Rien à voir avec la diabolique complexité des dialogues platoniciens. Dans le cadre de cette pensée, alors, oui, toute beauté sensible est l’ombre d’une beauté intelligible que l’esprit seul peut discerner dans l’immortel. Cette philosophie est d’autant plus importante que c’est elle qui inspire les doctrines professées par l’Académie du dessin fondée en 1563 à Florence par Côme de Médicis.
Toutes les Académies, qui vont se multiplier en Europe pendant l’âge classique sont calquées sur le modèle de l’Académie florentine, et toutes penseront l’art dans le cadre – dont elles n’avaient, il est vrai, qu’une connaissance bien approximative – de la philosophie ficinienne. Toutes vont formuler les règles de l’art, par exemple la règle des trois unités, qu’on prétend fallacieusement tirer de La Poétique d’Aristote. Prisonnière de ce carcan académique, la création artistique étouffe au XVIIIe siècle. Selon le point de vue qui est celui du sentiment esthétique, il n’y a qu’une seule règle qui ait autorité dans le domaine de l’art, et c’est de plaire. Kant ne précise-t-il pas que le sentiment de plaisir est le domaine propre que la troisième Critique arpente ? Les œuvres qui avaient été inspirées par le néoplatonisme florentin étaient si grandes qu’il n’était pas facile de répudier la philosophie qui les avait inspirées. Il fallait élaborer une nouvelle théorie du beau, construire un nouveau fondement. Telle est bien la tâche que la Critique de la faculté de juger accomplit magnifiquement en 1790.
Vous savez que sur la fresque de l’Ecole d’Athènes par Raphaël, Platon tient le Timée et montre le ciel, tandis qu’Aristote tient l’Ethique à Nicomaque et montre la terre. En fait, Raphaël a donné à Platon le visage de Léonard de Vinci. C’est un contresens : Léonard était aristotélicien, et c’est Michel-Ange qui était platonicien. On le voit assis sur les marches de cette Académie idéale, Raphaël lui a donné l’attitude du mélancolique. Il se présentait lui-même ainsi dans ses sonnets. Il y a, sur la voûte de la Sixtine, un très bel autoportrait de Michel-Ange en mélancolique, dans Le prophète Jérémie.

Raphaël, L’école d’Athènes (détail), 1509-1512, musée du Vatican. Platon a les traits de Léonard : il tient le Timée et pointe vers le ciel, Aristote désigne la terre et tient l’Ethique à Nicomaque.
TC : Chez Plotin, n’y a-t-il pas l’expression d’une tradition philosophique anti-artistique ? Le beau sensible est inférieur au beau intelligible, qui lui est détaché de toute matérialité. C’est la beauté de l’intelligence. Cela rejoint la question de tout à l’heure, sur une tradition de refus philosophique du beau sensible, qui expliquerait le dédain des philosophes pour l’esthétique.
JD : On ne peut pas dire qu’il n’y a pas chez Plotin une poétique de l’Un, une mystique. Il est banal de le dire, mais selon un article d’André Grabar, la philosophie de Plotin éclaire d’un jour particulièrement révélateur l’art de la mosaïque qui, comme vous le savez, joue un rôle capital dans l’art byzantin. A l’époque justinienne, donc trois cents ans après Plotin, les mosaïques, faites de dizaines de milliers de tesselles, chacune orientée différemment, réfléchissent en un miroitement surnaturel les flammes des bougies qui éclairent l’intériorité du sanctuaire. C’est tout le contraire d’une image perspective, qui ouvre un espace objectif et mesurable, c’est une vision mystique, une apparition qui s’accomplit dans l’intériorité de l’âme. André Grabar avait écrit sur ce thème une remarquable étude, qui montrait bien comment la philosophie plotinienne permettait de comprendre cet art. Il y a donc bien une esthétique, si l’on peut oser l’anachronisme, plotinienne, la pensée d’une vision plus qu’humaine, et de très haute spiritualité, mais qui conduit à l’aveuglement de l’extase, une fusion mystique de l’âme en cet Un qui est la source infinie de toute donation, et qui est lui-même absolument impensable. Il ne faut donc pas s’empresser d’affirmer que l’ascétisme plotinien est hostile à toute esthétique…

Mosaïque du Jugement Dernier, mosquée Sainte-Sophie, Istanbul (fondée en 537, sous l’Empereur Justinien). Le fond doré fait signe vers la lumière divine, vision pour nous ineffable et mystique.
Le positivisme contre l’esthétique
Quant à ce que vous dites du dédain des philosophes pour l’esthétique, il faut rappeler qu’en France la philosophie universitaire a été extrêmement marquée par Auguste Comte. C’est au sein de cette pensée que s’est constituée la Troisième République. Gambetta, Jules Ferry se réclamaient de cette philosophie. C’est d’ailleurs frappant : nous sommes place de la Sorbonne, et il n’y a ici qu’une seule statue, c’est celle d’Auguste Comte ! Tout de même ! On pourrait mettre tant de grands, à commencer par Descartes puisqu’il nous a fait l’honneur de naître en France ! Mais Auguste Comte ! C’est invraisemblable ! Cette philosophie a donné lieu à ce qu’il faut plutôt appeler une idéologie, c’est-à-dire une pensée dont l’objectif n’est pas de chercher la vérité, mais de soutenir un pouvoir. Il s’agissait de donner un substitut de religion à une société sans religion, de rétablir un ordre intellectuel et moral que le bouleversement des idées avait fortement menacé, en un mot de mettre fin à la révolution. On ne sait pas assez combien Charles Maurras était un grand admirateur d’Auguste Comte. Il a rédigé une étude fort pertinente, en laquelle il montre comment le positivisme est une arme puissante contre l’anarchie, comment il fournit un substitut de religion à la religion absente, et contribue ainsi avec force au rétablissement de l’ordre. Le positivisme propose encore selon Maurras une discipline spirituelle, qui permet de faire taire les intellectuels, ces éternels contestataires, que Comte lui-même nommait les « métaphysiciens ». Cela correspondait parfaitement aux besoins de la remise en ordre de la IIIème République (dont Maurras fut pourtant un farouche adversaire). Gambetta était imprégné de ces idées. Elles ont orienté l’université française vers la religion de la science, et pour ce qui est de la philosophie, vers l’épistémologie. Tel fut par exemple le cas de Pierre Duhem, qui n’était pas très éloigné politiquement de l’Action française, dont Maurras fut l’inspirateur.
L’histoire des sciences prétendait alors être toute la philosophie, mais était une histoire des sciences bien particulière : il s’agissait moins de faire œuvre d’historien que de suivre à la trace le cheminement de la « vérité ». Cela a donné lieu à des livres extraordinaires : Duhem par exemple un composé un pesant ouvrage, peut-être un millier de pages, sur Léonard de Vinci. Or, il n’y est presque jamais question de l’œuvre de Léonard ! L’idée fixe de Duhem, c’est de montrer que Léonard avait trouvé la loi de la chute des corps bien avant Galilée, et qu’il était précédé sur cette voie par certains philosophes du moyen âge, Buridan par exemple. Etrange historien, indifférent à la vérité historique, et qui ne se penchait sur le passé que pour y retrouver le reflet du présent. C’est exactement là le « mouvement rétrograde du vrai » que Bergson dénonçait à la même époque. Forme extrême du dogmatisme positiviste : seule la vérité scientifique compte, le reste est sans importance. On ne saurait par exemple concevoir une histoire de l’imaginaire. Ce point de vue nous paraît aujourd’hui d’une inconcevable étroitesse.
Le superbe ouvrage de Marc Bloch, Les Rois thaumaturges (1924), a été l’un des premiers à percer une brèche dans cette forteresse. Enfin un historien qui s’intéressait au non-positif : que le roi guérisse par simple attouchement les écrouelles, c’était là une vieille superstition indigne d’intéresser la recherche universitaire. En vérité, la thèse de Bloch a révolutionné la théorie de l’histoire, et chacun sait ce que lui doit l’Ecole des Annales. Il fallait que l’imaginaire ait ainsi conquis droit de cité pour qu’une histoire non simplement factuelle de l’art soit possible, et pour que la philosophie n’ait pas le sentiment de déroger en choisissant l’œuvre d’art pour objet d’analyse. C’est ce qui explique sans doute que l’esprit de la philosophie des sciences a longtemps été dominant au sein de la philosophie française, et comment cette rigidité a refoulé l’esthétique dans les marges. Ce qui me conforte davantage encore dans le choix que j’ai fait de la philosophie de l’art. Il y a dans la pensée esthétique, quelque chose d’insolent qui me réjouit profondément. Elle redonne tous ses droits à l’idée de la volupté, à l’expérience de la jouissance. L’esthétique est depuis Kant le domaine propre du sentiment de plaisir. L’entendement est au principe de la théorie de la connaissance, le désir se trouve au fondement de la moralité, mais c’est le sentiment de plaisir qui définit le véritable terrain de l’expérience esthétique. Voyez le très instructif tableau que Kant a placé à la fin de l’introduction de la troisième Critique. Je trouve cela très intéressant, le plaisir. Comte, en revanche, ne semble guère apprécier…

Jean-Honoré Fragonard, Les baigneuses (1765), musée du Louvre. La scène est comme un petit paradis terrestre ; le plaisir sensuel et charnel est suggéré aussi par l’eau et les plantes. Les baigneuses s’amusent et celle du milieu a même l’air de s’envoler, prise d’un ravissement très profane. L’esthète se propose de jouir du monde pleinement, ici et maintenant.
Le XVIIIème siècle fut un siècle merveilleusement voluptueux. On eut alors une idée neuve en Europe : établir le bonheur sur la terre… Le paradis terrestre est un mythe qui mérite qu’on le pense. C’est autour de ce lieu bien problématique, telle la vision qui se déploie autour du point aveugle, que la philosophie esthétique gravite. Qui renoncerait à en chercher le chemin ?








