La première partie de l’entretien est consultable à cette adresse.
C : Les songes de 1619
AP : Venons-en, si vous le voulez bien, à la très délicate question des songes de novembre 1619. Une abondante littérature a déjà été publiée à ce sujet, et l’une des vertus de votre analyse consiste à restituer le contexte allemand où eurent lieu ceux-ci. Mais afin de faire sentir l’importance de la question rosicrucienne, je voudrais à cet égard citer la présentation synthétique que propose Bernard Gorceix de la Bible des Rose-Croix :
« La confrérie nourrit en fin de compte un seul grand projet, celui de l’établissement d’une « philosophie ». Cette dernière est nouvelle, mais seulement dans sa forme : en effet, elle « n’est rien de nouveau ; elle est conforme à celle dont Adam hérita après la Chute, et que pratiquèrent Moïse et Salomon. » Elle se résume en une proposition : synthèse ordonnée, harmonique, de toutes les sciences, et de toutes les croyances, l’on disait, aux temps d’Andreae, pansophie ; il s’agit de réaliser l’unité de la connaissance, de concilier la totalité du savoir avec la totalité de la foi[1]. »
La tentation n’est-elle pas ici très grande de rapprocher cette inquiétude de la « confrérie » rosicrucienne – peu importe ici la réalité de son existence – de celle de Descartes, et notamment de sa recherche des fameux fondements d’une science admirable ? Et si le rapprochement est possible, la question de la mens comme fondement de l’unité des sciences suffit-elle à établir une distinction claire entre la position cartésienne et la supposée position rosicrucienne ?

EM : Je ne vous surprendrai sans doute pas en vous disant que la littérature rosicrucienne doit être replacée dans le contexte de son élaboration et de sa diffusion. C’est l’époque où se constituent un peu partout en Allemagne des universités protestantes, et une scolastique moderne (Schulmetaphysik) dont le rapport avec la scolastique jésuite du XVIe siècle a été documenté par de nombreux travaux d’historiens de la philosophie (Petersen, Courtine, et alii). Or ce retour en force de l’aristotélisme universitaire n’est pas du tout au goût de l’aile gauche de la Réforme, et un vent de révolte se lève chez ceux pour qui l’idée d’une scolastique luthérienne a autant de sens que celle d’un cercle carré (Luther voulait brûler les œuvres d’Aristote — et peut-être aurait-il mis ce funeste projet à exécution si Melanchthon n’avait eu l’idée plus judicieuse de donner à la Réforme un ancrage universitaire et académique). Les idées rosicruciennes sont donc contestataires, violemment anti-jésuites et anti-académiques. Un bon Rose-Croix, si cela existe, parle en effet de « pansophie » (au lieu de la segmentation disciplinaire des savoirs) mais c’est un illuminé et un anarchiste ; c’est sans doute à eux que pense Descartes lorsqu’il désapprouve « ces humeurs brouillonnes et inquiètes » (AT VI, 14) qui planifient chaque jour de nouvelles réformes. Au contraire, on peut aussi voir dans les Règles pour la direction de l’Esprit une sorte de conversion ascétique : au lieu d’étudier vainement la connaissance de tout, l’esprit bien conduit doit plutôt étudier le tout de la connaissance, autrement dit l’entendement lui-même et les moyens de toute connaissance, sans rechercher la connaissance des arcanes des choses, si intéressante et désirable soit-elle. Je ne pense donc pas que Descartes ait pu se laisser séduire par les pamphlets rosicruciens ou la jactance des lullistes et autres professeurs d’omniscience, qui sont légion en ce début de la Guerre de Trente Ans. Quant à l’unité de la mens dont parle la première des Règles pour la direction de l’esprit, ce n’est pas l’unité ni l’unition mystique de l’esprit à Dieu : Descartes la réfère plutôt à la bona mens, c’est-à-dire au pouvoir de bien juger, que seul possède celui qui a la connaissance d’un critère ou une règle du jugement. Donc, oui, je crois que la distinction entre la position cartésienne des Regulae et celle qu’on attribue aux Rose-Croix (s’ils existent) est on ne peut plus claire, et que leurs positions sont diamétralement opposées.
AP : Un des points saillants de votre lecture consiste à refuser de voir dans les textes de 1619 une étape sentimentale ou magique, et ce au profit d’une critique précoce de l’enthousiasme magique. Ainsi, vous êtes amené à interpréter l’ensemble à un double niveau : niveau naturaliste, d’abord, lorsque vous montrez que Descartes a sans doute utilisé le De occultis miraculis de Levinus Lemnius, qui rattache l’enthousiasme et ses effets à du psychosomatisme. Niveau parodique, ensuite, notamment en vertu des textes d’Andreas Libau dont l’Examen philosophiae novae de 1615 offrait des armes contre l’alchimie spiritualiste des paracelsiens et contre les connexions harmoniques chères aux textes rosicruciens. Libau, dites-vous, quoique lui-même alchimiste (mais bien plus acquis aux voies opératives que spéculatives) voit chez les Rose-Croix une « manifestation dérivée du délire qui s’est installé à Cassel, et un symptôme de la dégénérescence qui, rongeant depuis des années déjà la cour de Cassel, gagne progressivement Marbourg[2]. »
En outre, comme pour fortifier la naturalisation de votre lecture, vous insistez sur les liens communs de la littérature scientifique de l’époque qui se retrouvent dans le deuxième songe et qui évoquent des passages de l’Oculus de Scheiner, ce qui vous permet de conclure ainsi : la lumière devient « la condition de possibilité que présuppose tout phénomène. Prendre parti sur les fondements de l’optique et la nature de la lumière reviendra à décider de toute la physique. (…). Il est donc certainement question d’optique dans les songes et, avec elle, des fondements de la physique[3]. »
Si cette lecture est en effet très éclairante – sans mauvais jeu de mots – pour le deuxième songe, je vous confesse ma circonspection pour le premier et le troisième dont je ne vois pas bien en quoi ils peuvent se laisser interpréter par des questions d’optique ni par une réflexion générale sur la lumière. Faut-il donc voir le deuxième songe comme la clé des trois songes, et ce en dépit de sa grande brièveté dans le récit de Baillet ?
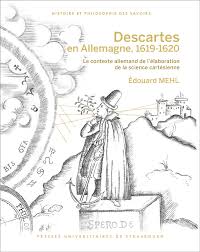
EM : Je ne prétends pas avoir trouvé la clé des songes, et je doute même qu’il en existe une. Le récit des Olympica n’est pas un texte à clé, ni un récit allégorique dans lequel Descartes aurait cherché à dissimuler un sens préalablement constitué — un sens qu’il cherche à extraire en interprétant les rêves qu’il a vraiment faits, et qui ne sont pas une invention de philosophe. Qu’il y ait dans le récit cartésien et dans cette expérience curieuse des « yeux étincelants » un rapport clair, direct, et, pourrait-on dire, traçable, avec l’Oculus de Scheiner, cela constitue en soi un élément intéressant, et confirme qu’il est utile d’explorer le contexte allemand des années 1619-1620. Ce rapport n’est pas la vérité des songes, mais un fil conducteur pour progresser dans le déchiffrement d’un texte qui est loin d’avoir livré tous ses secrets. Cependant, n’oublions pas que, dix ans plus tard, Descartes présente l’étude de la lumière comme la clé de toute la physique ; et qu’il entend se servir de l’explication optique des parhélies pour passer de là à l’explication de tous les phénomènes de la nature. Or, des parhélies, il en a été observé en Allemagne dix ans plus tôt, en mars 1619, et j’ai montré qu’aussi bien Kepler que Faulhaber s’intéressent de près à ce phénomène. Il ne me semble donc pas exagéré de dire, sur la base de ces éléments, que dès 1619 Descartes entrevoit la possibilité de refonder toute la physique sur la base de l’optique — une optique rénovée par les travaux de Kepler et ceux, tout récents, de Scheiner. Toute la philosophie de Descartes ne se résume certes pas à cette seule intention, mais il faut en reconnaître l’importance et la centralité dans son projet philosophique, sous peine d’en voir échapper l’essentiel.
AP : Au-delà de la question de la physique et de l’optique, ne peut-on pas voir dans ce deuxième songe une illustration parfaite de la « résolution philosophique », ce que d’ailleurs suggère Baillet, permettant de dissiper les illusions et les frayeurs qui en découlent ? Tony James, dans un livre que j’avais recensé ici, a donné une interprétation très stimulante allant en ce sens que je vous soumets :
« J’émettrai une hypothèse qui me paraît correspondre à tout le contexte : dans la capacité qu’a son esprit de se détacher et d’observer, yeux ouverts ou yeux fermés, Descartes voit déjà comment ne pas être victime des illusions de ses songes. Plus tard, dans la Recherche de la vérité, il comparera les doutes à « des fantômes et vaines images, qui paraissent la nuit à la faveur d’une lumière débile et incertaine : si vous les fuyez, votre crainte vous suivra ; mais si vous approchez comme pour les toucher, vous découvrirez que ce n’est rien, que de l’air et de l’ombre, et en serez à l’avenir plus assuré en pareille rencontre[4]. » (AT X, 513, 20-27).
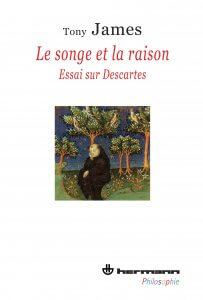
EM : Je ne suis pas sûr de bien saisir ce que vous entendez ici par « résolution philosophique » : s’il s’agit de la certitude, et de la différence éprouvée entre le certain et le douteux, je serai d’accord pour dire qu’il y a là le sol expérientiel de la philosophie cartésienne, et nous pouvons tout à fait accepter avec Alquié l’idée que les Meditationes transcrivent ultérieurement dans le langage des philosophes ce qui est d’abord une expérience vécue. Le rêveur des nuits de novembre 1619 a des représentations ; il sait qu’il les a, que les choses représentées soient vraies ou qu’elles ne soient que des illusions oniriques. On peut donc, si l’on veut, voir dans ce texte le point de départ de l’idéalisme subjectif. J’ai cependant, avec le recul du temps, un doute sur le fait qu’on puisse trouver au récit des Olympica un intérêt quelconque sans y projeter rétrospectivement les thèses formulées avec la netteté et la rigueur que l’on connaît au Descartes de la maturité. D’ailleurs, je trouve que le Placard de la licence en droit (1616) est un texte beaucoup plus construit et beaucoup plus instructif que les bribes de 1619, transmises par un biographe moralement scrupuleux, mais qui ne comprenait pas grand-chose à ce qu’il a tant bien que mal reconstitué et retranscrit.
AP : Concernant la question de l’enthousiasme, j’ai là aussi une petite réserve à vous soumettre : il est tout à fait exact que le terme est, à l’époque, relativement banal lorsqu’il est question de connaissance ; en revanche, ne faut-il pas justement dans ce contexte accorder foi à la précision de Baillet selon laquelle Descartes s’imagina que les trois songes ne pouvaient « être venus que d’en haut » ? N’y a-t-il pas justement dans cette précision la marque d’une volonté explicite, celle de marquer le caractère non banal et non rhétorique de cet enthousiasme ayant envahi Descartes ?
EM : Vous avez tout à fait raison de souligner l’importance de cette séquence, dans laquelle le rêveur se persuade que les songes ne peuvent lui venir que « d’en haut ». Mais les formulations comptent, et il est hélas impossible de décaper le récit de tous les ajouts qu’y a fait Baillet. Je ne veux pas m’acharner sur le brave abbé qui a fait de son mieux, de manière aussi sincère et fidèle que possible. Mais quand on voit le nombre d’inexactitudes et d’incohérences dans le détail de sa reconstitution historique, et la facilité avec laquelle il fait ressusciter des gens qui sont morts depuis longtemps, on a du mal à croire qu’il peut retranscrire fidèlement un récit dont il a compris l’importance, mais dont le sens, manifestement, lui échappait en partie. Descartes a-t-il littéralement pensé et écrit que ces songes lui venaient « d’en haut » ? Nous ne le saurons pas tant que nous n’aurons pas retrouvé le manuscrit cartésien. Mais comme ce manuscrit est perdu – sans doute définitivement – il faut rester prudent, et ne pas prêter aux premiers textes de Descartes le sens que leur a trouvé, faute de mieux, un brave abbé hagiographe.
AP : Pour finir sur ce sujet – si je puis dire –, que peut-on identifier de séminal dans les songes de 1619 qui structurera l’ensemble des écrits cartésiens ? Vous écrivez, pour marquer la continuité cartésienne, que « la grande différence entre les Olympica et les textes de la maturité ne vient pas de ce que Descartes aurait changé de philosophie, mais plutôt de ce qu’il aurait changé d’interlocuteur[5]. »
EM : Extrait de son contexte, ce propos peu paraître excessif. Comme je ne prétends pas avoir trouvé la clé des songes, je ne prétends pas non plus que toute la métaphysique des Meditationes est contenue in nuce dans l’épisode de novembre 1619 : ce serait absurde ! En revanche, je crois qu’il y une forme de continuité, tout à fait inattendue et surprenante, entre le débat philosophique allemand opposant l’orthodoxie luthérienne aux enthousiastes et aux « Schwärmer » (de Paracelse aux écrits pseudo-weigeliens), et la réfutation du scepticisme dans le contexte français du libertinage érudit (de Montaigne à La Mothe le Vayer). Dans ces débats, qui n’ont apparemment rien à voir, il y a bien des constantes, et je voulais seulement suggérer que l’hypothèse d’une fausseté radicale de la représentation comme telle (à partir des arguments du rêve, de la folie et du « malin génie ») plonge ses racines dans un sol tout à fait étranger à celui que foulent habituellement les Mersenne, Gassendi, La Mothe le Vayer, etc. Je n’en donnerai ici qu’un exemple : dans le texte de la Recherche de la Vérité, que vous citiez un peu plus haut, c’est Eudoxe qui s’adresse à Épistémon. Or, curieusement, il y a un précédent à ce dialogue : à l’été 1619, Kepler dédie son maître-ouvrage, l’Harmonice Mundi, à Jacques Ier d’Angleterre. Or cet ardent contempteur de la sorcellerie a lui-même commis un ouvrage fort connu à cette époque, une Démonologie en forme de dialogue, dont les deux protagonistes sont… un Eudoxe et un Épistémon ! C’est dire que les études cartésiennes ont eu tort de limiter leurs investigations aux sources françaises, et de transporter Descartes de La Flèche à Paris sans prêter la moindre attention au séjour allemand, qu’on sait pourtant décisif.
D : Un personnage décisif : Christoph Besold
AP : Un des nombreux points forts de Descartes en Allemagne est de mettre l’accent sur un juriste allemand, Christopher Besold (1577-1638), dont le nom est peu connu. Pourtant, vous montrez à quel point ses écrits sont importants pour comprendre non seulement ce qui lie et sépare Descartes de Montaigne et Charron, mais aussi pour mesurer l’apparition d’une réflexion sur la représentation et la subjectivité chez Descartes. Avant toutes choses, que sait-on avec certitude quant aux rapports de Descartes à Besold ?
EM : Nous ne savons absolument rien d’un éventuel rapport personnel. Mais de la même manière qu’on peut se demander s’il a rencontré Kepler ou le mathématicien Faulhaber (ce qui est quasi certain, depuis qu’on a remarqué la mention d’un certain « Polybe » chez Faulhaber), on peut aussi s’interroger sur ses rencontres avec d’autres figures, moins connues. Je me suis donc plus d’une fois posé la question de savoir s’il avait pu passer à Tübingen, et y rencontrer Besold ou Michael Mästlin — l’ami et le maître de Kepler. Cela n’a rien d’invraisemblable. Ceci dit, ce qui compte, c’est la lecture des textes, et j’ai eu la surprise de découvrir avec Besold un auteur d’une très grande richesse, difficilement classable, tant l’ouverture de son champ est grande, au point d’intégrer des références qu’il est très inhabituel de voir se rencontrer sous une même plume : Maître Eckhart et Montaigne, Sénèque et Campanella, Nicolas de Cues et Machiavel ! Devant une telle diversité, chez un auteur de surcroît très peu étudié, il est difficile de donner une image exacte de ce qui fait l’originalité de sa pensée. Aussi me suis-je concentré sur quelques aspects de cette pensée qui ont un rapport avec la problématique cartésienne des premières années, notamment la question de l’unité et de la « connexio scientiarum ». Besold, ici, se réfère à un paradigme stoïcien identifiant dans l’esprit vertu et science : l’unité des sciences ne peut être réalisée que dans et par la sagesse, qui est elle-même l’unité de la science et de la vertu, ou bien de l’entendement et de la volonté. C’est pourquoi, au-delà de la personne et l’œuvre de Besold, j’ai tenté de comprendre ce qu’il y a de stoïcien dans l’entreprise des Regulae ad directionem ingenii, et il m’est apparu que c’était une piste fructueuse, même si je suis entretemps parti sur d’autres voies, plus proches de l’histoire des sciences.
AP : Vous rappelez que Besold réduit le monde à sa représentation, et même que « l’ego sum » devient l’abrégé de l’univers[6]. » Mieux encore : le terme egoïtas apparaît chez Besold et c’est l’ego qui « objette » les choses désormais et non l’ego qui serait un reflet du macrocosme. Ainsi se dessine une figure de la subjectivité relativement à laquelle se laissent penser les choses comme objets. Qu’apporte dans de telles conditions Besold par rapport à Descartes ? Que lui manque-t-il pour être déjà cartésien ?
EM : Assurément, il manque beaucoup de choses à Besold pour être cartésien, tout simplement parce que chez lui, l’abord de la subjectivité pensante ne s’inscrit absolument pas dans le projet de la méthode. Avec vingt ans de recul, je dirais que ce n’est pas merveille s’il y a des points d’intersection thématique entre deux philosophies d’une même époque. Mais en dehors de ces points de contact, les projets eux-mêmes sont à peine comparables. Cela ne veut pas dire que Besold ne m’intéresse plus, mais, désormais, ce qui m’intéresse encore davantage, c’est la question de savoir si l’émergence de la subjectivité moderne doit plus au renouveau du stoïcisme, ou si elle n’est, comme le pensent les heideggeriens, qu’un accident dans l’histoire longue de l’aristotélisme, qui a vu la notion de « réalité objective » – au sens scolastique du terme – s’immiscer systématiquement dans tout rapport à l’étant pour le fonder. Or Besold est un auteur important, mais sa lecture ne nous permet pas, à elle seule, d’avancer dans cette question.
AP : Vous dites également que Besold permet à Descartes d’aborder Montaigne et Charron ; quelle perspective Besold offre-t-il à Descartes pour se rapporter aux deux penseurs renaissants ?
EM : Montaigne et Charron sont surtout compris dans ce qu’on a appelé la « querelle du libertinage » (cf. les travaux de René Pintard, Tullio Gregory et alii). Ce qui est mis en avant par leurs détracteurs, c’est surtout la dimension sceptique et subversive de leur pensée. Or Besold offre une lecture originale, spiritualiste et politique de ces penseurs. Chez l’universitaire allemand, le scepticisme de l’auteur des Essais est une problématique très effacée, à peine visible. En revanche, il en souligne la dimension critique : Besold a, par exemple, parfaitement bien intégré la critique montagnienne de la dépravation des Conquistadors, mais elle entre chez lui en curieuse résonance avec sa sensibilité protestante, i.e. celle d’une minorité opprimée qui s’identifie volontiers au judaïsme vétéro-testamentaire ou aux pacifiques habitants du Nouveau-Monde envahis par des monstres sanguinaires. Je ne pense pas du tout que le Père Garasse lise Montaigne comme cela !
AP : Un autre point me frappe dans les écrits de Besold, à savoir cette idée d’une raison une et universelle, transcendant la particularité des peuples, mais ne débouchant pas sur une morale universelle ni sur une politique universelle. Les mœurs autant que les politiques demeurent nécessairement des particularités, qui ne sauraient se dissoudre dans l’universel. Le rapprochement avec la fameuse morale par provision du Discours de la Méthode est ici plus que tentant.
EM : C’est que l’un comme l’autre ont une lecture profonde et originale du stoïcisme. Chez Besold, c’est une lecture spirituelle, chrétienne et une version complètement intériorisée du stoïcisme — ou, si vous le préférez, c’est le stoïcisme comme philosophie de l’intériorité, mais de l’intériorité comme néant (Nichtigkeit) qui ne peut être rempli que par la présence de Dieu. Le « sujet » n’a de communication à l’être que dans le dépouillement et l’anéantissement du moi – ce moi tyrannique qui veut être le centre de tout. D’où, certes, une certaine proximité avec les règles de la morale par provision, en particulier la troisième, qui prescrit de regarder comme absolument indifférent tout ce qui ne dépend pas de nous. Cependant, je pense qu’il y a une différence essentielle entre nos deux auteurs : c’est la fameuse « provision ». Le statut particulier de cette morale, faite « par provision », tient au fait qu’elle ignore encore le fondement métaphysique que constitue la connaissance d’un Dieu créateur. Et, donc, elle n’aborde pas un seul instant la question, pourtant essentielle en morale, de la mort, contrairement à ce que Descartes fera après 1645, dans la correspondance avec Élisabeth. Le rapprochement est donc tentant, mais l’intérêt de ce rapprochement tient surtout à la différence qu’il fait apparaître : tous deux ont une morale de l’indifférence à l’égard des biens extérieurs, mais la morale « par provision » n’a pas encore un fondement métaphysique assez solide pour qu’elle rende au philosophe même la mort indifférente.
AP : Historiquement parlant, vous établissez une filiation depuis Nicolas de Cues jusqu’à Besold, puis jusqu’à l’ego cogito. En un sens, dites-vous toutefois, l’ego cogito n’est la conséquence de rien si ce n’est de sa propre évidence ; mais vous ajoutez que sa primauté principielle n’est possible qu’à une condition essentielle, à savoir que la place de premier principe soit vacante. « Or la pensée des weigeliens et de Besold, enracinée dans une tradition dont le premier maillon allemand est Nicolas de Cues, a justement créé cette possibilité en précipitant le déclin de ce qui, tenant la place du premier principe, faisait obstacle au cogito[7]. » Ce premier principe qui aurait disparu avec Nicolas de Cues, c’est le principe de non-contradiction ; pardonnez la naïveté de ma question mais le principe de non-contradiction en tant que principe premier n’était-il pas déjà contesté aussi bien par tous les épicuriens que par un certain néoplatonisme ? La skêdasis néoplatonicienne avait d’ores et déjà, et ce bien avant Nicolas de Cues, relativisé la primauté de principe de contradiction tandis que l’épicurisme lui avait fait un sort dès l’Antiquité, de sorte qu’il était déjà fortement relativisé à l’époque de Nicolas de Cues.
EM : C’est une question importante, dans laquelle il faut distinguer plusieurs choses. D’abord, j’ai étudié dans Descartes en Allemagne le « déclin » du principe de contradiction, c’est-à-dire le mouvement par lequel le principe de contradiction perd toute portée ontologique (celle dont Métaphysique Γ entreprend de faire la déduction), pour n’exprimer plus que le point de vue, fermé, de l’entendement fini. Il y a donc un « autre » premier principe, qu’Aristote n’a pas vu, et que le Cusain désigne comme celui de la coincidentia oppositorum (coïncidence des contradictoires, du droit et du courbe, du fini et de l’infini, etc.). L’opposition des deux principes, et des deux logiques qui en découlent, c’est celle du fini et de l’infini, de l’entendement discursif et de la sagesse créatrice, à laquelle on n’accède que par la « docte ignorance ». C’est le moment où apparaît l’incompatibilité radicale entre l’aristotélisme et la théologie chrétienne. Chez les héritiers de Nicolas de Cues, cette dualité des principes tombe elle-même dans la subjectivité, les deux principes correspondant aux deux instances que sont respectivement l’entendement et l’esprit — la mens. Je ne dis pas que Descartes s’inscrit lui-même dans ce moment de l’histoire de la métaphysique allemande, mais qu’il faut en tenir compte pour interpréter l’émergence de l’ego cogito. J’ajoute que je suis assez d’accord avec ce que vous dites sur l’Épicurisme, mais je le comprends un peu autrement que vous. Les Épicuriens sont connus pour avoir transformé le concept de la logique, et pour en avoir éliminé la dialectique. Il ne reste donc, en fait de logique, que la discipline intitulée « canonique » qui est la recherche d’un critère de vérité. Or il est clair que le principe de contradiction ne constitue pas un tel critère : c’est un principe de la logique formelle auquel on peut certes rapporter nos connaissances, pour vérifier leur validité, mais la non-contradiction n’est pas le critère de vérité, que Descartes trouve, lui, dans la perceptio purement intellectuelle, donnée avec le cogito lui-même, et comme celui-ci.
E : La question de la création des vérités éternelles
AP : La question précédente permet d’introduire un des thèmes communs de vos deux ouvrages, à savoir celui des vérités éternelles. Le déclin du principe de contradiction est en effet explicitement relié par vos soins à l’émergence d’une réflexion sur la création des vérités éternelles. Je vous cite :
« Si l’on tâche d’interpréter Descartes à partir de ce déclin du principe de contradiction et non celui-ci à partir de Descartes, trois choses doivent s’ensuivre : d’une part la thèse de l’indifférence divine par rapport au contradictoire logique (donc la création des vérités éternelles) doit y être expressément rapportée, et doit apparaître comme la conséquence directe de ce déclin. Ensuite on doit pouvoir trouver trace d’une confrontation entre les deux premiers principes, car le cogito ne pourra prétendre à la première place qu’à condition de montrer qu’il satisfait mieux aux réquisits d’un premier principe que le principe de contradiction. Enfin, si le principe de contradiction est destitué de son rôle de principium cognoscendi, il ne peut plus être l’instrument de la démonstration en métaphysique et n’est qu’un énoncé vide sur la forme de notre connaissance. Ce n’est pas sa vérité qui est contestée, c’est sa fonction[8]. »
Je dois confesser une certaine incompréhension dans le raisonnement suivi ici, et ce pour la raison suivante : si je vous suis bien, vous montrez que c’est parce que le principe de contradiction avait perdu de sa primauté principielle que Descartes a pu parvenir à la thèse selon laquelle Dieu n’y était pas soumis. Soit. Mais si se substitue au principe de non-contradiction celui de l’ego cogito, cela ne change rien pour Dieu qui n’est guère plus soumis à la représentation humaine qu’il ne l’est au principe de contradiction. A cet égard, si l’on voit comment l’écroulement de la primauté du principe de non-contradiction libère Dieu, on ne voit pas du tout en quoi cette libération divine peut être rapportée à l’émergence de l’ego cogito, Dieu le transcendant infiniment.
EM : Il faut rappeler ici un moment intermédiaire du raisonnement, sans lequel il est en effet difficile de comprendre ce qui est ici avancé, et qui nous fait approcher de plus près la question centrale de la « création des vérités éternelles » — car c’est bien là que se réside la singularité cartésienne dont nous parlions tout à l’heure. Ce moment intermédiaire, c’est le fait que la non-contradiction définit, formellement, la possibilité, mais la possibilité au sens purement et seulement logique. Or la possibilité prise en ce sens n’existe pas en soi, elle n’existe qu’objectivement dans l’entendement, et Descartes tient que cette possibilité n’est pas une condition préalable à laquelle une chose doit satisfaire pour exister. Ce n’est pas parce qu’elles sont a priori possibles qu’elles sont créées, mais parce qu’elles sont créées qu’elles sont a posteriori et comme de facto possibles. Comme le montreront encore plus clairement les 6e Réponses que les Lettres de 1630, Descartes pense exprimer par là le sens du fiat divin : le créateur n’agit pas sub ratione boni, ni sub ratione veri, car cette ratio procède de la création, non l’inverse : « … facta est lux, et vidit Deus lucem quod esset bona » : il fallait que la lumière fût d’abord faite, pour qu’en apparaisse la bonté. En un sens, on pourrait aller jusqu’à dire que Dieu est une puissance incompréhensible à toute créature, voire pour elle-même, dans la mesure où elle n’a aucune idée de ce qu’elle fait. On voit très bien comme il est facile de tomber de là dans le nécessitarisme pur, ce que Spinoza a souligné avec ce que l’on peut prendre pour une touche d’ironie : à tout prendre, la doctrine (cartésienne) de l’indifférence absolue de la volonté divine s’écarte moins de la vérité que celle qui veut soumettre l’agir divin au principe du meilleur (Ethique I, prop. 33, scolie 2). Mais Spinoza élimine purement et simplement la notion de possibilité, ramenée à la seule limitation de l’entendement fini (il ne peut donc pas y avoir d’idée adéquate du possible qua possibile), tandis que Descartes ne l’élimine pas : il la rabat sur l’esse objectivum, qui est lui-même justiciable du principe de causalité (puisque les idées ne sont pas rien, elles ont besoin d’une cause, etc.). Ceci me permet de vous répondre : le « déclin du principe de contradiction » rabat la possibilité sur l’entendement, dans lequel elle a un certain être objectif ; et celui-ci, en tant qu’il est de l’être (quand bien même « diminué »), a besoin d’une cause, dont la Troisième méditation montrera qu’il dépend nécessairement d’un être actuellement infini.
AP : Cette discussion me rappelle un de vos articles consacré à la logique cartésienne où vous envisagez le rapport de Descartes à l’Art de Lulle dans les mois qui nous intéressent, en 1619. Là encore, je vous cite :
« Après avoir établi ou rétabli le fil des recherches lulliennes de Descartes entre mars en novembre 1619, il deviendra possible d’en dégager deux implications essentielles pour le cartésianisme. La première sera le rejet du probable et, corrélativement, la destitution du principe de contradiction de son rôle de pierre de touche de la vérité logique, car l’art de Lulle établit du probable, c’est-à-dire du non-contradictoire, mais la certitude requise pour le savoir ne se satisfait pas du non-contradictoire, elle exige l’évidence dans le rapport aux objets, ce qui est tout autre chose. La seconde conséquence concerne la question de la systématisation de la science par la voie de la logique ; par où la tradition allemande, elle-même déterminée par la place qu’elle fait au ramisme et au lullisme, prendra toute son importance pour la compréhension de la genèse de la pensée cartésienne[9]. »
On voit que le contexte est très compliqué car il y a l’héritage du Cusain, qui fragilise la primauté du principe de non-contradiction, le travail propre de Raymond Lulle, et ce qu’en fait Descartes. Si l’on quitte l’article et qu’on lit Descartes en Allemagne, les paramètres du débat deviennent multiples : outre l’héritage de Nicolas de Cues et l’importance de Raymond Lulle, apparaissent Bruno, la querelle entre Kepler et Fludd, mais aussi les querelles internes chez les Luthériens et les réformés ; tous ces éléments semblent nécessaires pour rendre intelligible le problème de la création des vérités éternelles. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Descartes et la fabrique du monde complexifie encore le contexte en élargissant la question théologique. Vous y proposez, à partir d’un commentaire de la Genèse, de réinscrire la « création des vérités éternelles » dans le débat théologique et herméneutique sur la création de la res extensa (stereoma), dont les « vérités éternelles » ne sont que les déterminations formelles[10]. »
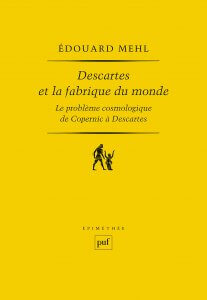
Sans en revenir à notre discussion initiale consacrée à la méthode, je me demande tout de même si la multiplication des paramètres contextuels ne finit pas par noyer la pensée cartésienne : la complexité même du contexte que vous établissez, et qui s’étend à l’hermétisme, à la physique, au statut des mathématiques, à la théologie jésuite, à la théologie réformée, et aux querelles internes entre plusieurs formes d’hermétisme – celle de Fludd et celle de Kepler – ne finit-elle pas par faire perdre de vue ce qui est essentiel et ce qui est accidentel, tout en rendant difficile la détermination de l’interlocuteur principal de Descartes ? Et, plus encore, quand on lit Descartes et la fabrique du monde on peut avoir l’impression que la théorie cartésienne se comprend finalement à partir d’une réflexion qui se dispense au fond de la référence à nombre de querelles théologiques, voire aux querelles hermétiques :
« Concluons sur ce point que la thèse que la création des vérités éternelles nous semble gagner en intelligibilité si au lieu d’en faire une prémisse métaphysique d’un raisonnement physique, et une sorte de préalable à toute entreprise de connaissance, on l’envisage plutôt comme un corollaire de la thèse portant sur l’identification de la quantité à l’essence des corps, ce qui correspond bien à l’ordre d’exposition du Monde, sans minorer l’importance et l’originalité d’une thèse qui n’appartient pas à la physique dont elle établit les fondements, permettant ainsi à la physique de quitter le régime de la simple supposition. C’est parce que les vérités mathématiques ne sont que l’intelligibilité de la nature corporelle et les déterminations formelles de l’étendue, qu’elles dépendent de l’institution divine « au même titre que les créatures ».[11] »
EM : La métaphysique de Descartes n’est certainement pas une affaire simple, et je crois qu’il faut, pour y comprendre quelque chose, refuser par principe l’enfermement unilatéral dans tel ou tel segment disciplinaire, car c’est bien cela qui mène fatalement à « rater l’essentiel ». Au fil des années, ce qui n’était peut-être qu’une forme de curiosité bibliothécaire est devenu chez moi un a priori méthodologique. D’où l’impression d’un certain empilement de références, d’un foisonnement de questions, et, bref, comme dit Montaigne, qu’il n’y a point de fin en cette inquisition. Que répondre à cela ? D’abord qu’en philosophie on ne progresse pas de manière linéaire, mais par l’approfondissement d’une question. C’est une activité de ruminant. Sans patience, et sans endurance, pas de concept ! Ensuite, qu’il y a des résultats tangibles, consignés dans ces deux livres, où se dessine une lecture de Descartes que je soumets à la discussion d’une communauté de chercheurs : ce que nous faisons ici même. Enfin, je me permettrai à mon tour une remarque, et vous retourne la question : si vous estimez que ces recherches finissent par ensevelir l’essentiel et le noyer dans un océan d’érudition, vous devez savoir ce qu’il est, mais… vous ne le dites pas !
AP : Moi j’en reste à de prudentes remarques formelles !
EM : Quant à moi, je le dis, d’un bout à l’autre de la Fabrique du monde : l’essentiel c’est que l’objet de la physique, la nature, n’est pas la substance matérielle des scolastiques, mais l’étendue ou stereoma qui constitue à elle seule l’objet adéquat de l’idée du corps. La « métaphysique » de Descartes s’organise toute entière autour de cet énoncé qui est rigoureusement essentiel, ou si l’on préfère central ; c’est justement en raison de cette centralité qu’il se décline aussi bien dans la méthode (Règles pour la direction de l’esprit, XIV), dans la physique (où il est cependant traité ex suppositione), et dans la métaphysique — car je tiens que les trois Lettres à Mersenne de 1630, auxquelles il faut rattacher celle du 17 mai 1638 (AT II, 138), constituent la première tentative, inchoative et donc incomplète, pour en fournir une déduction. Je crois qu’il y a effectivement par là une simplification majeure en ce que Descartes court-circuite les interminables discussions des « philosophes » (les guillemets servant ici à souligner la connotation péjorative attachée à ce terme dans le Monde) : le problème de la res extensa n’est pas du tout un problème scolastique. Et je crois aussi que cette manière d’aborder Descartes est extraordinairement économique, puisqu’en un sens elle ramène l’objet de toutes les sciences (mathématiques, physique, métaphysique) à l’unique question de l’étendue, et à celle de son intelligibilité. Ceci m’a conduit à soutenir – et à souligner, avec beaucoup plus d’insistance qu’on ne l’a fait jusqu’à présent – que les « vérités éternelles » sont toutes, médiatement ou immédiatement, comprises dans l’étendue (même l’arithmétique pure), et que c’est même en cela seul qu’elles sont vraies. Une chose est vraie si et seulement si elle est, médiatement ou immédiatement, représentable dans l’étendue. L’étendue prise en ce sens définit donc, « für uns Menschen wenigstens », l’horizon de l’intelligibilité, et l’essence (finie) de la vérité.
AP : Privilégions alors un de ces aspects multiples, celui du double héritage issu du Cusain. En affrontant cette double tradition, « on comprendra alors, écrivez-vous, de quelle manière la doctrine cartésienne de la création des vérités éternelles, en 1630, met un terme à ce conflit, qui n’est plus celui de la foi et de la raison, mais qui est devenu le conflit de deux scepticismes : celui du croyant et celui du mathématicien. Dépassant cette alternative en tâchant d’examiner par la raison humaine le rapport entre la rationalité finie et la transcendance créatrice, Descartes retrouve un équilibre perdu depuis l’instauration cusaine[12]. » Mais de quel « équilibre » est-il ici question ? L’affirmation de la création des vérités éternelles me semble plutôt procéder de l’affirmation d’un déséquilibre total entre la rationalité finie et la transcendance créatrice, celle-ci étant soudainement dotée d’une transcendance telle qu’elle réduit celle-là à presque rien, la raison humaine ne pouvant aucunement relever du même ordre que celui dont procède la raison divine.
EM : Voilà qui sonne très pascalien ; ce n’est pas sans fondement, puisque Pascal, rappelant le principe de l’incommensurabilité entre le fini et l’infini, assume la thèse cartésienne de l’incompréhensibilité divine, mais renverse – ou plutôt il inverse – Descartes, puisqu’il étend cette incompréhensibilité à tout le créé, donc à l’étendue elle-même (« […] l’homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature : car il ne peut concevoir ce que c’est que corps… »[13]), si bien que l’incompréhensibilité devient, paradoxalement, le caractère du réel. Il y a bien une manière d’inspiration pascalienne de lire Descartes, consistant à dire que l’efficience, en tant qu’elle dépend de la seule puissance divine (ut efficiens et totalis causa), est elle-même incompréhensible au même titre que la puissance qui la produit. Mais je crois plutôt que l’efficience est intégralement réductible au concept du mouvement qui en épuise l’intelligibilité. Si l’on peut dire que la position cartésienne est « équilibrée », c’est parce que l’incompréhensibilité de l’infini n’affecte pas l’intelligibilité du fini, et parce que nous avons de la disproportion ou de l’incommensurabilité elle-même une idée parfaitement claire et distincte (maxime clara). Il n’y a donc, chez Descartes, aucun pathos de la disproportion, et le rapport du fini à l’infini n’est pas une pensée dans laquelle le fini s’anéantit lui-même (cf. Pascal, « infini-rien »), mais plutôt la condition sous laquelle il s’apparaît à lui-même. Si vous me permettez de paraphraser ici le « théorème » transcendantal de Kant, la simple conscience de moi-même, déterminée dans le temps, prouve l’existence d’un être infini par lequel je suis moi-même produit et maintenu dans le temps. Il n’y a, chez Descartes, aucune dramatique de la finitude : l’être fini n’est jamais véritablement séparé ni « seul au monde ». Il ne peut à la rigueur s’apparaître tel que dans le moment du doute, mais ce doute n’est jamais une propriété réelle des objets eux-mêmes (les choses ne sont jamais véritablement douteuses ; je peux juste douter si j’ai véritablement affaire à des choses, ce qui est complètement différent !).
AP : De manière générale, si je vous comprends bien, la question des vérités éternelles est réinterprétée chez vous comme la manière cartésienne d’intervenir dans un débat complexe, à savoir celui qui oppose Kepler à Robert Fludd et qui envahit progressivement tout l’entourage de Mersenne. Il est vrai que Fludd avait publié le Monochordium Mundi Symphoniacum en 1622 contre Kepler, qui était une réflexion sur la portée des nombres et la numérologie, et dans lequel il reprochait à Kepler d’en rester à la surface des choses sans comprendre de quoi les nombres sont les chiffres. Plus encore, il reprochait à Kepler de ne pas saisir la portée arithmosophique de la mathématique, allant bien au-delà de ce que Kepler retenait de l’hermétisme. Vous dites que Descartes renvoie Kepler et Fludd dos à dos dans l’affirmation de la création des vérités éternelles ; mais j’aurais deux questions : en quoi la thèse cartésienne a-t-elle quelque chose à voir avec la querelle de Fludd et Kepler, et si elle entretient un rapport avec celle-ci, ne peut-on pas plutôt considérer que la balance cartésienne penche paradoxalement en faveur de Fludd au sens où la création des vérités éternelles ramène les vérités mathématiques au même niveau que celui des vérités physiques, c’est-à-dire au niveau ontique du créé ? Certes, là n’était pas l’intention de Fludd mais il n’empêche que Descartes affirme la communauté ontique des vérités physiques et mathématiques, fussent-elles vidées de toute profondeur ontologique puisque créées, et retrouve sur un mode désontologisé et négatif l’intime parenté fluddienne entre physique et mathématique.
EM : Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. D’une part, au plan doxographique, il est vrai que Descartes joue un rôle d’arbitre dans ce débat (où interviennent aussi, dans les années 1620, Mersenne et Gassendi), de la même manière que Kant, sans en nommer les protagonistes, arbitre la discussion entre Leibniz et Newton (Clarke) dans l’Esthétique Transcendantale. Dans cette querelle, il est d’abord clair que Descartes rejette, comme Kepler, l’arithmosophie fluddienne, qui prête des propriétés littéralement magiques aux nombres formels. Cette critique vient de loin, et elle découle d’un débat interne à l’interprétation de Copernic. En effet, dans la Narratio Prima (1540) qui a fait la publicité de la théorie copernicienne, Rheticus avait avancé l’hypothèse que la disposition héliocentrique des orbes planétaires se règle sur les propriétés du senaire (6 = 1 [Terre] + 2 [Vénus, Mercure] + 3 [Mars, Jupiter, Saturne]). Mais Kepler avait raillé cette spéculation, qui fait reposer la rationalité du monde réel sur de simples analogies, plaisantes pour l’esprit mais au fond arbitraires. Et c’était bien contre cette arithmosophie hermétique qu’il fallait comprendre l’entreprise initiale du Mysterium Cosmographicum (1596), où Kepler tentait de dériver la raison des positions planétaires de la géométrie, et de l’interposition entre les orbes planétaires des cinq solides réguliers de la géométrie euclidienne. Lorsqu’il réédite cette œuvre de jeunesse et l’annote en 1621 (au moment de son altercation avec Robert Fludd), Kepler enfonce le clou : « l’égalité des nombres avec les nombres qui sont leurs parties [ce qui est le cas du senaire : 6 = 1 + 2 + 3] est purement accidentelle ; elle n’apporte rien à leur constitution, mais elle résulte, par nécessité géométrique, des nombres déjà constitués ». La théorie des nombres ne précède pas les figures de la géométrie, et même si l’on peut faire des opérations d’arithmétique sans recourir aux figures (alors qu’inversement on ne peut pas mesurer des figures sans les nombres), cela ne plaide nullement en faveur d’une antériorité logique de l’arithmétique pure. Comme les Regulae l’affirmeront, le nombre nombre les déterminations de la figure (côtés, arêtes, angles, sommets… ), donc l’idée même d’une science générale des nombres indépendante de la géométrie est une espèce d’enfantillage ludique mais illusoire auquel les mathématiciens sérieux ne perdent pas leur temps. Encore une fois : les vérités éternelles sont toutes comprises, médiatement ou immédiatement dans l’étendue. De ce point de vue, à savoir celui de l’antériorité de la géométrie dans la théorie mathématique, il n’y a aucun doute que Descartes partage les vues de Kepler et n’accorde aucune valeur aux spéculations de Robert Fludd.
Reste cependant, comme vous le soulignez, la question de savoir si la « balance cartésienne » ne penche pas en faveur de celui pour qui les mathématiques ne font que manipuler des entia rationis qui n’atteignent pas la substance des choses matérielles, à laquelle prétend accéder le physicien. Je ne le crois pas du tout, mais je ne nie pas que la question puisse se poser. Sur ce point, aucun de mes deux ouvrages n’avait un grain de lecture assez fin pour ressaisir toute l’originalité des positions de Kepler. On peut voir cependant l’incidence qu’a eue la discussion avec Fludd. En 1619, au livre IV de l’Harmonice Mundi, Kepler a une conception purement abstractive de l’harmonie : la quantité elle-même n’est qu’un accident, et elle n’est pas l’essence ni la substance des corps, puisque la quantité est un prédicat, et non le subjectum praedicationis. Quelques mois plus tard, répondant aux objections de Fludd, Kepler introduit un argument décisif : même si la quantité n’est qu’un accident, c’est un accident inséparable, sans lequel la « substance nue » d’un corps ne peut aucunement être connue. Et c’est enfin dans l’editio altera du Mysterium Cosmographicum que Kepler franchit le pas en affirmant que la « solidité [trisimensionnelle] est l’idée pure de la matière » — énoncé beaucoup plus net et précis que celui relevé naguère par Alexandre Koyré : « Ubi materia, ibi geometria » – énoncé que le savant historien avait emprunté à un ouvrage beaucoup plus ancien de Kepler (le De Astrologiae fundamentis certioribus), où le remplissement / remplacement de la « substance matérielle » par la quantité n’en était encore qu’à un stade préparatoire.
AP : Outre toutes ces dimensions, il y a aussi la dimension physique ; chez Descartes, les choses changent et les vérités éternelles sur lesquelles les mathématiciens fondent leur démonstration sont les dimensions du mouvement, d’où un retour à une forme nouvelle et subtile de naturalisme fondé sur la scientia de motu. La quantité n’est en effet diversifiée et variée que par le mouvement ; la physique considère la quantité de mouvement et ce sont désormais les lois du mouvement qui déterminent les lois de la nature…
EM : Oui, et c’est aussi par là que s’explique la différence entre la physique de Descartes et celle de Kepler. Chez ce dernier, l’approche du mouvement est d’abord dynamique : le mouvement doit toujours vaincre et surmonter une résistance, qui est la répugnance naturelle de la matière au mouvement. C’est cela que Kepler appelle l’inertie, inertie que, bien sûr, Descartes entend de manière diamétralement opposée, puisqu’elle devient la tendance d’un corps à persévérer dans son état de repos ou de mouvement. Le mouvement n’est donc plus l’expression d’un effort pour surmonter la répugnance au mouvement, il n’est plus lié à la potentialité de la matière : il est tout ce qu’il est, et il se confond avec sa mesure quantitative. Partant, les lois qui décrivent la manière dont la quantité de mouvement se distribue entre les corps sont tout aussi intelligibles que les opérations élémentaires de l’arithmétique, le physicien n’ayant rien de plus ni de mieux à faire que des additions et des soustractions : dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, il n’y a rien que l’étendue et ses modes, c’est-à-dire les différentes façons dont s’y distribue la quantité de mouvement. Le gain d’intelligibilité, sur le plan de la théorie physique, est important, puisque Descartes a en vue une explication unifiée de tous les phénomènes physiques : les lois du mouvement doivent expliquer de manière unitaire toutes les déterminations fondamentales du monde matériel, et rendre compte aussi bien de la lumière que de la gravité. Mais cette simplification a un coût : elle ne dépasse pas un certain niveau de généralité, et la physique cartésienne serait, si telle était son intention, à peu près incapable de « composer la machine ».
Conclusion : Des vérités éternelles aux essences et à « l’horizon de monde »
AP : Je voudrais finir cet entretien en évoquant la question de la Genèse et du commentaire perdu qu’en a rédigé Descartes vers 1641. Bien des signes annonciateurs de votre intérêt pour le problème de la cosmogénèse apparaissent dans Descartes en Allemagne mais c’est Descartes et la fabrique du monde qui exploite au mieux, souvent d’une manière spéculative, ce qui put figurer dans le commentaire cartésien de Bereshit. Dans cette optique, on est obligé, je pense, d’introduire le problème des essences et c’est d’ailleurs ce que vous faites dès Descartes en Allemagne lorsque vous mentionnez la Lettre du 27 mai 1630 où est évoquée « cette essence n’est autre chose que ces vérités éternelles, lesquelles je ne conçois point émaner de Dieu, comme les rayons du soleil. » Or, dites-vous, avec la création des vérités éternelles, Descartes ramène les essences au statut de créatures, prend le contrepied de toute émanation et confirme son opposition au rosicrucianisme et au paracelsisme ; et, ajoutez-vous, « la géométrisation des essences s’accompagne d’un effet retour immédiat : la naturalisation des vérités mathématiques, immanentes à la mens humana[14]. »
EM : En effet mon intérêt pour le commentaire cartésien de la Genèse a commencé avec la lecture des premiers textes, et la perplexité initiale de Descartes devant l’intelligibilité du sens littéral du récit de la Genèse (« non potest litteraliter intelligi », AT X, 218, 15-18). Je ne l’avais d’abord que simplement relevé, mais j’ai tâché de comprendre, par la suite, quels ont pu être les effets de cette perplexité sur le développement de la pensée cartésienne. Or, comme on l’a dit plus haut, l’inversion typique du récit de la Genèse « dixit… et facta est lux… et vidit quod esset bona » constitue certainement le motif scripturaire qui sert de justification à la critique de l’indépendance des vérités logiques et mathématiques. La « raison de bonté » et de vérité ne précèdent pas la détermination de la volonté divine. Il y a aussi des indices textuels complémentaires, moins souvent commentés, qui témoignent de l’attention cartésienne aux aspects théologiques de sa cosmologie. Ainsi, la doctrine de la perfection « collective » ou universelle (AT I, 153-154) doit-elle être liée au commentaire de Gen 1, 31 [« viditque Deus cuncta quae fecit et erant valde bona »], ce qui autorise Descartes à soutenir une proposition si paradoxale qu’elle peut paraître sophistique : « cela même que les choses particulières périssent (…) est une des principales perfections de l’univers ». De ce fait, il apparaît assez clairement que la doctrine de l’indifférence divine qui soumet tout à une volonté indifférente, repose, au point de vue de Descartes, sur une parfaite fidélité au texte révélé, au lieu que l’École, avec la doctrine des idées exemplaires, et l’indépendance du possible – ce qui est éminemment le cas de Suarez, comme l’a si bien montré Jean-Luc Marion – parle de Dieu à la manière des gentils, c’est-à-dire « comme d’un Jupiter ou Saturne », avec pour conséquence de « l’assujettir au Styx et aux Destinées » (AT I, 145, 10-12). Voilà, si l’on peut dire, une jolie pierre jetée dans le jardin des « géants de l’École » !
AP : Pour autant, je pense que vous serez d’accord pour ne pas faire de toutes les essences des vérités éternelles : vous dites par exemple que l’espace n’est pas une propriété mais l’essence même du monde. Or, il me semble délicat de faire de l’espace comme tel, c’est-à-dire directement, une vérité éternelle !
EM : Pourquoi ? Je ne vois pas où est le problème ! en revanche, je vois un sérieux problème à soutenir qu’il puisse y avoir des essences qui ne soient pas des vérités éternelles ; que seraient de telles essences ? Peut-être quelque chose comme un sourire sans chat, mais cela ne se voit qu’au pays des merveilles. En ce qui concerne l’espace comme tel, vous avez parfaitement compris que c’est tout l’enjeu de ma lecture des « vérités éternelles » : je comprends effectivement que toutes les vérités éternelles n’émanent pas de Dieu mais de l’étendue « comme les rayons du soleil ». Il ne fait donc aucun doute que l’étendue est la première de toutes les vérités créées, que toutes les autres enveloppent et présupposent, comme il ne fait aucun doute que Descartes ne fait aucune différence entre la création de l’étendue (i.e. le corps), et celle de l’idée de l’étendue (i.e. son être objectif dans l’entendement). Je crois comprendre que ce qui vous gêne est ici le risque de l’idéalisme absolu, ce à quoi je me contenterai de répondre par les remarques suivantes : i/ d’abord, comme le dit bien Heidegger, la phobie de l’idéalisme est une phobie de la philosophie elle-même ; ii/ le monde des corps, ce monde-ci dans lequel nous avons la vie, l’être et le mouvement, n’est effectivement lui-même, dit Descartes, qu’un « ens rationis divinae », c’est-à-dire un étant créé par un acte simple de l’esprit divin (« totus hic mundus ens rationis divinae, hoc est ens per simplicem actum mentis divinae creatum », AT VII, 134) ; iii/ l’étendue objectivement représentée dans l’entendement définit le monde, à telle enseigne que la preuve (transcendantale) de l’unicité du monde s’appuie sur l’unicité de l’idée de la matière, à savoir l’étendue (cf. Principia Philosophiae, II, art. 22, AT VIII-1, 52, 21 : « nec ullius alterius materiae ideam in nobis reperimus ») ; iv/ d’où le réalisme (empirique) de Descartes : ce monde créé est très vrai et c’est un monde « très parfait ». Mais je ne m’étonne pas de votre incompréhension devant cette lecture, car vous-même, si je vous ai bien compris, pensez qu’il y a dans le monde sensible et dans le « monde intelligible » des idéalités mathématiques une forme de « précarité ontologique », appartenant à leur nature même, et que révèle l’expérience du doute[15]. Or, si vous me permettez à mon tour de formuler une réserve ou une objection, je crois que votre conception du doute révélateur de la « précarité du monde », revient à faire de ce doute une propriété des choses elles-mêmes, au lieu de le faire porter sur la seule relation de nos pensées à ces objets. Or le fait que je puisse feindre qu’il n’y a « aucun monde, ni aucun lieu » n’implique pas que ce monde est douteux, ni qu’il faille donner raison à ceux qui prétendent que la vie est un songe.
AP : Oui, c’est en effet une différence de lecture que nous avons ; je dirais que c’est la précarité et non le doute qui caractérise les choses elles-mêmes, et je crois en effet que le fait même que Descartes ne puisse prouver directement que Dieu et l’ego dit quelque chose de la précarité ontologique des choses, et pas simplement du sujet. En outre, je ne vois pas comment l’on pourrait dire du doute qu’il n’est qu’une certaine manière de se rapporter aux choses sans présupposer l’existence absolue des choses et donc contredire par ce biais la logique même des Méditations qui me semble rendre impossible le fait d’interpréter le doute comme un simple artifice de méthode.
EM : On ne s’avise peut-être pas assez qu’il y a un problème quasi insurmontable chez Descartes lui-même. Affirmer, comme le fait le Discours, que dans le doute se découvre la certitude d’être une « substance… qui pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose matérielle », n’est-ce pas affirmer ce que l’on nie, et nier ce que l’on affirme, puisqu’on maintient ipso facto la référence à l’espace comme une condition nécessaire à la perception de soi-même comme res cogitans ? On sait que Descartes s’est ensuite donné beaucoup de peine pour ne pas succomber à l’objection (« comment peut-on nier qu’on soit un corps, si l’on ne sait pas ce que c’est ? »), et c’est ce qui explique l’étirement de l’ordre des raisons tout au long des six Méditations. Quoi qu’il en soit, il m’est avis que l’objection qu’on fait à bon droit à la métaphysique du Discours, s’appliquerait aussi bien à ce que vous dites de la précarité conçue comme un prédicat ontologique : comment pouvez-vous affirmer que les choses sont ‘précaires’, si vous en doutez ? Comment et pourquoi la thèse de leur précarité devrait-elle échapper au doute ?
AP : Il y a beaucoup de choses dans vos questions et je ne voudrais surtout pas faire dévier l’entretien vers l’interprétation que je propose de Descartes ; toutefois, puisque vous m’y invitez aimablement, voici quelques éléments de réponse.
Avant toutes choses, mon propos précédent portait sur les Méditations et non sur le Discours que vous convoquez dans vos remarques ; et il n’est pas certain que les deux textes aient le même statut ni la même ambition.
Deuxièmement, il me semble que dans le passage que vous mentionnez, Descartes établit des essences d’un genre nouveau et détermine ce que je ne peux pas ne pas me représenter lorsque je pense à quelque chose (c’est pourquoi je ne suis pas convaincu par le fait qu’une essence soit par nature une vérité éternelle). Et, pour ce faire, il procède en deux temps : 1) il isole la singularité d’une représentation, celle liée à ma propre existence ; est-il possible de nier ma propre existence comme je peux nier mon propre corps ? Or la réponse est précise : il y a contradiction à nier ma propre existence, car un être non existant ne peut penser qu’il existe, alors qu’il n’y a aucune contradiction logique entre exister et nier le corps. L’affirmation d’une existence est en somme incompatible avec le doute de sa propre existence. Puis, 2) il interroge le sens même de l’existence de ce moi, pour en déterminer l’essence, c’est-à-dire pour déterminer ce que je ne peux pas ne pas me représenter à mon propre sujet en tant que j’existe. Ce que je ne peux pas ne pas me représenter, c’est ce dont l’omission implique impossibilité : il apparaît que ce n’est que si je peux former des représentations en général – penser – que je peux me représenter que je suis ; donc, du point de vue de la pensée, est nécessaire à l’affirmation de la pensée « je suis » le fait d’être une chose capable de penser, de disposer de représentations. Et je crois que c’est tout.
Troisièmement, je vois bien que vous me dites que, pour définir ce moi comme « chose pensante », donc pour définir ce que je ne peux pas ne pas me représenter à mon propre sujet, Descartes procède par élimination, et semble rendre dépendant le résultat de ce qu’il a éliminé, en l’occurrence le rendre dépendant du lieu – qui est un des noms de l’espace en tant qu’il est visé comme situation –, des choses matérielles, de corps, qui sont autant de choses étendues engageant le problème de l’étendue. La question est donc double et opère à deux niveaux : 1) Descartes rend-il dépendante la « chose pensante » de ce qu’il nie ? et 2) Faut-il savoir avec certitude le sens de ce qui est éliminé pour être certain qu’il diffère de ce que je suis ? A la première question, je crois que la réponse ne fait aucun doute : du point de vue exclusivement logique, Descartes montre que si je ne peux pas douter que je suis, c’est pour montrer que, quand je pense à la nécessité de l’affirmation de mon être, je pense nécessairement à l’affirmation d’une chose qui pense ; partant, il est impossible que, tout à la fois, je doute – je pense – et que je nie que je sois une chose qui pense. C’est la seule nécessité attachée à l’affirmation de mon être et, à ce titre, elle ne me semble pas dépendre de ce qui est éliminé ; je crois qu’il mentionne cela pour dissiper les réflexes confus et quotidiens qui font que, lorsque nous pensons à nous, nous pensons à une série de choses ambiguës, s’étendant de mon corps à mon environnement immédiat, et qui témoignent de l’extrême difficulté à circonscrire le moi. « Mon univers » comme dirait l’époque… En revanche, le deuxième aspect de votre question me paraît plus délicat : comment être sûr qu’en étant une chose qui pense je ne suis pas un corps, alors même qu’on ne connaît pas avec certitude le sens du corps ? Il est vrai que Descartes semble réactiver le sens de choses qui viennent pourtant d’être réputées fausses sans aucun motif justifiant leur réactivation ; mais a-t-il douté de la notion de corps, de lieu ou d’espace ? Rien n’est moins certain car, ce dont il doute, c’est exclusivement de ce qu’il a reçu par les sens, des pensées qui sont venues à son esprit, et de ce qu’il a construit par le raisonnement démonstratif ; sauf erreur de ma part, ne figure aucune révocation en doute de l’étendue comme nature simple, qui n’est ni reçue par les sens ni construite par raisonnement démonstratif ni même venue à l’esprit ; à ce titre, dans la mesure où le sens de l’étendue n’est pas révoqué en doute, Descartes ne me semble pas commettre d’erreur logique en affirmant que je ne suis pas un corps et en distinguant la pensée de la chose étendue.
Enfin, pour la dernière partie de votre question, il me semble que l’on peut lire nombre de textes ainsi ; le doute est un certain rapport que j’entretiens vis-à-vis de mes représentations – ce sur quoi, je pense, tout le monde s’accordera – mais je crois qu’il est aussi un signe ; autrement dit, il me semble que l’on se focalise excessivement sur la finalité du doute, ce qui permet de le réduire à un artifice méthodologique, et que l’on oublie qu’il est fondé par une série de justifications qui sont autant de signes que le doute n’est possible qu’à la faveur d’une certaine ontologie. Ce que je veux dire, c’est que si les réalités matérielles et intellectuelles disposaient d’une pesanteur ontologique intrinsèque –, alors le doute ne serait pas possible, fût-ce artificiellement, et les justifications que Descartes en donnerait n’auraient aucun sens. Si les choses disposaient d’une force ontologique suffisante, le doute ne pourrait aucunement être fondé, et chacun admettrait comme Engels que la preuve du pudding est qu’il se mange ; dire ce que dit Engels, c’est dire que dans la réalité matérielle se joue une sorte de pesanteur ontologique telle qu’elle rend inepte toute justification du doute à son endroit. Inversement, je crois que, chez Descartes, les réalités matérielles et intellectuelles accusent un déficit intrinsèque de pesanteur ontologique, déficit qui autorise en un second temps la plausibilité du doute. Cela ne veut pas dire que les choses ne sont pas, car cela n’a pas de sens de prédiquer la précarité du non-être, mais cela veut dire que les choses accusent une certaine inconsistance ontologique, qui se traduit à notre échelle par la possibilité même d’en douter, mais aussi par l’impossibilité d’en fournir une preuve directe. Bref, les choses ont quelque chose d’inconsistant et de révocable, propriétés qui définissent la précarité.
Je crois, enfin, que l’on ne s’intéresse pas suffisamment à la signification ontologique du fait que seuls l’ego et Dieu reçoivent une preuve directe et que l’on ne se demande pas suffisamment ce qui manque au monde pour pouvoir être prouvé avec plus d’évidence. Lorsque Descartes démontre l’existence de Dieu et qu’il sort du simple cadre de la représentation, que fait-il ? Il découvre une idée qui n’est pas qu’une idée, qui n’est même pas un concept[16], mais qui est lestée de tout le poids ontologique de son créateur ; à ce titre, c’est bien la rencontre avec l’Être qui est en jeu dans la Troisième Méditation, si bien que ce qui est démontrable est en même temps ce qui possède le maximum d’Être. C’est pourquoi, là où il y a Être, il n’est aucun doute possible, et je ne vois aucun texte de Descartes proposant une justification fondée et rationnelle d’un doute envers l’existence divine. D’où vient cette impossibilité de douter sous une forme justifiée de l’existence divine qui, soit dit en passant, ne tient plus pour ce qui se rapporte à la bonté divine… ? Ma modeste hypothèse consiste à répondre en faisant de la démontrabilité le signe de la présence de l’Être – ce que j’appelle l’Ens ut demonstratum –, et du doute la conséquence ou le signe de la précarité des choses.
Bref, pour le dire de manière générale et avec des implications, le doute implique la précarité et, par contraposition, l’Être implique la démontrabilité directe et l’impossibilité d’un doute rationnel à son endroit.
Mais revenons à votre lecture si vous le voulez bien. Une dernière question, pour finir, me vient à l’esprit. Vous dites des propriétés géométriques qu’elles ne peuvent être pensables que « dans un horizon de monde », et c’est cela qui serait la leçon des métaphysiques de 1630 comme de 1641. Qu’entendez-vous ici par « horizon de monde » ?
EM : Rien n’échappe à votre acribie, car cette formule condense en effet l’essentiel des résultats de mon travail, et j’ai voulu en faire le résumé des thèses que je soutiens. Pour la petite histoire, je suis aussi enseignant, et il m’arrive souvent d’employer une formule analogue pour expliquer aux étudiants la Réfutation de l’idéalisme. Il m’arrive donc de dire que le théorème kantien signifie que la conscience de soi n’est possible que dans le monde, ou du moins dans l’horizon du monde. Je ne vais pas épiloguer sur le sens précis que je donne à cette formule par rapport à Kant, mais cela vous donne une indication sur la manière dont je l’entends à propos de Descartes. J’entends donc par là i/ que toutes les vérités logico-mathématiques ont soit un fondement intuitif direct dans l’étendue, soit un fondement indirect et médiat en tant qu’on peut les y représenter ; ii/ que l’unité objective de l’espace (de la représentation de l’espace), est l’unique fondement d’une preuve de l’unicité du monde — il y a donc là, manifestement, un virage transcendantal cartésien. iii/ Que les vérités logico-mathématiques ne sont donc que la vérité du monde sensible, et non d’un monde supposément intelligible dont nous n’avons ni idée ni perception. iv/ Que cet horizon de monde, et sa représentation nécessaire, constituent la structure même de la subjectivité finie qui les porte en elle, et qui s’apparaît à elle-même en eux (d’où l’affirmation que ces vérités sont toutes mentibus nostris ingenitae). Je ne partage donc pas, une fois de plus, l’analyse d’Heidegger selon laquelle la métaphysique cartésienne n’aboutirait qu’à la position d’un sujet « isolé et weltlos ». Mais on peut se risquer à dire que cet horizon de monde est la structure même de la subjectivité finie. « Feindre qu’il n’y ait aucun monde » n’est-ce pas, justement le faire apparaître, dans l’abolition de toute réalité intra-mondaine, comme cet horizon lui-même ?
AP : Merci infiniment de cette discussion !
[1] Bernard Gorceix, La Bible des Rose-Croix, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1998, p. XXIII.
[2] Descartes en Allemagne, op. cit., p. 47.
[3] Ibid., p. 38-39.
[4] Tony James, Le songe et la raison. Essai sur Descartes, Paris, Hermann, 2010, p. 39-40.
[5] Descartes en Allemagne, op. cit., p. 39.
[6] Ibid., p. 138.
[7] Ibid., p. 169.
[8] Ibid., p. 176-177.
[9] Edouard Mehl, « Descartes critique de la logique pure », Les Etudes philosophiques, Paris, PUF, 2005/4, n° 75, p. 491-492.
[10] Edouard Mehl, Descartes et la fabrique du monde, op. cit., p. 47.
[11] Ibid., p. 205-206.
[12] Ibid., p. 185.
[13] Pascal, Les Pensées (« Disproportion de l’homme »), Lafuma 199, Seuil, 1963, p. 528.
[14] Descartes en Allemagne, op. cit., p. 296.
[15] Thibaut Gress, Descartes et la précarité du monde, Paris, CNRS Éditions, 2012.
[16] Le relevé lexical du texte français et du texte latin est effectué par nos soins dans l’entrée « Infini » du Dictionnaire Descartes en vue de montrer que l’idée d’infini n’est pas un concept ; cf. Thibaut Gress, Dictionnaire Descartes, Paris, Ellipses, 2018, p. 127-128.








